Philosophie de la Ve République
| à la surface | au mitan | en profondeur |
|---|---|---|
| Primaires | Esprit de la Ve République | Symbole |
| réussite | contexte | fondation |
| Petits coups | Des partis | rite grec |
| addition | Du président | rite albin |
| éléments de langage | du parlement | Hestia |
| miel & fiel | du dialogue | Moïse |
| Retour aux primaires | fondation mosaïque | |
| Du prophétisme |
Petit rappel du contexte
De Gaulle, on le sait, n'eut de cesse de lutter contre ce qui, dans son esprit, était le pire des régime : le régime des partis. Non qu'il en eût au régime parlementaire en tant que tel, parce qu'après tout en stricte définition constitutionnelle, la Ve est bien un régime parlementaire puisque le gouvernement y est responsable devant le Parlement, mais qu'il désaprouvât tout système où, au gré de majorités fragiles, l'exécutif fût à ce point fragilisé et balloté qu'il en devînt impuissant.
On se souvient évidemment du traumatisme qu'aura représenté pour lui la débâcle de 40 et ce qu'il écrivit à ce sujet et d'Albert Lebrun qui présidait la république à ce moment-là : il ne manqua que deux choses : qu'il fût un chef et qu'il y eût un Etat !
La remarque, pour cinglante et cruelle qu'elle fût, ne manque pas de justesse. C'est le même traumatisque qui lui fit souhaiter dès 44 un exécutif fort, ce qu'il détailla dans le discours de Bayeux et lui fit quitter le pouvoir - alors encore provisoire - dès Janvier 46 quand il réalisa qu'il ne pouvait endiguer le retour de la prédominance des partis. L'instabilité endémique de la IVe alla lui donner raison, et la guerre d'Algérie l'occasion de revenir au pouvoir et de fonder un régime à son goût.
Des partis
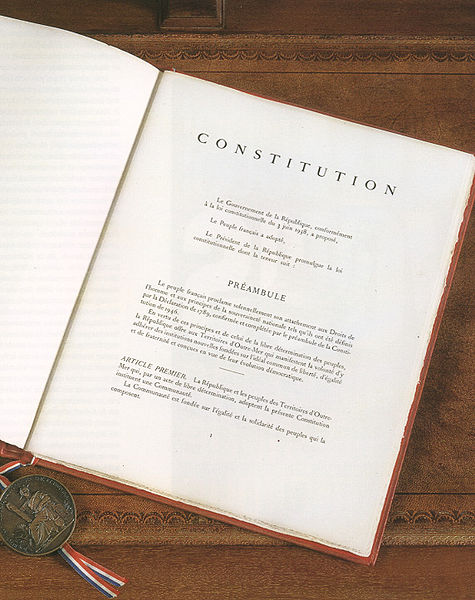 Dans son souci, très militaire d'ailleurs, de l'efficacité, De Gaulle cherchait un système qui donnât à l'exécutif une assise suffisamment forte pour qu'il ne soit pas l'otage des combinaisons parlementaires nécessairement fluctuantes. Dans l'entretien qu'il accorda en 65, à l'occasion de la campagne électorale de la 1e présidentielle au suffrage universel, il dressa un de ces tableux qu'il affectionnait tant qui, de la Belle Epoque à 1958 ne visait qu'à désigner combien, dans les grands moments de crise, les partis étaient toujours déficients et, dans les périodes plus calmes, plus enclins à s'amuser à leurs combinaisons qu'à former de grands projets pour l'avenir.
Dans son souci, très militaire d'ailleurs, de l'efficacité, De Gaulle cherchait un système qui donnât à l'exécutif une assise suffisamment forte pour qu'il ne soit pas l'otage des combinaisons parlementaires nécessairement fluctuantes. Dans l'entretien qu'il accorda en 65, à l'occasion de la campagne électorale de la 1e présidentielle au suffrage universel, il dressa un de ces tableux qu'il affectionnait tant qui, de la Belle Epoque à 1958 ne visait qu'à désigner combien, dans les grands moments de crise, les partis étaient toujours déficients et, dans les périodes plus calmes, plus enclins à s'amuser à leurs combinaisons qu'à former de grands projets pour l'avenir.
La pensée gaullienne se résume à une expression prononcée lors de cet entretient c'est trop dur pour les partis !
Deux dispositifs auront contribué à l'affaissement du rôle des partis :
- l'article 4 de la constitution qui affirme les partis mais ne leur reconnaît que le rôle de concourrir à l'expression du suffrage universel : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie
- l'appel direct au peuple en cas de crise que ce soit par le biais du référendum, de la dissolution de l'Assemblée Nationale ou après la réforme de 63, l'élection du président au suffrage universel.
Ce que de Gaulle nomme majorité nationale dans son intervention de Sept 65, ce qu'il définit comme l'avènement du peuple, comme source du pouvoir et comme recours, détermine effectivement un processus par lequel on passe par dessus les partis, dès lors plutôt perçus comme des obstacles sinon des parsites du souverain populaire que comme son expression légitime.
A ce titre, indéniablement, de Gaulle invente une voie qui est, à l'extrême possibilité de l'irruption du peuple dans le champ politique sans que pour autant celui-ci ne bascule dans la révolution ou la terreur. Pointe avancée au plus loin possible de l'intrusion de ce tiers que d'ordinaire on exclut, faute sinon de pouvoir faire fonctionner le système.
Dès lors c'est toute la mécanique du symbole, tel que nous l'avions évoquée, qui est sinon enrayée, en tout cas limitée à sa plus stricte expression. Il n'y a plus de médiateur, hormis, on le verra, le président lui-même.
Du président
 Le président, quant à lui, indéniablement renforcé dans son rôle par l'élection au suffrage universel, ce qui lui sembla d'autant plus nécessaire qu'après lui, il sembla à de Gaulle que ses successeurs ne pourraient lui substituer le poids de la légitimité historique qu'il aura acquise par ailleurs, se voit attribuer le rôle de tracer la route et de fixer les moyens. De Gaulle qui utilise pour désigner le président à la fois du terme de mandataire mais aussi de celui de guide, ce qui ne va pas sans connotation religieuse forte, on le devine, aura réussi le tour de force de renforcer considérablement la fonction tout en reprenant quasi terme à terme l'article qui le définissait sous la IIIe et la IVe.
Le président, quant à lui, indéniablement renforcé dans son rôle par l'élection au suffrage universel, ce qui lui sembla d'autant plus nécessaire qu'après lui, il sembla à de Gaulle que ses successeurs ne pourraient lui substituer le poids de la légitimité historique qu'il aura acquise par ailleurs, se voit attribuer le rôle de tracer la route et de fixer les moyens. De Gaulle qui utilise pour désigner le président à la fois du terme de mandataire mais aussi de celui de guide, ce qui ne va pas sans connotation religieuse forte, on le devine, aura réussi le tour de force de renforcer considérablement la fonction tout en reprenant quasi terme à terme l'article qui le définissait sous la IIIe et la IVe.
Posture inconfortable que celle de la présidence, quoiqu'on dise et quel que soit son titulaire : comment être à la fois arbitre, guide et en même temps dans la mêlée ? Posture dangereuse qui se prête à tous les abus, tant les contre-pouvoirs sont faibles, malaisés à mettre en oeuvre, et d'autant plus rares depuis le quinquennat.
Ce qui avait fait dire à Mitterrand que ces institutions étaient dangereuses avant lui et le redeviendront après lui.
Posture difficile tant la symbolique n'est plus désormais portée que par le président seul : tous n'ont pas la stature de de Gaulle, voire de Mitterrand et l'on voit bien avec Sarkozy combien la volonté d'occuper pleinement le poste ( je n'ai pas été élu pour faire la sieste ) peut rapidement décliner en hyperprésidence rapidement insupportable. Rapidement rejetée.
Une logique sacrificielle ... mais justement pas symbolique
On pourrait assez aisément reprendre l'analyse de Girard sur la stratégie émissaire à l'occasion des présidentielles :
La Nation se rassemble à intervalles réguliers et résoud ses divisions, ses conflits, ses heurts et ses violence en les projetant sur un homme, non choisi au hasard certes, mais sur un homme dès lors considéré comme responsable de tout, et, ipso facto, comme thaumaturge. Une fois investi, la Nation rassemblée retourne à ses affaires courantes ... jusqu'au prochain conflit grave qui exigera un sacrifice.
Envisagé sous cet aspect, il n'est alors pas étonnant que depuis 81- depuis en réalité que se fait évidence que la crise sera longue, rampante, endémique - pas étonnant donc qu'aucune majorité ne se vît redonduire. En 86, la majorité socialiste est éconduite ; en 88 Mitterrand est réélu, mais sa majorité, même pas absolue aux législatives est à nouveau désavouée en 93 ; la droite ne parvient à conserver le pouvoir en 95 qu'au prix d'une lutte fratricide entre Chirac et Balladur ; majorité défaite en 97 à l'occasion de la dissolution ; gauche socialiste éconduite dès le premier tour en 2002 ; et enfin, derechef, une majorité de droite qui ne parvient à conserver le pouvoir en 2007 qu'au prix d'une nouvelle lutte fratricide entre Sarkozy Villepin et Chirac ( Les fauves) et du simulacre d'une rupture (j'ai changé).
Une grille de lecture qui aide à comprendre que la logique de la Ve est plus une logique d'incarnation que de symbole. L'Elu incarne la France, et ne tient sa légitimité que de sa capacité à en rassembler l'histoire, la grandeur, les aspirations ... les valeurs. Et gare à celui qui n'y parvient pas, veut se faire ordinaire ou pis encore se révèle pour ce qu'il est - un simple manager.
En réalité, cette présidence demeure une présidence pour temps de fondations ; certainement pas pour temps ordinaire. Elle contraint à tout cas celui qui l'exerce à s'exhausser à des niveaux insoupçonnés de mégalomanie (de Gaulle savait suavement parler de lui à la 3e personne).
Une logique de l'incarnation ... pas de la représentation 
Décidément, la Ve installe un pouvoir métaphysique ; certainement pas symbolique. Il y a dans l'irritant et cruel D'un château ... l'autre de l'insupportable Céline, des pages lumineuses sur le coup de l'incarnation qui méritent d'être relues. Car, comprenons-nous bien, la logique de l'incarnation renvoie toujours à la catabole, à un pouvoir descendant, certainement pas à un pouvoir ascendant, renvoie à Dieu, la France ou tout ce qu'on voudra d'abstraction à dénicher sur l'encan des brocantes de la modernité - certainement pas de la démocratie.
Que de Gaulle fût démocrate, et à ce titre la France bénéficie encore de ce doux privilège d'avoir eu un général rétablissant la république plutôt que de l'abolir, est indéniable ; qu'il fût républicain est ue bien autre affaire. Rien ne lui fut plus étranger que le temps long de la maturation, du débat et de la négociation ; rien ne lui fut plus étranger, mais n'était-ce pas à la fois un maurrassien et un militaire, que l'idée que la France pût être collectivement symbolisée par la rprésentation nationale ; pour un homme tel que lui, l'incarnation ne pouvait être que miraculeuse et personnelle.
Ne cherchons pas plus loin les reproches adressés dès l'origine de pouvoir personnel dont il se tire non sans élégance, humour et pertinence mais auxquels il n'échappe pourtant définitivement pas.
Amusant de ce point de vue l'article très récent de R Bacqué au sujet de la folie présidentielle montrant à quel point une campagne électorale relève de l'épreuve, de la technique de l'extase et de la purgation, qui seule, peut, d'un homme ordinaire, faire un président ; désignant combien est vaine l'aspiration hollandaise à une présidence normale tant ni le processus, ni la fonction ne le sont, tant d'ailleurs les Français semblent précisément attendre, espérer autant que craindre, toujours un être d'exception, une sorte de deus ex machina ou, ce qu'en logique, on nomme un démon. Tant décidément il y a quelque chose ici de l'odyssée grecque ou de la révélation biblique : les textes sacrés n'utilisent-ils pas indifféremment craindre et aimer pour désigner le rapport à Dieu ?
Dans tout président il y a le lointain écho du divin - ou de l'idole ! Et l'on sait que les idoles sont aussitôt brûlées que vénérées. D'où à l'évidence ce jeu de massacre politique depuis 81, que l'affaissement des pouvoirs au gré de l'évolution de l'Europe, mais aussi de la mondialisation libérale n'aura fait qu'amplifier tant est gigantesque l'écart entre la réalité des pouvoirs politiques désormais et l'image extatique que l'on s'en fait.
Aux confins de la grandeur et de la folie, cette fonction qui devrait assumer le symbolique pour parvenir à subsumer la violence, ne parvient en fin de compte qu'à la cristalliser - au risque de la folie
Il y a quelques années, l'ex-collaborateur de Giscard Jean Sérisé avait résumé devant une journaliste sa définition des candidats à la présidentielle : " Il y a ceux qui ne sont pas assez fous pour tenir jusqu'au bout, ceux qui sont trop fous pour convaincre et ceux qui le sont juste assez pour parvenir à être élus. " Il avait achevé sa démonstration par cette conclusion sans appel : " Mais n'oubliez pas : ils sont fous. " *
Du parlement
Ce dernier aura évidemment été affaibli, et, contrairement aux bonnes intentions proclamées ici et là, contrairement même à la récente réforme constitutionnelle suppsée renforcer les pouvoirs t l'autonomie du Parlement, rien ne semble pouvoir y faire.
Plusieurs dispositifs y auront contribué :
- la Chambre n'est pas maîtresse de son ordre du jour ce qui explique que moins d'un quart des lois votées le furent sur initiative parlementaire depuis 58
- le scrutin majoritaire qui, écrasant les petits partis, produit toujours des majorités amplifiées (3 chambres introuvables depuis 58 : 1968 ; 1981 ; 2007 - avec la création du parti majoritaire unique)
- le vote de la censure qui se fait non plus à la majorité des votants mais à celle des inscrits qui n'aura permis, en 60 ans, qu'une seule fois à une motion de censure d'aboutit et de provoquer la démission d'un gouvernement - non sans d'ailleurs que ceci ne provoquât, dans la foulée, la dissolution de la chambre.
- la distribution des pouvoirs au sein de la dyarchie de l'exécutif qui fait, qu'en tout état de cause le parlement ne peut censurer que le lampiste, et non le véritable auteur de la politique en question
- l'affaissement progressif du rôle du premier ministre : on se souvient d'un Fillon qualifié de collaborateur. Un processus inéluctable à partir du moment où chaque décision est d'abord envisagée par les instances élyséennes. On remarquera l'inflation galopante du nombre de collaborateurs au Palais qui atteste que très rapidement l'Elysée aura constitué un gouvernement-bis d'autant plus démocratiquement gênant que ce dernier est composé d'individus non-élus, non contrôlés, irresponsables politiquement, donc ! Que ce processus se soit aggravé durant le mandat de Sarkozy est une évidence, mais le ver était dans le fruit dès le départ.
Une logique de l'ordre pas du dialogue
En 60 ans, la Ve sera passé d'une logique de commandement militaire à une logique managériale, mais en réalité, ceci revient au même. Ceci demeure un pouvoir non certes pas auto-cratique, mais, étymologiquement, monarchique.
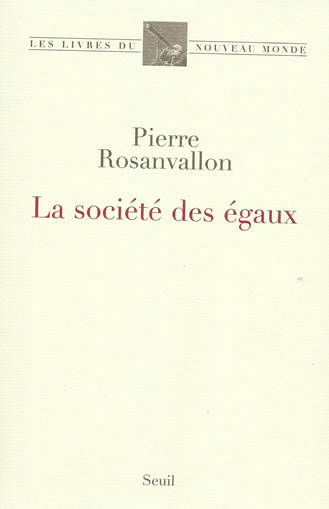 Or, inévitablement une telle logique finit toujours par produire de l'inégalité parce que précisément ce qui fonde la précellence du chef tient à l'inégalité de ceux qu'il dirige.
Or, inévitablement une telle logique finit toujours par produire de l'inégalité parce que précisément ce qui fonde la précellence du chef tient à l'inégalité de ceux qu'il dirige.
Rosanvallon dans son dernier ouvrage relève à juste titre que si l'égalité était l'aspiration fondatrice de la Révolution, et sa réduction une volonté politique partagée jusqu'il y a peu, la marque précisément de notre époque tient non pas tant à l'aggravation de l'écart qu'à l'absence de volonté de réduire les inégalités qui a cessé d'être un mot d'ordre politique légitime.
Ce qui est tout sauf étonnant : ne l'oublions pas, la logique managériale qui prédomine, l'idéologie libérale qui la justifie et l'aura emporté depuis une trentaine d'années, est celle de l'entreprise. Or la logique de l'entreprise est celle du salariat, de l'employabilité, de l'efficacité qui sont tous des flexions du lien de subordination.
Cette logique du commandement n'est pas républicaine ; ne peut l'être.
Enfin, ne l'oublions pas, même si ceci n'est qu'une conséquence de cela, telle qu'entendue par les fondateurs de la république, autant les révolutionnaires de 89 que les instigateurs de laconstitution de 1975, la république est affaire de représentation nationale, et donc de dialogue : à ce titre, il n'est pas étonnant que le paradigme républicain reste pour beaucoup celui, parlementaire, des républiques passées, même si l'on doit bien admettre que l'instabilité gouvernementale fit beaucoup pour leurs ruines.
Relisons Mendès France ** : manifestement nous avons déplacé trop loin le centre de gravité du pouvoir : il était trop arc-bouté sur le législatif au point de phagocyter l'exécutif ; il est désormais tellement exécutif qu'il en aura avalé le législatif. Souvenons-nous d'un Grevy que son expérience malheureuse de la République de 1848 fit se méfier à ce point de tout pouvoir césarien et donc de toute présidence forte qu'il vida le peu de pouvoir que le texte de 1875 ménageait à la présidence.
Retour aux primaires
Après ce, long, détour, reste à se poser la question de lalégitimité de ces primaires.
Rappelons d'abord qu'avant d'entamer le processus le PS s'était enquis de la chose, ce n'est donc pas au niveau juridique qu'il fait poser la question.
Un argument plaide en faveur : dans la mesure où l'élu sera désormais non le candidat d'un parti mais d'un ensemble plus large et volontaire, l'argument du retour au régime des partis semble tomber de lui-même. Certes, et ce ne peut l'être, il n'aura pas la légitimité d'un élu du corps entier, mais ce n'est pas l'objet de la consultation ; il aura en revanche assuré la légitimité de sa candidature largement hors de ses rangs. De ce point de vue l'idée même de la primaire semble aller dans le sens de l'esprit des institutions, en dépit de l'argument sarkozyste, trop circonstantiel pour être pertinent.
Un autre plaide en sens contraire : les primaires vont trop dans le sens techniciste, managérial et, pour tout dire, césarien de la constitution pour qu'on n'y puisse craindre le risque amplifié d'une personnalisation à outrance, d'une peopolisation, d'une aggravation - s'il était encore possible - de l'Etat spectacle.
Au final, effectivement, la république a besoin de symbole, pas de héros ! Cette république-ci nourrit plutôt des guides et des chefs. Et les écrabouille sitôt qu'ils ont cessé de servir.
Qu'au moins ces deux-là, n'oublient pas qu'avant d'être socialistes, il sont démocrates ; qu'avant d'être démocrates, il se doivent d'être républicains !
Entretiens de Gaulle / Michel Droit décembre 65
(les trois)
extrait : ( passage assez long sur les institutions) qui complète la conférence de presse de septembre
Conférence de Presse de Septembre 65
article de Bacqué ( à la fin)
Pierre MENDÈS FRANCE, Choisir, pp. 85-86, Stock, 1974
« Je n'ai jamais été partisan du gouvernement d'assemblée, c'est-à-dire d'un gouvernement exercé par cinq ou six cents personnes. L'exécutif, l'équipe qui agit, ne peut comporter qu'un nombre limité de personnes entre lesquelles règne une certaine homogénéité, une solidarité ; elles discutent entre elles mais elles doivent être assez proches les unes des autres pour pouvoir prendre des décisions rapidement et les respecter. C'est indispensable surtout dans un pays comme la France, où le gouvernement résulte forcément d'une coalition de volontés. C'est ainsi, seulement, qu'une équipe ( c'est le vrai mot ) chargée de la conduite quotidienne des affaires peut affirmer sa volonté, son autorité, disposer de la durée, de la stabilité. Ce qui manquait sous la IIIème et plus encore sous la IVème. Mais, à côté de cela, il faut une instance, l'Assemblée, fidèlement représentative des tendances qui règnent dans le pays, qui les confronte publiquement et qui se prononce sur les options principales. L'exécution reste le domaine du Gouvernement et ce dernier agit au nom des forces politiques majoritaires dans l'Assemblée. Ainsi donc, deux pouvoirs : l'exécutif ( homogène ) et le représentatif ou législatif ( inévitablement composite ), dont chacun a son indépendance et sa mission. Sous la IVème République, il n'y avait, en réalité, qu'un pouvoir : l'Assemblée ; le Gouvernement n'existait plus, il était dominé, écrasé, phagocyté par le Parlement. Sous la Vème, il n'y a de nouveau qu'un pouvoir : l'exécutif, le Gouvernement ou plutôt le Président ; l'Assemblée ne joue aucun rôle, sinon de pure figuration. On est passé d'un extrême à l'autre. Je ne pense pas qu'il soit sain et démocratique d'investir, comme aujourd'hui, de moyens aussi larges et aussi incontrôlés un seul homme et pour sept ans [...] Un homme élu par trente millions d'électeurs est forcément très puissant ; or, volontairement, on n'a prévu aucun contrepoids, aucun partage, aucune institution de contrôle ».