| précédent | suivant |
|---|
Ruine de la réciprocité
La réciprocité, on le sait, est la condition même de tout contrat et suppose que dans l'échange chacun cède, mais gagne en retour. Elle dit la dynamique de la relation ou, si l'on préfère, la relation en acte. Il n'est pas de société qui tienne, toute inégalitaire qu'elle soit, ou toute démocratique qu'elle se veuille, qui ne génère différenciation, individualisation et donc frontières. Fonder, on l'a vu, c'est partager mais ici le partage se fait entre l'humain et l'inhumain - ce qui n'est pas nouveau - mais sur le mode de l'exclusion, et, bien vite, de l'extermination. C'est qu'ici la relation est unilatérale et certainement pas mutuelle : le juif n'existe pas, ou tout au plus en tant que vermine qu'il faut extirper. Dès lors, nulle société ne surgit de ce partage-ci mais le camp qui est la grande machine à dissolution.
Ce que Lévinas avait bien vu, et ce dès 34, ce qui est en jeu dans le nazisme c'est l'homme lui-même et donc la conception même qu'il peut se faire de lui-même. Tout ce sur quoi se fondent autant le judaïsme que le christianisme tient en cette idée que l'homme ne se réduit pas à son corps, n'est pas son corps, mais a un corps. Ce qui se joue dans le nazisme, et dans l'holocauste qu'il rend possible, c'est bien la réduction de l'homme à son corps, sans que la volonté libre puisse jamais rien d'autre que s'y soumettre.
 L'essence de l'homme n'est plus dans la liberté, mais dans une espèce d'enchaînement. Être véritablement soi-même, ce n'est pas reprendre son vol au-dessus des contingences, toujours étrangères à la liberté du Moi ; c'est au contraire prendre conscience de l'enchaînement originel inéluctable, unique à notre corps; c'est surtout accepter cet enchaînement.
L'essence de l'homme n'est plus dans la liberté, mais dans une espèce d'enchaînement. Être véritablement soi-même, ce n'est pas reprendre son vol au-dessus des contingences, toujours étrangères à la liberté du Moi ; c'est au contraire prendre conscience de l'enchaînement originel inéluctable, unique à notre corps; c'est surtout accepter cet enchaînement.
Dès lors, toute structure sociale qui annonce un affranchissement à l'égard du corps et qui ne l'engage pas devient suspecte comme un reniement, comme une trahison. Les formes de la société moderne fondée sur l'accord des volontés libres n'apparaîtront pas seulement fragiles et inconsistantes, mais fausses et mensongères. L'assimilation des esprits perd la grandeur du triomphe de l'esprit sur le corps. Elle devient oeuvre des faussaires. Une société à base consanguine découle immédiatement de cette concrétisation de l'esprit. Et alors, si la race n'existe pas, il faut l'inventer ! *
La violence est ici, ou ce que JP Sartre nommait mauvaise foi - la réduction de l'autre à l'état de chose, impropre à devenir, à changer. L'absence de dialogue, et donc d'échange, s'ensuit logiquement qui justifie cet interdit du regard. Ce que signifie la réciprocité est bien la possibilité de fonder une communauté d'intérêt, une histoire et de se donner un projet.
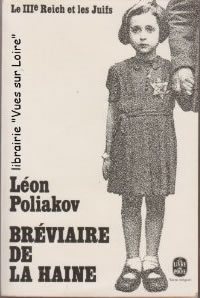 Poliakov l'avait en son temps superbement illustré : le projet nazi au-delà de la destruction des juifs avait aussi celle de déplacer les races supposées inférieures - dont, notamment les slaves. Le crime contre l'humanité consiste ici à ne plus considérer l'homme comme autrement qu'une pâte qu'on pût modeler à sa guise et donc à envisager l'homme, à quoi même l'Allemand n'échappe pas, comme englué dans sa race, dans sa définition. Point d'esprit ici qui pût être moteur, mais une matière seule, inerte, qui n'échappera jamais à son destin de chose. Le dualisme métaphysique avait ceci de particulier qu'il autorisait toujours, pour cet homme jeté, étranger, dans un monde de choses, de tenter d'échapper à quelque destin que ce soit par la force de sa volonté, de sa liberté, quand même cette échappatoire pût sembler illusoire à certains, obérée en tout cas, par la propension au mal, à l'erreur, à la faute. Imaginer qu'on pût disposer des hommes comme on dispose de l'espace en déplaçant ici les frontières, là les pouvoirs revenait à ne considérer l'homme que comme un être disponible, à disposition, soit d'une cause si sa race l'y autorisait, soit d'une tâche à réaliser s'il était considéré comme servile, soit enfin comme devant être éliminé si sa race était perçue comme parasite. Le nazisme se révèle pour ce qu'il est : fondamentalement parasitaire au sens où il n'envisage de relation qu'unilatérale que ce soit avec l'autre ou avec le monde. Il est négation absolue de tout ce qui n'est pas soi.
Poliakov l'avait en son temps superbement illustré : le projet nazi au-delà de la destruction des juifs avait aussi celle de déplacer les races supposées inférieures - dont, notamment les slaves. Le crime contre l'humanité consiste ici à ne plus considérer l'homme comme autrement qu'une pâte qu'on pût modeler à sa guise et donc à envisager l'homme, à quoi même l'Allemand n'échappe pas, comme englué dans sa race, dans sa définition. Point d'esprit ici qui pût être moteur, mais une matière seule, inerte, qui n'échappera jamais à son destin de chose. Le dualisme métaphysique avait ceci de particulier qu'il autorisait toujours, pour cet homme jeté, étranger, dans un monde de choses, de tenter d'échapper à quelque destin que ce soit par la force de sa volonté, de sa liberté, quand même cette échappatoire pût sembler illusoire à certains, obérée en tout cas, par la propension au mal, à l'erreur, à la faute. Imaginer qu'on pût disposer des hommes comme on dispose de l'espace en déplaçant ici les frontières, là les pouvoirs revenait à ne considérer l'homme que comme un être disponible, à disposition, soit d'une cause si sa race l'y autorisait, soit d'une tâche à réaliser s'il était considéré comme servile, soit enfin comme devant être éliminé si sa race était perçue comme parasite. Le nazisme se révèle pour ce qu'il est : fondamentalement parasitaire au sens où il n'envisage de relation qu'unilatérale que ce soit avec l'autre ou avec le monde. Il est négation absolue de tout ce qui n'est pas soi.
C'est bien à ce titre qu'il mérite le vocable de totalitaire parce qu'il n'envisage effectivement le réel que comme une totalité monolithique à quoi tout et tous doivent se soumettre. A ce titre, il est intrinsèquement amoral dans la mesure même où il ne laisse aucune place pour le libre arbitre.
 Rien n'illustre mieux cette perspective que le célèbre la véritable réalité de l'individu c'est l'Etat de Mussolini. Car, pour le politique comme pour le sociologue, la question reste bien celle de la place de la partie dans le tout. Si l'on peut considérer avec Lévinas que le libéralisme fait le fond de la pensée occidentale et rend possible cette idée d'un homme pouvant échapper à son destin par le libre jeu de sa raison et de sa volonté, alors il faut bien admettre que la question tant politique que morale se joue autour de la valeur de l'individu.
Rien n'illustre mieux cette perspective que le célèbre la véritable réalité de l'individu c'est l'Etat de Mussolini. Car, pour le politique comme pour le sociologue, la question reste bien celle de la place de la partie dans le tout. Si l'on peut considérer avec Lévinas que le libéralisme fait le fond de la pensée occidentale et rend possible cette idée d'un homme pouvant échapper à son destin par le libre jeu de sa raison et de sa volonté, alors il faut bien admettre que la question tant politique que morale se joue autour de la valeur de l'individu.
La négation de l'individu
Que l'individu soit difficile à penser est une évidence ; que sa naissance avec le christianisme produise la spécificité de ce qui sera la pensée occidentale en est une autre, incontestable. Dès Hegel, mais on la retrouve aussi chez Bergson dans les deux sources , domine la métaphore de l'organisme qui, quoiqu'on en ait, laisse à penser effectivement que la partie n'a de sens que dans et par sa place dans le tout. Tout se joue dans l'organisme, dans l'organisation et le pas est vite franchi, que ni Hegel ni Bergson ne franchissent quant à eux, consistant dès lors à ne considérer la partie que comme une expression partielle du tout, aisément centrifuge. Car tout le problème, vu en tout cas du côté de la société, demeure le maintien de la cohésion : c'est que l'individualité est ambivalente qui cherche à la fois à s'identifier à un modèle, un groupe - centripète - mais en même temps à s'en distinguer - centrifuge - en sorte qu'il ne saurait subsister de collectivité qui ne sache tempérer l'un par l'autre.
De ce point de vue on peut dire que la pensée nazie s'arrête où commence l'humanisme occidental : en effet, où celle-ci voit une finalité, celle-là un problème. Non seulement l'individu ne peut être l'élément premier, ce que Comte avait déjà vu, pour ce qu'il ne serait qu'une abstraction, qu'une illusion mais ce n'est même pas la famille qui formerait le socle de la société, mais la race. Illusion de la raison ou de la concupiscence petite-bourgeoise, bien éloignée de la grandeur völkish, l'individualité est à proprement parler ce qu'il faut éradiquer, ce à quoi il ne faut surtout accorder aucune place.
Le nazisme est une formidable machine à reproduction du même, et donc, si l'on suit la leçon de Girard, une machine à violence.
Elle réside bien ici la seconde grande leçon à tirer du nazisme et du génocide qui en découle irrémédiablement : parce qu'école de soumission, le collectif nazi ne produit jamais une société mais une masse informe, grouillante et désordonnée qui ne peut se survivre que par l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Il n'y peut exister de réciprocité parce qu'il s'agit d'un monolithe. Il est à la limite du social, la négation même du politique : ne se justifiant par rien d'autre que par soi, n'imaginant pas d'autre voie que la réalisation d'une nature impérieuse à quoi nul ne saurait échapper, il est effectivement au-delà de toute morale.
Jaspers l'avait vu, parce qu'en définitive, tout acte est un acte individuel, qui suppose que l'on prenne pour soi la prescription légale, il engage l'individu moralement.
La sphère de la morale est bien ainsi l'individu, l'échange, le dialogue avec l'autre : miner l'individu c'est rendre toute morale impossible. Avant d'être un crime moral, l'anti-individualisme est un crime contre la morale.
Qu'existent des formes plus douces de ce crime, qu'Arendt a théorisées sous le concept de délaissement, de désolation semble aujourd'hui clair et laisse à comprendre la crainte de Blum qui par anticipation de Girard met en évidence que dans la lutte contre les nazis le risque demeure patent de mettre en jeu les mêmes forces totalitaires.
C'est bien ici à un véritable engrenage à quoi nous assistons : pas d'humanité sans solidarité ; mais pas de solidarité sans réciprocité ni donc de reconnaissance de l'autre comme alter ego - à la fois même et autre. Qui nous enjoint à une double réflexion au sujet du Mal : à la fois comme absence tant il est vrai que l'écrasement de l'individualité remet en question jusqu'à la possibilité même d'entretenir un rapport au monde- ce que Arendt nommait acosmisme - et à l'autre et donc de se poser la question de la valeur morale de son acte ; mais aussi comme positivité - au sens de sa radicalité, comme propension de l'âme à commettre le mal tout en le sachant tel.
Empire de la pesanteur
 Reste la pesanteur puisqu'aussi bien il ne saurait être question ici de quelque grâce que ce soit, de quelque salut concevable. Totalement arrimé à sa nature, à quoi il ne saurait se soustraire, l'homme ne saurait échapper au destin que sa race suppose, à la valeur que sa race impose. Valeur ici, totalement incrustée dans la chose elle-même et jamais l'objet d'un quelconque jugement, valeur intangible, éternelle pour cette raison même, qui ne saurait se décliner autrement que de manière binaire, sans qu'aucune nuance ne puisse intervenir - ce qu'atteste la gêne continue qu'éprouvèrent les nazis à régler le sort des Mischlinge.
Reste la pesanteur puisqu'aussi bien il ne saurait être question ici de quelque grâce que ce soit, de quelque salut concevable. Totalement arrimé à sa nature, à quoi il ne saurait se soustraire, l'homme ne saurait échapper au destin que sa race suppose, à la valeur que sa race impose. Valeur ici, totalement incrustée dans la chose elle-même et jamais l'objet d'un quelconque jugement, valeur intangible, éternelle pour cette raison même, qui ne saurait se décliner autrement que de manière binaire, sans qu'aucune nuance ne puisse intervenir - ce qu'atteste la gêne continue qu'éprouvèrent les nazis à régler le sort des Mischlinge.
Assez intéressant que dans un récent entretien G Steiner ait évoqué, à propos de la jeunesse, l'acédie - de άκηδέω signifiant négliger - et qui illustre cette torpeur spirituelle qui pousse à se replier sur soi-même et à récuser en tout cas à être incapable d'entretenir quelque rapport à l'autre et au monde que ce soit. Forme religieuse du délaissement arendtien ? en tout cas signe supplémentaire de ce que Serres soulignait déjà - combien négligence était l'antonyme parfait de religion.
Où se révèle assez bien que pesanteur et grâce forment bien un couple indissociable qui fait le fond de toute morale : aux deux extrémités du chemin, parce que nous ne pouvons qu'hésiter entre la pesanteur qui nous signe mais nous englue et la grâce qui nous exhausse ; qu'il n'est de chemin et donc de liberté que sur fond d'une alternative mais d'une espérance aussi à y pouvoir échapper.
Voici du nouveau dans notre approche : que la morale soit, non pas l'obéissance servile à des prescriptions venues d'ailleurs ou du fond d'une nature à quoi nul ne saurait se soustraire, mais bien au contraire qu'elle soit échappatoire, sortie voire percée. Tout dans nos mythes le dit et répète inlassablement : du mythe de Pandore qui souligne combien quoique non divin l'homme se distingue néanmoins de la bête ; du mythe romain, où il n'est pas interdit de penser que la sortie de Rémus, quoique condamnable et fatale, signale la sortie de l'indécision et donc le choix ; du récit biblique qui n'expulse Adam que pour inventer d'avance une alliance qui le fît revenir. Entre les deux, l'équilibre, qui est oscillation, doute sans conteste, mais en même temps dynamique continuée. Entre la roche - π ε τ ρ α - à quoi l'on est attaché, et l'apothéose qui vous accueille au sein de l'Olympe, il y a un chemin : qui a nom morale. Entre le silence des pierres et le logos créateur, à mi-chemin !
On le sait tous les fondateurs viennent d'ailleurs, ne sont, à leur façon, que des refondateurs : eux aussi ont tenté une percée, sont sortis mais ne le firent que pour recommencer, que pour rentrer. Il n'est pas de sortie qui n'implique, réciproquement, un retour à venir. La seule façon d'échapper au silence des pierres mais aussi à toute consomption devant l'absolu demeure le chemin
Or ce qu'interdit précisément la pensée nazie, c'est précisément ce chemin qui vous fait concevoir un autre monde, une esquive, une sortie.
1) sur les sources du fascisme lire
a) à propos du FN ;
b) de Maurras
