| index | précédent | suivant |
|---|
Remugles
Avec la page sur les étonnantes dérives de nos intellectuels (Remugles) , celle sur le dérapage de Netanyahou (Communication) et celle sur l'évidement du discours politique (Désarroi) cette réflexion autour de Boulanger (Collusion) clôt ce qui ne peut que constituer un préambule à une réflexion plus générale sur la communication, notamment politique dont on trouvera ici les toutes premières lignes ...
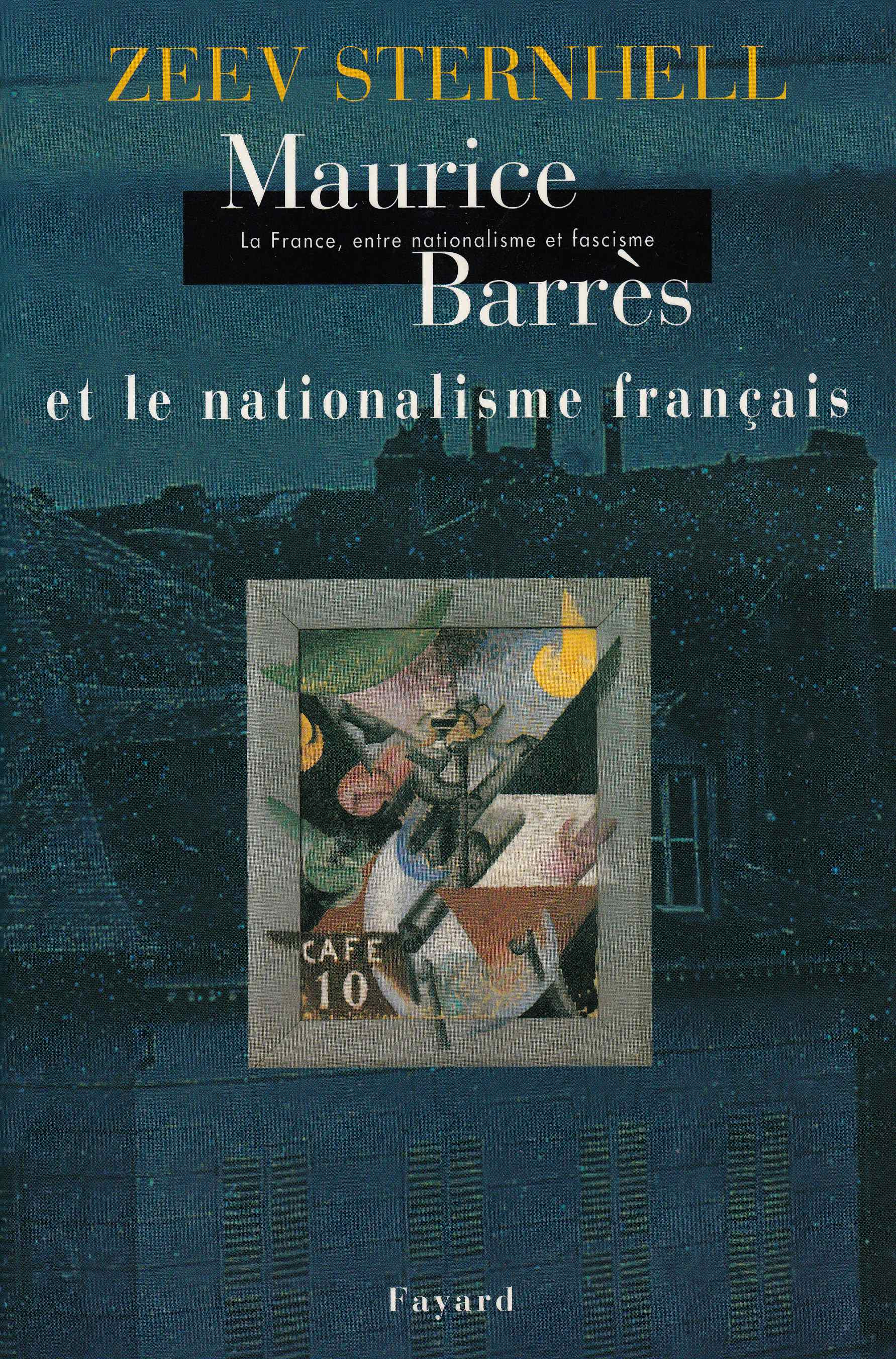 À la fin du XIXe siècle, le climat intellectuel de l'Europe marque une nette évolution qui contribue à créer une orientation politique nouvelle. En France, en Allemagne, en Russie, en Autriche-Hongrie, en Italie, des phénomènes apparaissent qui, au-delà de leurs aspects spécifiques dus aux conditions locales, présentent une analogie fondamentale. Dans ces pays, en effet, un même malaise existe. Et malgré les formes multiples que celui-ci a pu revêtir, il est partout reconnaissable à son expression: remise en cause de l'ensemble des idées et des institutions caractéristiques de la civilisation industrielle et négation systématique des valeurs héritées duXVIIIe siècle et de la Révolution française. C'est ainsi que des hommes et des mouvements, évoluant dans des situations politiques pour le moins dissemblables, ont pu parvenir à des conclusions identiques. Il s'agit bien là de premiers frémissements d'un monde nouveau.
À la fin du XIXe siècle, le climat intellectuel de l'Europe marque une nette évolution qui contribue à créer une orientation politique nouvelle. En France, en Allemagne, en Russie, en Autriche-Hongrie, en Italie, des phénomènes apparaissent qui, au-delà de leurs aspects spécifiques dus aux conditions locales, présentent une analogie fondamentale. Dans ces pays, en effet, un même malaise existe. Et malgré les formes multiples que celui-ci a pu revêtir, il est partout reconnaissable à son expression: remise en cause de l'ensemble des idées et des institutions caractéristiques de la civilisation industrielle et négation systématique des valeurs héritées duXVIIIe siècle et de la Révolution française. C'est ainsi que des hommes et des mouvements, évoluant dans des situations politiques pour le moins dissemblables, ont pu parvenir à des conclusions identiques. Il s'agit bien là de premiers frémissements d'un monde nouveau.
Les changements qui interviennent alors, et ce en l'espace d'une génération, sont si profonds qu'il n'est pas exagéré, en les évoquant, de parler de révolution intellectuelle. Une révolution qui annonce et prépare, par ses thèmes comme par son style, la politique des masses propre à notre siècle. Car le vaste mouvement de pensée des années 1890 est d’abord un mouvement de révolte, un « souffle de révolte » disait le jeune Barrès, Un mouvement dirigé contre le monde de la matière et de la raison, contre le matérialisme et contre le positivisme, contre la société bourgeoise et sa médiocrité, contre la démocratie libérale et ses incohérences. Dans l'esprit de la génération de ces années-là, la civilisation est en crise, une crise à laquelle il ne peut être de solution que totale.
Ce sont les premières lignes du Maurice Barrès de Z Sternhell dont on sait qu'il fit en son temps débat pour avoir brisé un peu de ce silence sur les origines françaises du fascisme. Nous nous étions endormis à l'idée que la République et les grands idéaux de 89 nous eussent prémunis contre toute tentation totalitaire et que, toute honte bue, l'épisode Vichy n'aurait été qu'un épisode fâcheux certes, mais épisode seulement. Ce que des études nombreuses depuis, mais à ce moment là celle de Paxton sur Vichy et celles de Sternhell contribuèrent à démentir.
On en eût certes aisément fait l'économie mais un regard tant soit peu lucide et honnête force à reconnaître qu'il n'est pas de culture ou d'histoire qui ne connaisse et camoufle ses heures sombres. Paris eut beau se croire ville lumière et la France la Patrie de l'humanisme et des droits de l'homme, sous le tapis, décidément, bien trop de poussières planquées ; dans le placard bien des cadavres qu'on eût tant désiré oublier ...
Que le passé au moins se regarde en face.
Sarkozy en son temps - lors de la campagne de 2007 - avait fustigé la tendance à vouloir s'excuser de tout 1 : si l'on veut dire par là que la France n'a pas à abandonner ses aspirations à l'universel et aux droits de l'homme, c'est évidemment incontestable. Que ceci nous incite à un peu plus de prudence, un moins de morgue et plus d'ouverture à l'autre et à la différence, le devrait être tout autant.
Pourquoi songeais-je pourtant à ces lignes introductives ?
 Il aura fallu l'assaut simultané, venu d'horizons très différents, et de hauteurs bien variables, d'un Finkielkraut, d'un Onfray, de cette inénarrable N Morano pour qu'elles me reviennent en mémoire. Oh je sais bien que l'histoire ne se répète jamais ou alors sur le mode de la farce 2. Je n'ignore pas que comparaison n'est pas raison ! Je devine bien, au reste, que ce serait verser dans le piège tendu par Alain Finkielkraut lui-même, que d'ainsi systématiquement interpréter le présent à l'aune de canons éculés et non nécessairement pertinents pour mesurer la spécificité de notre temps.
Il aura fallu l'assaut simultané, venu d'horizons très différents, et de hauteurs bien variables, d'un Finkielkraut, d'un Onfray, de cette inénarrable N Morano pour qu'elles me reviennent en mémoire. Oh je sais bien que l'histoire ne se répète jamais ou alors sur le mode de la farce 2. Je n'ignore pas que comparaison n'est pas raison ! Je devine bien, au reste, que ce serait verser dans le piège tendu par Alain Finkielkraut lui-même, que d'ainsi systématiquement interpréter le présent à l'aune de canons éculés et non nécessairement pertinents pour mesurer la spécificité de notre temps.
En même temps ces deux évidences qui se martèlent avec une bien vulgaire obsession :
- l'époque heureuse où les droites extrêmes, laminées par la honte de la collaboration et la défaite, à défaut de disparaître, firent au moins profil bas ; où les racismes de tout poil, après le génocide, perdaient tout espace où s'exprimer, est bel et bien terminée. On s'affola en 82 quand à Dreux pour la première fois un candidat du FN fut en position de l'emporter. Lentement, systématiquement le poison s'instilla. Le 21 avril ne fut qu'un signe précurseur, pas encore bien dangereux mais révélateur. Mais en même temps qu'à la surface politique, sous des dehors parfois scandaleux et tantôt assagis, en tout cas le laissant accroire sous l'égide de Marine Le Pen, le terrain politique républicain se fissurait progressivement, dans les profondeurs, les langues se déliaient - qui sont celles désormais des intellectuels ! Bien éloignée l'époque des intellectuels engagés, payant de leur personne pour défendre une cause, une justice, une vérité (Sartre, Camus, Foucault plus près de nous) : ils paradent désormais sur les tréteaux médiatiques suintant, sous une langue habile et souvent brillante, un fiel dévastateur et corrosif. L'engagé d'autrefois n'était assurément pas exempté d'erreurs, de contre-vérités ou de petits arrangements : tout au moins définissaient-ils ou rappelaient, la ligne rouge à ne pas franchir. Ceux-là la franchissent. Allègrement.
- indéniablement notre période est époque de ruptures, de mutations profondes : les périls environnementaux inversent du tout au tout notre rapport au monde, nos modèles économiques s'épuisent à lutter contre une crise qui s'éternise et qu'en réalité ils nourrissent, des politiques impuissantes que l'affaiblissement des états aggrave, une mondialisation trépidante assise sur une évolution technologique rapide, tous ces phénomènes se répercutant du reste les uns sur les autres brouillent les perspectives et s'ils donnent effectivement le sentiment d'un monde d'avant définitivement perdu, n'offrent aucun horizon clair, ou si peu réjouissant. A côté des postures politiquement correctes qui n'enchantent personne, la tentation de plus en plus forte de la radicalité. Révolte encore sourde, colère qui monte ...
Oui, décidément, même si les causes sont différentes et les effets sans rapport, on ne me fera pas croire que les mêmes ingrédients ne sont pas ici rassemblés pour une même pitance infâme. La TV s'y surajoute qui confère à ceci l'allure d'un cirque odieux où l'excessif tient lieu de pensée tout en garantissant l'audimat. Et le vide idéologique, l'absence de repère culturel achèvent d'ériger ces bateleurs d'un soir en penseur du siècle.
 Encore Barrès avait-il été fin lettré et grand découvreur de talent : c'est lui, notamment qui repéra avec une rare sagacité un grand écrivain en gestation dans ce premier recueil de poèmes du jeune Mauriac - les Mains jointes - qui ne le méritait peut-être pas. Comment oublier ces lignes du Souvenirs sur l'Affaire où Blum raconte son désarroi devant les hésitations puis le refus de Barrès de signer la pétition de 97 demandant la révision du procès Dreyfus ? Dans leur entrevue, Barrès déclara :
Encore Barrès avait-il été fin lettré et grand découvreur de talent : c'est lui, notamment qui repéra avec une rare sagacité un grand écrivain en gestation dans ce premier recueil de poèmes du jeune Mauriac - les Mains jointes - qui ne le méritait peut-être pas. Comment oublier ces lignes du Souvenirs sur l'Affaire où Blum raconte son désarroi devant les hésitations puis le refus de Barrès de signer la pétition de 97 demandant la révision du procès Dreyfus ? Dans leur entrevue, Barrès déclara :
Il y a un souvenir qui m’obsède. J’ai assisté, il y a trois ans, à la dégradation de Dreyfus. J’ai écrit un article, dans le Journal, vous vous rappelez... Eh bien ! je me demande si je ne me suis pas mépris. Je me rends compte que chacune des attitudes, chacune des expressions de visage que j’interprétais comme le signe d’une scélératesse totale, parfaite, comportait aussi le sens inverse. Dreyfus était-il le scélérat ;était-il un stoÏque, un martyr ? Je n’en sais plus rien... Non, non... je suis troublé et je veux réfléchir encore. Je vous écrirai...
puis quelques jours plus tard Barrès lui signifiera, par lettre, son refus :
dans le doute, c’est l’instinct national qu’il choisirait comme point de ralliement
Blum n'imaginait pas que Barrès fût ailleurs que dans le camp de la défense du juste : il demeura pourtant de l'autre côté, définitivement. On ne dira jamais assez combien l'Affaire Dreyfus fut un tournant et pour beaucoup un baptême politique. Blum ne sera plus jamais le dandy littéraire qu'il était encore ; Jaurès y prend toute sa dimension. Surtout, pour une longue période des valeurs changent de camp : après elle, l'antisémitisme ne pourra plus être de gauche ; le nationalisme restera de droite ...
Blum l'aima trop pour le haïr jamais3 mais cette désertion-ci aura écorné quelque chose de la beauté de notre histoire. Il n'y a jamais très loin de Barrès à Maurras ; de Maurras à la honte ! Cet impensé-là ressemble à s'y méprendre au refoulé freudien qui finit toujours par resurgir par la fenêtre quand on crut l'avoir chassé par la porte. Il en est ici comme de tout retour du refoulé : insidieux mais violent.
C'est le même étonnement, la même tristesse qui saisit aujourd'hui. Je n'imaginais pas un Onfray qui se fit connaître autrefois par cette belle initiative de l'Université Populaire de Caen sombrerait jamais dans cette représentation ombrageuse de soi même si depuis quelques temps on ne le pouvait soupçonner de s'être déjà laissé prendre au piège de l'illusionnisme médiatique. Cela fait depuis trop longtemps que sa réécriture de l'histoire de la philosophie ressemble à un jeu de massacre où il s'agit surtout de dégommer les icônes : à force de nous faire accroire que les vrais penseurs seraient ailleurs, il suggère surtout que le seul vrai philosophe ce serait lui. L'ego est haïssable : le sien est brillant mais tonitruant. Je n'imaginais pas un Finkielkraut défaillir là non plus. Découvert en 77 avec le Nouveau désordre amoureux qu'il écrivit avec P Bruckner au moment même où parurent les Fragments d'un discours amoureux de R Barthes, il révéla assez vite dans la Défaite de la pensée son peu de goût pour la modernité, caché sous l'exigence de rigueur de la pensée. Cet homme-là ne voit que menaces et pertes dans les évolutions modernes - et pourquoi pas.
Je crois bien inévitable que se fichent toujours en face des laudateurs de la modernité quelques nostalgiques invétérés : Comte n'eut pas tort de considérer la nécessaire conciliation d'ordre et progrès. C'est toujours dans ce face-à-face, qui n'est pas toujours un débat, mais souvent une série infinie d'invectives ; pas un dialogue, plutôt une dialectique épuisante, que se fait l'histoire - en tout cas celle des idées. Que cet homme-là fût un antimoderne, un nostalgique d'une IIIe qui n'exista sans doute que dans ses rêves, soit, pourquoi pas ! Mais alors qu'au moins il ne nous fasse pas la leçon d'avoir lu notre époque avec des références dépassées !
Zélateurs d'un Occident superbe et triomphant, ces deux-là retrouvent à l'occasion les accents de ces anti-Lumières qu'avait repérés Strenhell- Lumières qu'il préférait d'ailleurs appeler les Lumières franco-kantiennes. Fallait-il vraiment qu'en sus, à l'occasion de la crise des migrants, s'y distille cette peur qui incite si aisément à la haine de l'autre ? Que l'Occident ait toujours un problème avec l'Islam qu'il connaît mal et comprend encore moins est une vieille histoire ; que les terrorismes de tout poil, les intégrismes fallacieux de fous de dieu avinés de dogmes et de violences et prompts à toutes les exactions n'aient pas arrangé la vision déjà bien abîmée de l'Islam, on le comprend bien. On aurait pu attendre des intellectuels qu'ils tracent la ligne rouge à ne pas franchir, éclairent et expliquent. Que nenni ! Voici que constatant une diversité qui n'est pas prête à disparaître et au lieu d'en prendre acte à défaut de s'en réjouir, au lieu de souligner comment se fait l'intégration de ceux-là, de pointer ce que la République pourrait faire mieux pour les y soutenir, voici que celui-ci se désole d'une identité nationale en pleine désintégration et se prête à rêver de seuils !
On ne pose jamais innocemment la question de l'identité : on y verse incontinent de la République à la Nation. Et l'on se prête, volontairement ou non, à toutes les récupérations ultra-droitières. C'est ce qui arrive à Finkielkraut et Onfray - pour le moins.
Je me moque de savoir qui ils sont désormais ! Je n'ai pas l'obsession des étiquettes que goûtent si paresseusement les médias droguées aux polémiques faciles. Je sais seulement, qu'avec leurs hantises d'un autre âge, ils ouvrent l'horizon de toutes les manipulations ; couvrent de leur notabilité toutes les récupérations possibles d'une extrême-droite qui ne s'en prive évidemment pas. De Finkielkraut à Morano il y a un lien. Involontaire sans doute ; non désiré peut-être ; mais un lien que tisse avec gourmandise une extrême-droite qui n'avait pas besoin de cela pour enfler à loisir. On ne passe pas innocemment de la défense de la République à celle de la Nation, même maquillée en défense de la culture !
Je n'ai que deux questions à poser qui toutes les deux font mal :
- où sont les intellectuels de l'autre ban ? Pourquoi se taisent-ils ? En est-il encore, au moins ? C'en est déjà assez que la gauche, égarée dans les compromissions d'un social-libéralisme introuvable mais implacable, imaginaire et si mal théorisé, eût déjà déserté et ressemblât si peu à elle-même : fallait-il en plus ce silence sidéral des intellectuels ? A chaque fois que, dans notre histoire, la gauche manqua à ce point à sa propre dignité, il se trouva toujours des voix pour la rappeler sinon à l'ordre, du moins à sa vocation (j'entends encore celles de Sartre, Camus fouettant les lâchetés indignes d'un Guy Mollet - sans même évoquer, de l'autre côté, celle étrange et magnifique d'un Mauriac). Mais aujourd'hui où sont-ils ces femmes et ces hommes, l'humanisme chevillé à l'âme et ivres de modernité ? Quand se lèveront-ils pour couvrir de leurs voix passionnées celle moribonde et étriquée, désespérée et désespérante de ces Cassandre au petit pied ?
- je ne vois pas sans inquiétude se répandre, sans honte, cette peur de l'autre qui a un nom : xénophobie. J'ai retenu la leçon d'A Memmi : il n'est pas de racisme qui puisse passer à l'acte, qui n'ait préalablement été capable de nommer sa hantise, son ennemi. Le racisme, qui se proclame et s'énonce, est toujours menace imminente d'un racisme en acte. Tous, à un moment ou à un autre finissent par assimiler l'autre - en l'occurence le musulman - à un délinquant, au mieux ; à un terroriste, au pire ; un ennemi, finalement. Ces glissements sont connus ! on les a déjà vus et entendus jusqu'au dégoût. Alors oui, je le sais : nous ne sommes pas dans les années trente ; encore moins dans celles 1890 ! On a changé d'ennemi : ce n'est plus le juif mais le musulman ; il est toujours sémite ! Où l'on se remet à évoquer les seuils de tolérance ! A quand les quotas ?
N'y a-t-il vraiment aucun rapport ? Les peurs archaïques ne déroulent-elles pas toujours les mêmes effets désastreux ? Les crises mimétiques sécrètent toujours les mêmes victimes émissaires, les mêmes sacrifices illusoires ; les mêmes recettes violentes ... Nous le savons depuis Girard, au moins. Derrière cette sacralisation de la culture occidentale, cette dénonciation d'une identité française en péril, il y a une mise à mort qui se profile ...
Notre société serait-elle à ce point moribonde qu'elle ne supportât plus rien ; plus rien d'autre qu'elle-même ? Je ne tomberai pas dans le piège d'un ethnocentrisme à l'envers qui balaierait notre histoire comme indigne et maligne. Elle aura eu et a encore des gloires incontestables autant que des ombres détestables comme d'autres - comme toutes. Je ne la crois pas - l'espère en tout cas - si épuisée qu'elle ne fût plus capable d'aucun rebond, d'aucune envolée. Ce que je sais en revanche, c'est qu'à chaque fois qu'il y eût une telle trahison des clercs, une telle ambiance délétère et désespérée, advint le temps de la colère du peuple. Que cette colère, pour renforcée qu'elle fut d'une longue patience et désespérance, est toujours dévastatrice ; souvent tragique.
Ceux-là jouent avec le feu : gare !
Il m'arrive d'espérer qu'il s'agisse seulement ici d'un effet de génération : celle, la mienne, dite du baby-boom, n'a pas encore quitté la scène et répugne au reste à abandonner les rênes du pouvoir ; la suivante n'a encore prise sur rien. Celle-là, qui fut de toutes les mutations, de toutes les illusions mais aussi de tous les abandons, n'imagine toujours pas qu'il puisse en aller autrement que de ces rêves adolescents ; celle-ci, écrasée par la flexibilité, l'incertitude, le peu de place qu'on lui réserve et le peu de perspective qu'on lui offre, semble plus se débrouiller que lutter, plus chercher la règle de la souffrance minimale qu'espérer et concevoir un monde qui lui convînt. Celle-là, au nom des périls incontestables des tentations totalitaires, s'enquit de fustiger les idéologies. Le travail de sape aura été efficace : celle-ci semble n'avoir plus de promontoire théorique par où se hisser. S'étonne-t-on que cette génération n'eût pas de culture, de références ? Oublie-t-on si malhonnêtement qu'on lui avait eu appris combien toute pensée était potentiellement totalitaire ? Est-on à ce point infatué de sa propre gloire pour n'envisager pas seulement que ces références existent mais tellement à l'écart des nôtres ?
J'aimerais que ce ne fût ici que ritournelle amère des vieux cons à l'encontre des jeunes cons ... Mais ces haines recuites, ces peurs cacochymes, ces lâches xénophobies ....
1) cette déclaration - une parmi tant d'autres, au soir de sa victoire :
Je veux en finir avec la repentance, qui est une forme de haine de soi et la concurrence des mémoires, qui nourrit la haine des autres
2) Marx Le 18 Brumaire de L Napoléon Bonaparte :
Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce.
3) Léon Blum, Le vrai monument de Maurice Barrès, Le Populaire, 25 septembre 1928 :
Je ne parlerai jamais de Barrès sans émotion. Je l'ai connu à vingt ans, quand il en avait trente. Il était un jeune homme glorieux et déjà magistral, le prince nonchalant et dédaigneux de ma génération comme de la sienne. Je l'admirais sans doute alors plus qu'aujourd'hui, mais je reste aussi touché qu'en ce temps-là de sa grâce si fière, de son charme câlin et un peu rude, de ce ton d'égalité autoritaire qu'il savait introduire dans l'amitié. L'affaire Dreyfus nous sépara brutalement, mais l'affection avait été assez vive (de part et d'autre, je le crois) pour que nous en ayons gardé plus que le souvenir. Nous en sentions en nous la racine encore intacte, et quand le hasard nous réunissait dans un couloir de la Chambre, ce n'était pas sans une sorte d'attendrissement. « Comment oublier, me disait-il un jour, que vous avez aimé ma jeunesse et qu'elle vous le rendait bien ? » Je ne l'avais pas oublié plus que lui, et je me souvenais aussi que c'est moi qui l'avais reçu devant le lit funèbre de Jaurès et qu'il m'avait dit : « Votre deuil est aussi le mien. » Cela avec des larmes dans les yeux, de vraies larmes qui effaçaient bien des choses.
J'évoque ces souvenirs, par un mouvement d'expansion naturelle dont la cérémonie de Sion-Vaudemont me fournit l'occasion, et aussi pour bien montrer que devant le nom de Barrès je ne suis ni critique hostile ni même spectateur impartial : sa mémoire m'est restée chère comme sa personne.