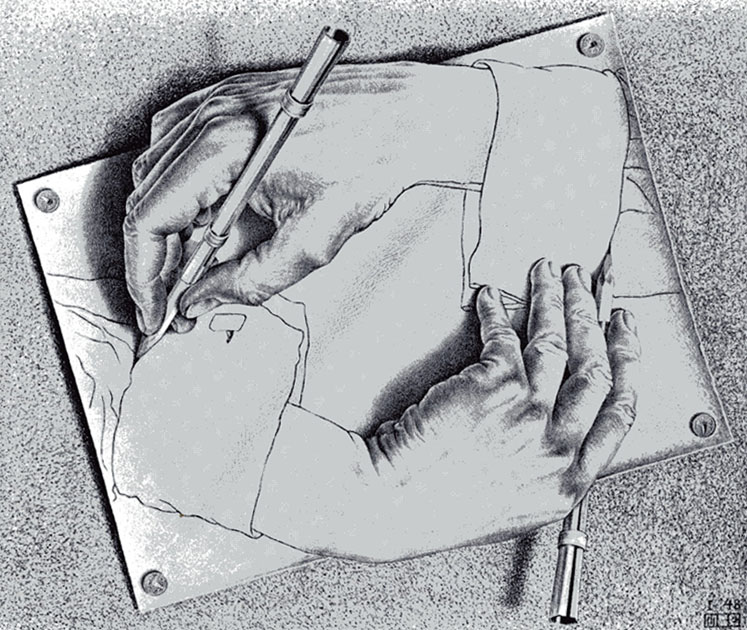| index | précédent | suivant |
|---|
Collusion ou collision ? 1
Avec la page sur les étonnantes dérives de nos intellectuels (Remugles) , celle sur le dérapage de Netanyahou (Communication) et celle sur l'évidement du discours politique (Désarroi) cette réflexion autour de Boulanger (Collusion) clôt ce qui ne peut que constituer un préambule à une réflexion plus générale sur la communication, notamment politique dont on trouvera ici les toutes premières lignes ...
Le boulangisme est assurément plus intéressant que le général lui-même, personnage falot, de peu de convictions et sans doute plus manipulé que manipulateur. Il n'empêche : il représente la première grande crise que traverse une IIIe République âgée d'à peine plus de dix ans.
 Une République, dite opportuniste - ce qui à l'époque n'était pas nécessairement péjoratif - qu'on nommerait aujourd'hui réformiste par opposition à une tendance radicale. Une république qui commence de décevoir de part et d'autres : à gauche, sans même évoquer les socialistes encore très peu nombreux - Jaurès, rappelons-le se fera élire en 85 sur une profession de foi opportuniste et soutiendra d'ailleurs Ferry - on verra, chez les radicaux les plus fervents où l'on compte encore Clemenceau, dans les successeurs de Gambetta - Ferry, Freycinet etc - plus des affairistes soucieux de satisfaire leurs intérêts propres et de conserver aux leurs les cordons du pouvoir que des républicains sincères occupés à réaliser le programme de Belleville.[2] A droite, évidemment, monarchistes et bonapartistes, en perte cruelle de vitesse, ne désarment pourtant pas contre la Gueuse laquelle pourtant sert assez bien leurs intérêts.
Une République, dite opportuniste - ce qui à l'époque n'était pas nécessairement péjoratif - qu'on nommerait aujourd'hui réformiste par opposition à une tendance radicale. Une république qui commence de décevoir de part et d'autres : à gauche, sans même évoquer les socialistes encore très peu nombreux - Jaurès, rappelons-le se fera élire en 85 sur une profession de foi opportuniste et soutiendra d'ailleurs Ferry - on verra, chez les radicaux les plus fervents où l'on compte encore Clemenceau, dans les successeurs de Gambetta - Ferry, Freycinet etc - plus des affairistes soucieux de satisfaire leurs intérêts propres et de conserver aux leurs les cordons du pouvoir que des républicains sincères occupés à réaliser le programme de Belleville.[2] A droite, évidemment, monarchistes et bonapartistes, en perte cruelle de vitesse, ne désarment pourtant pas contre la Gueuse laquelle pourtant sert assez bien leurs intérêts.
C'est cette - curieuse et rare - conjonction des oppositions qui se réalisera sous le nom de Boulanger. Que l'homme ne fût pas à la hauteur de la situation, est une évidence et fut une incroyable chance pour la République. Mais la question n'est jamais celle de l'homme, plutôt des forces qui le soutiennent.
Il eut pourtant quatre occasions de prendre le pouvoir :
- lors de la crise gouvernementale de mai 86 mais il reste au ministère à expédier les affaires courantes
- le 8 juillet 1887 où Boulanger, éjecté du gouvernement doit rejoindre à Clermont-Ferrand son poste de général de corps d’armée La foule avertie, amassée tente de l'empêcher de partir aux cris de A l’Élysée ! à l’Élysée !
- le 19 avril 1888, Boulanger, se rend au Palais Bourbon pour y prendre son siège de député. Là encore, la foule immense l’attendait qui n'attendait qu'un signe pour le faire proclamer chef d’un gouvernement provisoire.
- le 27 janvier 1889, après sa victoire écrasante à Paris. La foule est de plus en plus épaisse. On chante. On crie. On se bouscule. Il est plébiscité. 57% dès le premier tour de scrutin dans ce fief républicain et rouge. "A l’Élysée"… "A l’Élysée !"…
Il n'en saisit aucune.
C'est pourtant son programme qui indique au mieux ce qui se trame sous ce personnage ambigu :
- réforme constitutionnelle où fleure bon le césarisme avec appel direct au peuple et antiparlementarisme : appel à un pouvoir fort, autoritaire
- dénonciation d'une classe politique affairiste, corrompue, véreuse
- culte de la Patrie et donc de l'armée ; de l'effort avec au passage dénonciation des valeurs humanistes supposées émollientes
- union capital/travail mais force est de constater la faiblesse sociale et économique du travail
Au delà d'une histoire de la crise boulangiste, ou même de son analyse, qui n'est pas de notre propos, ce qui intéresse ici, dans cette première formulation du nationalisme français de la fin du XIXe qui, ne l'oublions pas, trouvera à s'exprimer une seconde fois de manière décisive lors de l'Affaire Dreyfus, c'est la convergence qu'on y peut déceler entre une certaine gauche extrême et les courants réactionnaires. La question n'est pas celle de la duplicité - ou de l'inconsistance - de Boulanger lui-même qui affectait un programme radical au moment même où il allait chercher son financement chez la duchesse d'Uzès, elle réside bien plutôt dans cette étonnante configuration où les extrêmes semblent se rejoindre, comme on dit parfois paresseusement, dans une identique détestation de la démocratie bourgeoise. Assurément, d'un côté comme de l'autre, on imagina pouvoir se servir de Boulanger comme d'un levier pour mieux faire valoir ses revendications. La même histoire, toujours se répète, ou mieux, les grands principes cèdent vite le pas à la médiocre tactique électorale.
 Comment ne pas songer à la droite conservatrice allemande qui finira par accepter Hitler au gouvernement croyant l'y pouvoir mieux contrôler ? à cet A Hugenberg, pourtant ultra-conservateur, qui dut céder la place dès Juin ? La République dut à la pusillanimité de Boulanger de ne pas courir ce risque-là mais les illusions furent les mêmes.
Comment ne pas songer à la droite conservatrice allemande qui finira par accepter Hitler au gouvernement croyant l'y pouvoir mieux contrôler ? à cet A Hugenberg, pourtant ultra-conservateur, qui dut céder la place dès Juin ? La République dut à la pusillanimité de Boulanger de ne pas courir ce risque-là mais les illusions furent les mêmes.
Comment au reste ne pas se souvenir d'un Pétain qui, identiquement à Boulanger, s'était fait une réputation de général républicain qui lui permit de contrôler toute la politique militaire de l'entre-deux-guerres et que Blum saluait encore en 39 comme tel.
Même si la France n'a jamais vraiment renoncé aux délices de l'homme providentiel ni au césarisme qu'elles impliquent - songeons simplement au doublet étonnant que représente à cet égard celui qui déchira le milieu du XXe, Pétain/de Gaulle, comment ne pas voir que s'y joue un autre doublet homme fort/pouvoir fort ? Pour un Napoléon qui mit fin à la Révolution ou un Pétain, la République, combien de de Gaulle qui la rétablirent - même sur le mode ambivalent d'un exécutif fort ? Mais surtout, combien de généraux ?
Le même constat s'impose : le centre conservateur ou même timidement réformiste ne sait que faire de ses extrêmes : les rejeter hors de la représentation populaire quand eux sont faibles, composer lâchement avec eux, dans le cas contraire. Ces mêmes extrêmes, identiquement, ne savent pas que faire de ce qu'ils nomment au gré et selon les époques, la Gueuse, le système, l'établissement (Le Pen) : y entrer, même avec l'intention de le renverser c'est courir le risque d'y être contaminé, corrompu et d'y perdre toute légitimité ; s'en tenir à l'écart, encourir la peine de l'impuissance.
 Le même constat s'impose : c'est toujours par l'éducation que les extrêmes envisagent d'influencer la cité. La ligue des Patriotes fut d'abord une société de gymnastique ; Pétain, invité au soir du 6 février 34, à entrer dans le gouvernement Doumergue demanda, on s'en souvient peu, le portefeuille de l’Éducation - ce qu'il n'obtint pas. Comment oublier ces camps de jeunesse, ces mises en scène tapageuses du corps jeune, sain supposé toujours symboliser la régénération du corps social lui-même ? Des sociétés de Déroulède aux chantiers de jeunesse de Pétain ou à la Hitlerjugend, les images sont les mêmes ; obsédantes ! [3]
Le même constat s'impose : c'est toujours par l'éducation que les extrêmes envisagent d'influencer la cité. La ligue des Patriotes fut d'abord une société de gymnastique ; Pétain, invité au soir du 6 février 34, à entrer dans le gouvernement Doumergue demanda, on s'en souvient peu, le portefeuille de l’Éducation - ce qu'il n'obtint pas. Comment oublier ces camps de jeunesse, ces mises en scène tapageuses du corps jeune, sain supposé toujours symboliser la régénération du corps social lui-même ? Des sociétés de Déroulède aux chantiers de jeunesse de Pétain ou à la Hitlerjugend, les images sont les mêmes ; obsédantes ! [3]
Le même constat s'impose : où l'on peut observer les prémices du fascisme, Sternhell me semble avoir raison, c'est dans la soumission de l'individu au collectif que ce nationalisme sourcilleux suppose. Dans la Vulgate boulangiste, comme plus tard dans celle de Pétain, on retrouve, inlassablement répétés, les termes de courage, de sacrifice, de service, d'abnégation voire même d'un patriotisme entendu comme religion (pour Déroulède). De là à voir dans les idées des Lumières, dans la notion de droit de l'homme, dans l'humanisme en général, un corps de principes qui nous eût éloigné de l'essentiel - la défense de la patrie - il n'y a qu'un pas ! Il fut franchi par Déroulède ; il le sera, allègrement, par le nazisme qui s'alla chercher ses sources dans une Grèce aryenne imaginaire ou dans les mystiques boréales ... Prodigieux renversement des valeurs qui transforme, l'air de rien, les principes fondateurs de la République, en obstacle à la régénération de la Nation, tout ceci sous l'air de la témérité et de l'héroïsme. C'est qu'à feindre le dépassement des idéologies, on sombre vite dans l’exaltation de valeurs supposées transcendantes, qui, en tout cas, nous dépasseraient assez pour que nous ne sachions nous y dérober. [4]
En tout état de cause, on arguera toujours du dépassement du clivage droite/gauche, perçu comme amplement dépassé par les circonstances - ou le pragmatisme nécessaire - présenté comme une division interne confinant à la guerre civile quand il eût fallu s'unir contre l'ennemi commun.
C'est ce brouillage idéologique en tout cas, stupide parce qu'en réalité sera toujours déjà une idéologie que de proclamer qu'elles fussent dépassées, qui est la porte ouverte au pire. Que toutes les options démocratiques aient été tentées, que toutes les politiques eussent échoué (souvenons-nous du Contre le chômage on a tout essayé de Mitterrand) , que l'on ne focalise plus l'attention que sur la supposée probité morale de son héraut et la détestation commune de l'affairisme de ses adversaires, que l'on oublie, ne serait ce qu'un instant, que les idées ont une origine et surtout une histoire, que l'on passe pour négligeable que ces extrêmes-là ne sont jamais que les avatars d'autres plus anciens, alors, oui, tout devient possible ; surtout le pire.
Le même constat s'impose : l'identique antienne du redressement nécessaire après la défaite. En 85, comme  en 40. Ce qui se terre là dessous, c'est la hantise du déclin, de la décadence. Le refus de la médiocrité et de la soumission pour une Nation au passé glorieux. Refus, prétexte à tous les renoncements, à toutes les compromissions, mais à toutes les provocations revanchardes aussi. La lente installation de la république conservatrice, pour ce qu'elle signifiait le renoncement au moins immédiat à toute revanche et récupération des provinces perdues ( songeons au Y penser toujours ; n'en parler jamais de Gambetta) ne pouvait qu'agacer ce nationalisme sourcilleux et l'on ne comprendra rien à la manière provocatrice dont Boulanger traita l'affaire Schnaebelé à Pagny/Meuse si l'on oublie la tendance du faible à bomber le torse. Même rêve de grandeur restaurée que l'on retrouve dans la Révolution Nationale de Pétain même s'il dut passer par la collaboration mais assurément avec l'ambition de se retrouver une place forte dans cette nouvelle Europe supposée se construire.
en 40. Ce qui se terre là dessous, c'est la hantise du déclin, de la décadence. Le refus de la médiocrité et de la soumission pour une Nation au passé glorieux. Refus, prétexte à tous les renoncements, à toutes les compromissions, mais à toutes les provocations revanchardes aussi. La lente installation de la république conservatrice, pour ce qu'elle signifiait le renoncement au moins immédiat à toute revanche et récupération des provinces perdues ( songeons au Y penser toujours ; n'en parler jamais de Gambetta) ne pouvait qu'agacer ce nationalisme sourcilleux et l'on ne comprendra rien à la manière provocatrice dont Boulanger traita l'affaire Schnaebelé à Pagny/Meuse si l'on oublie la tendance du faible à bomber le torse. Même rêve de grandeur restaurée que l'on retrouve dans la Révolution Nationale de Pétain même s'il dut passer par la collaboration mais assurément avec l'ambition de se retrouver une place forte dans cette nouvelle Europe supposée se construire.
Est-il utile de faire un rapprochement avec la situation actuelle ? Certes, la défaite n'est pas aujourd'hui militaire - cela fait un moment que la guerre s'est déplacée sur le terrain économique - mais l'incapacité de la République à répondre aux mutations en cours, mais à résoudre aussi tant la crise économique que celle de l'emploi, ouvre aux extrêmes un champ vaste où susciter et déployer la crainte de la défaite et du déclin. Désormais, comme autrefois, se retrouvent, dans la même détestation d'un système qu'on nommera aujourd'hui capitalisme financier, tous ceux qui veulent casser la baraque et se piquent de couleurs révolutionnaires. Pour tous, la République n'est que le paravent d'une oligarchie même si les uns cherchent une alternative dans un socialisme désormais introuvable , les autres dans un retour au passé, corporatiste le plus souvent. Certes, l'ennemi n'est plus l'Allemagne - encore que l'on observe ici et là quelques rémanences d'une Allemagne dominatrice - mais concédons que de l'Europe à la finance internationale, ses substituts ne manquent pas qui suffisent à agiter le chiffon rouge.
"L'expérience a démontré que la responsabilité des ministres devant la Chambre équivaut à l'absorption du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif, et à l'avilissement du premier. La Chambre doit légiférer, elle ne doit pas gouverner. (...)
Dans une démocratie, les institutions doivent se rapprocher autant que possible du gouvernement direct. Il est juste et bon qu'on interroge le peuple par voie directe chaque fois que s'élèveront de graves conflits d'opinions qu'il peut seul résoudre. C'est pourquoi je pense qu'il est indispensable d'introduire dans notre Constitution le référendum. (...)
Je crois qu'un gouvernement fondé sur des institutions ainsi renouvelées ouvrirait dans la République une ère de paix et d'ordre, de travail et de crédit, d'harmonie et de réconciliation que le régime parlementaire ne peut même pas essayer de réaliser."
Général Boulanger, discours à la Chambre des députés, 4 juin 1888.
Le même constat s'impose : politiquement, un antiparlementarisme rémanent jouant toujours sur les mêmes arguments ; qui en appelle toujours à la consultation directe du peuple, par dessus les intermédiaires invariablement perçus comme parasites, traîtres ou corrompus. Argument que l'on retrouve aussi bien chez les monarchistes - il sera décliné jusqu'au dégoût par Maurras - que par certains radicaux, nostalgiques ou pas, du mandat impératif, soucieux en tout cas d'une représentation la plus proche possible de la base, éventuellement révocable, impliquant à tout le moins, une large décentralisation.
Le souvenir demeure entier, à gauche, d'un Rousseau n'entendant la démocratie que directe ; on n'oubliera pas non plus que celle qu'inventèrent les Grecs n'était effectivement pas représentative. On n'oubliera pas enfin que le terme démocratie demeurera péjoratif très tard, jusque dans les années qui précédèrent 89 et que ce n'est à ce titre pas tout à fait un hasard que les constituants parlèrent de République et non de démocratie. Mais faut-il rappeler que dans les vastes unités politiques qui sont les nôtres, renoncer à la démocratie représentative revient à renoncer à la démocratie tout court ?
On évoque sous le terme de populisme cette propension à flatter le peuple en le consultant par dessus les corps constitués - souvent en flattant ses tendances les plus frustres ce qu'autrefois l'on nommait démagogie. Le terme est détestable qui veut tout dire et son contraire - chacun finissant par devenir le populiste de l'autre. Il n'empêche, même si le recours au peuple demeure quand même le fondement de la démocratie, l'opprobre jetée sur les corps intermédiaires est invariablement un des marqueurs de la pensée d'extrême-droite.
"Vous avez raillé le Parlement ! Il est étrange, pour vous, que cinq cent quatre-vingts hommes se permettent de discuter des plus hautes idées qui ont cours dans l'humanité et ne résolvent pas d'un seul coup tous les problèmes économiques et sociaux qui sont posés devant les hommes. Comment ! Les plus grands esprits, tous ceux qui chez tous les peuples honorent l'humanité, ont médité sur ces choses ; ils sont divisés parce que la recherche est longue, parce que la vérité se dérobe, et voici que, par un phénomène qui vous surprend, ces cinq cents hommes qui sont ici ne s'accordent pas sans discussion. Eh bien, puisqu'il faut vous le dire, ces discussions sont notre honneur à tous. Elles prouvent surtout notre ardeur à défendre les idées que nous croyons justes et fécondes. Ces discussions ont leurs inconvénients, le silence en a davantage encore.
Oui ! gloire aux pays où l'on parle, honte aux pays où l'on se tait. Si c'est le régime de discussion que vous croyez flétrir sous le nom de parlementarisme, sachez-le, c'est le régime représentatif lui-même, c'est la République sur qui vous osez porter la main."
Clemenceau en réponse, 4 juin 1888.
Faut il se souvenir que c'est de ce même argument dont joua Sarkozy [5] en 2012, influencé ou non par Buisson ? Récuser les corps intermédiaires n'est jamais anodin même quand on se pique de référendum et non de plébiscite.
Clemenceau ne manqua ainsi pas de répondre vertement à Boulanger et il en montrera, bien plus tard, l'exemple, en ne suspendant jamais le fonctionnement des institutions durant ces longs mois de guerre où il dirigea le gouvernement (17-18).
Faut-il rappeler que le fascisme, même non vraiment mis en application du fait des guerres, n'en demeure pas moins un régime technocratique fondé d'une part sur l'excellence du chef - à qui on vouera un culte - et sur des corps de techniciens chargés d'appliquer l'ordre de ce dernier. A l'opposé strict de la démocratie où le souverain l'est, non pas parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est le peuple, le fascisme comme n'importe quelle technocratie juge que la complexité du pouvoir moderne interdit de le pouvoir confier, même indirectement au peuple. On connaît le mot de Clemenceau affirmant que la guerre était chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires ; on pourrait dire que pour le fascisme technocratique, la politique est trop sérieuse pour être abandonnée au peuple, seul lui revenant d'approuver la ligne du maître. Ici, référendum rime toujours avec plébiscite.
Prudences
Elle s'impose par principe : ce n'est pas parce que les ingrédients sont identiques que des recettes différentes présenteraient le même plat.
Il est vrai que des saillies obscènes de Morano, aux considérations ronchonnes de Finkielkraut en passant par les rodomontades d'Onfray on peut repérer plus que des analogies avec ce qu'on vit, entendit et lut durant la période Boulanger et nos grandes crises démocratiques. Il est vrai que de l'épuisement de notre système politique - qui se remet mal de l'hyper-présidentialisation induite par la réforme du quinquennat - au prolongement endémique de la crise économique en passant par l'impuissance des politiques à la surmonter ; il n'est pas faux que du brouillage idéologique à la domination éhontée d'une pensée technicienne ivre de recettes et ennemie acharnée de la pensée en passant par l'angoisse ressentie devant des mutations périlleuses conduisant ensemble à l'aggravation du vivre ensemble ; il est vraisemblable que de la confusion idéologique résultant de la récusation imbécile de tout système de pensée au nom du refus de tout totalitarisme à la servilité veule au pragmatisme ambiant - qu'autrefois on nommait simplement réalisme - en passant par la victoire incroyable, surgissant tel un retour du refoulé, de la subjectivité sur la raison, il n'est pas inexact, dis-je, qu'il y eût, d'entre cette atmosphère fin de siècle qui caractérisa la montée du nationalisme en France, et le déclinisme dépressif qui nous caractérise aujourd'hui, des rapports évidents, des analogies criantes, des ressemblances inquiétantes.
Pour autant comparaison n'est pas raison et l'histoire bredouille rarement.
Il n'empêche ! la montée de l'extrême-droite qui n'est pas qu'un fait isolé en France mais que l'on observe partout en Europe, la contamination d'une idéologie délétère, le silence des intellectuels ou, pire encore, leur dérive droitière, en tout cas conservatrice ; l'incapacité des politiques à proposer et réaliser une alternative crédible et possible ; cette montée, surtout, sourde mais désormais envahissante de la peur, ressemble à s'y méprendre à une crise des fondations ; à une crise de type mimétique (tous pourris ! ). L'histoire a montré que nos cités ne s'en sortirent jamais que par une stratégie émissaire. Finance, Islam, terrorisme, immigration, l'Europe en font pour l'instant les frais. A qui le tour demain ? Pour quelle régression mentale ? Pour quel déni de la démocratie ? Pour quelle négation de l'homme ?
1)H Guillemin Le général Boulanger 1972
2) cf programme du parti radical en 1881 qui reprenait pour l'essentiel celui de Belleville
3) lire notamment l'aticle 2 des status de la Ligue des Patriote :
La Ligue a pour but la révision du traité de Francfort et la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France, elle a pour tâche la propagande et le développement de l'éducation patriotique et militaire. C'est par le livre, le chant, le tir et la gymnastique que cette éducation doit être donnée.
4) Déroulède cité par Sternhell
L'idéologie humanitaire, en laissant « s'éteindre l'esprit militaire », a engendré « un péril national ». Par conséquent, le premier pas vers le relèvement consiste à protéger le pays contre toutes les doctrines internationalistes qui ne sont guère plus que « l'exploitation de la France par l'étranger », contre toutes les chimères humanitaires et, en général, à remettre en question toutes les valeurs léguées par l'époque antérieure.
5) Doit-on mentionner que ce fut tout au long de son mandat, et l'est resté depuis, un des leit-motive de la pensée sarkozyste ?
Lire notamment cet ITV parue dans Libération à propos de la eprésentation de la Révolution
Joël Pommerat : J’avais un projet de travailler sur ce que j’appelais, peut-être avec naïveté, la question idéologique, c’est-à-dire nos représentations individuelles, collectives de l’individu et de la société. Maintenant, le «grand mot», c’est «sortons des idéologies». Cette formule, on l’entend encore, elle n’est pas dépassée. Les gens ne se rendent même pas compte de la bêtise de cette formule, comme si ceux qui prétendaient être sortis de l’idéologie n’y étaient pas en plein. J’ai eu un jour le grand honneur de dîner avec notre ancien président Sarkozy. J’ai été effaré de l’insistant discours qu’il nous tenait : aujourd’hui, il n’y a plus ni droite ni gauche, c’en est fini des idéologies, de l’affrontement des partis, on est passé à autre chose. Ce discours-là m’écrase depuis des années.
Souvenons-nous de l'éloge des frontières que Sarkozy entonna lors d'un de ses meetings de campagne de 2012
Je veux affirmer l’importance cruciale des frontières »
l'Europe a trop laissé s'affaiblir la Nation alors que les pays qui gagnent dans le monde aujourd’hui, ce sont les pays qui croient dans l’esprit national ! ». [mais ne confondons pas] le sentiment national, qui est hautement respectable, avec le nationalisme qui est une idéologie profondément dangereuse .
La Nation est un partage, le partage d’une identité collective, elle a toujours eu contre elle ceux qui ne croient qu’à la lutte des classes ! Ils ont oublié combien comptent pour un homme l’attachement à sa terre natale, au paysage dans lequel on a grandi, à la culture dont on a été nourri par ses parents et ses grands-parents, ils n’ont rien fait d’autres que d’ouvrir la porte à la loi des communautés et des tribus ! S’il y a du communautarisme et des tribus, c’est parce que l’on n’a pas assez défendu la Nation !
Sans frontières, il n’y a pas de Nation, pas d’Etat, pas de République, pas de civilisation. (…) La frontière, c’est l’affirmation que tout ne se vaut pas, qu’entre le dedans et le dehors ce n’est pas la même chose, tracer une frontière entre les cultures, le vrai et la faux, la beauté et laideur, c’est le long travail de la civilisation . (…) L’Europe a trop cédé à la religion du libre-échange et de la déréglementation au nom de l’abaissement des frontières, trop cédé à une conception d’un monde sans Etat.
Nous ne sommes pas supérieurs aux autres mais nous sommes différents des autres et nous voulons que l’on respecte cette différence !
Comment ferons nous si plus personne n’est fier d’être français si on banalise tout si on dit que tout se vaut ! Dans les 5 années qui viennent je ne veux pas laisser la France se diluer dans la mondialisation !
je renvoie à l'analyse des discours de Toulon et Toulouse (entre les deux tours) que je fis en son temps