Emmanuel Levinas
De l’existence à l’existant
[1947] [Vrin, 1986, p. 147-174]
L’HYPOSTASE
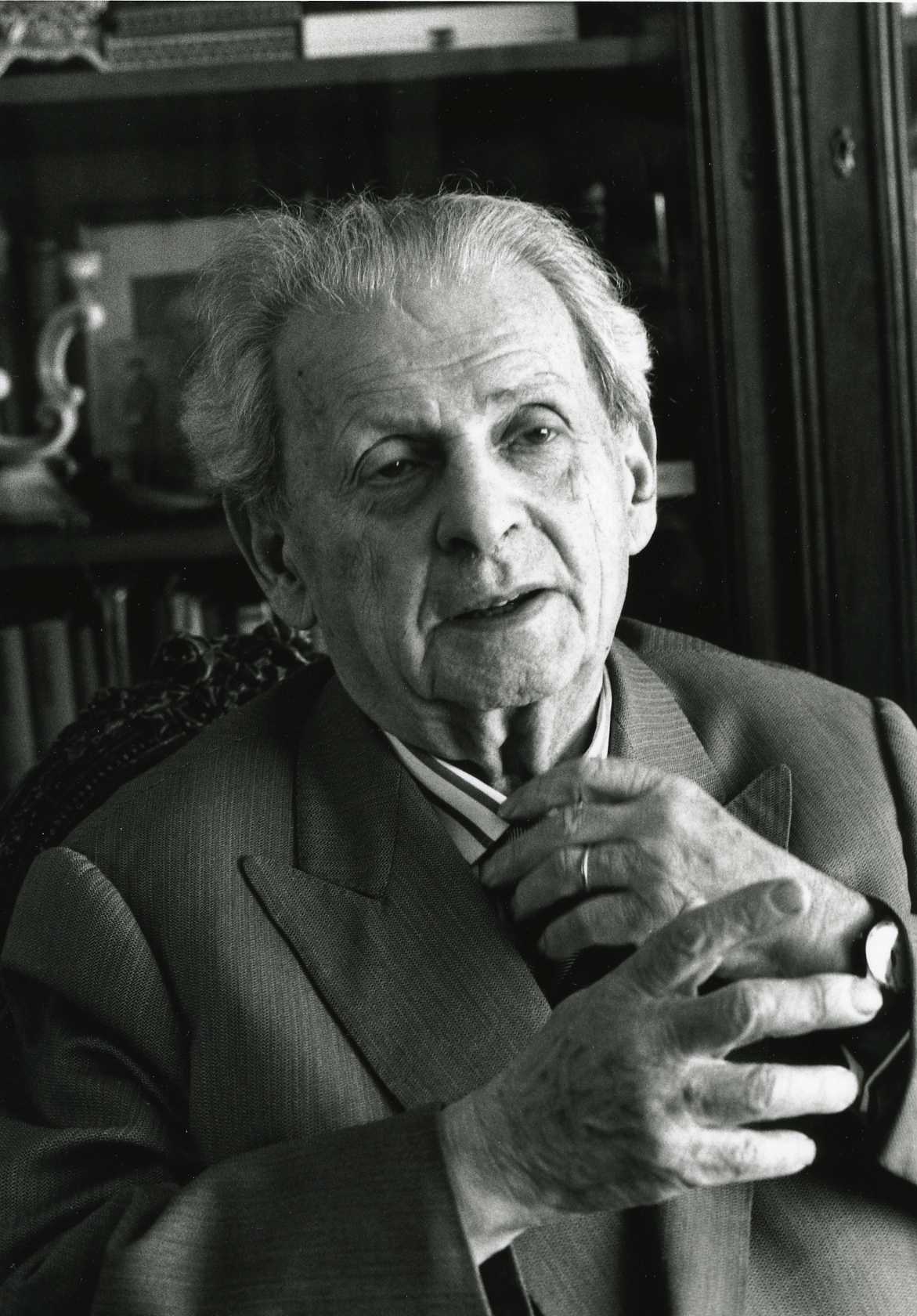 3° Vers le temps
3° Vers le temps
Nous pensons – et c’est le thème fondamental de la conception du temps qui dirige ces recherches – que le temps ne traduit pas l’insuffisance de la relation avec l’être qui s’accomplit dans le présent, mais qu’il est appelé à remédier à l’excès du contact définitif qu’accomplit l’instant. La durée sur un autre plan que celui de l’être – mais sans détruire l’être – résout le tragique de l’être. Mais si le développement de ce thème dépasse les limites que se pose la présente étude, nous ne pouvons pas nous empêcher d’esquisser, ne fût-ce que très sommairement, la perspective où se situent les thèmes sur le « je » et le « présent » que nous venons de poser.
a) Le « moi » comme substance et le savoir
Dans le courant de la conscience qui constitue notre vie dans le monde, le moi se maintient comme quelque chose d’identique à travers la multiplicité changeante du devenir. Quelles que soient les traces que la vie nous imprime en modifiant nos habitudes et notre caractère, en changeant constamment l’ensemble des contenus qui forment notre être, un invariable demeure. Le « je » reste là pour relier l’un à l’autre les fils multicolores de notre existence.
Que signifie cette identité ? Nous sommes portés à la considérer comme l’identité d’une substance. Le « je » serait un point indestructible, dont émanent actes et pensées sans l’affecter par leurs variations et leur multiplicité. Mais la multiplicité des accidents peut-elle ne pas affecter l’identité de la substance ? Les relations de la substance avec les accidents sont autant de modifications de cette substance, et dès lors l’idée de substance apparaît dans une régression à l’infini. C’est alors que la notion du savoir permet de maintenir l’identité de la substance sous la variation des accidents. Le savoir est une relation avec ce qui, par excellence, demeure extérieur, la relation avec ce qui reste en dehors de toute relation, un acte qui maintient l’agent en dehors des événements qu’il accomplit. L’idée du savoir – relation et acte hors rang – permet de fixer l’identité du « je », de le garder enfermé dans son secret. Il se maintient sous les variations de l’histoire qui l’affecte en tant qu’objet, sans l’affecter dans son être. Le « je » est donc identique parce qu’il est conscience. La substance par excellence, c’est le sujet. Le savoir est le secret de sa liberté à l’égard de tout ce qui lui arrive. Et sa liberté garantit son identité. C’est grâce à la liberté du savoir que le « je » peut demeurer comme une substance sous les accidents de son histoire. La liberté du « je », c’est sa substantialité ; elle n’est qu’un autre mot pour le fait que la substance n’est pas engagée dans la variation de ses accidents. Loin de dépasser la conception substantialiste du moi, l’idéalisme la préconise sous une forme radicale. Le je n’est pas une substance douée de pensée ; il est substance parce qu’il est doué de pensée.
b) Le « moi » comme identification et enchaînement à soi
Mais l’interprétation idéaliste de l’identité du « je » utilise l’idée logique de l’identité, détachée de l’événement ontologique de l’identification d’un existant. L’identité, en effet, est le propre non point du verbe être, mais de ce qui est ; d’un nom qui s’est détaché du bruissement anonyme de l’il y a. L’identification est précisément la position même d’un étant au sein de l’être anonyme et envahissant. On ne peut donc pas définir le sujet par l’identité, puisque l’identité recèle l’événement de l’identification du sujet.
Cet événement ne se produit pas en l’air ; nous avons montré qu’il est l’œuvre de la position et la fonction même du présent qui dans le temps – à partir duquel on l’aborde habituellement, – est la négation ou l’ignorance du temps, pure référence à soi, hypostase. En tant que référence à soi dans un présent, le sujet identique est certes libre à l’égard du passé et de l’avenir, mais reste tributaire de lui-même. La liberté du présent n’est pas légère comme la grâce, mais une pesanteur et une responsabilité. Elle s’articule dans un enchaînement positif à soi : le moi est irrémissiblement soi.
Considérer la relation entre moi et soi comme constituant la fatalité de l’hypostase, ce n’est pas faire undrame d’une tautologie. Être moi comporte un enchaînement à soi, une impossibilité de s’en défaire. Le sujet recule certes par rapport à soi, mais ce mouvement de recul n’est pas la libération. C’est comme si on avait donné de la corde à un prisonnier sans le détacher.
L’enchaînement à soi, c’est l’impossibilité de se défaire de soi-même. Non seulement enchaînement à uncaractère, à des instincts, mais une association silencieuse avec soi-même où une dualité est perceptible. Être moi, ce n’est pas seulement être pour soi, c’est aussi être avec soi. Quand Oreste dit : « … Et de moi-même me sauver tous les jours », ou quand Andromaque se plaint : « Captive, toujours triste, importune à moi-même », le rapport avec soi que disent ces paroles, dépasse la signification de métaphores. Elles n’expriment pas l’opposition dans l’âme de deux facultés : volonté et passion, raison et sentiment. Chacune de ces facultés enferme le moi tout entier. Tout Racine est là. Le personnage cornélien est déjà maître de lui-même comme de l’univers. Il est héros. Sa dualité est surmontée par le mythe auquel il se conforme : honneur ou vertu. Le conflit est en dehors de lui, il y participe par le choix qu’il fera. Chez Racine, le voile du mythe se déchire. Le héros est débordé par lui-même. C’est là son tragique : le sujet est à partir de soi et déjà avec ou contre soi. Tout en étant liberté et commencement, il est porteur d’un destin qui domine déjà cette liberté même. Rien n’est gratuit. La solitude du sujet est plus qu’un isolement d’un être, l’unité d’un objet. C’est, si l’on peut dire, une solitude à deux ; cet autre que moi court comme une ombre accompagnant le moi. Dualité de l’ennui distincte de la socialité que nous connaissons dans le monde et vers laquelle le moi fuit son ennui ; distincte aussi du rapport avec autrui qui détache le moi de son soi. Dualité qui éveille la nostalgie de l’évasion, mais qu’aucun ciel inconnu, aucune terre nouvelle n’arrivent à satisfaire, car dans nos voyages nous nous emportons.
c) La pensée d’une liberté et le temps
Mais pour que cette charge et ce poids soient possibles en tant que charge, il faut que le présent soit aussi la conception d’une liberté. Conception et non point la liberté même. On ne peut pas tirer de l’expérience de la servitude la preuve de son contraire. La pensée d’une liberté suffirait pour en rendre compte, pensée qui, par elle-même, impuissante sur l’être, montre ce que l’expression « l’acte de la pensée » comporte de métaphore. La pensée ou l’espoir de la liberté expliquent le désespoir qui caractérise dans le présent l’engagement dans l’existence. Elle est faite du scintillement même de la subjectivité qui se retire de son engagement sans le détruire. C’est cela la pensée de la liberté qui n’est que pensée : le recours au sommeil, à l’inconscience, fugue et non pas évasion ; divorce illusoire entre moi et soi qui finira par une reprise de l’existence en commun ; liberté qui ne suppose pas un néant où elle se jette, qui n’est pas comme chez Heidegger un événement de néantissement, mais qui se fait dans le « plein » même de l’être par la situation ontologique du sujet. Mais, espoir seulement de la liberté et non point liberté à l’égard de l’engagement, cette pensée frappe dans les portes fermées d’une autre dimension : elle pressent un mode d’existence où rien n’est définitif et qui tranche sur la subjectivité définitive du « je ». Nous venons de désigner l’ordre du temps.
La distinction établie entre la libération et la simple pensée d’une libération interdit toute déduction dialectique du temps à partir du présent. L’espoir d’un ordre où l’enchaînement à soi du présent puisse se dénouer, ne force pas encore ce dénouement. Il n’y a aucun exorcisme dialectique dans le fait que le « je » conçoit une liberté. Il ne suffit pas de concevoir un espoir, pour déclencher un avenir.
d) Temps de la rédemption et temps de la justice
Mais impuissant de le déclencher, dans quel sens l’espoir vise-t-il le temps ? Tourné vers l’avenir, est-il l’attente des événements heureux qui peuvent s’y produire ? Mais l’attente d’événements heureux n’est pas par elle-même espoir. L’événement peut apparaître comme possible, en vertu des raisons positivement perceptibles dans le présent et alors, on attend avec plus ou moins de certitude un événement qui ne comporte d’espoir que dans la mesure où il est incertain. Ce qui fait l’acuité de l’espoir, c’est la gravité de l’instant où il s’accomplit. L’irréparable est son atmosphère naturelle. L’espoir n’est espoir que quand il n’est plus permis. Or ce qui est irréparable dans l’instant d’espoir, c’est son présent même. L’avenir peut apporter une consolation ou une compensation à un sujet qui souffre dans le présent, mais la souffrance même du présent reste comme un cri dont l’écho retentira à jamais dans l’éternité des espaces. Il en est du moins ainsi dans la conception du temps calquée sur notre vie dans le monde et que nous appelons, pour les raisons que l’on verra, le temps de l’économie.
En effet, dans le monde, le temps lui-même est donné. L’effort du présent s’allège du poids du présent. Il porte en lui l’écho du désir et les objets lui sont donnés « pour la peine ». Ils ne détendent pas la torsion de l’instant sur lui-même, ils l’indemnisent. La peine est vidée de ses exigences profondes. Le monde est la possibilité du salaire. Dans la sincérité de l’intention qui exclut toute équivoque, le moi est naïf. Il se désintéresse du définitif attachement à soi. Le temps, dans le monde, sèche toutes les larmes, il est l’oubli de cet instant impardonné et de cette peine que rien ne saurait compenser. Toutes les implications du moi, toutes ses inquiétudes de soi, toute la mascarade où son visage n’arrive pas à se dépouiller de masques, perdent de l’importance.
L’alternance d’efforts et de loisirs où nous jouissons du fruit des efforts constitue le temps même du monde. Il est monotone car ses instants se valent. Il va vers un dimanche, pur loisir où le monde est donné. Le dimanche ne sanctifie pas la semaine, mais la compense. La situation, ou l’engagement dans l’existence qu’est l’effort, se refoule, se compense et s’amortit, au lieu d’être réparé dans son présent même : c’est l’activité économique.
Dès lors, le monde économique n’embrasse pas seulement notre vie dite matérielle, mais toutes les formes de notre existence où l’exigence du salut avait été marchandée, où Esaü a déjà vendu son droit d’aînesse. Le monde, c’est le monde laïque où le « je » accepte le salaire. La vie religieuse elle-même, quand elle se comprend dans cette catégorie du salaire, est économique. L’outil sert cette aspiration à l’objet comme à un salaire. Il n’a rien à faire avec l’ontologie, il se subordonne au désir. Il ne supprime pas seulement l’inconfortable effort, mais le temps d’attente. Dans la civilisation moderne, il ne prolonge pas seulement la main pour lui permettre d’atteindre ce qu’elle n’atteint pas ; il permet de l’atteindre plus vite, c’est-à-dire supprime dans l’acte le temps que l’acte est appelé à assumer. L’outil supprime les temps intermédiaires, il ramasse la durée. Les outils modernes sont des machines, c’est-à-dire des systèmes, des agencements, des ensembles, des coordinations : installations d’éclairage, téléphones automatiques, coordination du rail et de la route. La multiplicité d’organes est le trait essentiel de la machine. Elle résume les instants. Elle fait de la vitesse, elle fait écho à l’impatience du désir.
Mais ce temps de la compensation ne suffit pas à l’espoir. Il ne lui suffit pas que la larme soit essuyée ou la mort vengée ; aucune larme ne doit se perdre, aucune mort se passer de résurrection. L’espoir ne se contente donc pas d’un temps composé d’instants séparés, donnés à un moi qui les parcourt pour recueillir dans l’instant suivant, aussi impersonnel que le premier, le salaire de sa peine. L’objet véritable de l’espoir, c’est le Messie ou le salut.
La caresse du consolateur qui effleure dans la douleur ne promet pas la fin de la souffrance, n’annonce pas de compensation, ne concerne pas, dans son contact, l’après du temps économique ; elle a trait à l’instant même de la douleur qui alors n’est plus condamné à lui-même, qui entraîné « ailleurs » par le mouvement de la caresse, se libère de l’étau du « soi-même », se trouve de « l’air frais », une dimension et un avenir. Ou, plutôt, elle annonce plus qu’un simple avenir, elle annonce un avenir où le présent bénéficiera d’un rappel. Cet effet de la compassion, des plus connus, est habituellement posé comme le fait premier de la psychologie, par lui on explique. En fait, il est infiniment mystérieux.
La peine ne se rachète pas. Comme le bonheur de l’humanité ne justifie pas le malheur de l’individu, la rétribution dans l’avenir n’épuise pas les peines du présent. Il n’y a pas de justice qui puisse la réparer. Il faudrait pouvoir revenir à cet instant ou pouvoir le ressusciter. Espérer, c’est donc espérer la réparation de l’irréparable, c’est donc espérer pour le présent. On pense généralement que cette réparation est impossible dans le temps et que l’éternité seule, où les instants distincts dans le temps sont indiscernables, est le lieu du salut. Et ce recours à l’éternité qui ne nous semble pas indispensable, témoigne du moins de l’exigence impossible du salut qui doit concerner l’instant même de la douleur et non seulement donner compensation. L’essence du temps ne consiste-t-elle pas à répondre à cette exigence du salut ? L’analyse du temps économique, extérieur au sujet. n’escamotet-elle pas la structure essentielle du temps par laquelle le présent n’est pas seulement indemnisé mais ressuscité ? L’avenir n’est-il pas avant tout une résurrection du présent ?
e) Le « je » et le temps
Nous pensons que le temps est précisément cela. Ce qu’on appelle « l’instant suivant » est résiliation de l’engagement irrésiliable de l’existence fixée dans l’instant, la résurrection du « je ». Nous pensons que dans l’instant suivant, le « je » n’entre pas identique et impardonné – simple avatar – pour faire une nouvelle expérience dont la nouveauté ne le débarrasse pas de son enchaînement à soi ; mais que sa mort dans l’intervalle vide aura été la condition d’une nouvelle naissance et que l’« ailleurs » qui s’ouvre à lui ne sera pas seulement un « dépaysement » mais un « ailleurs qu’en soi », sans qu’il s’abîme, pour autant, dans l’impersonnel ou l’éternel. Le temps n’est pas une succession des instants défilant devant un je, mais la réponse à l’espoir pour le présent que, dans le présent, exprime précisément le « je » équivalent au présent. Toute l’acuité de l’espoir dans le désespoir tient à l’exigence du rachat de l’instant même du désespoir. C’est de l’espoir pour le présent qu’il convient de partir comme d’un fait premier pour comprendre le mystère de l’œuvre du temps. L’espoir espère pour le présent même. Le martyre ne s’en va pas dans le passé pour nous laisser un droit à un salaire. Au moment même où tout est perdu, tout est possible.
En résumé, il ne s’agit pas de contester le temps de notre existence concrète, constitué par une série d’instants par rapport à laquelle le « je » est extérieur. Tel est en effet le temps de la vie économique où les instants se valent et à travers lesquels le « je » circule, pour en assurer la liaison. Le temps y est le renouvellement du sujet, mais ce renouvellement ne chasse pas l’ennui. Il ne débarrasse pas le moi de son ombre. Il s’agit de se demander si l’événement du temps ne peut pas être vécu plus profondément comme la résurrection del’irremplaçable instant. À la place du « je » qui circule dans le temps, nous posons le « je » comme le ferment même du temps dans le présent, le dynamisme du temps. Non pas celui de la progression dialectique, ni celui de l’extase, ni celui de la durée où le présent empiète sur l’avenir et par conséquent n’a pas entre son être et sa résurrection l’intervalle du néant indispensable. Le dynamisme du « je » réside dans la présence même du présent, dans l’exigence que cette présence implique. Exigence qui ne concerne pas la persévérance dans l’être, ni, à proprement parler, la destruction impossible de cette présence, mais le dénouement du nœud qui se noue en elle : le définitif que son évanescence ne dénoue pas. Exigence d’un recommencement d’être et espoir dans chaque recommencement de son non-définitif. Le « je » n’est pas l’être qui, résidu d’un instant passé, tente un instant nouveau. Il est cette exigence du non-définitif. La « personnalité » de l’être est son besoin même du temps comme d’une fécondité miraculeuse dans l’instant lui-même par lequel il recommence comme autre.
Mais cette altérité, il ne peut pas se la donner. L’impossibilité de constituer le temps dialectiquement est l’impossibilité de se sauver par soi-même et de se sauver tout seul. Le « je » n’est pas indépendant de son présent, ne peut parcourir seul le temps, trouver sa récompense en niant simplement le présent. En situant le tragique humain dans le définitif du présent, en posant la fonction du je comme inséparable de ce tragique, nous ne trouvons pas au sujet les moyens de son salut. Il ne peut venir que d’ailleurs, quand tout dans le sujet est ici.
f) Le temps et l’Autre
Comment en effet le temps surgirait-il dans un sujet seul ? Le sujet seul ne peut se nier, n’a pas le néant. L’altérité absolue de l’autre instant – si toutefois le temps n’est pas l’illusion d’un piétinement – ne peut pas se trouver dans le sujet qui est définitivement lui-même. Cette altérité ne me vient que d’autrui. La socialité n’estelle pas, mieux que la source de notre représentation du temps, le temps lui-même ? Si le temps est constitué par ma relation avec autrui, il est extérieur à mon instant, mais il est aussi autre chose qu’un objet donné à la contemplation. La dialectique du temps est la dialectique même de la relation avec autrui, c’est-à-dire un dialogue qui doit à son tour être étudié en des termes autres que ceux de la dialectique du sujet seul. La dialectique de la relation sociale nous fournira un enchaînement de concepts d’un type nouveau. Et le néant nécessaire au temps – dont le sujet est incapable – vient de la relation sociale.
La philosophie traditionnelle – Bergson et Heidegger y compris – demeurait dans la conception d’un temps, soit purement extérieur au sujet, d’un temps objet, soit entièrement contenu dans le sujet. Mais il était toujours question d’un sujet seul. Le moi tout seul – le monade – avait déjà un temps. Le renouvellement qu’apporte le temps se présentait à la philosophie classique comme un événement dont il peut être rendu compte par le monade : la négation. C’est dans l’indétermination du néant auquel aboutit l’instant qui se nie à l’approche de l’instant nouveau, que le sujet puisait sa liberté. La philosophie classique passait à côté de la liberté qui ne consiste pas à se nier, mais à se faire pardonner son être, par l’altérité même d’autrui. Elle sous-estimait dans le dialogue par lequel autrui nous délivre, l’altérité d’autrui, puisqu’elle pensait qu’il existe un dialogue silencieux de l’âme avec elle-même. C’est à la mise en valeur des termes originaux dans lesquels il faut penser le dialogue qu’est subordonné en fin de compte le problème du temps.
g) Avec l’Autre et en face de l’Autre
La relation sociale n’est pas initialement une relation avec ce qui dépasse l’individu, avec quelque chose de plus que la somme des individus et supérieure à l’individu, au sens durkheimien. La catégorie de la quantité, ni même celle de la qualité ne décrit pas l’altérité de l’autre qui n’est pas simplement d’une autre qualité que moi, mais qui porte, si l’on peut dire l’altérité comme qualité. Encore moins le social consiste-t-il dans l’imitation du semblable. Dans ces deux conceptions la sociabilité est cherchée comme un idéal de fusion. On pense que ma relation avec l’autre tend à m’identifier à lui en m’abîmant dans la représentation collective, dans un idéal commun ou dans un geste commun. C’est la collectivité qui dit « nous », qui sent l’autre à côté de soi et non pas en face de soi. C’est aussi la collectivité qui s’établit nécessairement autour d’un troisième terme qui sert d’intermédiaire, qui fournit le commun de la communion. Le Miteinandersein heideggerien demeure aussi la collectivité de l’avec, et c’est autour de la « vérité » qu’il se révèle dans sa forme authentique. Il est collectivité autour de quelque chose de commun. Aussi comme dans toutes les philosophies de la communion, la socialité chez Heidegger se retrouve tout entière dans le sujet seul et c’est en terme de solitude que se poursuit l’analyse du Dasein, dans sa forme authentique.
À cette collectivité de camarades, nous opposons la collectivité du moi-toi qui la précède. Elle n’est pas une participation à un troisième terme – personne intermédiaire, vérité, dogme, œuvre, profession, intérêt, habitation, repas – c’est-à-dire elle n’est pas une communion. Elle est le face-à-face redoutable d’une relation sans intermédiaire, sans médiation. Dès lors l’interpersonnel n’est pas la relation en soi indifférente et réciproque de deux termes interchangeables. Autrui, en tant qu’autrui, n’est pas seulement un alter ego. Il est ce que moi je ne suis pas : il est le faible alors que moi je suis le fort ; il est le pauvre, il est « la veuve et l’orphelin ». Il n’y a pas de plus grande hypocrisie que celle qui a inventé la charité bien ordonnée. Ou bien il est l’étranger, l’ennemi, le puissant. L’essentiel, c’est qu’il a ces qualités de par son altérité même. L’espace intersubjectif est initialement asymétrique. L’extériorité d’autrui n’est pas simplement l’effet de l’espace qui maintient séparé ce qui, par le concept, est identique, ni une différence quelconque selon le concept qui se manifesterait par une extériorité spatiale. C’est précisément en tant qu’irréductible à ces deux notions d’extériorité, que l’extériorité sociale est originale et nous fait sortir des catégories d’unité et de multiplicité qui valent pour les choses, c’est-à-dire valent dans le monde d’un sujet isolé, d’un esprit seul. L’intersubjectivité n’est pas simplement l’application de la catégorie de la multiplicité au domaine de l’esprit. Elle nous est fournie par l’Éros, où, dans la proximité d’autrui, est intégralement maintenue la distance dont le pathétique est fait, à la fois, de cette proximité et de cette dualité des êtres. Ce qu’on présente comme l’échec de la communication dans l’amour, constitue précisément la positivité de la relation ; cette absence de l’autre est précisément sa présence comme autre. L’autre, c’est le prochain – mais la proximité n’est pas une dégradation ou une étape de la fusion. Dans la réciprocité des rapports, caractéristique de la civilisation, l’asymétrie de la relation intersubjective s’oublie. La réciprocité de la civilisation – le règne des fins où chacun est à la fois fin et moyen, personne et personnel1, est un nivellement de l’idée de fraternité, qui est un aboutissement et non point un point de départ et qui renvoie à toutes les implications de l’éros. Il faut, en effet, pour se poser dans la fraternité et pour être soi-même le pauvre, le faible et le pitoyable, l’intermédiaire du père, – et il faut pour postuler le père – qui n’est pas simplement une cause ou un genre – l’hétérogénéité de moi et d’autrui. Cette hétérogénéité et cette relation entre les genres à partir desquels la société et le temps doivent être compris – nous amènent au seuil d’un autre ouvrage. Au cosmos qui est le monde de Platon s’oppose le monde de l’esprit, où les implications de l’éros ne se réduisent pas à la logique du genre, où le moi se substitue au même et autrui à l’autre. L’originalité de la contrariété et de la contradiction de l’éros a échappé à Heidegger, qui, dans ses cours, tend à présenter la différence des sexes comme une spécification d’un genre. C’est dans l’éros que la transcendance peut être pensée d’une manière radicale, apporter au moi pris dans l’être, retournant fatalement à soi, autre chose que ce retour, le débarrasser de son ombre. Dire simplement que le moi sort de lui-même est une contradiction, puisque, en sortant de soi, le moi s’emporte, à moins qu’il ne s’abîme dans l’impersonnel. L’intersubjectivité asymétrique est le lieu d’une transcendance où le sujet, tout en conservant sa structure de sujet, a la possibilité de ne pas retourner fatalement à lui-même, d’être fécond et, disons le mot en anticipant – d’avoir un fils.
1. Dans le livre de Maurice BLANCHOT : Aminadab, la description de cette situation de réciprocité est poussée jusqu’à la perte d’identité personnelle.