| index | précédent | suivant |
|---|
03 - Le savant et le politique
Episode 2 : ce cynique que l'on entend trop
| Judéo-christianisme | le gouffre de la transcendance | Diogène et Alexandre | le rêve de César | apparentements terribles |
|---|
On connaît tous - quel enseignant d'histoire de littérature ou de philosophie ne nous l'aura pas eu répété à satiété ? - l'épisode de ce Diogène, philosophe cynique, qui d'un trait méprisant repousse les avances d'un Alexandre au sommet de sa gloire d'un Ecarte-toi de mon soleil ! dont les lointains échos résonnent encore comme le triomphe - en forme de revanche de la sagesse, philosophie et plus généralement de la connaissance sur le pouvoir. De la pensée sur l'action. De l'être sur l'avoir. De la prudence sur la démesure. Comme si le pouvoir et la gloire du siècle empêchaient d'atteindre l'être en sa vérité.
Il faut dire que tout y est, en cette rencontre rapportée par Plutarque notamment, pour ériger cette anecdote en une allégorie édificatrice : les protagonistes opposés à l'extrême : le riche, guerrier puissant, monarque ayant circonvenu tout antagonisme et triomphé de toutes manœuvres, au sommet de sa gloire, ivre de réussite, toujours entre deux conquêtes mais assurément sans repos jamais, d'un côté ; le philosophe de l'autre, sale, nu, s'étant dépouillé de tout ou presque, vivant d'expédients au milieu des ordures et dont les seuls hauts faits demeurent quelques saillies méprisantes ou apophtegmes sibyllins que notent avec gourmandise les chroniqueurs avides de laisser retomber sur eux quelque scorie de sa grandeur.
Le premier généreux, empressé de le rencontrer ; prompt à satisfaire les demandes que le sage serait amené à formuler. Le second, bravache, un brin effronté, provocateur en tout cas, refusant tout et d'abord le dialogue - ce qui est un comble pour un philosophe. Ne lui faisant pas même la grâce d'une sentence. Lui demandant seulement de s'écarter.
Une fin de non recevoir.
La chose, pourtant, est loin d'être si simple.
Ceci, d'abord, que glissa Alexandre après l'entrevue à son entourage de généraux et courtisans qui s'en moquèrent :
« Pour moi, leur dit ce prince, si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Plutarque
A bien lire le portrait qu'en brosse Plutarque, le monarque est ivre moins de pouvoir que de compétition et l'aura été très jeune. Combattre pour être le premier : dans l'exercice du pouvoir mais aussi dans les activités physiques voire intellectuelles ou artistiques. Etre le meilleur, être devant ! Alexandre en vérité est la représentation même de cette démesure qui faisait tellement peur aux grecs. L'ivresse du pouvoir, la mégalomanie c'est l'obsession d'être avant tout et tous, celui qui commence absolument une série, d'être la cause première.
Diogène, quant à lui, qui ne porte sans doute pas tout-à-fait par hasard ce nom - engendré par le divin - est sans doute figure plus trouble qu'il n'y parait. L'anecdote rapportée de l'écuelle montre bien que Diogène s'était lui-même engagé dans un combat où dans ses rapports avec les dieux il lui importait d'être le premier - celui qui ne laisserait aucun objet, aucun outil, aucun truchement s'interposer entre lui et les dieux. Je suis battu, s'écrie-t-il, voyant le jeune enfant ! C'est un aveu.
La légende d'une confrontation entre la démesure et la prudence, la folie et la sagesse était donc bien un leurre ; ce fut donc seulement d'un autre combat dont il s'était agi où pouvoir et connaissance n'auront été que prétextes pour étancher orgueil inassouvi !
La question est donc ailleurs. Non pas dans la confrontation entre le savant et le politique mais au contraire dans la perpétuelle fascination que l'un exerce sur l'autre - pour ne pas dire leur fascination respective.
On le comprendra d'autant mieux qu'on reliera le Je suis battu de Diogène à cette remarque, joliment cruelle, consignée dans son Journal
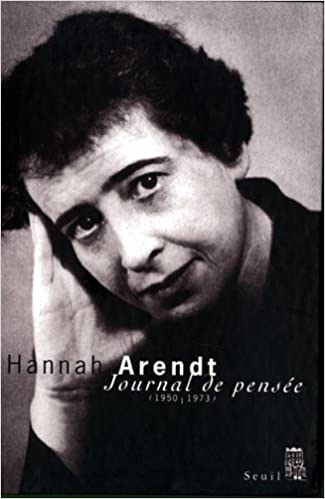 L’affinité entre le philosophe et le tyran depuis Platon : quelle naïveté de l’expliquer par le manque de temps du philosophe (Kojeve dans Critique) ! La logique occidentale, qui passe pour la pensée et la raison, est tyrannique par définition. Contre l'immuabilité des lois de la logique, il n’est aucune liberté ; si la politique est une affaire qui concerne l’homme et la constitution raisonnable, seule la tyrannie peut produire une bonne politique – La question est : Existe-t-il une pensée qui ne soit pas tyrannique ? Tel est proprement ce en quoi consiste tout l'effort de Jaspers, même s!il n'en est pas entièrement conscient. Car la communication, contrairement à la discussion - à la pensée « qui plaide » - ne tient pas à s'assurer de la vérité au moyen de la supériorité du raisonnement. Arendt, note 20, décembre 1950, journal de pensée, I, p 60
L’affinité entre le philosophe et le tyran depuis Platon : quelle naïveté de l’expliquer par le manque de temps du philosophe (Kojeve dans Critique) ! La logique occidentale, qui passe pour la pensée et la raison, est tyrannique par définition. Contre l'immuabilité des lois de la logique, il n’est aucune liberté ; si la politique est une affaire qui concerne l’homme et la constitution raisonnable, seule la tyrannie peut produire une bonne politique – La question est : Existe-t-il une pensée qui ne soit pas tyrannique ? Tel est proprement ce en quoi consiste tout l'effort de Jaspers, même s!il n'en est pas entièrement conscient. Car la communication, contrairement à la discussion - à la pensée « qui plaide » - ne tient pas à s'assurer de la vérité au moyen de la supériorité du raisonnement. Arendt, note 20, décembre 1950, journal de pensée, I, p 60
Comment ne pas se rappeler que penser c'est d'abord classer, ranger, mettre en ordre ; refuser tout aléatoire et ramer à des formes déjà connues. A réduire, car tel est le mot exact, la diversité infinie du monde à un nombre limité de déterminismes - toujours les mêmes - la diversité des choses et des idées à un nombre limité de mots.
Le risque de la tyrannie n'est certainement pas une raison pour ne pas tenter l'aventure de la pensée mais il est suffisant pour balayer l'ironie nietzschéenne : la pensée n'est pas une fuite ; elle menace sans cesse d'être emprise sur le monde. Ce qu'appréhender, concevoir, saisir, comprendre, cerner un problème, maîtriser un sujet voire contempler ou encore epistémè ἐπιστήμη en leurs étymologies attestent.
Comte a dit le maître-mot en affirmant qu'il n'y avait pas de liberté de conscience en physique : le but avoué est bien de produire une connaissance soigneusement argumentée, prouvée et vérifiée en sorte qu'elle ne laisse plus aucun doute, devienne évidente au sens de Descartes et ne supporte plus aucune contestation.
Freud a suggéré l'essentiel en justifiant l'hypothèse de l'Inconscient (Métapsychologie) comme nécessaire et légitime : légitime, dès lors qu'une hypothèse vient combler un vide et permet d'expliquer des phénomènes autrement inexplicables ; nécessaire parce qu'elle permet une thérapie - donc une action.
Tout est dit qui marque effectivement la logique occidentale - tout du moins classique pour quoi il n'y a pas de désordre. Le désordre n'est jamais qu'un ordre non encore dévoilé, élucidé. N'est donc qu'une apparence. Quand tout, dans les sciences modernes, depuis la mécanique ondulatoire, la théorie de la relativité, des quanta et alii, signale plutôt le contraire et rejoint en fin de compte la perception grecque : l'ordre repose sur un fond irrépressible de désordre dont il n'est qu'une exception fragile et passagère.
La tyrannie réside ici, en cette logique qui parait bien être celle d'un Procuste : faire rentrer dans les cases c'est ramener à l'ordre ; n'accepter aucun écart, différence, exception. Cette tyrannie c'est celle qui poussa un Cioran au scepticisme radical et me fait considérer comme une bénédiction que nous n'arrivions nulle part ni jamais à un savoir définitif qui serait effectivement la biffure extrême de la liberté. Hume l'avait deviné qui considérait que nous n'étions jamais tolérants que par conscience de ne pas posséder de savoir définitif … une tolérance qui s'avère bien n'être qu'une valeur par défaut … faute de mieux. Quel détenteur de vérité n'aimerait pas la partager de gré - par le débat, la preuve - ou de force - par l'éducation voire la rééducation.
Dès lors entre le Prince et le philosophe, entre le pouvoir et le savoir, contrairement aux apparences il réside peut-être moins d'opposition que de voisinage, moins de conflits que de discret cousinage. Les deux veulent être les premiers, ériger en ordre ce qui leur tient à cœur. Comment comprendre autrement qu'ordre vise autant le commandement que l'organisation.
C'est autour de l'ordre que ces deux-là tournent, manœuvrent. L'ordre leur est circonstance.
Il n'est pas certain que le philosophe veuille le pouvoir, en tout cas l'exercer directement. Mais qu'il accourt vite sitôt que le despote l'appelle : Voltaire à Berlin ; Diderot à St Petersbourg. Il se voit bien en conseiller occulte, éminence grise ou écarlate. Mais on peut l'y contraindre : Platon l'évoque. Mais il ne rechigne pas à l'occasion de s'engager et même quand il ne le fait pas, son silence pèse. Il n'est pas évident que le despote veuille toujours contrefaire le penseur mais il ne déteste pas le faire croire ou - a minima - les flatter. En réalité ils sont pris dans la même spirale mimétique : n'écoutons pas les diatribes que souvent ils s'adressent l"un à l'autre : elles ne valent que pour la parade.
On pourra toujours se réfugier dans un irénisme béat ou seulement satisfait, penser est un acte. Même si l'opinion croit l'honorer en la flattant, et que l'intéressé, réfugié en son antre, désert, librairie ou poêle, se targuerait un peu trop aisément d'échapper à toute tentation, erreur et démesure, nonobstant il se fait d'autant mieux impérial qu'il se drape de neutralité, de preuve, de désintéressement.
Je me souviens encore de la méfiance qu'une partie de ma famille, celle qui avait des origines populaires, ouvrières, aura nourri à mon égard sitôt qu'adolescent j'avais marqué mon goût pour les choses de la pensée, et parfois la détestation quand j'entamai des études de philosophie. L'intellectuel avait mauvaise presse décidément tant pour des raisons sociales que je ne compris pas immédiatement que pour des raisons métaphysiques en tout cas pour ceux qui, parmi eux, avaient gardé de fortes attaches religieuses et craignirent que je n'y perdisse le chemin de la foi.
L'intellectuel ne gagna son titre et ses titres de gloire qu'avec l'Affaire Dreyfus : on le sait c'est à l'occasion d'un manifeste que le terme apparut pour la première fois en tant que substantif. Mais cette gloire ne valut que pour lui. Il n'en demeura pas moins aux yeux de beaucoup ou bien l'indécrottable fauteur de troubles ou bien le courtisan bientôt traître ; en tout cas un inutile beau causeur mais passif ; un boulet dont il fallait bien supporter les maladresses ; anticiper les embardées.
J'entends encore cette méfiance dans ces propos d'Arendt ; dans la certitude où elle fut que depuis Platon le philosophe ne pouvait plus parler du politique comme s'il s'adressait à l'humanité entière comme on peut encore le faire pour les sciences de la nature ; qu'il est dans l'ordre des choses que l'intellectuel, habitué à se former une théorie, une représentation à propos de tout, finisse par se piéger lui-même avec ses propres armes. Qu'il ne fut pas étonnant que Platon préférât le tyran Denys. L'histoire d'entre eux deux commençait mal … ceci allait durer. Oui, nombreux furent ceux qui, intellectuels ou seulement cultivés, se révélèrent, fascinés, admiratifs, bientôt consentants. La rigueur de leur pensée, la sophistication de leurs représentations ne leur évitèrent aucune erreur. J'ai vécu cette douloureuse épreuve de réaliser soudainement que l'arme brillante et infaillible contre l'erreur, la faute, l'horreur et la stupidité était un leurre. Que ni l'intelligence, si difficile à cerner, ni le bon sens tant vanté par nos prédécesseurs, ni la recherche soignée et prudente, encore moins le commerce de la philosophie et des philosophes, non que rien de tout cela ne puisse vous prémunir contre le pire bafouait violemment l'espérance que l'on avait nourri d'avec le philosophie ne pouvoir étoffer notre rapport au monde, l'idéal de pouvoir se mettre au service de l'humain plutôt que de l'instrumentaliser.
Je ne suis pas certain de m'être jamais totalement remis de cette tragique déconvenue même si elle m'aida à comprendre ce que je poursuivais ; ce qui me hantait et que je désirais éviter et épargner aux autres. A comprendre ce que voulait dire : penser. Il m'est arrivé de m'agacer à entendre Nietzsche ridiculiser les intellectuels comme s'ils n'étaient que irrémédiables faibles, patauds, incapables d'affronter la réalité ; préférant se réfugier dans le monde sage des idées … tout simplement parce que le monde des idées n'est ni sage ni quiet. Mais il m'est souvent arrivé de m'attrister en constatant combien mes collègues enseignants réagissaient encore comme les bons élèves qu'ils furent, aussi empressés de se pousser du col pour arriver premier que peu enclin à quitter le banc des écoles où ils se rassuraient si paresseusement. Mais m'agaçait tout autant de constater combien toute l'organisation de l'Université en aggravant la règle de l'évaluation par les pairs, contribuait exagérément à produire des figures narcissiques plus inquiètes de la parution que de la valeur de leurs contributions ; soucieuses de leur classement plus précautionneusement que de l'état du monde.
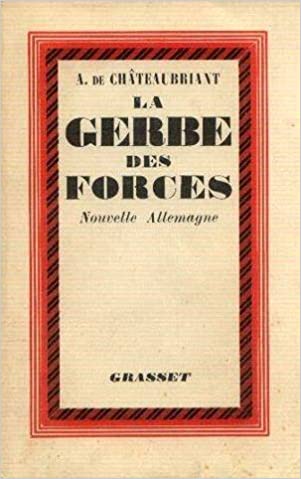
 Comment comprendre un Marc Augier, pourtant de l'aventure des Auberges de la Jeunesses, membre du cabinet de Léo Lagrange en 1936, qui bascule dans la fascination pour le nazisme après avoir lu un texte d'A de Châteaubriant, lui aussi tout émoustillé après un voyage en Allemagne ? Comment comprendre que ces gens, pas si sots que cela, pourtant ou pas plus que leurs contemporains, aient été dupés par propagande de si mauvaise facture ? Comment comprendre qu'un Gide réalisera vite, de retour de Moscou,l'étendue des dégâts, quand d'autres, entêtés de ne rien entendre ou rassurés de ne rien vouloir voir, s'émerveillèrent entre et toujours …même après Budapest ou pire, après Prague ? Comment comprendre Brasillach et tant d'autres ? Comment comprendre que cet aventurier de carnaval ait pu refaire surface après-guerre sans remords, sans aveu, sans vergogne surtout, jurant de la seule fascination pour l'aventure, frôlant de peu l'attribution d'un prix littéraire ? Jouant les intellectuels bravaches et courageux ? Lui porta sa passion irrépressib le pour l'action comme un étendard, une excuse, un sésame vers la grandeur. Comme si agir se justifiait de soi seul !
Comment comprendre un Marc Augier, pourtant de l'aventure des Auberges de la Jeunesses, membre du cabinet de Léo Lagrange en 1936, qui bascule dans la fascination pour le nazisme après avoir lu un texte d'A de Châteaubriant, lui aussi tout émoustillé après un voyage en Allemagne ? Comment comprendre que ces gens, pas si sots que cela, pourtant ou pas plus que leurs contemporains, aient été dupés par propagande de si mauvaise facture ? Comment comprendre qu'un Gide réalisera vite, de retour de Moscou,l'étendue des dégâts, quand d'autres, entêtés de ne rien entendre ou rassurés de ne rien vouloir voir, s'émerveillèrent entre et toujours …même après Budapest ou pire, après Prague ? Comment comprendre Brasillach et tant d'autres ? Comment comprendre que cet aventurier de carnaval ait pu refaire surface après-guerre sans remords, sans aveu, sans vergogne surtout, jurant de la seule fascination pour l'aventure, frôlant de peu l'attribution d'un prix littéraire ? Jouant les intellectuels bravaches et courageux ? Lui porta sa passion irrépressib le pour l'action comme un étendard, une excuse, un sésame vers la grandeur. Comme si agir se justifiait de soi seul !
Serait ce que la pensée comme l'amour rendît aveugle ? que la pensée fût passion ?
 D'aucuns imaginèrent que la raison pût tempérer le tourbillon des passions et canaliser le cours de nos désirs ! Pardi ! cela ne marche pas ; ici d'autant moins que la raison elle-même est pétrie des démesures de la passion. On nous apprit autrefois le jeu fallacieux de l'équilibre et présenta comme summum de sagesse le juste milieu entre ces deux hyperboles de la tentation. Mais ceci ne marche pas non plus et comment ceci se le pourrait-il d'ailleurs tant l'obsession d'être le premier, devant règle action comme pensée ; raison comme pouvoir ?
D'aucuns imaginèrent que la raison pût tempérer le tourbillon des passions et canaliser le cours de nos désirs ! Pardi ! cela ne marche pas ; ici d'autant moins que la raison elle-même est pétrie des démesures de la passion. On nous apprit autrefois le jeu fallacieux de l'équilibre et présenta comme summum de sagesse le juste milieu entre ces deux hyperboles de la tentation. Mais ceci ne marche pas non plus et comment ceci se le pourrait-il d'ailleurs tant l'obsession d'être le premier, devant règle action comme pensée ; raison comme pouvoir ?
Je veux entendre pourquoi tenter signifie à la fois essayer et inciter à la faute, à l'excès : n'est-ce pas parce que l'acte en lui-même pour l'efficacité qu'il cherche incite en lui-même à la démesure, à la surenchère ; à l'hyperbole ? n'est-ce pas parce que la défaillance, ce mal que nous parvenons si difficilement à cerner, au point que nous ne l'imaginons que comme un certain bien ou plutôt un bien mal entendu, en réalité ne serait qu'une manière de penser, un dérapage de l'abstraction ? Nous savons trop combien poussée à son terme l'action est inverse de l'action : combien recroquevillée sur elle-même la pensée est acte débilitant. Le tyran aimera toujours s'adjoindre la science comme étendard de sa politique et justification de sa morale. Le philosophe , quant à lui, ne déteste pas jouer l'important mais si Machiavel qu'il se puisse croire, le plus souvent, il se prend dans ses propres pièges.
Il est, pourtant, deux exemples, d'une rencontre qu'on peut juger frontale, entre l'être de la pensée et l'acte même du pouvoir.
Socrate, d'abord, face au jugement de la Cité qui le condamne pour, dit-on, avoir perverti la jeunesse. Face surtout aux Lois qui se mettent à parler, à lui rappeler combien serait désastreuse pour elles, leurs puissance et légitimité, cette fuite à laquelle ses amis le convient. Il y a la loi ; il y a la vérité. Les deux ne coïncident pas toujours. Mais si Socrate, à l’instar de chacun, doit choisir entre les deux, il ne peut jouer l'une contre l'autre. Fuir serait détruire la Cité ; combattre une injustice, oui, par les moyens de la loi, le débat, la conviction etc.
Ainsi Socrate adopte l'attitude la meilleure, celle, stratégique que Serres aura repérée, qui fait gagner à tout coup : il quitte le monde des choses, du dur, de l'opaque et du résistant pour celui des mots qui font moins mal ou pas du tout, et qu'il maîtrise si bien. Dès lors et à jamais, Socrate l'emporte, héros vertueux en passant au verbe : aux yeux de tous, et de la postérité, c'est lui qui a raison, contre ses accusateurs, contre la Cité, dans cet entre-deux où il est à la fois contre et avec les lois ; désormais au-dessus : méta …
Le Christ ensuite, dans le désert, tenté par le diable. Épisode connu, relaté à la fois par Luc, Marc et Matthieu : confrontation de doubles assurément. On n'eut pas tort de nommer ainsi le diable Antéchrist : il est effectivement l'anti-messager. Lui ne cherche pas à réunir mais à diviser ; à emporter l'emprise sur l'homme à son propre profit.
Or Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint du Jourdain ; et il était conduit par l'Esprit dans le désert,
pendant quarante jours, étant tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là ; et après qu'ils furent achevés, il eut faim.
Et le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Et Jésus lui répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement [mais de toute parole de Dieu].
Et le diable l'ayant élevé, lui montra, en un instant, tous les royaumes de la terre ;
et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes ; parce qu'elle m'a été livrée et que je la donne à qui je veux.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Et Jésus répondant lui dit : [Va-t'en arrière de moi, Satan.] Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Et il le mena à Jérusalem, et le mit sur l'aile du saint lieu, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas.
Car il est écrit : Il donnera ordre à ton sujet à ses anges de te garder,
et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.
Et Jésus répondant lui dit : est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Et le diable ayant achevé toute la tentation, se retira de lui jusqu'à une autre occasion.
Luc, 4,1-13
 Les trois tentations mentionnées dans le texte sont caractéristiques : il s'agit toujours de braver Dieu, soit en faisant passer ses propres besoins avant toute chose, soit en provoquant l'écart aux lois et donc assumer de désobéir, soit enfin en se soumettant à autre que lui et ainsi trahir. Les textes toujours mettent dans la bouche du Christ l'insistance à réaliser la volonté du Père et non pas la sienne propre. Ainsi par exemple : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. (Mt, 26, 30 ) prière répétée trois fois comme le sera d'ailleurs le reniement de Pierre. Le diable, lui, parle de son propre fonds (Jn, 8, 44) il intercepte, interdit - il est l'intermédiaire qui s'érige en finalité, celui qui ne traduit plus, ne transmet plus mais trahit. Comme souvent c'est ce glissement parfois insensible parfois violent qui du moyen fait une fin, d'un intermédiaire fait un destinataire qui révèle la perversion ; le mal. La démesure, la mégalomanie, toujours commence quand on ne sait plus demeurer à sa place : les grecs n'avaient pas tort l'ὕϐρις commence dans l'immodestie.
Les trois tentations mentionnées dans le texte sont caractéristiques : il s'agit toujours de braver Dieu, soit en faisant passer ses propres besoins avant toute chose, soit en provoquant l'écart aux lois et donc assumer de désobéir, soit enfin en se soumettant à autre que lui et ainsi trahir. Les textes toujours mettent dans la bouche du Christ l'insistance à réaliser la volonté du Père et non pas la sienne propre. Ainsi par exemple : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. (Mt, 26, 30 ) prière répétée trois fois comme le sera d'ailleurs le reniement de Pierre. Le diable, lui, parle de son propre fonds (Jn, 8, 44) il intercepte, interdit - il est l'intermédiaire qui s'érige en finalité, celui qui ne traduit plus, ne transmet plus mais trahit. Comme souvent c'est ce glissement parfois insensible parfois violent qui du moyen fait une fin, d'un intermédiaire fait un destinataire qui révèle la perversion ; le mal. La démesure, la mégalomanie, toujours commence quand on ne sait plus demeurer à sa place : les grecs n'avaient pas tort l'ὕϐρις commence dans l'immodestie.
πειρασμὸν : tel est le terme qu'utilise le texte qui, comme en français, désigne à la fois l'épreuve, l'expérience et l'essai de corruption. Tout à fait révélateur en tout cas, dans la racine du terme et de ses variantes, l'idée d'extrémité comme si pousser à l'excès impliquait nécessairement corruption c'est-à-dire perversion.
Il y a quelque chose d'à la fois émouvant et tragique dans ce défi en forme d'esquive : Jésus est en face de son double négatif. Qu'importe le sens que l'on donnera à mal, qu'importe le risque que l'on prendra toujours d'y voir signe d'un dualisme plutôt manichéen (au sens trivial du terme) en réalité le Christ ici affronte le regard, accepte la lutte - au contraire de Socrate, de manière bien plus franche que Diogène. Et c'est le diable qui recule ! Tragique parce que se dessine la révolte absolue, irréversible contre le divin qui n'est finalement que l'attaque frontale, inévitable après la révolte des anges et l'instrumentalisation de l'humain en enjeu de ce défi : émouvant puisque même si, à ce moment, le diable cède, il ne renonce pas à l'idée de l'emporter ; et se dessine l'inimaginable - la défaite du divin - comme si tout ceci n'avait jamais été affaire que de révolution de palais ; de petits coups de forces miteux. L’apocalypse autant que les apocryphes signalent la dimension eschatologique de cette lutte qui ne se terminera qu'à la fin par l'enchaînement du diable. En attendant, de coup en coup, fumeux, miteux ou réussi, il avance ses pions … l'homme.
Le Christ affronte mais la lutte n'est pas physique ; ne relève pas de l'acte. Jésus parle, cite tel ou tel verset, rappelle que la Parole est vivante ; est la seule force qui importe ; la seule puissance vitale.
Non effectivement, Serres n'a pas tort :
Il existe bien une stratégie parasite pour prendre sans rien rendre. Celui qui l'invente se pose en amont de celui qui reste soumis à la bonne chance et à la mauvaise, mais entre l'amont et l'aval, il existe un seuil, comme un seuil de transformation, comme un changement de niveau ou d'ordre des choses. A chaque niveau, le jeu change de règles. Celui qui gagne toujours, celui qui a toujours raison, l'incontournable, ne joue pas au même jeu que celui qui perd et qui gagne, selon. Le jeu de la vérité comporte des risques, il est très important de pouvoir, savoir se tromper. C'est à l'erreur, c'est à la faillite qu'on reconnaît la recherche, c'est à l'erreur qu'on reconnaît la loyauté, c'est à l'erreur qu'on reconnaît la science, plus et mieux, c'est à l'erreur qu'on reconnaît l'humanité. C'est à la vérité constante et sans défaut qu'on reconnaît le diable, ou l'astucieux, ou l'imbécile. Errare humanum est, l'erreur est hominienne. Je revendique le droit à l'erreur, c'est un droit de l'homme. Changez de niveau, vous obtenez des martingales pour gagner à tous les coups. Métalangage, métaphysique.
Oui le Christ joue l'Être plutôt que l'agir ; et donc le λόγος. Ils ne jouent pas le même jeu ni sur le même terrain. Lui est ; l'autre doit faire ses preuves, jouer constamment l'acte, l'épreuve, le défi. Il n'est puissant que par ses conquêtes ; par lui même il n'est rien. Comme pour le Rendez à César, ceci conduit à constater l'incommensurabilité du divin avec tout ce qui n'est pas lui.
Mais ceci aide à comprendre l'impossible de cette rencontre, l'invraisemblable de cette entente. La signification même de la défaillance.
Je n'arrive toujours pas à comprendre - est-ce la candeur de mon imagination ? - que dans la périphérie du divin puisse se fomenter une quelconque révolte. Je sais seulement combien par son existence même elle dégrade déjà l'idée même du divin ; l'offense en tout cas. Mais ce dont je suis certain c'est que le refus de la lutte, voire de la simple confrontation, situe le divin dans une autre logique où précisément il ne peut que gagner.
On pourra toujours - et parfois on le peut - souligner que les puissants, en raison de l'idée qu'ils se font de l'intérêt général, œuvrent pour changer (améliorer ?) le monde, les cités, les rapports entre les hommes. Il n'en demeure pas moins, ombre pesante ou bise pour un instant encore légère, que l'ordre dont ils rêvent est idée qu'ils veulent appliquer, imposer comme si la chose avait eu jamais l'élégance d'obéir à l'idée.
Non décidément ces deux-là - le savant et le politique - ne se rencontreront jamais ; se toiseront tout-au-plus ; tenteront de s'instrumentaliser l'un l'autre, presque toujours : ils se ressemblent trop.
Nous connaissons les deux bornes de cette tyrannie : quand le politique s'est totalement aliéné le savoir ou se fait passer pour scientifique - qui a oublié DIAMAT et le Danube de la pensée ? ; quand le savoir oublie qu'il ne produit que des connaissances partielles et provisoires. Aux deux bornes, entre autoritarisme et totalitarisme …
Entre les deux, nous, qui errons et nous trompons, qui ne prétendons ni sauvez le monde ni tout savoir … cette toute petite chose qu'est l'humain.
A rapprocher du La philosophie est la forme contemporaine de l'impudeur de Camus ( Carnets p 155)
Les Grecs étaient assemblés dans l’isthme, et avaient arrêté, par un décret, qu’ils se joindraient à Alexandre pour faire la guerre aux Perses : il fut nommé chef de l’expédition, et reçut la visite d’une foule d’hommes d’État et de philosophes qui venaient le féliciter du choix des Grecs. Il comptait que Diogène de Sinope[21], qui vivait à Corinthe, en ferait autant. Mais, comme il vit que Diogène ne s’inquiétait nullement de lui, et se tenait tranquillement dans le Cranium[22], il alla lui-même le voir. Diogène était couché au soleil ; et, lorsqu’il vit venir à lui une foule si nombreuse, il se souleva un peu, et fixa ses regards sur Alexandre. Alexandre le salue, et lui demande s’il a besoin de quelque chose : « Oui, répond Diogène ; détourne-toi un peu de mon soleil. » Cette réponse frappa, dit-on, vivement Alexandre ; et le mépris que lui témoignait Diogène lui inspira une haute idée de la grandeur d’âme de cet homme ; et, comme ses officiers, en s’en retournant, se moquaient de Diogène : « Pour moi, dit-il, si je n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène. »
Diogène Laërce sur Diogène
