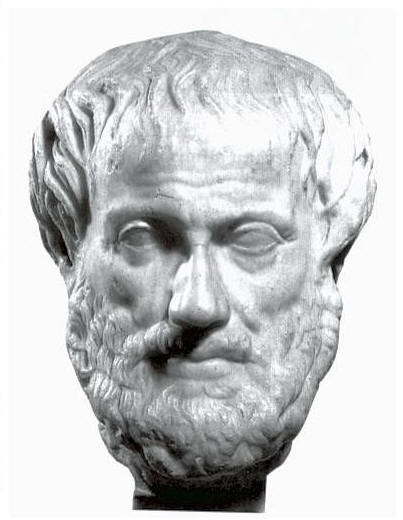 Aristote MÉTAPHYSIQUE
Aristote MÉTAPHYSIQUE
LIVRE I
TRADUCTION : VICTOR COUSIN.
CHAPITRE PREMIER. (retour)
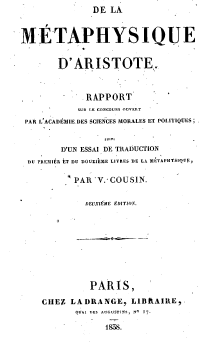 Tous les hommes ont un désir naturel de savoir, comme le témoigne l'ardeur avec laquelle on recherche les connaissances qui s'acquièrent par les sens. On les recherche en effet pour elles-mêmes et indépendamment de leur utilité, surtout celles que nous devons à la vue; car ce n'est pas seulement dans un but pratique, c'est sans vouloir en faire aucun usage, que nous préférons en quelque manière cette sensation à toutes les autres ; cela vient de ce qu'elle nous fait connaître plus d'objets, et nous découvre plus de différences. La nature a donné aux animaux la faculté de sentir : mais chez les uns, la sensation ne produit pas la mémoire, chez les autres, elle la produit; et c'est pour cela que ces derniers sont plus intelligents et plus capables d'apprendre que ceux qui n'ont pas la faculté de se ressouvenir. L'intelligence toute seule, sans la faculté d'apprendre, est le partage de ceux qui ne peuvent entendre les sons, comme les abeilles et les autres animaux de cette espèce; la capacité d'apprendre est propre à tous ceux qui réunissent à la mémoire le sens de l'ouïe. Il y a des espèces qui sont réduites à l'imagination et à la mémoire, et qui sont peu capables d'expérience : mais la race humaine s'élève jusqu'à l'art et jusqu'au raisonnement. C'est la mémoire qui dans l'homme produit l'expérience; car plusieurs ressouvenirs d'une même chose constituent une expérience; aussi l'expérience paraît-elle presque semblable à la science et à l'art; et c'est de l'expérience que l'art' et la science viennent aux hommes; car, comme le dit Polus, et avec raison, c'est l'expérience qui fait l'art, et l'inexpérience le hasard. L'art commence, lorsque, de plusieurs données empruntées à l'expérience, se forme une seule notion générale, qui s'applique à tous les cas analogues. Savoir que Callias étant attaqué de telle maladie, tel remède lui a réussi, ainsi qu'à Socrate; et de même à plusieurs autres pris individuellement, c'est de l'expérience; mais savoir d'une manière générale que tous les individus compris dans une même classe et atteints de telle maladie, de la pituite, par exemple, ou de la bile ou de la fièvre, ont été guéris par le même remède, c'est de l'art. Pour la pratique, l'expérience ne diffère pas de l'art, et même les hommes d'expérience atteignent mieux leur but que ceux qui n'ont que la théorie sans l'expérience; la raison en est que l'expérience est la connaissance du particulier, l'art celle du général, et que tout acte, tout fait tombe sur le particulier; car ce n'est pas l'homme en général que guérit le médecin, mais l'homme particulier, mais Callias ou Socrate, ou tout autre individu semblable, qui se trouve être un homme; si donc quelqu'un possède la théorie sans l'expérience, et connaît le général sans connaître le particulier dont il se compose, celui-là se trompera souvent sur le remède à employer; car ce qu'il s'agit de guérir, c'est l'individu. Cependant on croit que le savoir appartient plus à l'art qu'à l'expérience, et on tient pour plus sages les hommes d'art que les hommes d'expérience; car la sagesse est toujours en raison du savoir. Et il en est ainsi parce que les premiers connaissent la cause, tandis que les seconds ne la connaissent pas; les hommes d'expérience en effet, savent bien qu'une chose est, mais le pourquoi, ils l'ignorent; les autres, au contraire, savent le pourquoi et la cause. Aussi on regarde en toute circonstance les architectes comme supérieurs en considération, en savoir et en sagesse aux simples manoeuvres, parce qu'ils savent la raison de ce qui se fait, tandis qu'il en est de ces derniers comme de ces espèces inanimées qui agissent sans savoir ce quelles font, par exemple, le feu qui brûle sans savoir qu'il brûle. Les êtres insensibles suivent l'impulsion de leur nature; les manoeuvres suivent l'habitude; aussi n'est-ce pas par rapport à la pratique qu'on préfère les architectes aux manoeuvres, mais par rapport à la théorie, et parce qu'ils ont la connaissance des causes. Enfin, ce qui distingue le savant, c'est qu'il peut enseigner; et c'est pourquoi on pense qu'il y a plus de savoir dans l'art que dans l'expérience; car l'homme d'art peut enseigner, l'homme d'expérience ne le peut pas. En outre, on n'attribue la sagesse à aucune des connaissances qui viennent par les sens, quoiqu'ils soient le vrai moyen de connaître les choses particulières ; mais ils ne nous disent le pourquoi de rien ; par exemple, ils ne nous apprennent pas pourquoi le feu est chaud, mais seulement qu'il est chaud. D'après cela, il était naturel que le premier qui trouva, au-dessus des connaissances sensibles, communes à tous, un art quelconque, celui-là fut admiré des hommes, non seulement à cause de l'utilité de ses découvertes, mais aussi comme un sage supérieur au reste des hommes. Les arts s'étant multipliés, et les uns se rapportant aux nécessités, les autres aux agréments de la vie, les inventeurs de ceux-ci ont toujours été estimés plus sages que les inventeurs de ceux-là, parce que leurs découvertes ne se rapportaient pas à des besoins. Ces deux sortes d'arts une fois trouvés, on en découvrit d'autres qui n'avaient plus pour objet ni le plaisir ni la nécessité, et ce fut d'abord dans les pays où les hommes avaient du loisir. Ainsi, c'est en Égypte que les mathématiques se sont formées ; là, en effet, beaucoup de loisir était laissé à la caste des prêtres. Du reste, nous avons dit dans la Morale en quoi diffèrent l'art et la science et les autres degrés de connaissance; ce que nous voulons établir ici, c'est que tout le monde entend par la sagesse à proprement parler la connaissance des premières causes et des principes; de telle sorte que, comme nous l'avons déjà dit, sous le rapport de la sagesse, l'expérience est supérieure à la sensation, l'art à l'expérience, l’architecte au manoeuvre et la théorie à la pratique. Il est clair d'après cela que la sagesse par excellence, la philosophie est la science de certains principes et de certaines causes.
Tous les hommes ont un désir naturel de savoir, comme le témoigne l'ardeur avec laquelle on recherche les connaissances qui s'acquièrent par les sens. On les recherche en effet pour elles-mêmes et indépendamment de leur utilité, surtout celles que nous devons à la vue; car ce n'est pas seulement dans un but pratique, c'est sans vouloir en faire aucun usage, que nous préférons en quelque manière cette sensation à toutes les autres ; cela vient de ce qu'elle nous fait connaître plus d'objets, et nous découvre plus de différences. La nature a donné aux animaux la faculté de sentir : mais chez les uns, la sensation ne produit pas la mémoire, chez les autres, elle la produit; et c'est pour cela que ces derniers sont plus intelligents et plus capables d'apprendre que ceux qui n'ont pas la faculté de se ressouvenir. L'intelligence toute seule, sans la faculté d'apprendre, est le partage de ceux qui ne peuvent entendre les sons, comme les abeilles et les autres animaux de cette espèce; la capacité d'apprendre est propre à tous ceux qui réunissent à la mémoire le sens de l'ouïe. Il y a des espèces qui sont réduites à l'imagination et à la mémoire, et qui sont peu capables d'expérience : mais la race humaine s'élève jusqu'à l'art et jusqu'au raisonnement. C'est la mémoire qui dans l'homme produit l'expérience; car plusieurs ressouvenirs d'une même chose constituent une expérience; aussi l'expérience paraît-elle presque semblable à la science et à l'art; et c'est de l'expérience que l'art' et la science viennent aux hommes; car, comme le dit Polus, et avec raison, c'est l'expérience qui fait l'art, et l'inexpérience le hasard. L'art commence, lorsque, de plusieurs données empruntées à l'expérience, se forme une seule notion générale, qui s'applique à tous les cas analogues. Savoir que Callias étant attaqué de telle maladie, tel remède lui a réussi, ainsi qu'à Socrate; et de même à plusieurs autres pris individuellement, c'est de l'expérience; mais savoir d'une manière générale que tous les individus compris dans une même classe et atteints de telle maladie, de la pituite, par exemple, ou de la bile ou de la fièvre, ont été guéris par le même remède, c'est de l'art. Pour la pratique, l'expérience ne diffère pas de l'art, et même les hommes d'expérience atteignent mieux leur but que ceux qui n'ont que la théorie sans l'expérience; la raison en est que l'expérience est la connaissance du particulier, l'art celle du général, et que tout acte, tout fait tombe sur le particulier; car ce n'est pas l'homme en général que guérit le médecin, mais l'homme particulier, mais Callias ou Socrate, ou tout autre individu semblable, qui se trouve être un homme; si donc quelqu'un possède la théorie sans l'expérience, et connaît le général sans connaître le particulier dont il se compose, celui-là se trompera souvent sur le remède à employer; car ce qu'il s'agit de guérir, c'est l'individu. Cependant on croit que le savoir appartient plus à l'art qu'à l'expérience, et on tient pour plus sages les hommes d'art que les hommes d'expérience; car la sagesse est toujours en raison du savoir. Et il en est ainsi parce que les premiers connaissent la cause, tandis que les seconds ne la connaissent pas; les hommes d'expérience en effet, savent bien qu'une chose est, mais le pourquoi, ils l'ignorent; les autres, au contraire, savent le pourquoi et la cause. Aussi on regarde en toute circonstance les architectes comme supérieurs en considération, en savoir et en sagesse aux simples manoeuvres, parce qu'ils savent la raison de ce qui se fait, tandis qu'il en est de ces derniers comme de ces espèces inanimées qui agissent sans savoir ce quelles font, par exemple, le feu qui brûle sans savoir qu'il brûle. Les êtres insensibles suivent l'impulsion de leur nature; les manoeuvres suivent l'habitude; aussi n'est-ce pas par rapport à la pratique qu'on préfère les architectes aux manoeuvres, mais par rapport à la théorie, et parce qu'ils ont la connaissance des causes. Enfin, ce qui distingue le savant, c'est qu'il peut enseigner; et c'est pourquoi on pense qu'il y a plus de savoir dans l'art que dans l'expérience; car l'homme d'art peut enseigner, l'homme d'expérience ne le peut pas. En outre, on n'attribue la sagesse à aucune des connaissances qui viennent par les sens, quoiqu'ils soient le vrai moyen de connaître les choses particulières ; mais ils ne nous disent le pourquoi de rien ; par exemple, ils ne nous apprennent pas pourquoi le feu est chaud, mais seulement qu'il est chaud. D'après cela, il était naturel que le premier qui trouva, au-dessus des connaissances sensibles, communes à tous, un art quelconque, celui-là fut admiré des hommes, non seulement à cause de l'utilité de ses découvertes, mais aussi comme un sage supérieur au reste des hommes. Les arts s'étant multipliés, et les uns se rapportant aux nécessités, les autres aux agréments de la vie, les inventeurs de ceux-ci ont toujours été estimés plus sages que les inventeurs de ceux-là, parce que leurs découvertes ne se rapportaient pas à des besoins. Ces deux sortes d'arts une fois trouvés, on en découvrit d'autres qui n'avaient plus pour objet ni le plaisir ni la nécessité, et ce fut d'abord dans les pays où les hommes avaient du loisir. Ainsi, c'est en Égypte que les mathématiques se sont formées ; là, en effet, beaucoup de loisir était laissé à la caste des prêtres. Du reste, nous avons dit dans la Morale en quoi diffèrent l'art et la science et les autres degrés de connaissance; ce que nous voulons établir ici, c'est que tout le monde entend par la sagesse à proprement parler la connaissance des premières causes et des principes; de telle sorte que, comme nous l'avons déjà dit, sous le rapport de la sagesse, l'expérience est supérieure à la sensation, l'art à l'expérience, l’architecte au manoeuvre et la théorie à la pratique. Il est clair d'après cela que la sagesse par excellence, la philosophie est la science de certains principes et de certaines causes.
CHAPITRE II (retour)
Puisque telle est la science que nous cherchons, il nous faut examiner de quelles causes et de quels principes s'occupe cette science qui est la philosophie. C'est ce que nous pourrons éclaircir par les diverses manières dont on conçoit généralement le philosophe. On entend d'abord par ce mot l'homme qui sait tout, autant que cela est possible, sans savoir les détails. En. second lieu, on appelle philosophe celui qui peut connaître les choses difficiles et peu accessibles à la connaissance humaine; or les connaissances sensibles étant communes à tous et par conséquent faciles, n'ont rien de philosophique. Ensuite on croit que plus un homme est exact et capable d'enseigner les causes, plus il est philosophe en toute science. En outre, la science qu'on étudie pour elle-même et dans le seul but de savoir, paraît plutôt la philosophie que celle qu'on apprend en vue de ses résultats. Enfin, de deux sciences, celle qui domine l'autre, est plutôt la philosophie que celle qui lui est subordonnée; car le philosophe rie doit pas recevoir des lois, mais en donner; et il ne doit pas obéir à un autre, mais c'est au moins sage à lui obéir.
Telle est la nature et le nombre des idées que nous nous formons de la philosophie et du philosophe. De tous ces caractères de la philosophie, celui qui consiste à savoir toutes choses, appartient surtout à l'homme qui possède le mieux la connaissance du général ; car celui-là sait ce qui en est de tous les sujets particuliers. Et puis les connaissances les plus générales sont peut-être les plus difficiles à acquérir; car elles sont les plus éloignées des sensations. Ensuite, les sciences les plus exactes sont celles qui s'occupent le plus des principes; en effet celles dont l'objet est plus simple sont plus exactes que celles dont l'objet est plus composé; l'arithmétique, par exemple, l'est plus que la géométrie. Ajoutez que. la science qui peut le mieux enseigner, est celle qui étudie les causes; car enseigner, c'est dire les causes de chaque chose.
De plus, savoir uniquement pour savoir, appartient surtout à la science de ce qu'il y a de plus scientifique; car celui qui veut apprendre dans le seul but d'apprendre, choisira sur toute autre la science par excellence, c'est-à-dire la science de ce qu'il y a de plus scientifique; et ce qu'il y a de plus scientifique, ce sont les principes et les causes; car c'est à l'aide des principes et par eux que nous connaissons les autres choses, et non pas les principes par les sujets particuliers. Enfin, la science souveraine, faite pour dominer toutes les autres, est celle qui connaît pourquoi il faut faire chaque chose; or, ce pourquoi est le bien dans chaque chose, et, en général, c'est le bien absolu dans toute la nature.
De tout ce que nous venons de dire, il résulte que le mot de philosophie dont nous avons recherché les diverses significations, se rapporte à une seule et même science. Une telle science s'élève aux principes et aux causes; or, le bien, la raison des choses, est au nombre des causes. Et qu'elle n'a pas un but pratique, c'est ce qui est évident par l'exemple des premiers qui se sont occupés de philosophie. Ce fut en effet l'étonnement d'abord comme aujourd'hui, qui fit naître parmi les hommes les recherches philosophiques. Entre les phénomènes qui les frappaient, leur curiosité se porta d'abord sur ce qui était le plus à leur portée ; puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils en vinrent à se demander compte de plus grands phénomènes, comme des divers états de la lune, du soleil, des astres, et enfin de l'origine de l'univers. Or, douter et s'étonner, c'est reconnaître son ignorance.. Voilà pourquoi on peut dire en quelque manière que l'ami de la philosophie est aussi celui des mythes; car la matière du mythe, c'est l'étonnant, le merveilleux. Si donc on a philosophé pour échapper à l'ignorance, il est clair qu'on a poursuivi la science pour savoir et sans aucun but d'utilité. Le fait eu fait foi : car tout ce qui regarde les besoins, le bien-être et la commodité de la vie était déjà trouvé, lorsqu'on entreprit un tel ordre de recherches. Il est donc évident que nous ne cherchons la philosophie dans aucun intérêt étranger ; et comme nous appelons homme libre celui qui s'appartient à lui-même et qui n'appartient pas à un autre, de même la philosophie est de toutes les sciences la seule libre; car seule elle est à elle-même son propre but. Aussi, ne serait-ce pas sans quelque raison qu'on regarderait comme plus qu'humaine la possession de cette science; car la nature de l'homme est esclave à beaucoup d'égards; la divinité seule, pour parler comme Simonide, aurait ce privilège, et il ne convient pas à l'homme de ne pas se borner à la science qui est à son usage. Si donc les poètes disent vrai, et si la nature divine doit être envieuse, c'est surtout au sujet de cette prétention, et tous les téméraires qui la partagent, eu portent la peine. Mais la divinité ne peut connaître l'envie; les poètes, comme dit le proverbe, sont souvent menteurs, et il n'y a pas de science à laquelle il faille attacher plus de prix. Car la plus divine est celle qu'on doit priser le plus; or, celle-ci porte seule ce caractère à un double titre. En effet, une science qui appartiendrait à Dieu, et qui s'occuperait de choses divines, serait sans contredit une science divine : et seule, celle dont nous parlons satisfait à ces deux conditions. D'une part, Dieu est reconnu de tout le monde comme le principe même des causes; et de l'autre, la science des causes lui appartient exclusivement ou dans un degré supérieur. Ainsi toutes les sciences sont plus nécessaires que la philosophie, mais nulle n'est plus excellente. Et rien ne diffère plus que la possession de cette science et son début. On commence, ainsi que nous l'avons dit, par s'étonner que les choses soient de telle façon ; et comme on s'émerveille en présence des automates, quand on n'en connaît pas les ressorts, de même nous nous étonnons des révolutions du soleil et de l'incommensurabilité du diamètre; car il semble étonnant à tout le monde qu'une quantité ne puisse être mesurée par une quantité si petite qu'elle soit. C'est, comme dit le proverbe, par le contraire et par le meilleur qu'il faut finir, comme il arrive dans le cas que nous venons de citer, lorsqu'enfin on est parvenu à s'en rendre compte : car rien n'étonnerait plus un géomètre que si le diamètre devenait commensurable.
Nous venons de déterminer la nature de la science que nous cherchons, le but de cette science et de tout notre travail.
CHAPITRE III (retour)
Il est évident qu'il faut acquérir la science des causes premières, puisque nous ne pensons savoir une chose que quand nous croyons en connaître la première cause. Or, on distingue quatre sortes de causes, la première est l'essence et la forme propre de chaque chose; car il faut pousser la recherche des causes aussi loin qu'il est possible, et c'est la raison dernière d'une chose qui en est le principe et la cause. La seconde cause est la matière et le sujet; la troisième le principe du mouvement; la quatrième, enfin, celle qui répond à la précédente, la raison et le bien des choses; car la fin de tout phénomène et de tout mouvement, c'est le bien. Ces points de vue ont été suffisamment expliqués dans les livres de physique; reprenons cependant les opinions des philosophes qui nous ont précédés dans l'étude des êtres et de la vérité. Il est évident qu'eux aussi reconnaissent certaines causes et certains principes : cette revue peut donc nous être utile pour la recherche qui nous occupe. Car il arrivera ou que nous rencontrerons un ordre de causes que nous avions omis, ou que nous prendrons plus de confiance dans la classification que nous venons d'exposer.
La plupart des premiers philosophes ont cherché dans la matière les principes de toutes choses. Car ce dont toute chose est, d'où provient toute génération et où aboutit toute destruction, l'essence restant la même et ne faisant que changer d'accidents, voilà ce qu'ils appellent l'élément et le principe des êtres; et pour cette raison, ils pensent que rien ne naît et que rien ne périt, puisque cette nature première subsiste toujours. Nous ne disons pas d'une manière absolue que Socrate naît, lorsqu'il devient beau ou musicien, ni qu'il périt lorsqu'il perd ces manières d'être, attendu que le même Socrate, sujet de ces changements, n'en demeure pas moins ; il en est de même pour toutes les autres choses; car il doit y avoir une certaine nature, unique ou multiple, d'où viennent toutes choses, celle-là subsistant la même. Quant au nombre et à l'espèce de ces déments, on ne s'accorde pas.
Thalès, le fondateur de cette manière de philosopher, prend l'eau pour principe, et voilà pourquoi il a prétendu que la terre reposait sur l'eau, amené probablement à cette opinion parce qu'il avait observé que l'humide est l'aliment de tous les êtres, et que la chaleur elle-même vient de l'humide et en vit; or, ce dont viennent les choses est leur principe. C'est de là qu'il tira sa doctrine, et aussi de ce que les germes de toutes choses sont de leur nature humides, et que l'eau est le principe des choses humides. Plusieurs pensent que dès la plus haute antiquité, bien avant notre époque, les premiers théologiens ont eu la même opinion sur la nature: car ils avaient fait l'Océan et Téthys auteurs de tous les phénomènes de ce monde, et ils montrent les Dieux jurant par l'eau que les poètes appellent le Styx. En effet, ce qu'il y a de plus ancien est ce qu'il y a de plus saint; et ce qu'il y a de plus saint, c'est le serment. Y a-t-il réellement un système physique dans cette vieille et antique opinion? c'est ce dont on pourrait douter. Mais pour Thalès on dit que telle fut sa doctrine. Quant à Hippon, sa pensée n'est pas assez profonde pour qu'on puisse le placer parmi ces philosophes. Anaximène et Diogène prétendaient que l'air est antérieur à l'eau, et qu'il est le principe des corps simples; ce principe est le feu, selon Hippase de Métaponte et Héraclite d'Éphèse. Empédocle reconnut quatre éléments, ajoutant la terre à ceux que nous avons nommés; selon lui, ces éléments subsistent toujours et ne deviennent pas, mais le seul changement qu'ils subissent est celui de l'augmentation ou de la diminution, lorsqu'ils s'agrègent ou se séparent. Anaxagoras de Clazomène, qui naquit avant ce dernier, mais qui écrivit après lui, suppose qu'il y a une infinité de principes : il prétend que toutes les choses formées de parties semblables comme le feu et l'eau, ne naissent et ne périssent qu'en ce sens que leurs parties se réunissent ou se séparent, mais que du reste rien ne naît ni ne périt, et que tout subsiste éternellement. De tout cela on pourrait conclure que jusqu'alors on n'avait considéré les choses que sous le point de vue de la matière.
Quand on en fut là, la chose elle-même força d'avancer encore, et imposa de nouvelles recherches. Si tout ce qui naît doit périr et vient d'un principe unique ou multiple, pourquoi en est-il ainsi et quelle en est la cause? car ce n'est pas le sujet qui peut se changer lui-même ; l'airain, par exemple, et le bois ne se changent pas eux-mêmes, et ne se font pas l'un statue, l'autre lit, mais il y a quelque autre cause à ce changement. Or, chercher cette cause, c'est chercher un antre principe, le principe du mouvement, comme nous disions. Ceux des anciens qui dans l'origine touchèrent ce sujet, et qui avaient pour système l'unité de substance, ne se tourmentèrent pas de cette difficulté; mais quelques-uns de ces partisans de l'unité, inférieurs en quelque sorte à cette question, disent que l'unité et tout ce qui est, réel n'admet pas de mouvement, ni pour la génération et la corruption, ni même pour tout autre changement. Aussi, de tous ceux qui partent de l'unité du tout, pas un ne s'est occupé de ce point de vue, si ce n'est peut-être Parménide, et encore ne le fait-il qu'autant qu'à côté de son système de l'unité, il admet en quelque sorte deux principes. Mais ceux qui admettent la pluralité des principes, le chaud et le froid, par exemple, ou le feu et la terre, étaient plus à même d'arriver à cet ordre des recherches; car ils attribuaient au feu la puissance motrice, à l'eau, à la terre et aux autres éléments de cette sorte, la qualité contraire. Après ces philosophes et de pareils principes, comme ces principes étaient insuffisants pour produire les choses, la vérité elle même, comme nous l'avons déjà dit, força de recourir à un autre principe. En effet, il n'est guère vraisemblable que ni le feu, ni la terre, ni aucun autre élément de ce genre, soit la cause de l'ordre et de la beauté qui règnent. dans le monde, éternellement chez certains êtres, passagèrement chez d'autres ; ni que ces philosophes aient eu une pareille pensée : d'un autre côté, rapporter un tel résultat au hasard ou à la fortune n'eût pas été raisonnable. Aussi quand un homme vint dire qu'il y avait dans la nature, comme dans les animaux, une intelligence qui est la cause de l'arrangement et de l'ordre de l'univers, cet homme parut seul avoir conservé sa raison au milieu des folies de ses devanciers. Or, nous savons avec certitude qu'Anaxagoras entra le premier dans ce point de vue; avant lui Hermotime de Clazomène paraît l'avoir soupçonné. Ces nouveaux philosophes érigèrent en même temps cette cause de l'ordre en principe des êtres, principe doué de la vertu d'imprimer le mouvement.
On pourrait dire qu'avant eux, Hésiode avait entrevu cette vérité, Hésiode ou quiconque a mis dans les êtres comme principe l'amour ou le désir, par exemple Parménide. Celui-ci dit en effet dans sa théorie de la formation de l'univers:
«Il fit l'amour le premier de tous les Dieux. »
Hésiode dit de son côté :
« Avant toutes choses était le chaos ; ensuite,
La terre au vaste sein...
Puis l'amour, le plus beau de tous les immortels. »
Comme s'ils avaient reconnu la nécessité d'une cause dans les êtres capable de donner le mouvement et le lien aux choses. Quant à la question de savoir à qui appartient la priorité, qu'il nous soit permis de la décider plus tard.
Ensuite, comme à côté du bien dans la nature, on voyait aussi son contraire, non seulement de l'ordre et de la beauté, mais aussi du désordre et de la laideur, comme le mal paraissait même l'emporter sur le bien et le laid sur le beau, un autre philosophe introduisit l'amitié et la discorde, causes opposées de ces effets opposés. Car si l'on veut suivre de près Empédocle, et s'attacher au fond de sa pensée plutôt qu'à la manière presqu'enfantine dont il l'exprime, on trouvera que l'amitié est la cause du bien, et la discorde celle du mal ; de sorte que peut-être n'aurait-t-on pas tort de dire qu'Empédocle a parlé en quelque manière et a parlé le premier du bien et du mal comme principes, puisque le principe de tous les biens est le bien lui-même, et le mal le principe de tout ce qui est mauvais.
Jusqu'ici nous avons vu ces philosophes reconnaître deux des genres de causes déterminés par nous dans la Physique, la matière et le principe du mouvement ; mais ils l'ont fait confusément et indistinctement, comme agissent dans les combats les soldats mal exercés; ceux-ci frappent souvent de bons coups dans la mêlée, mais ils le font sans science; de même nos philosophes paraissent avoir parlé sans bien savoir ce qu'ils disaient, car l'usage qu'on les voit taire de leurs principes est nul ou peu s'en faut. Anaxagoras se sert de l'intelligence comme d'une machine pour faire le monde, et quand il désespère de trouver la cause réelle d'un phénomène, il produit l'intelligence sur la scène; mais dans tout autre cas, il aime mieux donner aux faits une autre cause. Empédocle se sert davantage, mais d'une manière insuffisante encore, de ses principes, et dans leur emploi il ne s'accorde pas avec lui-même. Souvent chez lui, l'amitié sépare, la discorde réunit : en effet, lorsque dans l'univers les éléments sont séparés par la discorde, toutes les particules de feu n'en sont pas moins unies en un tout, ainsi que celles de chacun des autres éléments; et lors-qu'au contraire c'est l'amitié qui unit tous les éléments, il faut bien pour cela que les particules de chaque élément se divisent.
Empédocle fut donc le premier des anciens qui employa en le divisant le principe du mouvement, et ne supposa plus une cause unique, mais deux causes différentes et opposées. Quant à la matière, il est le premier qui ait parlé des quatre éléments; toutefois, il ne s'en sert pas comme s'ils étaient quatre, mais comme s'ils n'étaient que deux, à savoir, le feu tout seul, et en opposition au feu, la terre, l'air et l'eau, ne faisant qu'une seule et même nature. C'est là du moins ce que ses vers donnent à entendre.
Voilà, selon nous, la nature et le nombre des principes d'Empédocle. Leucippe et son ami Démocrite disent que les éléments primitifs sont le plein et le vide, qu'ils appellent l'être et le non être; le plein ou le solide, c'est l'être; le vide ou le rare, c'est le non-être; c'est pourquoi ils disent que l'être n'existe pas plus que le non-être, parce que le corps n'existe pas plus que le vide : telles sont, sous le point de vue de la matière, les causes des êtres. Et de même que ceux qui posent comme principe une substance unique, expliquent tout le reste par les modifications de cette substance, en donnant pour principe à ces modifications le rare et le dense, de même aussi ces philosophes placent dans les différences les causes de toutes choses; ces différences sont au nombre de trois, la forme, l'ordre et la position : ils disent en effet que les différences de l'être viennent de la configuration, de l'arrangement et de la tournure; or, la configuration c'est la forme, l'arrangement c'est l'ordre, la tournure c'est la position. Ainsi, A diffère de N par la forme, AN de NA par l'ordre, et Z de N par la position. Quant au mouvement, à ses lois et à sa cause, ils ont traité cette question très négligemment, comme les autres philosophes. Nos devanciers donc n'ont pas été plus loin sur ces deux genres de causes.
CHAPITRE IV (retour)
Parmi eux et avant eux, ceux qu'on nomme Pythagoriciens, s'étant occupés des mathématiques, furent les premiers à les mettre en avant; et nourris dans cette étude, ils pensèrent que les principes de cette science étaient les principes de tous les êtres. Comme, de leur nature, les nombres sont les premiers des êtres, et comme ils leur paraissaient avoir plus d'analogie avec les choses et les phénomènes que le feu, l'air ou l'eau, que, par exemple, telle modification des nombres semblait être la justice, telle autre rame et l'intelligence, telle autre l'à-propos, et à peu près ainsi de toutes les autres choses; comme ils voyaient de plus dans les nombres les modifications et les rapports de l'harmonie ; par ces motifs joints à ces deux premiers que la nature entière a été formée à la ressemblance des nombres, et que les nombres sont les premiers de tous les êtres, ils posèrent les éléments des nombres comme les éléments de tous les êtres, et le ciel tout entier comme une harmonie et un nombre. Tout ce qu'ils pouvaient montrer dans les nombres et dans la musique qui s'accordât avec les phénomènes du ciel, ses parties et toute son ordonnance, ils le recueillirent, et ils en composèrent un système; et si quelque chose manquait, ils y suppléaient pour que le système fût bien d'accord et complet. Par exemple, comme la décade paraît être quelque chose de parfait et qui embrasse tous les nombres possibles, ils prétendent qu'il y a dix corps en mouvement dans le ciel, et comme il n'y en a que neuf de visibles, il en supposent un dixième qu'ils appellent antichthone. Mais tout ceci a été déterminé ailleurs avec plus de soin. Si nous y revenons, c'est pour constater à leur égard comme pour les autres écoles, quels principes ils posent, et comment ces principes tombent sous notre classification. Or, ils paraissent penser que le nombre est principe des êtres sous le point de vue de la matière, en y comprenant les attributs et les manières d'être; que les éléments du nombre sont le pair et l'impair; que l'impair est fini, le pair infini; que l'unité tient de ces deux éléments, car elle est à la fois pair et impair, et que le nombre vient de l'unité; enfin que les nombres sont tout le ciel. D'autres pythagoriciens disent qu'il y a dix principes, dont voici la liste :
Fini et infini,
Impair et pair,
Unité et pluralité,
Droit et gauche,
Mâle et femelle,
Repos et mouvement,
Droit et courbe,
Lumière et ténèbres,
Bien et mal,
Carré et toute figure à côtés inégaux.
Alcmæon de Crotone paraît avoir professé une doctrine semblable : il la reçut des Pythagoriciens ou ceux-ci la reçurent de lui; car l'époque où il florissait correspond à la vieillesse de Pythagore; et son système se rapproche de celui de ces philosophes. Il dit que la plupart des choses humaines sont doubles, désignant par là leurs oppositions, mais, à la différence de ceux-ci, sans les déterminer, et prenant au hasard le blanc et le noir, le doux et l'amer, le bon et le mauvais, le petit et le grand. Il s'exprima ainsi d'une manière indéterminée sur tout le reste, tandis que les Pythagoriciens montrèrent quelles sont ces oppositions et combien il y en a. On peut donc tirer de ces deux systèmes que les contraires sont les principes des choses et de l'un deux quel est le nombre et la nature de ces principes. Maintenant comment est-il possible de les ramener à ceux que nous avons posés, c'est ce qu'eux-mêmes n'articulent pas clairement; mais ils semblent les considérer sous le point de vue de la matière; car ils disent que ces principes constituent le fonds dont se composent et sont formés les êtres. Nous en avons dit assez pour faire comprendre la pensée de ceux des anciens qui admettent la pluralité dans les éléments de la nature.
Il en est d'autres qui ont considéré le tout comme étant un être unique, mais ils diffèrent et par le mérite de l'explication et par la manière de concevoir la nature de cette unité. Il n'est nullement de notre sujet, dans cette recherche des principes, de nous occuper d'eux; car ils ne font pas comme quelques-uns des physiciens qui, ayant posé une substance unique, engendrent l'être de cette unité considérée sous le point de vue de la matière ; ils procèdent autrement : les physiciens en effet ajoutent le mouvement pour engendrer l'univers; ceux-ci prétendent que l'univers est immobile ; mais nous n'en dirons que ce qui se rapporte à notre sujet. L'unité de Parménide paraît avoir été une unité rationnelle, celle de Mélisse une unité matérielle, et c'est pourquoi l'un la donne comme finie, l'autre comme infinie. Xénophane qui le premier parla d'unité (car Parménide passe pour son disciple), ne s'est pas expliqué d'une manière précise et paraît étranger au point de vue de l'un et l'autre de ses deux successeurs; mais ayant considéré l'ensemble du inonde, il dit que l'unité est Dieu. Encore une fois, il faut négliger ces philosophes dans la recherche qui nous occupe, et deux surtout, dont les idées sont un peu trop grossières, Xénophane et Mélisse. Parménide paraît avoir eu des vues plus profondes : persuadé que, hors de l'être, le non-être n'est rien, il pense que l'être est nécessairement un, et qu'il n'y a rien autre chose que lui; c'est un point sur lequel nous nous sommes expliqués plus clairement dans la Physique ; mais forcé de se mettre d'accord avec les faits, et, en admettant l'unité par la raison, d'admettre aussi la pluralité par les sens, Parménide en revint à poser deux principes et deux causes, le chaud et le froid, par exemple le feu et la terre; il rapporte l'un de ces deux principes, le chaud à l'être, et l'autre au non-être.
Voici le résultat de ce que nous avons dit, et de tous les systèmes que nous avons parcourus jusqu'ici : chez les premiers de ces philosophes, un principe corporel; car l'eau, le feu et les autres choses de cette nature sont des corps, principe unique selon les uns, multiple selon les autres, mais toujours considéré sous le point de vue de la matière; chez quelques-uns, d'abord ce principe, et à côté de ce principe, celui du mouvement, unique dans certains systèmes, double dans d'autres. Ainsi, jusqu'à l'école italique exclusivement, les anciens philosophes ont parlé de toutes ces choses d'une manière vague, et n'ont mis en usage, ainsi que nous l'avons dit, que deux sortes de principes, dont l'un, celui du mouvement, est regardé tantôt comme unique et tantôt comme double. Quant aux Pythagoriciens, comme les précédents, ils ont posé deux principes ; mais ils ont en outre introduit cette doctrine qui leur est propre, savoir: que le fini, l'infini et l'unité, ne sont pas des qualités distinctes des sujets où ils se trouvent, comme le feu, la terre et tout autre principe semblable sont distincts de leurs qualités, niais qu'ils constituent l'essence même des choses auxquelles on les attribue; de sorte que le nombre est l'essence de toutes choses. Ils se sont expliqués sur ces points de la manière que nous venons de dire, et de plus, ils ont commencé à s'occuper de l'essence des choses et ont essayé de définir; mais leur essai fut un peu trop grossier. Ils définissaient superficiellement, et le premier objet auquel avait l'air de convenir la définition donnée, ils le considéraient comme l'essence de la chose définie; comme si l'on pensait, par exemple, que le double est la même chose que le nombre deux, parce que c'est dans le nombre deux que se rencontre en premier lieu le caractère du double ; mais deux ou double ne sont pourtant pas la même chose, ou si non, l'unité sera multiple, ce qui arrive dans le système Pythagoricien. Voilà ce qu'on peut tirer des premiers philosophes et de leurs successeurs.
CHAPITRE V (retour)
Après ces différentes philosophies, parut la philosophie de Platon , qui suivit en beaucoup de points ses devanciers, mais qui eut aussi ses points de doctrine particuliers, et alla plus loin que l'école italique. Dès sa jeunesse, Platon se familiarisa dans le commerce de Cratyle avec les opinions d'Héraclite, que toutes les choses sensibles sont dans un perpétuel écoulement, et qu'il n'y a pas de science de ces choses; et dans la suite, il garda ces opinions. D'une autre part, Socrate s'étant occupé de morale, et non plus d'un système de physique, et ayant d'ail-leurs cherché dans la morale ce qu'il y a d'universel , et porté le premier son attention sur les définitions, Platon qui le suivit et le continua fut amené à penser que les définitions devaient porter sur un ordre d'êtres à part et nullement sur les objets sensibles; car comment une définition commune s'appliquerait-elle aux choses sensibles, livrées à un perpétuel changement? Or, ces autres êtres, il les appela Idées, et dit que les choses sensibles existent en dehors des idées et sont nommées d'après elles; car il pensait que toutes les choses d'une même classe tiennent leur nom commun des idées, en vertu de leur participation avec elles. Du reste, le mot de participation est le seul changement qu'il apporta; les Pythagoriciens en effet disent que les êtres sont à l'imitation des nombres, Platon en participation avec les idées. Comment se fait maintenant cette participation ou cette imitation des idées ? c'est ce que celui-ci et ceux-là ont également négligé de rechercher. De plus, outre les choses sensibles et les idées, il reconnaît des êtres intermédiaires qui sont les choses mathématiques, différentes des choses sensibles en ce qu'elles sont éternelles et immuables, et des idées en ce qu'elles admettent un grand nombre de semblables , tandis que toute idée en elle-même a son existence à part. Voyant dans les idées les raisons des choses, il pensa que leurs éléments étaient les éléments de tous les êtres. Les principes dans ce système sont donc, sous le point de vue de la matière, le grand et le petit, et sous celui de l'essence, l'unité; et en tant que formées de ces principes et participant de l'unité, les idées sont les nombres. Ainsi, en avançant que l'unité est l'essence des êtres et que rien autre chose que cette essence n'a le titre d'unité, Platon se rapprocha des pythagoriciens, et il dit comme eux que les nombres sont les causes des choses et de leur essence; mais faire une dualité de cet infini qu'ils regardaient comme un, et composer l'infini du grand et da petit, voilà ce qui lui est propre; avec cette prétention que les nombres existent en dehors des choses sensibles, tandis que les pythagoriciens disent que les nombres sont les choses mêmes, et ne donnent pas aux choses mathématiques un rang intermédiaire. Cette existence que Platon attribue à l'unité et au nombre en dehors des choses, à la différence des pythagoriciens, ainsi que l'introduction des idées, est due à ses recherches logiques (car les premiers philosophes étaient étrangers à la dialectique ) ; et il fut conduit à faire une dyade de cette autre nature différente de l'unité, parce que lés nombres, à l'exception des nombres primordiaux, s'engendrent aisément de cette dyade, comme d'une sorte de matière. Cependant, les choses se passent autrement, et cela est contraire à la raison. Dans ce système, on fait avec la matière un grand nombre d'êtres, et l'idée n'engendre qu'une seule fois ; mais au vrai, d'une seule matière on ne fait qu'une seule table , tandis que celui qui apporte l'idée, tout en étant un lui-même, en fait un grand nombre. Il en est de même du mâle à l'égard de la femelle; la femelle est fécondée par un seul accouplement, tandis que le mâle en féconde plusieurs : or, cela est l'image de ce qui a lieu pour les principes dont nous parlons. C'est ainsi que Platon s'est prononcé sur ce qui fait l'objet de nos recherches : il est clair, d'après ce que nous avons dit, qu'il ne met en usage que deux principes, celui de l'essence et celui de la matière; car les idées sont pour les choses les causes de leur essence, comme l'unité l'est pour les idées: Et quelle est la matière ou le sujet auquel s'appliquent les idées dans les choses sensibles et l'unité dans les idées? c'est cette dyade, composée du grand et du petit : de plus il attribua à l'un de ces deux éléments la cause du bien, à l'autre la cause du mal, de la même manière que l'ont fait dans leurs recherches quelques-uns des philosophes précédents, comme Empédocle et Anaxagoras.
CHAPITRE VI (retour)
Nous, venons de voir, brièvement et sommairement, il est vrai, quels sont ceux qui se sont occupés des principes et de la vérité, et comment ils l'ont fait : cette revue rapide n'a pas laissé de nous faire reconnaître, que de tous les philosophes qui ont traité de principe et de cause, pas un n'est sorti de la classification que nous avons établie dans la Physique, et que tous plus ou moins nettement l'ont entrevue. Les uns considèrent le principe sous le point de vue de la matière, soit qu'ils lui attribuent l'unité ou la pluralité, soit qu'ils le supposent corporel ou incorporel; tels sont le grand et le petit de Platon, l'infini de l'école italique; le feu, la terre, l'eau et l'air d'Empédocle; l'infinité des homoeoméries d'Anaxagoras. Tous ont évidemment touché cet ordre de causes, et de même ceux qui ont choisi l'air, le feu ou l'eau, ou un élément plus dense que le feu et plus délié que l'air; car telle est la nature que quelques-uns ont donnée à l'élément premier. Ceux-là donc n'ont atteint que le principe de la matière, quelques autres le principe du mouvement, comme ceux par exemple qui font un principe de l'amitié ou de la discorde, de l'intelligence ou de l'amour. Quant à la forme et à l'essence, nul n'en a traité clairement, mais ceux qui l'ont fait le mieux sont les partisans des idées. En effet, ils ne regardent pas les idées et les principes des idées, comme la matière des choses sensibles, ni comme le principe d'où leur vient le mouvement (car ce seraient plutôt, selon eux, des causes d'immobilité et de repos); mais c'est l'essence que les idées fournissent à chaque chose, comme l'unité la fournit aux idées. Quant à la fin en vue de laquelle se font les actes, les changements et les mouvements, ils mentionnent bien en quelque manière ce principe, mais ils ne le font pas clans cet esprit, ni dans le vrai sens de la chose; car ceux qui mettent en avant l'intelligence et l'amitié, posent bien ces principes , comme quelque chose de bon , mais non comme un but en vue duquel tout être est ou devient; ce sont plutôt des causes d'où leur vient le mouvement. Il eu est de même de ceux qui prétendent que l'unité ou l'être est cette même nature ; ils disent qu'elle est la cause de l'essence, mais ils ne disent pas qu'elle est la fin pour laquelle les choses sont et deviennent. De sorte qu'il leur arrive en quelque façon de parler à la fois et de ne pas parler du principe du bien; car ils n'en parlent pas d'une manière spéciale, mais seulement par accident. Ainsi, que le nombre et la nature des causes ait été déterminé par nous avec exactitude, c'est ce que semblent témoigner tous ces philosophes dans l'impossibilité où ils sont d'indiquer aucun autre principe. Outre cela, il est clair qu'il faut, dans la recherche des principes, ou les considérer tous comme nous l'avons fait, ou adopter les vues de quelques-uns de ces philosophes. Exposons d'abord les difficultés que soulèvent les doctrines de nos devanciers et la question de la nature même des principes.
CHAPITRE VII (retour)
Tous ceux qui ont prétendu que l'univers est un, et qui, dominés par le point de vue de la matière, ont voulu qu'il y ait une seule et même nature, et une nature corporelle et étendue, ceux-là sans contredit se trompent de plusieurs manières; car ainsi, ils posent seulement les éléments des corps et non ceux des choses incorporelles , quoiqu'il existe de telles choses. Puis, quoiqu'ils entreprennent de dire les causes de la génération et de la corruption , et d'expliquer la formation des choses, ils suppriment le principe du mouvement. Ajoutez qu'ils ne font pas un principe de l'essence et de la forme; et aussi, qu'ils donnent sans difficulté aux corps simples, à l'exception de la terre, un principe quelconque, sans avoir examiné comment ces corps peuvent naître les uns des autres; je parle du feu, de la terre, de l'eau et de l'air, lesquels naissent en effet les uns des autres, soit par réunion, soit par séparation. Or, cette distinction importe beaucoup pour la question de l'antériorité et de la postériorité des éléments. D'un côté, le plus élémentaire de tous semblerait être celui d'où naissent primitivement tous les autres par voie de réunion; et ce caractère appartiendrait à celui des corps dont les parties seraient les plus petites et les plus déliées. C'est pourquoi tous ceux qui posent comme principe le feu, se prononceraient de la manière la plus conforme à cette vue. Tel est aussi le caractère que tous les autres s'accordent à assigner à l'élément des corps. Aussi, nul philosophe d'une époque plus récente, qui admet un seul élément, n'a-t-il jugé convenable de choisir la terre, sans doute à cause de la grandeur de ses parties, tandis que chacun des trois autres éléments a eu son partisan : les uns se déclarent pour le feu , les autres pour l'eau, les autres pour l'air; et pourtant pourquoi n'admettent-ils pas aussi bien la terre, comme font la plupart des hommes qui disent que tout est terre? Hésiode lui-même dit que la terre est le premier des corps; tellement ancienne et populaire se trouve être cette opinion. Dans ce point de vue, ni ceux qui adoptent à l'exclusion du feu un des éléments déjà nommés, ni ceux qui prennent un élément plus dense que l'air et plus délié que l'eau, n'auraient raison; mais si ce qui est postérieur dans l'ordre de formation est antérieur dans l'ordre de la nature, et que, dans l'ordre de formation, le composé soit postérieur, l'eau sera tout au contraire antérieure à l'air et la terre à l'eau. Nous nous bornerons à cette observation sur ceux qui admettent un principe unique tel que nous l'avons énoncé. Il y en aurait autant à dire de ceux qui admettent plusieurs principes pareils, comme Empédocle qui dit qu'il y a quatre corps, matière des choses; car sa doctrine donne lieu d'abord aux mêmes critiques, puis à quelques observations particulières. Nous voyons en effet ces éléments naître les uns des autres, de sorte que le feu et la terre ne demeurent jamais le même corps : nous nous sommes expliqué à ce sujet dans la Physique. Quant à la cause qui fait mouvoir les choses, et à la question de savoir si elle est une ou double, on doit penser qu'Empédocle ne s'est prononcé ni tout-à-fait convenablement, ni d'une manière tout-à-fait déraisonnable. En somme, quand on admet sou système, on est forcé de rejeter tout changement, car le froid ne viendra pas du chaud ni le chaud du froid; car quel serait le sujet qui éprouverait ces modifications contraires, et quelle serait la nature unique qui deviendrait feu et eau? c'est ce qu'il ne dit pas. Pour Anaxagoras, si on pense qu'il reconnaît deux éléments, on le pense d'après des raisons qu'il n'a pas lui-même clairement articulées, mais auxquelles il aurait été obligé de se rendre, si on les lui eût présentées. En effet, s'il est absurde de dire qu'à l'origine tout était mêlé , pour plu-sieurs motifs, et entre autres parce qu'il faut que les éléments du mélange aient existé d'abord séparés, et parce qu'il n'est pas dans la nature des choses qu'un élément, quel qu'il soit, se mêle avec tout autre, quel qu'il soit; de plus, parce que les qualités et les attributs seraient séparés de leur substance; car ce qui peut être mêlé peut être séparé; cependant quand on vient à approfondir et à développer ce qu'il veut dire , on lui trouvera peut. être un sens peu commun; car lorsque rien n'était séparé, il est clair qu'on ne pouvait rien affirmer de vrai de cette substance mixte, et par exemple, qu'elle n'était ni blanche ni noire, ni d'aucune autre couleur; niais elle était de nécessité sans couleur; autrement, elle aurait eu quelqu'une des couleurs que nous pouvons citer; elle était de même sans saveur , et pour la même raison elle ne possédait aucun attribut de ce genre; car elle ne pouvait avoir ni qualité ni quantité ni détermination quelconque; autrement quelqu'une des formes spéciales s'y serait rencontrée, et cela est impossible lorsque tout est mêlé; car, pour cela, il y aurait déjà séparation , et Anaxagoras dit que tout est mêlé, excepté l'intelligence, qui seule est pure et sans mélange. Il faut donc qu'il reconnaisse pour principes l'unité d'abord; car c'est bien là ce qui est simple et sans mélange, et d'un autre côté quelque chose, ainsi que nous désignons l'indéfini avant qu'il soit défini et participe d'aucune forme. Ce n'est s'exprimer ni justement, ni clairement; mais au fond il a voulu dire quelque chose qui se rapproche davantage des doctrines qui ont suivi et de la réalité.Tous ces philosophes ne sont familiers qu'avec ce qui regarde la génération, la corruption et le mouvement, car ils s'occupent à peu près et exclusivement de cet ordre de choses, des principes et des causes qui s'y rapportent. Mais ceux qui étendent leurs recherches à tous les êtres, et qui admettent d'un côté des êtres sensibles, de l'autre des êtres qui ne tombent pas sous les sens, ceux-là ont dû naturellement faire l'étude de l'une et de l'autre de ces deux classes d'êtres; et c'est pourquoi il faut s'arrêter davantage sur ces philosophes pour savoir ce qu'ils disent de bon ou de mauvais qui puisse éclairer nos recherches. Ceux qu'on appelle pythagoriciens font jouer aux principes et aux éléments un rôle bien plus étrange que les physiciens; la raison en est qu'ils ne les ont pas empruntés aux choses sensibles. Les êtres mathématiques sont sans mouvement, à l'exception de ceux dont s'occupe l'astronomie (37); et cependant les pythagoriciens ne dissertent et ne font de système que sur la physique. Ils engendrent le ciel, ils observent ce qui arrive dans toutes ses parties, dans leurs rapports, dans leurs mouvements , et ils épuisent à cela leurs causes et leurs principes, comme s'ils convenaient avec les physiciens que l'être est tout ce qui est sensible, et tout ce qu'embrasse ce qu'or) appelle le ciel. Or, les causes et les principes qu'ils reconnaissent sont bons pour s'élever, comme nous l'avons dit, à ce qu'il y a de supérieur dans les êtres, et conviennent plus à cet objet qu'à l'explication des choses naturelles. Puis, comment pourra-t-il y avoir du mouvement, si on ne suppose d'autres sujets que le fini et l'in-fini, le pair et l'impair? ils ne le disent nullement; ou comment est-il possible que sans mouvement ni changement, il y ait génération et corruption, et toutes les révolutions des corps célestes? Ensuite, en supposant qu'on leur accorde ou qu'il soit démontré que de leurs principes on tire l'étendue, comment alors même rendront-ils compte de la légèreté et de la pesanteur? car d'après leurs principes et leur prétention même, ils ne traitent pas moins des corps sensibles que des corps mathématiques. Aussi n'ont-ils rien dit de bon sur le feu, la terre et les autres choses semblables, et cela, parce qu'ils n'ont rien dit, je pense, qui convienne proprement aux choses sensibles. De plus, comment faut-il entendre que le nombre et les modifications du nombre sont la cause des êtres qui existent et qui naissent dans le monde , depuis l'origine jusqu'à présent, tandis que d'autre part il n'y a aucun autre nombre hors celui dont le monde est formé? En effet, lorsque pour eux, l'opinion et l'à-propos sont dans une certaine partie du ciel, et un peu plus haut ou un peu plus bas l'injustice et la séparation ou le mélange, attendu, selon eux, que chacune de ces choses est un nombre, et lorsque déjà dans ce même espace se trouvent rassemblées une multitude de grandeurs, parce que ces grandeurs sont attachées chacune à un lieu ; le nombre qu'il faut regarder comme étant chacune de ces choses, est-il le même que celui qui est dans le ciel , ou un autre outre celui-là ? Platon dit que c'est un autre nombre; et pourtant lui aussi pense que les choses sensibles et les causes de ces choses sont des nombres; mais pour lui les nombres qui sont causes, sont intelligibles, et les autres sont des nombres sensibles.
CHAPITRE VIII (retour)
Laissons maintenant les Pythagoriciens ; ce que nous en avons dit, suffira. Quant à ceux qui posent pour principes les idées, d'abord, en cherchant à saisir les principes des êtres que nous voyons , ils en ont introduit d'autres en nombre égal à celui des premiers, comme si quelqu'un voulant compter des objets, et ne pouvant le faire, alors même qu'ils sont en assez petit nombre , s'avisait de les multiplier pour les compter. Les idées sont presque en aussi grand nombre que les choses pour l'explication desquelles on a eu recours aux idées. Chaque chose individuelle se trouve avoir un homonyme, non seulement les existences individuelles, mais toutes celles où l'unité est dans la pluralité, et cela pour les choses de ce monde et pour les choses éternelles. En second lieu, de tous les arguments dont on se sert pour établir l'existence des idées, aucun ne la démontre : la conclusion qu'on tire des uns n'est pas rigoureuse, et d'après les autres, il y aurait des idées là même où les Platoniciens n'en admettent pas. Ainsi d'après les considérations puisées dans la nature de la science, il y aura des idées de toutes les choses dont il y a science; et d'après l'argument qui se tire de l'unité impliquée dans toute pluralité, il y aura des idées des négations mêmes ; et par ce motif qu'on pense aux choses qui ont péri, il y en aura des choses qui ne sont plus : car nous nous en formons quelque image. En outre, on est conduit, en raisonnant rigoureusement, à supposer des idées pour le relatif dont on ne prétend pourtant pas qu'il forme par lui-même un genre à part, ou bien à l'hypothèse du troisième homme. Enfin, les raisonnements qu'on fait sur les idées renversent ce que les partisans des idées ont plus à coeur que l'existence même des idées : car il arrive que ce n'est plus la dyade qui est avant le nombre, mais le nombre qui est avant la dyade, que le relatif est antérieur à l'absolu, et toutes les conséquences en contradiction avec leurs propres principes, auxquelles ont été poussés certains partisans de la doctrine des idées. De plus, dans l'hypothèse sur laquelle on établit l'existence des idées , il y aura des idées non seulement pour les substances, mais aussi pour beaucoup d'autres choses : car ce ne sont pas les substances seules , mais les autres choses aussi que nous concevons sous la raison de l'unité, et toutes les sciences né portent pas seulement sur l'essence, mais sur d'autres choses encore; et il y a mille autres difficultés de ce genre. Mais de toute nécessité, ainsi que d'après les opinions établies sur les idées, si les idées sont quelque chose dont participent les êtres, il ne peut y avoir d'idées que des essences : car ce n'est pas par l'accident qu'il peut y avoir participation des idées; c'est par son côté substantiel que chaque chose doit participer d'elles. Par exemple si une chose participe du double en soi, elle participe de l'éternité, mais selon l'accident: car ce n'est que par accident que le double est éternel; en sorte que les idées seront l'essence, et que dans le monde sensible et au-dessus elles désigneront l'essence; ou sinon, que signifiera-t-il de dire qu'il doit y avoir quelque chose de plus que les choses particulières , à savoir, l'unité dans la pluralité? Si les idées et les choses qui en participent, sont du même genre, il y aura entre elles quelque chose de commun : car pourquoi y aurait-il dans les dualités périssables et les dualités multiples, mais éternelles, une dualité une et identique, plutôt que dans la dualité idéale et dans telle ou telle dualité déterminée ? Si, au contraire, elles ne sont pas du même genre, il n'y aura entre elles que le nom de commun , et ce sera comme si on donnait le nom d'homme à Callias et à un morceau de bois, sans avoir vu entre eux aucun rapport.
La plus grande difficulté, c'est de savoir ce que font les idées aux choses sensibles, soit à celles qui sont éternelles, soit à celles qui naissent et qui périssent : car elles ne sont causes pour elles ni d'aucun mouvement, ni d'aucun changement. D'autre part, elles ne servent en rien à la connaissance des choses, puisqu'elles n'en sont point l'essence : car alors elles seraient en elles; elles ne les font pas être non plus, puisqu'elles ne résident pas dans les choses qui participent d'elles. A moins qu'on ne dise peut-être qu'elles sont causes, comme serait, par exemple, la blancheur cause de l'objet blanc, en se mêlant à lui; mais il n'y a rien de solide dans cette opinion qu'Anaxagoras le premier, et après lui Eudoxe et quelques autres, ont mise en avant; et il est facile de rassembler contre une pareille hypothèse une foule de difficultés insolubles. Ainsi les choses ne sauraient venir des idées, clans aucun des cas dans lesquels, on a coutume de l'entendre. Dire que ce sont des exemplaires et que les autres choses en participent, c'est prononcer de vains mots et faire des métaphores poétiques; car, qu'est-ce qui produit jamais quelque chose en vue des idées? De plus , il se peut qu'il. existe ou qu'il naisse une chose semblable à une autre, sans avoir été modelée sur elle; et, par exemple, que Socrate existe ou n'existe pas, il pourrait naître un personnage tel que Socrate. D'un autre côté, il est également vrai que , en admettant un Socrate éternel , il faudra qu'il y ait plusieurs exemplaires et par conséquent plu-sieurs idées de la même chose; de l'homme, par exemple, il y aurait l'animal, le bipède, tout aussi bien que l'homme en soi. Il faut en outre qu'il y ait des idées exemplaires non seulement pour des choses sensibles , mais encore pour les idées elles-mêmes, comme le genre en tant que comprenant des espèces; de sorte que la même chose sera à la fois exemplaire et copie. De plus, il semble impossible que l'essence soit séparée de la chose dont elle est l'essence : si cela est, comment les idées qui sont les essences des choses , en seraient-elles séparées? On voit aussi dans le Phédon que les idées sont les causes de l'être et de la naissance : pourtant, les idées étant données, les choses qui en participent n'arrivent pas à la naissance, s'il n'y a un principe moteur; et il se fait beaucoup d'autres choses, comme une maison et un anneau, dont on ne dit pas qu'il y ait des idées; il est donc clair qu'il se peut que les autres choses aussi soient et deviennent par des causes semblables à celles qui font être et devenir les objets que nous venons de nommer.
Maintenant, si les idées sont des nombres, comment ces nombres seront-ils causes? Sera-ce parce que les êtres sont d'autres nombres , et que tel nombre par exemple est l'homme , tel autre Socrate , tel autre Callias? Mais en quoi ceux-là sont-ils causes de ceux-ci? car, que les uns soient éternels, les autres non , cela n'y fera rien. Si c'est parce que les choses sensibles sont des rapports de nombres, comme est par exemple une harmonie, il est évident qu'il y a quelque chose qui est le sujet de ces rapports; et si ce quelque chose existe, savoir la matière, il est clair qu'à leur tour les nombres eux-mêmes seront des rapports de choses différentes. Par exemple , si Callias est une proportion en nombres de feu, de terre, d'eau et d'air, cela supposera des sujets particuliers , distincts de la proportion elle-même ; et l'idée nombre, l'homme en soi, que ce soit un nombre ou non, n'en sera pas moins une proportion de nombres qui suppose des sujets particuliers et non pas un pur nombre, et on n'en peut tirer non plus aucun nombre particulier.
Ensuite, de la réunion de plusieurs nombres , résulte un nombre unique; comment de plusieurs idées fera-t-on une seule idée ? Si on prétend que la somme n'est pas formée de la réunion des idées elles-mêmes, mais des éléments individuels compris sous les idées, comme est par exemple une myriade, comment sont les unités qui composent cette somme? Si elles sont de même espèce, il s'ensuivra beaucoup de choses absurdes; si d'espèce diverse, elles ne seront ni les mêmes, ni différentes; car en quoi différeraient-elles, puisqu'elles n'ont pas de qualités? Toutes ces choses ne sont ni raisonnables ni conformes au bon sens. Et puis, il est nécessaire d'introduire un autre genre de nombre qui soit l'objet de l'arithmétique, et de ce que plusieurs appellent les choses intermédiaires; autrement de quels principes viendront ces choses ? Et pourquoi y aurait-il des choses intermédiaires entre les choses sensibles et les idées? De plus , les unités qui entrent dans une dualité, viennent chacune d'une certaine dyade antérieure; or, cela est impossible. Et aussi, pourquoi le nombre composé serait-il un? Outre ce que nous venons de dire, si les unités sont différentes, il fallait s'expliquer comme ceux qui admettent quatre ou deux éléments : ceux-ci en effet ne donnent pas comme élément fondamental des choses, ce qu'elles ont de commun, par exemple le corps; mais ils disent que c'est le feu et la terre, que le corps soit ou non quelque chose de commun entre ces éléments : mais ici , on pose pour principe l'unité, comme si c'était quelque chose d'homogène, à la manière du feu ou de l'eau ; s'il en était ainsi, les nombres ne seront pas des êtres; mais il est clair que, s'il y a une unité existante en soi, et que cette unité soit principe, il faut prendre le mot unité dans plusieurs sens; autrement, cela serait impossible.
Dans le but de ramener les choses aux principes de cette théorie, on compose les longueurs du long et du court, c'est-à-dire. d'une certaine espèce de grand et de petit, la surface du large et de l'étroit, le corps du profond et de son contraire. Or, comment le plan pourra-t-il contenir la ligne, ou le solide la ligne et le plan? car le large et l'étroit sont une espèce différente du profond et de son contraire. De même donc que le nombre ne se trouve pas dans ces choses, parce que ses principes , le plus ou le moins, sont distincts de ceux que nous venons de nommer, il est clair que de ces diverses espèces, celles qui sont supérieures, ne pourront se trouver dans les inférieures. Et il ne faut pas dire que le profond soit une espèce du large; car alors, le corps serait une sorte de plan. Et les points, d'où viendront-ils ? Platon combattait l'existence du point, comme étant une pure conception géométrique; d'autre part, il l'appelait le principe de la ligne, il en a fait souvent des lignes indivisibles. Pourtant , il faut que ces lignes aient une limite ; de sorte que par la même raison que la ligne existe, le point existe aussi.
Enfin , quand il appartient à la philosophie de rechercher la cause des phénomènes, c'est cela même que l'on néglige : car on ne dit rien de la cause qui est le principe du changement; et on s'imagine expliquer l'essence des choses sensibles, en posant d'autres essences; mais comment celles-ci sont-elles les essences de celles-là ? c'est sur quoi on ne se paie que de mots, car participer, comme nous l'avons déjà dit, ne signifie rien. Et ce principe que nous regardons comme la fin des sciences , en vue duquel agit toute intelligence et tout être; ce principe que nous avons rangé parmi les principes premiers , les idées ne l'atteignent nullement : mais de nos jours les mathématiques sont. devenues la philosophie toute entière, quoiqu'on dise qu'il ne faut les cultiver qu'en vue des autres choses. De plus, cette dyade , dont ils font la matière des choses , on pourrait bien la regarder comme une matière purement mathématique , comme un attribut et une différence de ce qui est et de la matière, plutôt que comme la matière même : c'est comme ce que les physiciens appellent le rare et le dense, ne désignant par là que les différences premières du sujet; car tout cela n'est autre chose qu'une sorte de plus et de moins. Quant à ce qui est du mouvement, si le grand et le petit renferment le mouvement, il est clair que les idées seront en mouvement : sinon, d'où est-il venu? c'en est assez pour supprimer d'un seul coup toute étude de la nature. Il eût paru facile à cette doctrine de démontrer que tout est un; mais elle n'y parvient pas , car, des raisons qu'on expose, il ne résulte pas que toutes choses soient l'unité, mais seulement qu'il y a une certaine unité existante , et il reste à accorder qu'elle soit tout : or cela , on ne le peut , qu'en accordant l'existence du genre universel, ce qui est impossible pour certaines choses. Pour les choses qui viennent après les nombres, à savoir, les longueurs, les surfaces et les solides, on n'en rend pas raison, on n'explique ni comment elles sont et deviennent, ni si elles ont quelque vertu. Il est impossible que ce soient des idées; car ce ne sont pas des nombres, ni des choses intermédiaires , car ces dernières sont les choses mathématiques , ni enfin des choses périssables ; mais il est évident qu'elle constituent une quatrième classe d'êtres.
Enfin, rechercher les éléments des êtres sans les distinguer, lorsque leurs dénominations les distinguent de tant de manières, c'est se mettre dans l'impossibilité de les trouver, surtout si on pose la question de cette manière : Quels sont les éléments des êtres? car de quels éléments viennent l'action ou la passion ou la direction rectiligne, c'est ce qu'on ne peut certainement pas saisir; on ne le peut que pour les substances; de sorte que rechercher les éléments de tous les êtres ou s'imaginer qu'on les connaît, est une chimère. Et puis, comment pourra-t-on apprendre quels sont les éléments de toutes choses? Évidemment, il est impossible alors qu'on possède aucune connaissance préalable; car quand on apprend la géométrie , on a des connaissances préalables, sans qu'on sache d'avance rien de ce que renferme la géométrie et de ce qu'il s'agit d'apprendre; et il en est ainsi de tout le reste; si donc il y a une science de toutes choses, comme quelques-uns le prétendent, il n'y a plus de connaissance préalable. Cependant, toute science, aussi bien celle qui procède par démonstration que celle qui ni procède par définitions, ne s'acquiert qu'à l'aide de connaissances préalables, totales ou particulières; car toute définition suppose des données connues d'avance; et il en est de même de la science par induction. D'ailleurs, si la science dont nous parlons était innée en nous, il serait étonnant que nous possédassions, sans le savoir, la plus puissante des sciences. Et puis, comment connaîtra-t-on les éléments de toutes choses et comment arrivera-t-on à une certitude démonstrative ? Car cela est sujet à difficulté; et on pourrait douter sur ce point comme on doute au sujet de certaines syllabes : les uns disent en effet que la syllabe DSA est composée des trois lettres D, S, A (54); les autres prétendent que c'est un autre son, différent de tous ceux que nous connaissons. Enfin, les choses qui tombent sous la sensation, comment celui qui est dépourvu de la faculté de sentir, pourra-t-il les connaître? Pourtant , il le faudrait si les idées sont les éléments dont se composent toutes choses, comme des sons composés viennent tous des sons élémentaires.
CHAPITRE IX (retour)
Ainsi donc, il résulte clairement de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, que les recherches de tous les philosophes se rapportent aux quatre principes déterminés par nous dans la Physique, et qu'en dehors de ceux-là il n'y en a pas d'autre; mais ces recherches ont été faites sans précision; et si, en un sens, on a parlé avant nous de tous les principes, on peut dire en un autre qu'il n'en a pas été parlé: car la philosophie primitive, jeune et faible encore, semble bégayer sur toutes choses. Par exemple, lorsque Empédocle dit que ce qui fait l'os c'est la proportion, il désigne par là la forme et l'essence de la chose ; mais il faut aussi que ce principe rende raison de la chair et de toutes les autres choses, ou de rien; c'est donc par la proportion que la chair et l'os et toutes les autres choses existeront, et non pas par la matière, laquelle est selon lui feu, terre et eau. Qu'un autre eût dit cela, Empédocle en serait nécessairement convenu; mais il ne s'est pas expliqué clairement.
L'insuffisance des recherches de nos devanciers a été assez montrée. Maintenant , reprenons les difficultés qui peuvent s'élever sur le sujet, lui-même ; leur solution nous conduira peut-être à celle des difficultés qui se présenteront ensuite.