| index | précédent | suivant |
|---|
3-Racines
J’ai longtemps pesté contre ces racines dont on arguait le plus souvent à titre défensif pour se distinguer de l’autre, l’assaillant toujours qui vous menacerait , de l’étranger, du déraciné, de celui qui est Weltlos comme le dirait Arendt. Et persiste à penser que j’ai raison : je ne suis pas un arbre décidément et répugne à n’être que mes lieux d’origine : l’essentiel n’est-il pas plutôt où nous allons que d’où nous venons ?
Elles m’agacent d’autant plus, ces racines, qu’on les dit judéo-chrétiennes – ce qui ne veut pas dire grand chose mais claque comme un verdict irrécusable ; une fin de non recevoir !
L'épisode Morano d'il y a quelques mois n'en fut que l'épiphénomène vulgaire et racoleur. On devine bien ce que la référence à ces racines-ci peut comporter de rapidement nauséabond quand elle est invoquée par des politiciens au petit pied sans plus trop d'envergure que de culture ou des candidats sans scrupule prompts à invoquer les plus vils réflexes droitiers : tout ressemble trop aux affres d'une culture qui se sent soudain aux abois pour ne pas tenter hérisser frontières et murs ! Pourtant ce sont ces mêmes réflexes identitaires que l'on perçoit, mobilisés, dans les soucis d'une culture d'entreprise ou dans les efforts pris auprès des salariés pour qu'ils parviennent, malgré les injonctions de flexibilité et d'adaptation constante, à s'identifier néanmoins à l'entreprise où ils travaillent.
Tout ici fait, sinon problème, en tout cas question : autant racines que judéo-chrétien et même le tiret qui sépare les deux termes.
En ces temps de parfaite inculture, s’aperçoit-on en utilisant cette formulation stupide qu’on omet :
- Toute la lignée culturelle grecque puis latine
- L’aire commune, la souche judaïque identique au christianisme et à l’Islam
- L’antisémitisme millénaire de l’aire chrétienne qui ne se pique de judaïsme que pour mieux récuser l’islam sans pour autant s’y intéresser jamais, ni s’en soucier vraiment.
Ce qui fait au moins 3 mensonges : beaucoup trop même pour un slogan ; même s’ils ne sont que par omission
Pour autant :
- Si judéo-christianisme est à rejeter, racine mérite d’être pensé, qui pose notre rapport au monde et a l’air de ne l‘envisager que par l’enracinement et donc par la terre, et ainsi, pour parler vrai, de la race
- D’un côté les grecs mais aussi les juifs : en face l’universalisme chrétien – au moins revendiqué
- D’un côté le culte de la terre : de l’autre la perte du monde
Alors quoi ?
judéo-christianisme d'abord
L'expression a une histoire que retrace Sebban ainsi que la méfiance, pour ne pas écrire le refus qu'elle suscite chez les historiens et spécialistes de la question. Il y a bien des raisons à ceci et le fait que le christianisme se soit pensé lui-même comme le successeur du judaïsme, d'autant plus légitime que ce dernier eût été incapable de reconnaître en le Christ le Messie tant attendu n'a pas joué un rôle anodin.
Léon Poliakov avait en son temps illustré combien les juifs avaient pu trouver leur place durant le Haut Moyen-Age au point qu'on y put repérer des familles juives ayant des chrétiens pour serfs : les croisades allaient mettre un terme à ce qui cependant ne fut pas pour autant un âge d'or. L'antijudaisme -théorique, théologique - allait soudainement prendre une réalité sociale et donner lieu à un discours bien plus vindicatif que celui d'un Augustin avec sa théorie du peuple témoin. Peuple désormais coupable, déicide, on lâchera les haines populaires contre lui tout en maintenant un discours tolérant mais condescendant à son égard.
 Qui peut oublier la synagogue aveugle de Strasbourg ?
Qui peut oublier la synagogue aveugle de Strasbourg ?
Ce qu'on ne saurait nier c'est que l’Église chrétienne s'est construite, non à partir du judaïsme mais contre lui au moins en le considérant comme failli, comme achevé. Ce qu'on ne saurait nier c'est la profonde méconnaissance qui s'en suivit. Si les Pères de l’Église cherchèrent aussi dans l'histoire biblique les assises de la religion nouvelle, jamais ils ne s'intéressèrent au judaïsme de leur époque qui se résuma toujours pour eux en une secte d'entêtés. Ce qu'on ne saurait nier c'est que l'universalisme chrétien pour réel et novateur qu'il fut, n'en demeura pas moins un universaliste très auto-centré : universalité oui, à condition qu'on en donnât soi-même le la. Cette incroyable méconnaissance, fruit assurément de cette étonnante présomption à s'ériger en continuateur d'une histoire que dès lors on présume achevée, on la repérera bien plus tard à l'égard de l'Islam.
la différence abyssale existant entre la religion théocentrique, à savoir la religion dans laquelle la fin de l’homme est le service de Dieu, et la religion anthropocentrique, c’est-à-dire la religion dans laquelle Dieu n’est rien d’autre que l’instrument approprié à la satisfaction du besoin de rédemption de l’homme.
LeibowitzConstitué contre le judaïsme, le christianisme en est également aux antipodes selon Y. Leibowitz : la position qu'adopte ce dernier est parfois rude, non dénuée ici et là de mauvaise foi, ne serait-ce qu'en invoquant la figure effacée des marcionites comme seuls susceptibles d'entamer un quelconque dialogue avec le judaïsme, néanmoins tant d'un point de vue théologique qu'historique, il n'a pas tort en soulignant qu'un dialogue semble difficile avec un interlocuteur qui nie jusqu'à la légitimité de votre existence.
D'où la glissade de la culture à la morale judéo-chrétienne présumant ici au moins un fond commun assis sur le Décalogue. Cette glissade tient autant, d'un côté, à la constitution progressive à partir du XIXe d'un État sinon laïque en tout cas moins soucieux de privilégier l'appartenance religieuse comme ciment social et, de l'autre, celle de la présence désormais reconnue et émancipée d'une population juive en quête d'intégration. Que tout ceci se fît, en France notamment, sur fond de l'idéologie des Lumières vivifiée par l'esprit de 89, prolongé quoique assagi jusque dans la pensée des fondateurs de la IIIe ne compta évidemment pas pour peu. Mais cette glissade tint aussi, et ceci dès le XVIIe , à la division des Églises, incapables dès lors de fournir cet appui aux États en train de se renforcer et d'affirmer leur raison spécifique, États qui iront dès lors le puiser dans une morale conçue comme universelle. [1]
Ainsi l'apparition de l'expression, loin de désigner une réflexion théorique moins encore une convergence idéologique, traduit seulement la visibilité sociale et parfois politique d'une population juive qui s'intègre, ou le tente toutefois. En somme l'expression judéo-chrétien est de nature intrinsèquement idéologique et politique mais certainement pas religieuse ni morale.
Qu'il y ait lieu de se réjouir d'un dialogue désormais plus apaisé entre judaïsme et chrétienté, notamment l'Église catholique qui a depuis Vatican II cessé au moins de prétendre à une hégémonie exclusive et jalouse est une évidence que la délicieuse mauvaise foi provocatrice de Leibowitz ne saurait dissimuler ; que l'anti-judaisme, qui n'a pas toujours été un antisémitisme et ne fut en tout cas jamais entendu d'un point de vue racial, ne soit plus porté par une institution aussi puissante que Rome est une avancée incontestable qui ne cache pourtant pas que, porté par les droites extrêmes et nationalistes à chaque crise, droite extrême dont il ne faut pas dissimuler qu'elle a le vent en poupe dans toute l'aire politique européenne, l'antisémitisme fonctionne comme un abcès de fixation terriblement efficace et dangereux, renaissant d'autant plus violemment de ses cendres qu'on avait pu le croire éteint. [2]
Racine ou héritage ?
S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit ;
On l'a oublié, mais la première mouture de la constitution européenne avait fait débat dans les années 2000, précisément parce qu'elle faisait mention de son héritage culturel, humaniste et religieux. On se souvient peut-être encore que Rome ne s'était pas fait faute de se mêler au débat en revendiquant haut et fort cet héritage allant jusqu'à évoquer l'idée d'apostasie à l'ide d'une Europe niant ses origines. [3]
On se souviendra peut-être enfin que Sarkozy au tout début de son mandat décembre 2007 - s'empressa de se rendre à St Jean de Latran dont historiquement le président de la République française est chanoine, pour affirmer non plus l'héritage mais ses racines chrétiennes affirmant à cette occasion pourvoir les concilier avec une laïcité enfin positive. [4]
Les deux métaphores se succèdent souvent ; elles ne sont pourtant pas strictement équivalentes. Un héritage se transmet mais celui qui le reçoit en dispose à sa guise et peut tout aussi bien le dilapider si tel est son bon plaisir, sa volonté déterminée ou son impuissance à faire autrement. Les racines au contraire, sous source de vie qu'elles extraient de la terre dont elles sont indissociables, cette terre dont on nous a tant rabâché qu'elle ne mentait pas. Les arracher, les nier c'est mourir - formellement Benoît XVI savait ce qu'il disait.
Historiquement, il n'a évidemment pas tort : l'Europe médiévale fut éminemment chrétienne ce qui ne l'empêcha pas d'être divisée pour autant. On a peine au reste à saisir l'emprise que l’Église eut sur la société médiévale, tant civile qu'institutionnelle et ce sera même celle-ci, par le contre-poids qu'elle exerça sur les monarchies qui les empêchèrent d'être tout à fait absolues. Sacre et crainte de l'excommunication conférèrent à la fois légitimité et limites au pouvoir royal. Et l'on voit bien, dans le souci robespierriste d'un culte de l’Être suprême, dans la fondation comtienne d'une religion de l'Humanité perçue comme indispensable, dans le débat enfin qui anima la République de 1881 puis celle de la Séparation de 1905 combien la recherche d'une morale laïque qui ne se voulut pas identique à la morale chrétienne mais ne put pas non plus s'en abstraire totalement, combien cette morale était incontournable et à rechercher dans le passé.
Mais héritage renvoie évidemment à mort et à Testament et donc bien au contentieux lourd entre judaïsme et christianisme, ce dernier s'érigeant en continuateur seul légitime d'une histoire - mal - terminée. Ce n'est pas tant d'ailleurs le terme lui-même qui fit désigner les deux grandes parties de la Bible chrétienne qui fait problème que de tenir des textes pour canons non retenus par la Bible hébraïque, que surtout en estimant cette dernière close quand tout dans la pensée juive stipule et exige que la tradition écrite se prolonge dans la tradition orale au moins autant que dans l'observance scrupuleuse par chacun de la Loi. A proprement parler, Rome achève Jérusalem - dans les deux sens du terme.
Quelle malhonnêteté intellectuelle camoufle-t-on derrière ces racines que l'on revendique au moins autant qu'on en cache - ou nie - une partie ? Qu'excave-t-on ? qu'ensevelit-on ? Tous les rites de fondations, on le sait, participent de ce double mouvement d'enfouissement et d'extraction. Rome à la fois enfouit ses cadavres, et d'abord celui de la mère puis celui du frère, mais érige immédiatement un Temple sur les lieux même de la tombe muette.
Il faut écouter la langue, elle dit tout ou presque, de ce qu'il faut y comprendre : διαθήκη est une déclinaison de θήκη caisse, cercueil, tombeau. Le terme est intéressant trois fois :
- Le radical θe signifie poser, placer qui nous renvoie immédiatement à θeos et donc à la divinité mais aussi à théâtre et théorie ... ce qui brille et donc se contemple
- On sait que le forum a été construit précisément sur un enclos qui servait de tombes et renvoie pour le moins au culte des morts
- L’alliance est un contrat et renvoie à la fois au droit et à la morale Pour autant, il est impossible de la considérer comme un contrat anodin : ce ne saurait être un pacte entre égaux ; entre équivalents ! si l'on voit bien ce que l'homme y reçoit ou gagne, on voit en revanche mal ce que Dieu y céderait ou gagnerait.
Qu'est-ce à dire ? Que ce dont on parle ici, ces racines ou cet héritage, qu'importe, relève du sacré, du tabou par excellence à quoi on pense toujours, dont on ne parle pas, que nommer même serait parjure. Veut-on dire par là qu'il n'est pas de société qui ne puisse s'ériger et prolonger sans un socle partagé de valeurs mais c'est une évidence ! que toute société les trouve prêtes à l'emploi dans un passé plus ou moins mythique et dès lors malaisément définissable sans doute. Mais c'est oublier consciemment d’ailleurs qu'il n'est pas de passé qui ne fasse l'objet d'une reconstruction rétrospective, d'ailleurs répétée et réarrangée à chaque période en raison des prismes et perspectives du moment.
Cette expression qui apparaît la première fois vers 180 dans un ouvrage de Méliton de Sardes sous la forme « παλαιας διαθήκη » (ancienne alliance) désigna par opposition, les textes antérieurs au Nouveau Testament. Le Concile de Laodicée officialise l’expression vers 360 en parlant d’Ancien testament et de Nouveau Testament. La traduction du grec διαθήκη a hésité entre testamentum (disposition testamentaire) et instrumentum (preuve d’une instruction). L’usage de « testamentum » en tant que volonté de Dieu s’est imposé, donnant « Vetus Testamentum » et « Novum Testamentum »[ mais on le comprend bien si le sens demeure d'un passage vers une ère nouvelle parachevant un passé révolu, ce n'est pas tout-à-fait la même chose que d'évoquer testament ou alliance.
Oui, tout ceci est bien caché ; l'est tellement que se piquant d'invoquer nos valeurs - toujours traditionnelles - on se trouve bien vite impuissant à seulement les nommer et que les présupposés les plus solides se sont pourtant effrités depuis 45 : notamment l'évidence de ces valeurs et l'idée qu'elles transcendent toute législation particulière.
Voudrait-on plutôt évoquer nos racines que le propos n'en serait ni plus acceptable, ni plus clair. C'est, à l'évidence, vouloir renouer avec les logiques d'appartenance avec lesquelles le christianisme se fut pourtant proposer de rompre : Il n'y a plus ni juifs ni grecs, écrit Paul. Serait ce à dire que cette appartenance ne fût que brièvement suspendue - le temps de rompre avec le judaïsme - pour prévaloir à nouveau s'agissant de l'universalisme chrétien ? que vivre dans l'aire européenne vous y arrimerait inéluctablement ?
Quelle que soit l'approche que l'on adopterait pour en rendre compte, racines est détestable qui draine les mêmes haine de l'autre et soumission pas même volontaire : on a ici un exemplaire parfait de ce que Sartre nommait mauvaise foi par où l'on réduit l'autre à ce qu'il est, donc a été, lui interdisant toute évolution, tout chemin qui s'en écartât. Qu'il soit confortable pour chacun de sur-jouer une quelconque essence, s'assurant ainsi une place dans la cité et la considération des autres, on n'en peut douter ; que les formes parfois revêches qu'adopte le pouvoir ou simplement l'idéologie dominante pour vous y enfermer, oui bien sûr. Pour autant, il y va bien de l'humaine condition qu'entre l'en-soi et le pour-soi toujours surgissent des écarts, des tensions. Les nier n'a d'autre nom qu'aliéner. Racine n'est autre que la rémanence putride de la peur, du refuge hâtif autour de quelques pseudo-certitudes et je crains bien qu'il n'ait rapidement d'autre synonyme que haine, en tout cas mépris, de l'autre.
Je veux bien que nulle cité ne puisse se fonder sans tracer des lignes et des principes qu'elle enfouit pour les ériger en temple. Faut-il pour autant que ces frontières ainsi tracées soit étanches et dessinent la négation de l'autre ; de l'étranger ? Même les grecs, pourtant si fiers de leur terre, si arc-boutés sur une autochtonie que l'on aura toujours trop vite fait d'assimiler à une xénophobie, même les athéniens surent toujours qu'il n'est de cité définitivement close sur elle-même ; qu'invariablement elle doit régler les rapports entretenus avec l'autre. Que Rome n'eût d'autre choix, ville sans femme et sans histoire, que de vouloir happer tout ce qui lui était extérieur au point d'avoir inventé la première forme réussie d'universalité politique se comprend à l'aune de la Grèce qui, au contraire vécut toujours dans le mythe plus rêvé qu'institué d'une autochtonie qu'elle savait ne pas pouvoir rimer avec autarcie. Mais Athènes était hantée par le risque de l'hybris et s'effondra d'ailleurs sitôt qu'elle y succomba. En réalité Athènes, qui toujours nourrit des contacts étroits avec les xénoï et savait à l'occasion les admirer - Perses et Égyptiens surtout - Athènes, qui n'a pas pour rien formé ce couple étrange entre Hestia et Hermès, Athènes représente le point de jonction exact entre l'intérieur et l'extérieur, entre la soumission et l'invention : la démocratie fondée est la preuve péremptoire d'une loi des Pères qu'on se refusa à observer servilement en même temps que de la conscience de la fragilité de tout ordre qu'il faudra toujours protéger. Mais ce qu'il y a de spécifique à Athènes tient précisément au fait que le danger y soit tant intérieur qu'extérieur, que le péril de l'hybris ne soit ni plus étranger que grec.
Ce qui change tout !
Malhonnête ou simplement négligente, cette référence aux racines ne traduit pas seulement une prodigieuse inculture si caractéristique pourtant de cette période désarmée d'avoir cru tant osé. Elle dit, sous l'aune de la nécessaire adaptation, sous l'égide de l'impérieuse flexibilité, la nécessité de se soumettre aux contraintes dont les racines ne sont jamais que le truchement nécessaire. Nicher un peu de culture, la plus réactionnaire possible, la plus figée en tout cas, comme promontoire à tous les renoncements, voici bien dans la manière funeste de notre temps. Ces trabans, sans aveu, mais avec foi et loi - la leur - réinventent la plus grande régression mentale qui soit, donnent tout son sens au mot obscurantisme.
Taisez-vous Messieurs les donneurs de leçons : vous n'êtes que les ultimes ectoplasmes d'une revanche toujours à prendre sur vos propres peurs, d'un revanche qui suinte la haine et la mort. Jamais, j'écris bien jamais, dans l'histoire vous ne fûtes autre que des parangons de servilité ; toujours, au nom de beaux principes, vous vous fîtes les alliés des divines surprises extrémistes. La morale, pour vous, n'est que le paravent tellement grossier de vos visées autoritaires. Qu'un peuple égaré en vienne à estimer souhaitable ce repli nécrophile sur soi en dit long sur la réalité fétide de votre pseudo-libéralisme : sous le pragmatisme apparemment raisonnable, pointe inexorablement un pétainisme à peine réajusté et le vent sinistre de tous les abandons.
1) Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 153-212
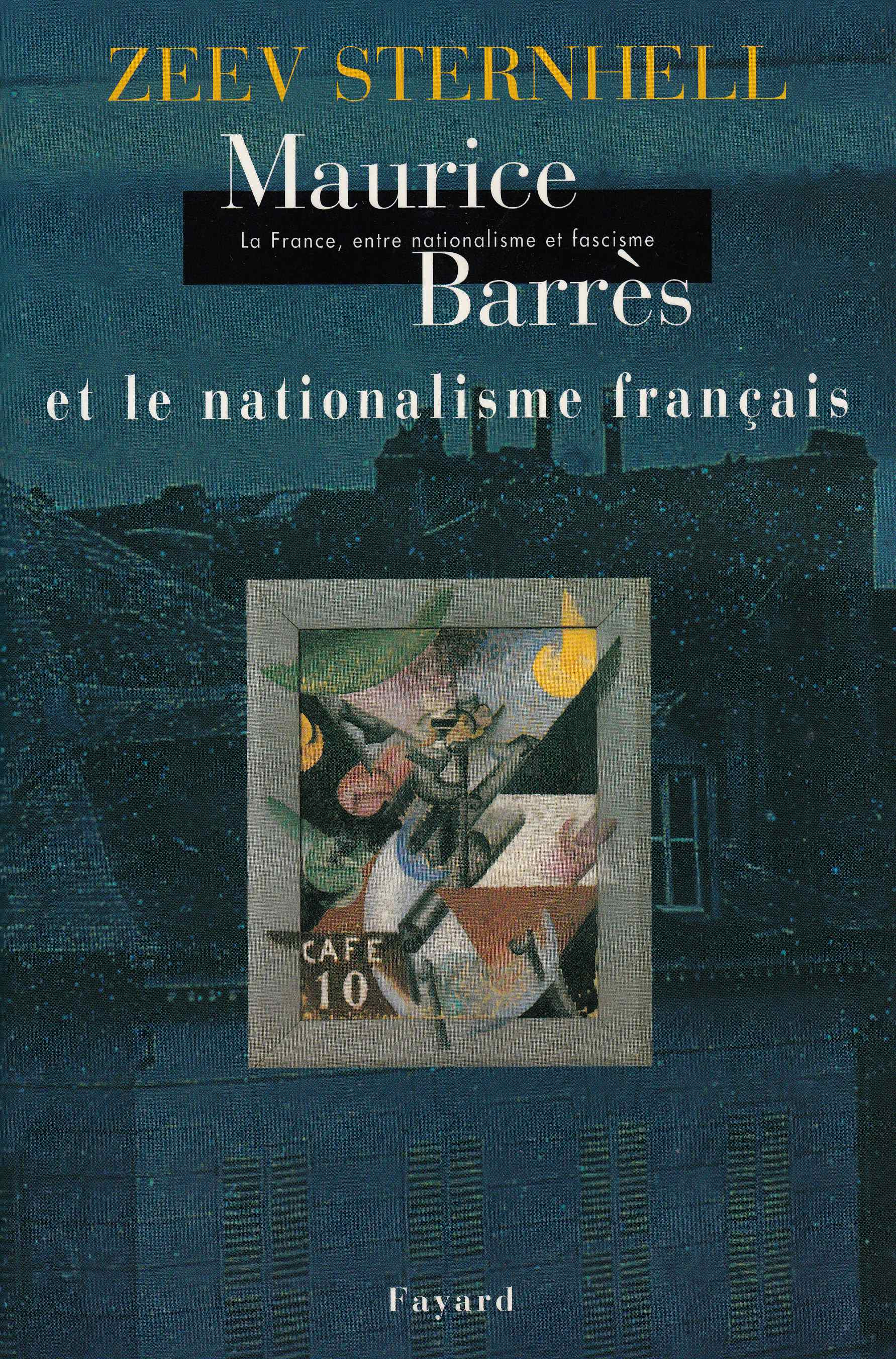 2) il n'est qu'à se souvenir des analyses faites par Z Sternhell
2) il n'est qu'à se souvenir des analyses faites par Z Sternhell
À la fin du XIXe siècle, le climat intellectuel de l'Europe marque une nette évolution qui contribue à créer une orientation politique nouvelle. En France, en Allemagne, en Russie, en Autriche-Hongrie, en Italie, des phénomènes apparaissent qui, au-delà de leurs aspects spécifiques dus aux conditions locales, présentent une analogie fondamentale. Dans ces pays, en effet, un même malaise existe. Et malgré les formes multiples que celui-ci a pu revêtir, il est partout reconnaissable à son expression: remise en cause de l'ensemble des idées et des institutions caractéristiques de la civilisation industrielle et négation systématique des valeurs héritées duXVIIIe siècle et de la Révolution française. C'est ainsi que des hommes et des mouvements, évoluant dans des situations politiques pour le moins dissemblables, ont pu parvenir à des conclusions identiques. Il s'agit bien là de premiers frémissements d'un monde nouveau.
Les changements qui interviennent alors, et ce en l'espace d'une génération, sont si profonds qu'il n'est pas exagéré, en les évoquant, de parler de révolution intellectuelle. Une révolution qui annonce et prépare, par ses thèmes comme par son style, la politique des masses propre à notre siècle. Car le vaste mouvement de pensée des années 1890 est d’abord un mouvement de révolte, un « souffle de révolte » disait le jeune Barrès, Un mouvement dirigé contre le monde de la matière et de la raison, contre le matérialisme et contre le positivisme, contre la société bourgeoise et sa médiocrité, contre la démocratie libérale et ses incohérences. Dans l'esprit de la génération de ces années-là, la civilisation est en crise, une crise à laquelle il ne peut être de solution que totale.
3Benoît XVI à l'occasion du 50e anniversaire du Traité de Rome
« On ne peut pas penser édifier une authentique ‘maison commune’ européenne en négligeant l’identité propre des peuples de notre continent. Il s’agit en effet d’une identité historique, culturelle et morale, avant même d’être géographique, économique ou politique ; une identité constituée par un ensemble de valeurs universelles, que le christianisme a contribué à forger, acquérant ainsi un rôle non seulement historique, mais fondateur à l’égard de l’Europe. Ces valeurs, qui constituent l’âme du continent, doivent demeurer dans l’Europe du troisième millénaire comme un ‘ferment’ de civilisation. Si elles devaient disparaître, comment le ‘vieux’ continent pourrait-il continuer de jouer le rôle de ‘levain’ pour le monde entier ? (…) N’est-il pas surprenant que l’Europe d’aujourd’hui, tandis qu’elle vise à se présenter comme une communauté de valeurs, semble toujours plus souvent contester le fait qu’il existe des valeurs universelles et absolues ? Cette forme singulière d’‘apostasie’ d’elle-même, avant même que de Dieu, ne la pousse-t-elle pas à douter de sa propre identité ? »
4) ici le texte complet de l'allocution
