| index | précédent | suivant |
|---|
Identité : le grand retour

Curieux entretien, assurément, que celui-ci : non seulement par les conditions dans lesquelles il se sera déroulé - à distance, au moment même où Macron dépisté positif s'était isolé - mais par sa longueur également. L'un étant peut-être à rapprocher de l'autre : la mise à distance est toujours propice à réflexion, elle est au reste ce qui la rend possible. Je ne suis pas sûr que la pensée, surgie au milieu du brouhaha de la place publique, soit, puisse être, pertinente. Le voici condamné, contraint et forcé, à la librairie.
Au point que la journaliste, présentant l'entretien, prête aux propos présidentiels des accents « presque aussi métaphysiques que politique » ! Savourons le presque. Le sarcasme me pousserait presque à souligner que le journalisme voit de la métaphysique dès qu'il repère une idée plus coutumier qu'il demeure des faits que de la pensée dont on lui a appris à se méfier ; mais il faut reconnaître que Macron qui se flatte de sa formation philosophique, ou le laisse croire en tout cas, truffe son entretien de lectures et références historiques (Maurice Agulhon, Marc Bloch, Benjamin Stora) au moins autant que politiques (Giscard, Mitterrand, Sarkozy et même Chevènement) ou implicites (Girard, Arendt, Rosanvallon) explicites (Maurras) sans compter les figures historiques marquantes (Colbert)
Tout y passe : de la représentation de l’État à celle de la France en passant par celle du peuple ; des blocages successifs aux perspectives … on peut reprocher beaucoup à Macron ; certainement pas de n'avoir pas de théorie ni de projets. Il brasse large ! il rêve de système. Il y a du A Comte chez cet homme-là ! Si on le laissait faire il se piquerait à son tour de fonder une religion.
C'est d'ailleurs tout le problème avec lui si l'on veut être honnête : le propos est tout sauf absurde qui sait parfois s'aérer des poncifs technophiles ; sait même parfois être séduisant. Ah je n'oublie pas le faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui du discours au Congrès de 2017 immédiatement après les élections présidentielles puis législatives.
En chacun de nous il y a un cynique qui sommeille. Et c'est en chacun de nous qu'il faut le faire taire, jour après jour. Et cela se verra. Alors nous serons crus. Alors nous rendrons le service que le peuple français attend de nous. Alors nous resterons fidèles à cette promesse de nos commencements, cette promesse que nous tiendrons parce qu'elle est la plus grande, la plus belle qui soit : faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui.
Mais en face de ce propos ? Le moins que l'on puisse dire est que le chemin reste bien obstrué qui va de la parole à l'acte. Nous ne pouvons oublier ni les paroles maladroites sur les premiers de cordée, ni celles expéditives sur le il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail ; ni celles surtout, méprisantes ou qui le parurent telles sur le pognon de dingue ; ni les mesures d'une rare violence sociale et l'inappétence à l'écoute à l'occasion des réforme de la SNCF, des retraites ou même des universités comme si tout ce bel équipage théorique n'avait jamais eu de sens que d'embellir sordides et bien étroites visées libérales.
Il y a dans cet entretien une tentative d'explication du désaveu qu'endure le politique : à bien y regarder Macron y voit des explications autant dans les circonstances que chez les français eux-mêmes. Pas dans le politique lui-même. Etrange incapacité à se mettre en jeu contrairement à ce qu'il énonce pourtant. On ne me fera pas croire que la distance prise à l'encontre des politiques et du politique par un peuple qui effectivement est depuis bien longtemps passionné de politique, ne tienne pas, en partie importante, dans ces jeux de cirque qui, de manière explicite depuis Chirac, implicite depuis Mitterrand, firent des campagnes électorales des exutoires purgatifs où tout était possible et dicible; où les promesses n'engageaient que ceux qui voulaient bien y croire … où la distance demeurait cyniquement abyssale entre le programme et les réalisations.
Je sais bien l'histoire ne jamais se répéter mais elle montre au moins que si le peuple sait être patient, ses colères surent être terribles.
Reprenons :
Sur le peuple
Je n'ai jamais été très convaincu par les généralisations hâtives ou les classifications paresseuses. La France ou le peuple français ne sont pas des catégories universelles, encore moins éternelles que trois ou quatre qualificatifs soigneusement sélectionnés permettraient de correctement cerner. Le peuple français n'est pas révolutionnaire parce qu'il fut l'acteur de la grande Révolution ; pas plus d'ailleurs qu'il n'est conservateur - il est sans doute les deux à la fois, selon les circonstances ; successivement ou simultanément.
Macron, avisé, se contente d'un terme qui engage à peu mais lui fait néanmoins tremper les doigts dans le pot de confiture. Peuple de paradoxes, dit-il, au pluriel. Mot fourre-tout puisqu'il peut désigner à la fois contradiction, contradiction apparente mais pas réelle ; opinion allant seulement à l'encontre de la croyance vulgaire ou, enfin ambivalence. Même si ceci va effectivement à l'encontre de l'opinion que d'un être, chose ou vivant, on puisse à la fois dire l'un et son contraire. Voici bien au reste l'une des fragilités tant de la dialectique que de la pensée complexe : il y aura toujours un biais permettant de fuir toute critique puisqu'on aura dit en même temps l'un et son opposé.
 On aura beaucoup glosé sur ce en même temps aux périodes de grâce de son mandat - la toute première année juste avant que l'affaire Benalla ne détraque la mécanique si bien ordonnancée, comme si ce fût là signe impérieux et furieusement original du génie présidentiel. Elle a même fait l'objet d'une notice Wikipédia. Les références montrent comment chacun y va de son interprétation - fût-elle psychanalytique - mais surtout comment l'expression hautement contagieuse envahit l'univers du discours, chez les courtisans bien sûr, mais aussi chez tous ceux qui vivent de la table (parole) du maître : les journalistes et autres commentateurs. On peut y suspecter la faiblesse de l'indécision - d'aucuns le feront mais un peu plus tard - ou même la martingale de qui ne peut être alors démenti.
On aura beaucoup glosé sur ce en même temps aux périodes de grâce de son mandat - la toute première année juste avant que l'affaire Benalla ne détraque la mécanique si bien ordonnancée, comme si ce fût là signe impérieux et furieusement original du génie présidentiel. Elle a même fait l'objet d'une notice Wikipédia. Les références montrent comment chacun y va de son interprétation - fût-elle psychanalytique - mais surtout comment l'expression hautement contagieuse envahit l'univers du discours, chez les courtisans bien sûr, mais aussi chez tous ceux qui vivent de la table (parole) du maître : les journalistes et autres commentateurs. On peut y suspecter la faiblesse de l'indécision - d'aucuns le feront mais un peu plus tard - ou même la martingale de qui ne peut être alors démenti.
Si tu n'as aucun talent, passe à la critique. Si tu n'as aucun talent critique, établis les textes, prends-les simplement comme objets. Si tu ne sais rien construire, passe au commentaire, la destruction même travaille en ta faveur et pour ton illustration. Si tu ne peux inventer de vérité, passe vite à l'épistémologie. Si ta philosophie ne vaut rien, passe au métalangage, où tu pourras dire qu'elle vaut. Si tu ne sais rien faire, fais de la publicité. Change d'ordre : le semi-conducteur travaille pour toi. Les stratégies incontournables passent par ces tricheries-là. Si tu es nul, fais-toi roi, fais-toi dieu, parle, en tout cas. Serres, Rome
Qu'importe au fond ! spécifique de ces propos : très dissertation d'élève voulant briller cette tendance à truffer la phrase de références explicites ou mieux encore implicites. Elles seront beaucoup historiques ici, mais pas exclusivement. Parfois discrètes ; pas toujours.

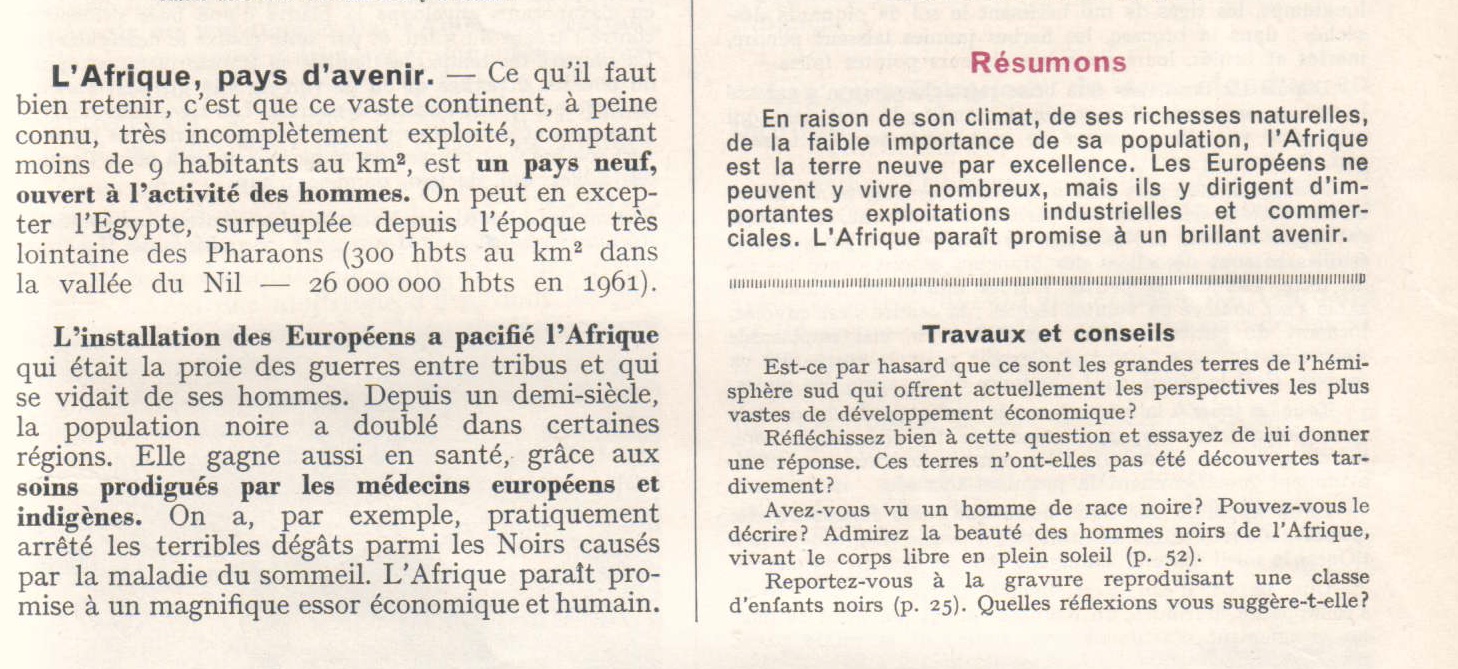 Il faut dire que des allégations de ce genre sur le peuple français - ou sur d'autres d'ailleurs - entrent dans le catalogue déjà assez fourni des préjugés et autres stéréotypes. Sans doute faudrait-il relire Otto Klineberg sur ces représentations que nous véhiculons, sans trop de vergogne, sur nous-mêmes et les autres . Inutile de se moquer : j'ai appris de la vie autant que de la philosophie combien réside ici le premier préjugé que de s'en croire prémuni. Le barbare c'est celui qui croit en la barbarie ! Ce qui n'est pas raison pour ne s'en pas défier. Car les discours sur l'ingratitude des peuples ou leur ingouvernabilité font légion. Qui a oublié le Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage attribué à Ch de Gaulle ?
Il faut dire que des allégations de ce genre sur le peuple français - ou sur d'autres d'ailleurs - entrent dans le catalogue déjà assez fourni des préjugés et autres stéréotypes. Sans doute faudrait-il relire Otto Klineberg sur ces représentations que nous véhiculons, sans trop de vergogne, sur nous-mêmes et les autres . Inutile de se moquer : j'ai appris de la vie autant que de la philosophie combien réside ici le premier préjugé que de s'en croire prémuni. Le barbare c'est celui qui croit en la barbarie ! Ce qui n'est pas raison pour ne s'en pas défier. Car les discours sur l'ingratitude des peuples ou leur ingouvernabilité font légion. Qui a oublié le Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage attribué à Ch de Gaulle ?
Il y a quelque chose de quasi infantile dans ces poncifs sur le peuple : quelque chose s'y joue qui ressemble terriblement au c'est pas moi c'est l'autre des cours de récréation de notre enfance. Quelque chose d'agaçant ; de terriblement décevant en tout cas.
Car enfin même si l'on peut admettre que gouverner soit devenu plus complexe encore qu'auparavant, il n'empêche que gouverner revient à gérer l'imprévu voire l'imprévisible et que nul, que je sache, n'a contraint les puissants du jour à en postuler la charge. Car enfin, en bonne et saine démocratie, le peuple est le souverain et il ne saurait être de pouvoir qui n'émane de lui. Qu'en démocratie représentative, le peuple soit de fait exclu du jeu régulier, on l'entend bien - pouvoir par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple … mais sans lui - les principes, d'être premiers, sont nécessairement en-dehors au même titre que les règles du jeu restent nécessairement hors compétition. Que l'outil de l'ordre devienne une fin en soi et s'empare du pouvoir, ceci s'appelle un coup d’État ; que le peuple, quelles que soient les raisons de son insatisfaction, entre dans l'arène et fait pression au-delà des normes convenues et constitutionnellement acceptées de la grève ou de la manifestation, c'est bien alors d'une révolution dont il s'agit.
Les meurtres des victoires s'exercent ordinairement par le peuple et par les officiers du bagage ; et ce qui fait voir tant de cruautés inouïes, aux guerres populaires, c'est que cette canaille de vulgaire, s'aguerrit et se gendarme, à s'ensanglanter jusques aux coudes et à déchiqueter , un corps à ses pieds, n'ayant ressentiment d'autre vaillance :
« Le loup et les ours répugnants s'acharnent sur les mourants, comme toutes les bêtes de race vile » ; comme les chiens couards, qui déchirent en la maison et mordent les peaux des bêtes sauvages qu'ils n'ont osé attaquer aux champs
Montaigne, Essais II, 27 citation d'Ovide Tristes III, v 35
Toujours alterneront ces images contradictoires ou ambivalentes - c'est selon, surtout selon la posture que l'on veut adopter - entre un peuple nécessairement bon sociable et la bête, brute, sanguinaire, sans aveu ni moralité. Il n'est qu'à lire Montaigne : la comparaison animalière n'est jamais loin pour fustiger l'irruption du peuple qui ne saurait être que désastreuse ; détestable. D'entre le XVIe et le XVIIIe, les Lumières : on imputera plutôt la violence populaire à la naïveté ou à l'ignorance et non plus à la bestialité mais, identiquement, le peuple acteur de l'histoire se présente toujours sous l'aune de la furie, de la violence ; comme une catastrophe.
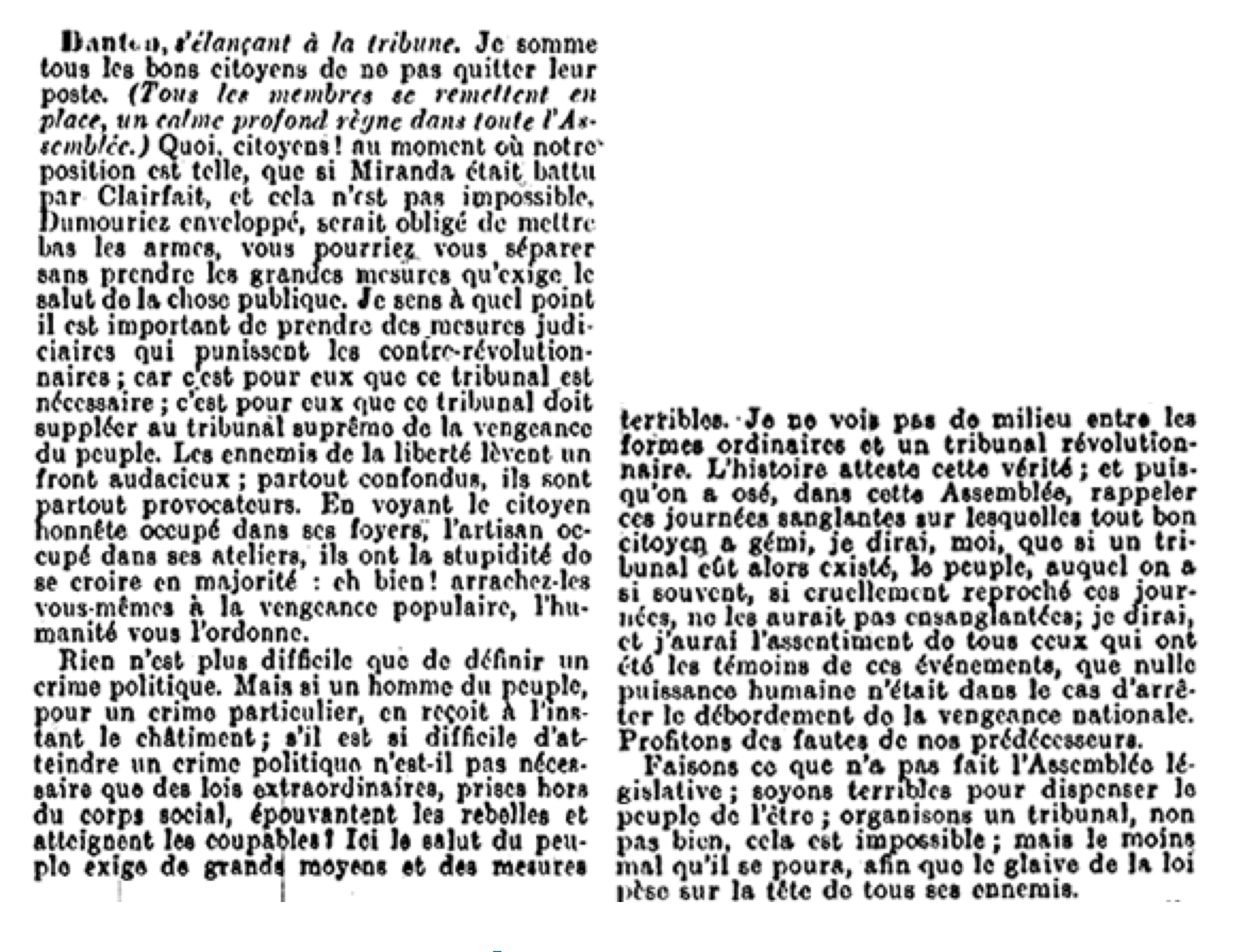
Mais c'est bien ici Danton qui eut raison lorsqu'il déclarera le 10 mars 93: si le peuple déborde et s'adonne à une violence évidemment détestable, ce n'est pas à cause d'une nature maligne mais de la peur qu'il éprouve ou du sentiment d'avoir été trahi, en tout cas délaissé.
Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être !
Car Danton dit deux choses également importantes : d'abord que la violence populaire est toujours le résultat d'une défaillance du politique ce qui est une autre manière de rappeler que l'état normal des choses politiques est bien celui où il s'en remet à la représentation nationale et que son irruption dans le champ politique est toujours une provisoire - et souvent dangereuse - exception qui ne saurait être fondatrice. Mais il dit aussi l'absolue pureté et innocence du peuple qui est réaffirmé en sa dignité de principe sacré. Au fond, la distribution des rôles est assez claire dans l'esprit de Danton : c'est à l'Assemblée, c'est au politique de faire quand il le faut, le sale travail, mais de toute manière de traduire politiquement les demandes du peuple pour lui permettre de demeurer dans le ciel pur des idées et des principes. Prises ensemble ces deux choses disent l'essentiel du politique qui pourraient prêter à sourire tant la révolution se voulut à l'écart de tout préjugé religieux où elle n'a cessé de considérer une large part de la source des troubles dont la société souffrait, si ne s'y jouait pourtant la cohérence de tous les rites de fondation.
De ce point de vue, rien que de ce point de vue, mais déjà de ce point de vue, cette imputation à la nature du peuple des difficultés du moment sonne de bien étrange manière.
haut de pageSur notre rapport à l’État
Que la France n'ait pas le même rapport à l’État que, notamment, les pays anglo-saxons, nul ne n'ignore ni ne s'en étonne. Le problème ne commence à se réellement poser qu'au double moment où l'on prône le libéralisme comme panacée universelle et où l'on persévère à placer le modèle américain au pinacle de ce qu'il faudrait imiter. Sauf à considérer que les USA se sont construits autour de la double jalousie des prérogatives des 13 colonies fondatrices, dans la même détestation en tout cas méfiance à l'égard d'un Etat fédéral dont il fallut limiter et surveiller étroitement les pouvoirs. Tout au contraire de la France, tôt construite autour d'un Etat centralisé et fort - dès Louis XI : comment s'étonner alors qu'il soit vu comme le principal acteur ; l'indispensable recours en période de crise où tout va mal ou celui qu'il faut transformer en cas de crise grave. Rien d'étonnant qu'on en change l'architecture après une défaite (1870 ; 1940) ou après son évidente incapacité à résoudre un problème (1958) ; rien d'étonnant non plus à ce que le pays mît du temps en en trouver forme acceptable après le séisme de 89 - 10 changements de régimes entre 1789 et 1975) .
Quand même ce fût un doux rêve, sans doute parfaitement adapté à la croissance étonnante des Trente Glorieuses, ç'aura été néanmoins le sens de cette fameuse 3e voie que cherchait de Gaulle : c'était surtout faire passer le politique d'abord et conférer à l’État, l'ardente obligation du Plan faisant partie du dispositif, un rôle économique moteur : les grandes réussites économique de l'époque furent ainsi toutes des initiatives publiques. Se tenir à égale distance du laisser passer laisser faire ainsi qu'il nomme le libéralisme où l’État se cantonnerait à gérer police, justice, armée et politique extérieure et du communisme soviétique où il avait engouffré tous les aspects de l'activité sociale, revenait à poursuivre les réformes de la Libération et à faire de l'initiative publique et des grandes entreprises nationalisées (banques ; énergie; automobile …) le grand aiguillon de la modernisation d la société.
Par ailleurs, et par quelque bout qu'on le prenne, il n'est pas une grande avancée politique ou sociale qui ne fût à l'initiative publique - et le plus souvent d'un pouvoir de gauche : ni les congés payés ni la semaine de 40 h n'auraient été adoptés sans la victoire du Front Populaire ; ni la Sécurité Sociale ni le système des retraites sans l'union présidant à la Libération ; rien de la réduction du temps de travail, ni la réforme du droit du travail, ni les commencements de la décentralisation, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés …
Est-ce à véritablement à l’État que l'on reproche tout où aux successives générations de politiciens qui, sous prétexte de liberté ont conjugué réforme sous toutes les formes possibles de la régression sociale ? Comment ne pas voir l'invraisemblable mystification de la dérégulation sous l'égide d'une pseudo-autorégulation ; de la financiarisation de l'économie ; de la très rapide désindustrialisation sous le prétexte d'une mondialisation dévoreuse d'emplois ici, créatrice d'emplois à très bas coûts ailleurs.
Comment ne as se rappeler que l'électorat, effectivement, a systématiquement regimbé devant l'aveu d'impuissance : quand Chirac en 1997 justifie la dissolution par la nécessité de s'adapter à la mondialisation présentée comme irrésistible, il se fait battre et ouvre la voie à Jospin ; quand celui-ci ne s'oppose pas à la fermeture d'une usine Renault à Vilvorde suggérant qu'on ne peut tout attende de l’État ou du gouvernement, la sanction ne tarde pas : il est sèchement éliminé en 2002, dès le 1e tour ! Les exemples foisonnent : du « dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé » de François Mitterrand en 1993, au « Que voulez-vous que je fasse ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ? » de Nicolas Sarkozy en 2008 : ce sont ces aveux d'impuissance que l'on ne pardonne pas.
On ne brigue pas les plus hauts postes de responsabilité pour seulement inaugurer les chrysanthèmes !
Ce que Macron sent mais ne veut admettre s'agissant de lui, ou de l'idéologie qu'il véhicule avec plus ou moins de franchise, et passablement peu d'honnêteté, c'est qu'il n'y a pas désaveu du politique ou de l’État mais des politiciens ; que ce que le peuple récuse c'est abaissement et l'impuissance.
L'abaissement ? l'allusion à Giscard d'Estaing est évidente, qui avait en son temps souligné que la France devait accepter d'être une puissance moyenne. On est très loin ici de l'idée de la France que s'était formée de Gaulle. S'agissait-il d’une mensongère illusion ? Pas tout-à-fait s'agissant d'un homme qui avait ramassé le pays dans le caniveau honteux de la collaboration pétainiste ; pas tout-à-fait pour autant que ceci consacrât, en démocratie, la primauté impérieuse du politique - ce pourquoi après 50 ans, en n'oubliant pas les échecs, erreurs ou excès d'autorité de ce régime, le consensus peut se maintenir sur sa personne ; de droite à gauche.
 L'impuissance ? Notre propension goguenarde à nous moquer de tout nourrit en partie la défiance à l'égard des politiques mais surtout la sensation que rien n'avance ou que les décisions efficaces concerneraient les seuls nantis ; de là l'antiparlementarisme latent que le discours gaullien sur les partis aura à la fois canalisé et entretenu, qui peut rapidement dériver vers le tous pourris, tous menteurs, tous incapables ! Entre la dérégulation et le transfert de compétences à l'Europe, tout semble confirmer que le roi est nu avec pour seul atout l'apparat de sa parole publique quand il en a encore le talent !
L'impuissance ? Notre propension goguenarde à nous moquer de tout nourrit en partie la défiance à l'égard des politiques mais surtout la sensation que rien n'avance ou que les décisions efficaces concerneraient les seuls nantis ; de là l'antiparlementarisme latent que le discours gaullien sur les partis aura à la fois canalisé et entretenu, qui peut rapidement dériver vers le tous pourris, tous menteurs, tous incapables ! Entre la dérégulation et le transfert de compétences à l'Europe, tout semble confirmer que le roi est nu avec pour seul atout l'apparat de sa parole publique quand il en a encore le talent !
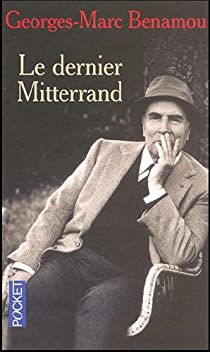 « En fait, je suis le dernier de grands présidents... (...) Enfin, je veux dire le dernier dans la lignée de De Gaulle. Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France... A cause de l'Europe... A cause de la mondialisation... A cause de l'évolution nécessaire des institutions. » Tout semble, oui, confirmer ces propos prêtés à Mitterrand par M Benamou
« En fait, je suis le dernier de grands présidents... (...) Enfin, je veux dire le dernier dans la lignée de De Gaulle. Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France... A cause de l'Europe... A cause de la mondialisation... A cause de l'évolution nécessaire des institutions. » Tout semble, oui, confirmer ces propos prêtés à Mitterrand par M Benamou
En réalité, le rôle de l’État a agité toutes les théories politiques : entre les monarchies mais aussi les tyrannies diverses et variées où il engouffre tout l'espace - l’État c'est moi - à Bakounine autant que Marx, ne l'oublions pas, qui veulent sa destruction pour l'outil exploiteur qu'il ne peut manquer d'être aux mains de la classe dominante - car le débat entre les anarchistes et les marxistes tient exclusivement sur la manière d'obtenir cette disparition de l’État - à Rousseau enfin qui en fait le moyen d'assurer l'équilibre entre ordre et liberté.
Il en va de l’État comme de n'importe quel outil : il devient pervers quand il est pris pour une fin en soi.
Ce qui derechef est l'affaire des politiciens qui s'en saisissent.
crise de l'autorité
Autre référence, implicite celle-ci, à Arendt quand elle évoque la crise de l'autorité. Sans entrer dans le détail, admettons au moins que l'autorité est moins ce que l'on a que ce que l'on vous prête. Elle est affaire de reconnaissance. Louis XVI a perdu exactement au moment où l'on ne vit plus en lui l'oint du Seigneur mais un homme, faible, pas forcément mauvais mais manipulé par les grands de sa Cour. Inutile d'aller chercher dans quelque transcendance la source de cette autorité, ou dans cet étrange coefficient personnel comme disait de Gaulle par quoi on pourrait définir le charisme : elle est l'effet d'un concours de circonstances, dans la coïncidence ou plutôt la cohérence, pour autant que celle-ci implique le mouvement, entre un homme, la position qu'il occupe, les événements et le crédit qu'on lui accorde. Je garde présent à l'esprit cet ebensosehr qu'utilise Marx pour désigner que l'histoire fait autant l'homme que l'homme l'histoire. Arendt n'a pas tort : autant les grecs puisaient l'autorité dans les Idées, dans cette contemplation qui autorisait le philosophe à sortir suffisamment de l'illusion et de l'apparence pour saisir une vérité dont il cherchera, à contre-cœur si l'on en croit l'allégorie de la caverne, à appliquer les termes dans la réalité humaine ; autant l'autorité, plutôt d'origine romaine, s'appuya plutôt sur la perpétuation de l'acte originaire de fondation, qui seule peut conférer quelque stabilité à l'organisation politique. C'est là constante de sa démarche : aucun pouvoir politique ne saurait être stable qui ne s'appuierait que sur un rapport de forces ou sur un pacte
Si le pouvoir enraciné dans un peuple qui s'était lié par des promesses mutuelles et vivait en corps constitués par un pacte, suffisait à mener à bien une révolution (sans que la violence sans borne des foules se donnât libre cours), il ne suffisait nullement à établir une union perpétuelle c'est-à-dire à fonder une autorité nouvelle Ni les pactes ni les promesses sur lesquelles les pactes reposent ne sont suffisants pour assurer la perpétuité c'est-à-dire pour donner aux affaires humaines ce degré de stabilité sans lequel les hommes seraient incapables de bâtir un monde pour leur postérité, un monde qu'ils veulent faire durer plus longtemps que leur propre vie d'hommes mortels
Arendt, Essai sur la révolution. p. 268-269.
C'est cette perpétuation que la période médiévale poursuivit obstinément avec sacres et fondation de l'Empire Romain Germanique ; en distribuant pouvoir sur la tête du roi et autorité sur celle de l’Église ; que la monarchie absolue, et c'est en ceci qu'elle fut absolue, à partir de Louis XIV brisa définitivement en réunissant sur sa tête les deux bornes du politique. Réunion entre pouvoir et autorité que la Révolution perpétua faisant du peuple une quasi-divinité que rien ne devait ni ne pouvait limiter.
Avec l'épuisement de la foi et de la puissance de l’Église, s'affaisse aussi la croyance que l'autorité transcenderait ceux qui en seraient détenteurs ; la mystique des deux corps du roi ne fonctionne plus et les pouvoirs modernes se retrouvent devant l'itérative aporie de tout pouvoir : l'instabilité comme sont instables, perpétuellement en mouvement les relations humaines à l'intérieur du corps social.
Cette crise de l'autorité est aussi celle de l'obéissance ou, plutôt celle de la liberté au sens où Rousseau l'avait déclarée obéissance aux lois qu'on s'est données. Que nous entendions liberté comme souveraineté absolue, comme ce qui, jamais ne devrait se soumettre à d'autres normes et règles que sa propre volonté, alors, oui, toute autorité s'effondre. Celle des sciences, de la raison d'abord avec cette sinistre tendance à suspecter complots dès qu'affirmation ne vous agrée point ; à s'enquérir de qui parle plutôt que de qu'il dit - d'où parles-tu camarade ? - à confondre opinion et raisonnement.
Il faut dire que les médias, assis sur cette sordide caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, y vont allègrement de leur touche balourde. Le comble, me semble-t-il, aura été atteint cette année à l'occasion des substances susceptibles de guérir du COVID 19 : un sondage de l’Ifop pour labtoo, les 3 et 4 avril pointe 59% des français estimant que le traitement par la chloroquine est efficace contre le coronavirus ! Voici, sans barguigner, l'opinion mise au même plan que tous les protocoles de vérification des sciences ; voici les français juges-arbitre des controverses nécessaires de la recherche scientifique ! On croit rêver.
Nous sommes en tout cas en plein dans ce que j'ai à maintes reprises évoqué comme brouillage idéologique et que Macron nomme mélasse intellectuelle : il n'en est assurément pas responsable mais en est l'héritier soigneux.
société victimaire et émotionnelle

 Les mots sont à très bon escient choisis : l'émotion est celle ressentie après chaque vague terroriste et elles furent nombreuses. Elles se traduisent à chaque fois par des foules rassemblées, manifestant non leur colère, non leur combat futur, non pas leur révolte mais seulement leur solidarité légitime, leur émotion ! On l'aura pu observer dès janvier 2015 quand commencèrent à fleurir les slogans je suis … qu'on retrouvera en octobre de cette année sous la forme je suis prof !
Les mots sont à très bon escient choisis : l'émotion est celle ressentie après chaque vague terroriste et elles furent nombreuses. Elles se traduisent à chaque fois par des foules rassemblées, manifestant non leur colère, non leur combat futur, non pas leur révolte mais seulement leur solidarité légitime, leur émotion ! On l'aura pu observer dès janvier 2015 quand commencèrent à fleurir les slogans je suis … qu'on retrouvera en octobre de cette année sous la forme je suis prof !
Les mots ont leur poids idéologique : ceux-ci sont décisif. A défaut de grille intellectuelle pour comprendre les événements, les juger, les combattre, à défaut de théorie perçue comme suffisamment évidente pour être reçue sans hésitations, ne demeure que le déferlement de sensations, d'émotions.
 D'où le victimaire ! Il y va ici de la théorie du désir mimétique de Girard ! Une société en train de se déliter, où tous les liens se distendent et où le conflit se généralise entre tous et chacun, a besoin, au risque d'exploser, de se rassembler autour d'un ennemi commun qu'elle sacrifie. Car si tous s'opposent à chacun, tout se ressemblent en ceci qu'ils se haïssent. Canaliser cette haine sur un ennemi commun à haïr est moyen classiquement utilisé que l'on retrouve dans tous les rites religieux comme dans tous les rites de fondation.
D'où le victimaire ! Il y va ici de la théorie du désir mimétique de Girard ! Une société en train de se déliter, où tous les liens se distendent et où le conflit se généralise entre tous et chacun, a besoin, au risque d'exploser, de se rassembler autour d'un ennemi commun qu'elle sacrifie. Car si tous s'opposent à chacun, tout se ressemblent en ceci qu'ils se haïssent. Canaliser cette haine sur un ennemi commun à haïr est moyen classiquement utilisé que l'on retrouve dans tous les rites religieux comme dans tous les rites de fondation.
Ce qui sans doute est le plus grave ici c'est que la loi sur les séparatismes qu'il entend faire voter, quoiqu'elle se veuille marcher sur ses deux jambes, ne fait que pointer un seul ennemi : l'islamisme radical.
Ce qui n'est rien résoudre et n'aide notamment pas à comprendre cette résurgence que peu attendaient du religieux et, surtout, dans sa forme la plus intolérante.
le grand retour de l'identité
Les mots ne sont jamais innocents et la référence à Sarkozy explicite. Jouer le jeu de l'extrême-droite c'est jouer avec le feu ! Parler avec ses mots, ses références, c'est en fin de compte lui donner raison ; toujours.
La droite s'est mise à parler identité, racines, communauté sans réaliser - ou pire en le réalisant - que c'était là remettre en question radicalement les principes d'une République qui ne veut entendre que des citoyens s'unissant librement autour de la loi. Qu'on le veuille ou non, mais je crains bien désormais que ce fût alors en le voulant, on aura, au nom de l'ordre, bientôt de la sécurité, mis le collectif indistinct qu'est la communauté au-dessus de l'individu, de la liberté de chacun estimant à mots de moins en moins couverts qu'il n'est de liberté individuelle que par la communauté. Vieux débat, mais c'est en fin de compte le destin du politique que de rabâcher les mêmes leçons …
Confondre les réseaux d'appartenances que nous tissons, aléatoirement ou volontairement, par notre naissance et notre parcours, avec notre identité n'est pas seulement une faute logique ; c'est une faute politique. Sous-entendre que nous n'échapperions jamais au creuset qui nous vit naître, que nous sommes ceci et ne pouvons pas ne pas l'être, revient toujours à regarder en arrière, une société à conserver vaille que vaille plutôt que d'en avant projeter l'horizon de nos volontés. C'est entendre sujet au pied de la lettre - ce qui jeté en-dessous doit se soumettre à la règle commune qui le rend possible.
On peut y voir l'effet d'une américanisation de notre vie politique ou plus simplement une droitisation assumée ! Je crains qu'il ne faille voir au-delà de ces stratégies électorales à courte-vue. Car ce que j'entends c'est la lente substitution de la communauté, de la race et du genre à la classe sociale. Celui-ci a le droit de parler selon l'endroit d'où il parle, qui il est. Ce qu'il énonce n'a bientôt plus de valeur ; déjà plus de sens.
Il a beau préciser n'admettre que la communauté nationale, il a accepté de se battre avec les armes de l'adversaire. Il a déjà perdu et nous entraîne dans son errance.
Faire de la République un socle commun, ou pire encore, une matrice, c'est encore jouer sur une métaphore naturaliste. Fabuleux contre-sens : la République n'a cessé d'être un surgissement contre l'ordre établi.
Elle est une conquête ; pas une nature.
Universalisme v/s communautarisme
On a beau me dire que ce ne sont que des mots, j'en ai perçu la gravité lorsqu'au moment du Bataclan où mourut un directeur d'IUT, je reçus de la part des présidents, directeurs et autres responsables, ces messages où voulut s’exprimer la tristesse, la solidarité, le deuil de la communauté universitaire ! Je me croyais simplement travailler dans une institution publique … patatras ! j'appartenais à une communauté.
 Je sais bien que le défaut, le plus grand, de la cuirasse républicaine c'est que Nation, peuple et citoyen qu'elle exhausse, sont des abstractions si lointaines du sol, de la sueur et de la peine qu'il est plus aisé - mais tellement plus sulfureux - d'évoquer nos racines. Qu'on me comprenne bien, je ne nie pas le rôle - et souvent le poids - que jouent notre passé, nos origines, l'éducation reçue, ces valeurs. Naître en France moitié du XXe, n'est pas la même chose que d'y naître au début ou en son extrême fin comme mes filles. Je ne le nie ni ne l'ignore. J'eusse pourtant pu naître ailleurs - et tout alsacien sait combien ce reste simple affaire de quelques mètres, défaites ou forfanterie. Tout, sans l'histoire de la République, dénie l'implacable de la nature, de la racine ; du sang. Tout dans mon éducation, dans mes réflexions me pousse à ne considérer que l'adhésion volontaire à quoi je peux me prêter, le contrat que je puis souscrire, les projets que je me suis donnés et me donne encore. Ce n'est assurément pas pour rien que j'eus tant aimé cette universalité humaine de condition qui, les choses étant absurdes, nous incitent, tous, ensemble, à conférer un sens à notre existence, à notre parcours.
Je sais bien que le défaut, le plus grand, de la cuirasse républicaine c'est que Nation, peuple et citoyen qu'elle exhausse, sont des abstractions si lointaines du sol, de la sueur et de la peine qu'il est plus aisé - mais tellement plus sulfureux - d'évoquer nos racines. Qu'on me comprenne bien, je ne nie pas le rôle - et souvent le poids - que jouent notre passé, nos origines, l'éducation reçue, ces valeurs. Naître en France moitié du XXe, n'est pas la même chose que d'y naître au début ou en son extrême fin comme mes filles. Je ne le nie ni ne l'ignore. J'eusse pourtant pu naître ailleurs - et tout alsacien sait combien ce reste simple affaire de quelques mètres, défaites ou forfanterie. Tout, sans l'histoire de la République, dénie l'implacable de la nature, de la racine ; du sang. Tout dans mon éducation, dans mes réflexions me pousse à ne considérer que l'adhésion volontaire à quoi je peux me prêter, le contrat que je puis souscrire, les projets que je me suis donnés et me donne encore. Ce n'est assurément pas pour rien que j'eus tant aimé cette universalité humaine de condition qui, les choses étant absurdes, nous incitent, tous, ensemble, à conférer un sens à notre existence, à notre parcours.
Regardez, écoutez ! chaque fois qu'on parle de nos racines c'est pour nous enjoindre de nous y soumettre ; réduire ; restreindre. Eh quoi ! je ne suis pas un arbre ! et j'exige qu'on me juge sur mes actes, mes projets ; pas sur mes origines. De ce je qui s'ébroue, on peut dire exactement ce que Siéyès avait écrit du Tiers Etat. Qu'est-il ? rien ! que veut-il être ? Tout !
refus de la violence
 Macron s'offusque de ce regain de violence ; non pas tant celui du terrorisme qui est extérieur et facilement condamnable. Mais bien celui de l'intérieur ; celui de ce corps social qui regimbe et manifeste. Oui, sans doute, ce mouvement des gilets jaunes a-t-il révélé des colères et occasionné des violences qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est oublier pourtant que manifestations et grèves font partie de ce rituel, de ces mises en scène du refus ; de cette représentation de la violence qui n'a d'autre but qu'elle n'éclate pas ; sont la pointe avancée de la violence acceptable. Que la tension soit trop forte, ni sublimation ni exutoire ne fonctionnent plus.
Macron s'offusque de ce regain de violence ; non pas tant celui du terrorisme qui est extérieur et facilement condamnable. Mais bien celui de l'intérieur ; celui de ce corps social qui regimbe et manifeste. Oui, sans doute, ce mouvement des gilets jaunes a-t-il révélé des colères et occasionné des violences qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est oublier pourtant que manifestations et grèves font partie de ce rituel, de ces mises en scène du refus ; de cette représentation de la violence qui n'a d'autre but qu'elle n'éclate pas ; sont la pointe avancée de la violence acceptable. Que la tension soit trop forte, ni sublimation ni exutoire ne fonctionnent plus.
La colère des peuples ressemble toujours un peu à la goutte d'eau qui déborde le vase : l'apparente rupture n'est en réalité que la résultante brusquement visible d'une continuité discrète, lentement accumulée. Que la violence soit, par principe moral ce qui est faute fondatrice ; par principe social ce qui est prohibé puisque sa délégation est le contrat constitutif du corps social nous le savons tous. Ne pas accepter que son irruption soudaine soit le résultat de frustrations cumulées ; de réformes successives se conjuguant en terme de régression sociale ; de promesses non tenues et de propos non seulement lénifiants mais cyniquement méprisants. Ne pas comprendre que la baisse continue des salaires, l'épuration jusqu'aux limites de l'obscène du Code du Travail, la négation de droits élémentaires, revenir patiemment mais efficacement sur toutes les avances sociales depuis la Libération, que tout cela, oui, présenté comme des réformes nécessaires, si modernes que les refuser serait absurde et ne pouvait être le fait que d'un peuple conservateur ou pire paresseux, ne pas comprendre que c'était ici allumer soi-même la mèche relève de la sottise ou d'une idiosyncrasie de dominants prêts à tout pour le demeurer.
Où la violence ? Dans ce mépris souverain de premiers de cordée …
Oh bien sûr la violence est répréhensible. Mais elle n'advient que dans ces sociétés déjà violentes.
Quand l’État, par ses agissements, souffle lui-même sur les braises qu'il ne s'étonne pas des humeurs acrimonieuses. Au lieu de réunir, il divise. Et le fait une seconde fois en tenant des propos ne fonctionnant que comme des simulacres.
mélasse intellectuelle
Il faut de la transcendance ! Pardi ! mais elle ne se décrète pas ni ne s'instille comme on glisserait quelque épice dans une recette trop fade. Oui il y a un bord sacré du politique. Qui s'en approche court le risque de la profanation. Que le peuple entre dans le jeu et tout s'effondre et les puissants ne sont plus que des pantins désarticulés.
J'ai moi-même à plusieurs reprises souligné le brouillage idéologique de notre époque. Mélasse est assez bien trouvé. Mais quel culot de s'en offusquer quand on en est soi-même un acteur. Se glorifier d'être et de gauche et de droite, entonner les canons étroits du libéralisme comme s'ils étaient le dépassement définitif de toutes les idéologies ; psalmodier comme autant de sirènes, les grandes incantations de l'évidence comme si c'était là révolutionnaires évidences qui ne sont pourtant que les dogmes sinistrement pragmatiques d'un management sottement répété depuis le banc des grandes écoles, c'est participer soi-même à cet embrouillamini ; l'entretenir ; le légitimer.
La plus grande des idéologies est encore de prétendre n'en défendre aucune.
Au bilan
A tenter de décortiquer cet ITV, on ressent le même embarras, répété depuis 2017. L'homme n'est ni sot ni inculte, même s'il a encore l'immaturité de le faire trop valoir et l'impatience orgueilleuse de la démesure. Rien de ce qu'il dit ici n'est véritablement faux et, pourtant … chose extraordinaire rien ne s'ensuit ! Rares furent nos politiques cultivés : De Gaulle et Mitterrand oui ; mais ni Sarkozy ni Hollande ni non plus vraiment Chirac. Lui, par sa double formation de philosophie et d'énarque aurait pu être le lien entre les grands anciens et l'avenir.
Il en avait l'opportunité … mais tellement la vanité.
Mais il y a chez cet homme, une rupture telle entre la parole et l'acte qu'on y pourrait aisément deviner troubles psychotiques si l'on inclinait aux grilles psychologiques. N'est-ce que la conséquence du penchant sinon despotique en tout cas monarchique de nos institutions ?
Ces gens-là ont tué le politique et osent même s'en plaindre. Gare au réveil du politique ; aux colères des peuples …