| index | précédent | suivant |
|---|
Ce qu'on quitte ce que l'on abandonne
| 1- Voyager | 2- Partir | 3 - Partir ou abandonner ? | 4- Fermer le cercle | 5 - Raconter |
|---|
Ni quitter ni abandonner ne sont des termes légers et l'étymologie incertaine d'abandonner le souligne ironiquement. Derrière quitter il y a quiétude, tranquillité cette sérénité que l'on conquiert lorsqu'on s'est libéré d'une dette, d'une charge, d'une responsabilité. Comme si en quittant un lieu on se défaisait d'un même tenant de toutes les contraintes mais aussi de toutes les influences dont il vous imprégnait ou qu'en quittant un être on ne se contentât pas seulement de s'éloigner de lui mais qu'on se libérât en réalité de toutes les obligations, juridiques, pécuniaires ou morales qu'on eût contractées auprès de lui. L'abandon quant à lui, qui est presque toujours celui d'une personne, ne revient pas seulement à rompre un lien, mais de manière explicitement péjorative, à cesser de prendre soin de ce ou celui avec qui on aura eu contracté obligations morales ou affectives. Qu'on se comprenne bien, quitter peut en certaines situations être action positive marquant un progrès, une élévation. Abandonner est toujours action qu'on n'aurait pas du commettre ; qu'il est inconcevable qu'on commît. A ce titre bien plus pesante que de seulement quitter un lieu ou un être. On pourrait presque imaginer que celui qui quitte par un certain aspect se libère d'une charge, d'un devoir, d'une habitude même voire que ce fût pour lui une nécessité ; en revanche celui qui abandonne s'empêtre en des liens dont il demeurera redevable sans jamais pouvoir totalement se libérer non pas d'une erreur mais bien d'une faute.
Ariane à Naxos
La nuit suivante, tes yeux vont découvrir la couronne de la fille de Minos; [3, 460] c'est le crime de Thésée qui en a fait une déesse. Délaissée par un époux parjure, mais heureuse depuis avec Bacchus, celle qui avait guidé avec un fil les pas d'un ingrat disait, s'applaudissant de son hymen: "Que j'étais folle de pleurer Thésée! en me trahissant il m'a servie." [3, 465]
Cependant le dieu qui se pare de sa chevelure, le dieu Liber, vainqueur des Indes revient chargé des dépouilles de l'Orient. Parmi les captives, jeunes filles remarquables par leur beauté, il est une fille de roi qui n'a que trop su plaire à Bacchus. Ariane verse des larmes; épouse, amante infortunée, elle court, [3, 470] les cheveux épars, le long du rivage, et ces paroles s'échappent de sa bouche: "Flots de la mer, écoutez mes plaintes pour la seconde fois; sable de ce rivage, soyez une seconde fois arrosé de mes larmes. Je m'écriais, je m'en souviens encore: parjure et perfide Thésée! Thésée est parti; je puis donner les mêmes noms à Bacchus. [3, 475] Je puis dire encore aujourd'hui. Femmes, ne croyez jamais aux serments des hommes; je suis trahie de nouveau, le nom seul du traître a changé; plût aux dieux qu'on ne m'eût pas arrachée à ma triste destinée; à cette heure, du moins, je n'existerais plus. Pourquoi es-tu venu à mon secours, ô Bacchus, dans ces solitudes où j'attendais la mort? [3, 480] En mourant alors, je n'aurais été malheureuse qu'une fois. O Bacchus, dieu inconstant, plus mobile que ce feuillage qui se joue à tes tempes, toi que je n'ai connu que pour te pleurer, tu as amené jusque sous mes yeux une indigne rivale, et troublé cette union jusque là si fortunée! [3, 485] Qu'est devenue la foi que tu m'avais jurée, et ces serments répétés chaque jour? Malheureuse! je suis donc réduite à déplorer deux fois la même injure! Tu accusais Thésée, tu lui donnais toi-même le nom de trompeur; condamné par toi-même, tu n'en es que plus coupable. Mais je veux souffrir en silence et dérober ma douleur à tous les regards; [3, 490] c'est une triste gloire que d'avoir pu être trompée tant de fois. Que Thésée surtout l'ignore, qu'il ne se réjouisse pas de t'avoir pour complice. Sans doute je suis trop noire, et la rivale que tu me préfères est éblouissante de blancheur! Je souhaite à tous mes ennemis sa couleur odieuse. [3, 495] Mais qu'importe, si sa laideur même l'embellit à tes yeux? Arrête, ô Bacchus, ne va pas te souiller dans ses embrassements; songe à tes serments; quel amour peut remplacer pour toi celui d'une femme habituée à chérir son époux? Ces cornes qui parent ton front me rappellent le beau taureau dont ma mère fut éprise; [3, 500] mais son amour était infâme, et moi je pouvais être glorieuse du mien. Ne me punis pas de t'aimer; t'ai-je puni, ô Bacchus, quand tu m'as fait l'aveu de ta passion? Ne sois pas surpris que je brûle pour toi; n'es-tu pas né dans les flammes? N'est-ce pas la main d'un père qui seule t'empêcha d'être consumé? [3, 505] Je suis cette Ariane à qui tu promettais le ciel; hélas, au lieu de m'y conduire, où m'as-tu laissée!"
Elle dit, et Bacchus, qui suivait ses pas, n'avait pas cessé de prêter l'oreille aux plaintes de l'infortunée; il la serre dans ses bras, de sa bouche il essuie les larmes d'Ariane. [3, 510] "Montons ensemble, dit-il, vers la voûte des cieux; l'amour nous a unis, qu'un même nom nous unisse encore, et prends celui de Libéra dans ta nouvelle demeure, comme souvenir de notre amour. Je placerai auprès de toi la couronne que Vénus avait reçue de Vulcain et que te donna Vénus." [3, 515] Il dit, et aussitôt les pierreries de cette couronne se changent en étoiles; on en compte neuf dans cette brillante constellation.
Ovide, Fastes, III, 459-516
 Ariane est la figure même de la femme abandonnée - mais on devrait plutôt écrire trompée. Celle qui aida Thésée à venir à bout du Minotaure en lui confiant, contre promesse de mariage, ce fameux fil lui permettant de sortir du labyrinthe, sera un peu plus tard abandonnée sur l’île de Naxos par ce même Thésée - pour des raisons loin d'être claires ; imprécises en tout cas comme si l'histoire s'attachait à demeurer celle d'Ariane ; pas celle de Thésée. Ou que, quelles qu'en fussent les justifications - une tempête exigeant un départ précipité ou une exigence des dieux - l'abandon est toujours un forfait qui doit se payer. On raconte que, dans sa précipitation, Thésée eût oublié de changer les voiles en sorte que voyant son bateau entrer arborant voiles noires suggérant la défaite face au Minotaure, Égée, son père, de désespoir se jette dans la mer. Qui porte ainsi son nom.
Ariane est la figure même de la femme abandonnée - mais on devrait plutôt écrire trompée. Celle qui aida Thésée à venir à bout du Minotaure en lui confiant, contre promesse de mariage, ce fameux fil lui permettant de sortir du labyrinthe, sera un peu plus tard abandonnée sur l’île de Naxos par ce même Thésée - pour des raisons loin d'être claires ; imprécises en tout cas comme si l'histoire s'attachait à demeurer celle d'Ariane ; pas celle de Thésée. Ou que, quelles qu'en fussent les justifications - une tempête exigeant un départ précipité ou une exigence des dieux - l'abandon est toujours un forfait qui doit se payer. On raconte que, dans sa précipitation, Thésée eût oublié de changer les voiles en sorte que voyant son bateau entrer arborant voiles noires suggérant la défaite face au Minotaure, Égée, son père, de désespoir se jette dans la mer. Qui porte ainsi son nom.
Certes, Ariane connaîtra une fin heureuse : aimée de Dionysos, elle sera son double parfait et y gagnera l'immortalité. Il n'empêche : elle demeure celle qu'on a bafouée, trahie. Comme si c'était là indélébile tache et faute impardonnable.
L'histoire n'est pas simple pour autant - la mythologie grecque en offre-t-elle une qui le soit ? Thésée a été volontaire pour tuer le Minotaure : Minos depuis la mort de son fils exigeait d'Athènes qu'elle lui livrât tous les neuf ans sept jeunes hommes et sept jeunes filles livrées en pâture au Minotaure. L'amant lâche et trompeur est donc aussi un héros. Ariane quant à elle ne trahit-elle pas son père en permettant à Thésée de sortir vivant de l'épreuve ?
J'aime cette histoire pour son ambivalence même : où les traversées sont toujours des épreuves à endurer, des combats à mener ou perdre, où les amours souvent volages sont autant d'envolées que de petites trahisons, où la noblesse d'âme du héros jouxte presque toujours une animalité malaisément contenue. De Zeus, parricide et fils de parricide, époux infidèle s'il en fût jamais, à Thésée, héros sans conteste et futur grand roi et réformateur, mais à l'occasion adepte de petits mensonges et honteuses vilenies comment ne pas considérer en ces mythes ce que les grecs toujours surent : qu'exister est déjà une malédiction qui vous condamne à l'injustice; est une fatalité qui souille et vous souille.
Cet être parti caractérisant le fait de vivre serait-il donc une trahison ? D'emblée ? Toujours ?
Imaginaire ou réel, l'abandon ne va pas sans une faute initiale, une malédiction proférée. Culpabilité et abandon marchent de concert. L'enfant abandonné finira toujours par se supposer une indignité qui justifiât son délaissement d'où la quête effrénée des origines ... Pourtant d'abandonnés, nous finissons tous par être un jour abandonneur : l'interdit de l'inceste ne signifie rien d'autre que l'obligation pour chacun qu'aller fonder ailleurs sa descendance ; la modernité, sous la forme de la mondialisation, que nous sommes condamnés à la transhumance systématique au point de ne plus pouvoir dire je suis d'ici mais seulement je suis parti d'ici pour aller ... partout, n'importe où ; ailleurs. La flexibilité à quoi le dogme libéral nous invite ou contraint prend les formes insolites de l'instabilité, de l'insécurité, réelle ou ressentie, dans nos vies intimes autant que professionnelles : nous ne savons plus que très mal maintenir des groupes sociaux stables ou pérennes ; nous ne savons plus faire bloc ou groupe, ou alors que très temporairement comme si l'individualité avait tout balayé et que nous ne dussions plus rien échafauder que sur le sable de nos propres incertitudes.
Notre histoire débute par une expulsion ; par une errance. L'ange pointe d'un doigt réprobateur le chemin de la sortie et l'issue macabre de la guerre pousse Enée à l'exil. Que ce soit celle de Rome ou celle de Jérusalem tout de ces pérégrinations nous rappelle que, non décidément, nous ne sommes pas d'ici et peut-être seulement de passage. Que notre chemin ponctue en chacune de ses courbures les stations successives d'une pénitence qui ne parviendra jamais à éteindre la faute, la défaillance ou seulement la faiblesse d'exister.
Il peut paraître surprenant que le grec utilise le même terme - προδοσια - pour désigner à la fois l'abandon et la traîtrise ? Que le latin avec traditor, tiré de trado - abandonner, laisser mais aussi enseigner - fassent ainsi le lien avec la transmission et donc le don ? προδοσια renvoie effectivement à δοσις - l'action de donner ou ce que l'on donne ou confie et au verbe διδομι : donner. Le traître - προδοτης - c'est celui qui donne par avance. Le verbe est révélateur surtout quand il se présente ainsi avec le préfixe pro : donner, offrir, servir, mais aussi livrer, donc produire, avec pro : payer d'avance ; trahir, livrer.
On le sait, il n'y a jamais loin du traducteur au traître : celui-là s'attache autant que faire se peut de ne rien perdre en chemin qui devra être confié au destinataire final quand celui-ci au contraire bloque la relation, s'interpose et manipule à son profit. Menteur et père du mensonge, d'intermédiaire il usurpe assez vite la place tant de l’émetteur que du destinataire.
L'abandon est bien l'antonyme parfait du don et il l'est deux fois. Quand je donne à la fois je reconnais l'autre et le pose à distance, en face de moi en sa dignité et autonomie mais d'un même mouvement je me l'attache d'un lien qui ne réside pas nécessairement dans la gratitude ou alors celle respective d'avoir pu donner et su recevoir, dans la reconnaissance mutuelle. L'abandon est la négation de ce lien, surtout de la réciprocité de ce lien. Il réifie l'autre, le jette sur le bas côté, le bannit à sa façon. Avec l'abandon on passe brusquement de la distinction à l'indifférence. Il est surévaluation de soi, mépris de tout ce qui n'est pas soi.
Ce que peut suggérer d'être abandonné se devine évidemment chez Ariane mais il faut scruter au-delà de la vanité blessée ; de la fierté bafouée.
L'abandon se mesure en terme de solitude et je crains bien qu'elle ne s'entende que radicale
Je n'en connais qu'une qui engage le rapport entretenu avec le divin.
Le regard détourné : l'incompréhensible par excellence
 Que purent ressentir ces cohortes s'avançant têtes déjà baissées vers la mort ? Quoi ce peuple qui fit de sa fidélité à Dieu, à sa Loi le pivot de sa survie ; qui se voulut peuple de prêtres et n'imagina pas qu'on puisse exister, vivre dignement, sans mettre chacun de ses gestes, chacun de ses efforts, toutes ses pensées et volontés au service de la Parole et de la Loi ? Quoi ce peuple qui réussit à préserver sa dignité malgré les offenses, les blessures et les interminables persécutions ; qui réussit à se maintenir en sa propre demeure tout en s'égarant au milieu des autres nations qui le méprisèrent ? comment ceux-là, conduits à la mort avec moins de considération qu'on eût même accordée aux bêtes, comment purent-ils ne pas être écrasés de désespoir no pas de mourir, non pas même de mourir ainsi mais de ne même plus pouvoir lever le regard vers les Hauteurs et d'y scruter un signe … parce que Dieu avait déjà détourné le regard ; avait abandonné son peuple. Je sais que parmi les survivants certains revinrent plus croyants encore qu'ils n'étaient partis et que d'autres y perdirent leur foi. Les deux réactions sont évidemment respectables : qui peut supporter durablement, levant les yeux au ciel, de n'y trouver pas même une présence ?
Que purent ressentir ces cohortes s'avançant têtes déjà baissées vers la mort ? Quoi ce peuple qui fit de sa fidélité à Dieu, à sa Loi le pivot de sa survie ; qui se voulut peuple de prêtres et n'imagina pas qu'on puisse exister, vivre dignement, sans mettre chacun de ses gestes, chacun de ses efforts, toutes ses pensées et volontés au service de la Parole et de la Loi ? Quoi ce peuple qui réussit à préserver sa dignité malgré les offenses, les blessures et les interminables persécutions ; qui réussit à se maintenir en sa propre demeure tout en s'égarant au milieu des autres nations qui le méprisèrent ? comment ceux-là, conduits à la mort avec moins de considération qu'on eût même accordée aux bêtes, comment purent-ils ne pas être écrasés de désespoir no pas de mourir, non pas même de mourir ainsi mais de ne même plus pouvoir lever le regard vers les Hauteurs et d'y scruter un signe … parce que Dieu avait déjà détourné le regard ; avait abandonné son peuple. Je sais que parmi les survivants certains revinrent plus croyants encore qu'ils n'étaient partis et que d'autres y perdirent leur foi. Les deux réactions sont évidemment respectables : qui peut supporter durablement, levant les yeux au ciel, de n'y trouver pas même une présence ?
Les chrétiens nomment cela déréliction d'un terme latin signifiant précisément abandon - derelictio. Tiré d'un verbe - relinquo - laisser en arrière, ne pas emmener avec soi ; abandonner ; délaisser, négliger - qui fait de ces reliques l'exact antonyme de religo. Est-ce un hasard ? Quelle que soit l'origine de religion - relegere ou religere - l'accent s'y trouve maintenu sur un lien soigneusement maintenu et entretenu, sur le lien et le soin. La négligence, l'abandon désignent donc bien ce lien qu'on a laissé ou fait dépérir.
L'abandon n'est donc, ne peut pas être, affaire uniquement sentimentale ou circonstancielle : elle est pour le moins anthropologique ; en réalité métaphysique. Car concerne ce lien que nous nous devons d'entretenir avec le monde ; avec l'être. C'est sans doute pour cette raison que l'abandon est bien plus pesant que le simple délaissement car touche au principe de solidarité qui est l'un des fondements de toute morale possible. Solidarité qui ne concerne pas que les êtres mais le monde avec eux ; solidarité qui seule peut conférer quelque épaisseur à notre présence.
L'homme habite le monde en poète selon Hölderlin formule qi'Heidegger aimait à reprendre et commenter à sa si singulière façon. Il faut l'entendre au moins en ceci qu'être au monde ne consiste pas seulement à occuper ou s'approprier un espace mais à laisser celui-ci vous imprégner au moins autant qu'on s'y attachera à laisser des traces. Dans habiter il y a au moins autant habitudes qu'avoir. Etre au monde ne saurait seulement consister à gratter la terre pour qu'elle consente à nous nourrir ou bien à la parcourir avec précipitation entre deux horaires d'avion et de trains, entre période de labeurs et de vacuité. Le monde ne saurait être un consommable mis à notre disposition et qu'il nous serait loisible de souiller ; ne peut être une marchandise ou ne le deviendrait qu'à notre plus grand péril ; n'est pas même seulement la branche sur quoi nous serions assis et qu'il nous importerait égoïstement de soigner pour notre propre préservation ! Non, il est étoffe dont au moins en partie nous serions faits mais qu'en retour, par notre présence, nous constituons comme monde.
Relation en boucle, système complexe dirons-nous : le monde n'est monde que parce que nous y sommes à le regarder, concevoir et transformer quand parallèlement nous en sommes le surgeon autant que le parasite.
J'aime à rappeler qu'en grec comme en latin, que κόσμος - cosmos - comme mundus désignent à la fois le monde, l'ordre du monde et la parure des femmes. Ce ne saurait être un hasard mais c'est exactement en cet interstice de la langue que s'instille la poésie à quoi Hölderlin fait référence. Dans la mythologie grecque comme dans les textes bibliques, le divin délègue l'organisation du monde qui à Prométhée qui à Adam.
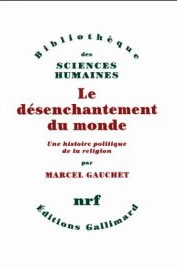 Ce dernier se verra notamment confier le soin de nommer les animaux après celui de les dominer et de prendre soin du monde. Que l'homme soit en quelque sorte la couronne de la création, un être à part, supérieur ontologiquement à tout ce qui existe autour de lui, on le sait c'est le sens même de la théologie de la création. Que le rapport parfois catastrophique que l'homme entretient avec le monde y trouve en partie sa source est évident : au même titre que le devenir comme maître et possesseur de la nature de Descartes, s'est insinuer par là l'idée d'un monde marchandise ; désenchanté ! disponible comme un stock où l'on viendrait puiser. Mais ceci signe surtout la posture acrobatique de l'homme - à la fois dans et devant le monde - ; l'obligation qui lui est faite d'à la fois de l'entretenir et de lui donner un sens : bref de constamment l'inventer et de se réinventer avec lui.
Ce dernier se verra notamment confier le soin de nommer les animaux après celui de les dominer et de prendre soin du monde. Que l'homme soit en quelque sorte la couronne de la création, un être à part, supérieur ontologiquement à tout ce qui existe autour de lui, on le sait c'est le sens même de la théologie de la création. Que le rapport parfois catastrophique que l'homme entretient avec le monde y trouve en partie sa source est évident : au même titre que le devenir comme maître et possesseur de la nature de Descartes, s'est insinuer par là l'idée d'un monde marchandise ; désenchanté ! disponible comme un stock où l'on viendrait puiser. Mais ceci signe surtout la posture acrobatique de l'homme - à la fois dans et devant le monde - ; l'obligation qui lui est faite d'à la fois de l'entretenir et de lui donner un sens : bref de constamment l'inventer et de se réinventer avec lui.
Je ne m'aventurerai pas à proposer interprétation du silence divin face au génocide : elle serait à la fois ridicule et invariablement anthropocentrique. Et relèverait les mêmes apories - je devrais écrire les mêmes incompréhensions - que face à la question du mal : ou bien Dieu n'eût pas pu intervenir mais alors quel sens donner à sa toute-puissance ? ou bien il se désintéressa du monde mais alors que reste-t-il de la miséricorde, de la grâce ; de l'amour divin ?
Je m'y aventurerai d'autant moins que ce serait postuler une réponse à la question de l'existence de Dieu et aux dédales de la foi. Tel n'est pas mon propos ni ici ni ailleurs. A tout le moins, le divin est le nom que nous prêtons à nous questions, nos angoisses au moins autant qu'à nos idéaux : que chacun y réponde comme il peut. Je sais seulement que la croyance en un dieu transcendant, supérieur et extérieur à un monde qu'il a créé impose à l'humain distance, respect et donc soin plutôt que consumérisme échevelé.
Si vous me permettez une réponse brève et peut-être un peu massive, mais issue d’une longue réflexion : la philosophie ne pourra pas produire d’effet immédiat qui change l’état présent du monde. Cela ne vaut pas seulement pour la philosophie, mais pour tout ce qui n’est que préoccupations et aspirations du côté de l’homme. Seul un dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la pensée et la poésie une disponibilité pour l’apparition du dieu ou pour l’absence du dieu dans notre déclin ; que nous déclinions à la face du dieu absent. Heidegger, ITV Spiegel 1966
Ai toujours été surpris, et ne fus pas le seul, par cette étrange réponse : seul un dieu peut encore nous sauver ! Autant j'entends sans souci que la philosophie ne puisse avoir aucun effet - immédiat ou non - sur la marche du monde - est-ce d'ailleurs son objet ? - autant je nourris quelque réticence - en dépit de son amphigouri usuelle - à intégrer cette remarque à la philosophie heidegerienne. Tel n'est d'ailleurs pas le sujet.
Il est dans l'abandon et donc dans une présence qui se récuse, qui se refuse. Dans un retrait.
Pour autant que le divin soit le nom que nous donnons à cette voix insistante qui nous intime à chaque instant que nous ne sommes pas que de ce monde, alors, oui, cette absence - mais il faut ici entendre ce retrait - du divin équivaut à un silence sidéral qui nous laisse seuls, impuissants à parler à d'autres que nous-mêmes, réduits à la pesante noirceur des choses, à n'être plus que disponibles, corvéables … utilisables.
Qu'est-ce, après tout que la présence ? Le latin suggère l'idée d'être en avant, devant et donc de commander, diriger ou inspirer au moins. Mais le terme se joue d'un gérondif : cet être là au-devant, ne cesse de s'y maintenir. Cette pré sence - prae(s)ens- est une avancée continue et continuée ; est une tension, un effort, un soin précautionneusement préparé.
La douleur produite par l'abandon ne tient pas seulement au silence plombé de la solitude mais à la volonté minutieusement élaborée pour y parvenir : il faut autant d'acharnement pour que se nouent et maintiennent les liens que de méticulosité pour qu'ils se dénouent. Jamais ils ne peuvent s'effilocher par mégarde. L'abandon n'est jamais volontaire ou seulement négligent …
 C'est pour cette raison même que le regard détourné sur la mort de son peuple accable à jamais son chemin. C'est pour cette raison que je ne puis sans trouble émotion regarder cette femme digne à en pleurer, fière à en trembler s'avancer vers la mort tout en regardant fixement - pas même sur un ton de reproche ni surtout de plainte ou de gémissements - celui dont l'appareil la fixe tel un objet, tel un souvenir ; tel un animal de foire. C'est bien dans le regard de l'autre que nous existons ; dans les yeux désormais baissés que nous sombrons.
C'est pour cette raison même que le regard détourné sur la mort de son peuple accable à jamais son chemin. C'est pour cette raison que je ne puis sans trouble émotion regarder cette femme digne à en pleurer, fière à en trembler s'avancer vers la mort tout en regardant fixement - pas même sur un ton de reproche ni surtout de plainte ou de gémissements - celui dont l'appareil la fixe tel un objet, tel un souvenir ; tel un animal de foire. C'est bien dans le regard de l'autre que nous existons ; dans les yeux désormais baissés que nous sombrons.
Je n'ai jamais su que faire de ces yeux détournés ; de ce silence abyssal. Nul ne le peut ; ne le pourra jamais. Je ne puis imaginer le divin enfreindre sa propre loi pour sauver son peuple à force d'invraisemblables miracles : je ne puis en réalité me mettre à la place du divin ni même avoir l'orgueil de le tenter. Je puis seulement considérer que cet enfer alors produit, méticuleusement ourdi et frénétiquement perpétré n'avait pu l'être qu'à distance incommensurable du divin par une humanité livrée à elle-même.
Ce dont l'humanité est capable une fois tue en elle cette voix qui l'enjoint de s'exhausser ; une fois étouffé l'appel de l’être, s'étale ici dans sa cruelle nudité.
Je sais ce que nous devons aux mères, au divin et à nos amours : de nous inciter à dire non, à ne pas nous contenter de ce que nous sommes, de vouloir nous exhausser.
C'est cela qu'à être seuls, livrés à nous-mêmes, nous avons perdu. D'irrémédiable. Dont nous demeurons inconscients.
Nous devrions être inconsolables.
III, 1, 3. Entre-temps, Astérion était mort sans laisser de descendants. Minos se proposa pour être roi, mais le trône lui fut refusé. Il soutenait que les dieux eux-mêmes lui avaient confié le royaume ; et, pour le prouver, il déclara qu'il obtiendrait d'eux tout ce qu'il leur demanderait. C'est pourquoi il fit un sacrifice à Poséidon, et pria que des flots de la mer apparaisse un taureau, en promettant qu'il le sacrifierait aussitôt. Et voilà que Poséidon lui envoie un très beau taureau : Minos obtint le règne, mais il conserva ce taureau parmi ses bêtes, et en immola un autre. Ayant obtenu le contrôle des mers, Minos se rendit très vite maître de presque toutes les îles. Poséidon, furieux que Minos ne lui ait pas sacrifié le taureau, fit en sorte que Pasiphaé tombe amoureuse de l'animal. La jeune femme, donc, amoureuse du taureau, trouva un allié en Dédale, l'architecte qui avait été banni d'Athènes pour homicide. Il construisit une vache de bois montée sur des roulettes ; l'intérieur était creux, et elle était recouverte d'une peau de bovidé ; il la mit dans le pré où le taureau avait l'habitude de paître, et Pasiphaé y entra. Quand le taureau s'en approcha, il la monta, comme s'il s'agissait d'une vraie vache. Ainsi la jeune femme mit au monde Astérion, dit le Minotaure : il avait la tête d'un taureau et le corps d'un homme. Minos, suivant les conseils de certains oracles, le tint reclus dans le labyrinthe, construit par Dédale ; avec son grouillement de méandres, il était impossible de trouver la sortie. Nous reparlerons du Minotaure, d'Androgée, de Phèdre et d'Ariane, quand nous raconterons l'histoire de Thésée.
