| index | précédent | suivant |
|---|
- >2016
-> 2017
Des femmes et de la moralité
Assurément nous faudrait-il ériger le rapport aux femmes et le souci qu'on leur accorde comme aune de la mesure, comme critère d'une démesure menaçant toujours de pointer.
La semaine passée, poursuivant ma petite réflexion sur le rapport toujours ambivalent qu'on pouvait nourrir à l'égard du pouvoir, sur cette pulsion incroyable qui nous conduit à la démesure, j'écrivis ceci, presque à la dérobée, mais en devinant qu'il y avait là quelque chose à développer. Même si je reconnais que c'est notoirement cuistre de se citer soi-même.
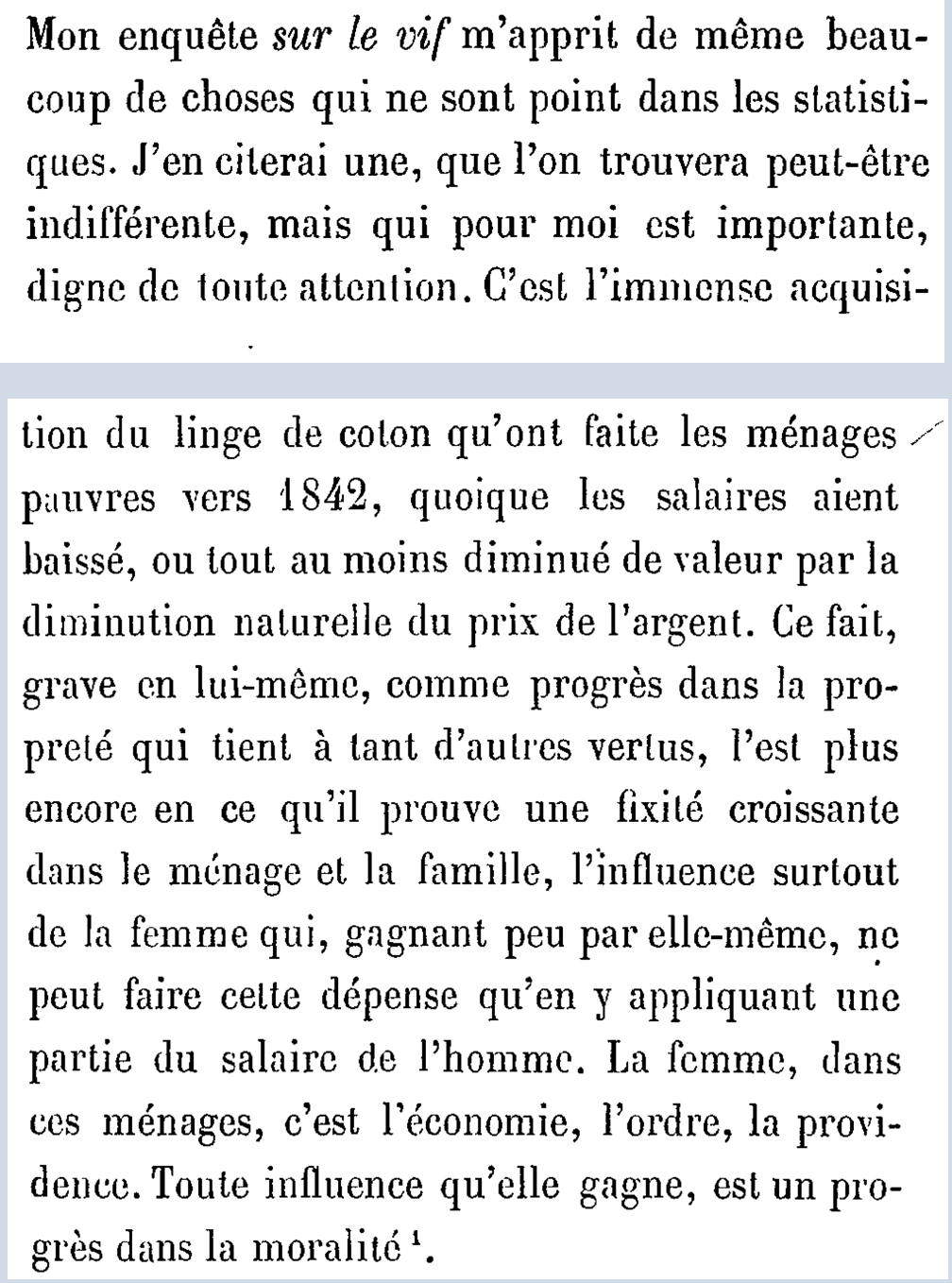 Moins d'une semaine auparavant j'étais tombé presque par hasard, sur ces quelques pages de Michelet par quoi commence Le Peuple : voici l'historien fouaillant dans les petits détails de la vie quotidienne et qui, un demi-siècle avant les Annales de Lucien Febvre et Marc Bloch découvre que la réalité y gagne en épaisseur, en véracité. Même si là dessous persiste une représentation plutôt traditionnelle, disons convenue, de la femme, que ne dénigrera pas Freud pour qui elle représente l'intérieur, l'intime, le sentiment, la moralité par opposition à l'homme qui incarne l'autorité, l'ordre extérieur, on ne peut pas ne pas voir ici la reformulation de cet autre cliché aussi ancien sans doute que la culture humaine : certes, la femme est soumise à l'homme dans à peu près tous les compartiments de l'existence humaine, en y étant même considérée comme un être inférieur, en revanche elle seule détiendrait le véritable pouvoir, sur les mœurs, la morale, les sentiments … bref sur les âmes - ne serait ce que parce que c'est elle qui assure l'essentiel de l'éducation. Et donc sur l'avenir ! sur le temps. Ce qui rejoint une troisième représentation, politique cette fois, qui définit traditionnellement les technocraties comme étant plutôt le gouvernement des choses que celui des hommes avec comme arrière fond cette phrase de J Lachelier selon qui l'espace est la forme de la puissance humaine ; le temps celle de son impuissance.
Moins d'une semaine auparavant j'étais tombé presque par hasard, sur ces quelques pages de Michelet par quoi commence Le Peuple : voici l'historien fouaillant dans les petits détails de la vie quotidienne et qui, un demi-siècle avant les Annales de Lucien Febvre et Marc Bloch découvre que la réalité y gagne en épaisseur, en véracité. Même si là dessous persiste une représentation plutôt traditionnelle, disons convenue, de la femme, que ne dénigrera pas Freud pour qui elle représente l'intérieur, l'intime, le sentiment, la moralité par opposition à l'homme qui incarne l'autorité, l'ordre extérieur, on ne peut pas ne pas voir ici la reformulation de cet autre cliché aussi ancien sans doute que la culture humaine : certes, la femme est soumise à l'homme dans à peu près tous les compartiments de l'existence humaine, en y étant même considérée comme un être inférieur, en revanche elle seule détiendrait le véritable pouvoir, sur les mœurs, la morale, les sentiments … bref sur les âmes - ne serait ce que parce que c'est elle qui assure l'essentiel de l'éducation. Et donc sur l'avenir ! sur le temps. Ce qui rejoint une troisième représentation, politique cette fois, qui définit traditionnellement les technocraties comme étant plutôt le gouvernement des choses que celui des hommes avec comme arrière fond cette phrase de J Lachelier selon qui l'espace est la forme de la puissance humaine ; le temps celle de son impuissance.
Nous y voici : que vise-t-on réellement quand on concentre ses efforts vers le pouvoir ? Les hommes ou les choses ? On ne peut pas ne pas remarquer que, dans toute la culture occidentale, ce qui est perçu comme un danger, une source de violence bientôt inacceptable, c'est le rapport contradictoire à l'autre ; pas à la chose qui, inerte et sans conscience, est immédiatement posée comme à notre disposition.
La moralité commence avec l'intimité : très significatif de son temps et des préjugés de son temps, Michelet n'imagine pas autrement le rôle des femmes que dans le soin du foyer ni les pratiques masculines ailleurs que dans l'alcoolisme. Les ravages de ce dernier sont évidents, même si présenter la classe ouvrière comme une bête dont il faille endiguer les mauvais penchants a quelque chose de très caractéristique du regard bourgeois et hygiéniste de l'époque. En revanche, on voit bien que l'existence même d'un ménage, d'un lieu de vie agréable pour la famille est à la fois une condition et la forme de la vie privée. L'apparition d'appartements, de pièces séparées, de lieux de toilette et d'aisance sont autant de signes non seulement d'une exigence de confort et de conditions de vie améliorées - mais ceci viendra tard au milieu du XXe - mais surtout d'un souci d'intimité et donc de distinction entre vie publique et vie privée où se signalent en même temps moralité et responsabilité mais donc, implicitement, la prééminence de l'individu sur le collectif.
La moralité commence avec l'autre - pas avec la chose ; pas avec le monde. C'est que cette terre que je désire occuper, cet objet que je convoite, il y a toujours quelqu'un qui la possède ou y baguenaude, toujours quelqu'un qui s'en orne ou en use. Vieille dialectique, assurément, qui pourrait laisser à penser que ce qui se dit ici ne serait qu'un vaste truisme ; et qui l'est effectivement par un certain côté. Au reste, si l'on scrute attentivement le Décalogue, il faut peu se temps pour s'assurer qu’effectivement les commandements visent tous mon rapport à l'autre où je me dois d'éviter toute violence ; mon rapport à Dieu où je me dois d'éviter présomption et blasphème. Est-ce pour cette raison que l'homme de pouvoir préfère les conquêtes et l'économiste retraduise en guerre tous les rapports commerciaux ou sociaux ? Par facilité sans doute : les choses obéissent à des lois qu'il suffit de décrypter et ne regimbent point. Sans doute est-ce pour cette identique raison que le pouvoir adopte toujours la même stratégie de réification de l'autre : sou-mettre c'est dégrader. Soit tuer soit asservir. Asservir, ôter à un être la capacité de se déterminer par lui-même et d'exercer ainsi sa volonté, c'est lui interdire ceci même qui fait le vivant : être proprio motu.
Voici qui est la marque de l'Occident : tout traduire en rapport de force donc tout réifier. Jusque et y compris la connaissance : devenir comme maître et possesseur de la nature ! Ce qui précisément désormais nous explose à la figure !
Je voudrais qu'on le comprenne bien : on touche ici aux deux gestes qui signent admirablement la qualité de notre présence au monde. Soit nous réifions à tout va et nous glorifions de cette avancée que scandent nos sciences et techniques ; soit au contraire nous prêtons vie à tout, même aux choses inertes. C'est ce que A Comte nommait fétichisme où il voyait l'état premier, voire enfantin, de l'entendement humain. Nous n'avons toujours pas quitté la manière positiviste, scientiste, de lire notre histoire et continuons de croire que désenchanter le monde, cesser d'y voir un être, le considérer comme un système mu par des lois intangibles est un progrès tant de la connaissance que de notre humanité même. C'est oublier que dans les structures les plus profondes de notre sensibilité, dans les résidus enfantins de notre perception, se languit cette insistante incrédulité qui nous interdit d'admettre jamais être seuls au monde.
Notre inquiétante - mais tout aussi inquiète - humanité réside sans doute dans cet irrésistible arraisonnement du monde. Comment ne pas voir qu'à sa manière, ce fétichisme qu'on prétend primitif aura constitué une véritable protection - à l'instar du Décalogue qui incita au moins à délégitimer toute violence à l'égard de l'autre - contre nos empiétements. Je ne saurais pas lire autrement le mythe de la tour de Babel : toute domination sur le monde ne peut s'entendre que comme un blasphème.
La moralité commence avec les femmes : oui, Michelet a raison mais pas nécessairement pour les causes qu'il envisage. Il n'est pas grand chose qui puisse enrayer notre insatiable appétit de choses, sinon la résistance de l'être. Or, au début de chacune de nos histoires, il y a une femme : une mère. Regardons bien ; lisons mieux : telles que nous les traduisons, exprimons ou pratiquons, presque à chaque fois il n'est question quand nous évoquons les femmes que de conquête, de séduction, de possession. Nos amours empruntent trop souvent les chemins et le vocabulaire de la guerre ou de la chasse pour que ce puisse être un hasard.
Sauf que ! il est une femme qui ne se possède jamais ni ne peut se réduire à nos belliqueuses tensions : la mère. Au début ; au tout début ; au point d'origine … quelqu'un ; qui ne demande rien mais donne tout. Qu'il pût y avoir des femmes qui ratassent leurs maternité, qui n'eussent pas comme on dit étrangement la fibre maternelle, c'est possible ; c'est même très probable sans qu'on puisse toujours déceler les raisons d'un tel échec. Parfois, pour le malheur des deux d'ailleurs, pour leur souffrance respective ou non, le lien ne se noue point, ni les regards ne se croisent. Et c'est grande pitié !
Des quatre termes qui désignent l'amour chez les grecs (ἔρως, φιλία, στοργή et enfin ἀγάπη c'est sans doute storgé qui paraît le mieux lui ressembler, lui qui désigne la tendresse éprouvée pour un enfant. E Badinter avait montré en son temps combien peu instinctif était l'amour maternel, combien tout autant que la féminité elle-même, la maternité était affaire non d'instinct ou de nature mais de déterminismes sociaux et culturels. Il semble au contraire que la relation de la mère à l'enfant, quand elle existe, parce qu'elle est inconditionnelle ou en tout cas se le veuille, et qu'au delà des clichés classiques du sacrifice, de l'abnégation, elle confine à l'absolu, se rapprocherait plutôt de la grâce.
Parfois il m'est arrivé de céder à des regrets, à un nostalgie misérable en songeant à ce que je n'ai pas eu . Et pourtant, les amours humaines, je sais qu'elles se trompent d'objet. Il y a dans tout amour un instant, ou des instants ineffables, un point de rencontre, une coïncidenc e miraculeuse, mais d'un jour, et quelquefois d'une heure , et puis l'un ou l'autre s'éloigne, et que la liaison dure, ne change rien à cette double solitude, à ces solitudes enchaînées.
Aimer les corps, ce n'est pas aimer les êtres. Les posséder et en jouer, jusqu'à la satiété, jusqu'au dégoût, ce n'est pas le pire, c'est l'indifférence qui est le pire et qui vient à bout même du .ressentiment. Que l'obsession de l'autre tourne à l'ennui de sa présence, ce changement lent ou rapide est la fatalité des passions et fait du mariage ce que presque partout nous voyons qu'il est. En considérant un certain visage, en écoutant une certaine voix, nous essayons de nous rappeler le temps où pour nous ce visage faisait la nuit et le jour sur le monde et où l'air que nous respirions était moins nécessaire à notre vie que cette voix bouleversante. C'est maintenant un visage comme tous les visages, une voix comme toutes les voix : c'est la petite ligne blanche à peine distincte d'une très ancienne cicatrice.
Et si je calomnie ici les passions de l'amour j'en demande pardon, s'ils existent, à celles et à ceux qui, aussi longtemps qu'ils auront vécu, se seront aimés, cc qui s'appelle aimés, et qui auront dès ici-bas connu cet instant eternel, et qui n'auront pas eu recours à cette défaite : l'amour devenu amitié, la passion muée en tendresse. Le véritable amour ne change pas. Il est, ou il n'a jamais été.
Cette exjgence dans les êtres qui sont faits pour aimer, qui n'ont jamais su qu'aimer, j'ai pensé quelquefois- qu'elle était assez puissante pour inventer un objet à sa mesure et que ce n'est pas la peur qui crée les dieux comme le croyait Lucrèce, - mais le cœur des hommes, mais cette incoercible passion. Que l'homme issu de la matière, et qui n'est que matière, selon vous, et qui y retournera, ait été capable d'inventer son Dieu, et ce Dieu-là, non une idole de bois ou de métal, non une idole sensuelle et goulue, mais qu'il ait tiré de lui toute la douceur et toute la force, toute la puissance et toute la faiblesse, l'amour enfin et son exigence infinie, et qu'à ce dieu inventé, il ait soufflé des paroles qui après bientôt deux mille ans continuent d'être esprit et vie ... Cette impossibilité ne peut paraître possible qu'à ceux qui n'ont pas -vécu le christianisme du dedans et pour qui il ne relève que de la critique historique de l'étude comparée des religions et des mythes.
Mauriac, Nouveaux mémoires intérieurs, Epilogue p 441
Comment ne pas rapprocher ceci avec ce texte de Mauriac tiré de l’Épilogue des Nouveaux Mémoires Intérieurs ?
Aimer les corps, ce n'est pas aimer les êtres
Bien sûr, dans un contexte bien différent, pour un argumentaire différent, et dans l'approche si particulière de Mauriac, ce doublet âme/corps où le corps classiquement fonctionne à la fois comme un aimant et comme l'obstacle majeur, ce doublet invite à se reposer la question de nos relations amoureuses en réintroduisant subrepticement des relations de pouvoir sitôt qu'il est question de corps, donc de matière, donc d'objet. Que dans la perspective chrétienne qui est la sienne, la relation charnelle soit, si ce n'est systématiquement fautive en tout cas éminemment dangereuse parce que fallacieuse en ceci qu'elle laisserait à entrevoir une proximité et un lien en réalité superficiel, n'a rien d'étonnant mais oblige néanmoins à se demander ce que nous mettons sous le mot amour !
Mauriac ici se désole de la dégradation si fréquente des relations - : l'amour devenu amitié, la passion muée en tendresse. Le véritable amour ne change pas. Il est, ou il n'a jamais été - qu'il présente comme une défaite. Il faut y voir cette double intuition que d'abord, à l'instar de l'approche grecque mais aussi biblique (Jn, 21, 15) il y eût des degrés à l'amour et que surtout, nous ne savons pas toujours ce que nous entendons par ce terme qui se referme sur l'essentiel de ses significations.
Qu'on se comprenne bien et ne se méprenne pas : raisonner à partir d'un petit passage de Michelet laissant entendre que les femmes détinssent la clé de la moralité pour aboutir à une distinction peut-être ancienne mais très chrétienne sur l'amour et notamment l'amour maternel peut sembler étrange. Serait ce à dire que les femmes seules fussent capables d'amour ? évidemment non ! Mais ceci dit au moins que nous ne savons pas toujours de quoi nous parlons lorsque nous évoquons l’amour ; que la part qu'y joue la chair, pour agréable qu'elle fût, à la fois facilite et trouble la rencontre et le lien tissé entre les êtres.
J'aime assez ceci, à mesure que j'avance dans mes petites méditations :
 le point extrême de vacuité qui me fascine mais que nous atteignons si souvent dans nos propos arguant sempiternellement de mots dont nous ne pesons pas véritablement le sens. Ainsi de amour ; mais aussi de valeurs ; de moralité …
le point extrême de vacuité qui me fascine mais que nous atteignons si souvent dans nos propos arguant sempiternellement de mots dont nous ne pesons pas véritablement le sens. Ainsi de amour ; mais aussi de valeurs ; de moralité …- le sens même de la démarche métaphysique, plutôt que de contextualiser l'objet de la recherche dans le temps et l'espace et donc de l'inscrire invariablement dans un rapport de forces économique, politique ou social, qui consiste à l'analyser comme tel, à donner sa chance à l'objet et à ne pas le réduire à la relation que nous entretenons avec lui
- cette certitude désormais acquise sur la relation en boucle entre moralité et intimité qui va bien au delà de ce que j'avais initialement présumé : ce n'est pas tant que la ligne entre soi et l'autre soit flottante, c'est aussi qu'elle s'inscrit dans la manière dans nous occupons l'espace jusqu'à celui de nos appartements
- ce rapport à la matière, trouble surtout s'agissant du corps, mais assurément pas pour les raisons que l’Église parfois bien obtuse avait subodorée mais bien plutôt pour nous condamner au rapport de forces, à la conquête belliqueuse ; à la violence.
Quatre points au moins qui méritent d'être réfléchis, travaillés ou repensés ; qui feront l'objet assurément des prochaines pages.
Freud eut incontestablement tort lorsqu'il eut reclus la femme dans l'espace privé où dominent douceur, émotion, sentiment mais il avait compris que la distribution intérieur/extérieur jouait ici un rôle essentiel. Il faut relire ces passages pour réaliser qu'à côté des préjugés de son temps qui pèsent de toute leur sottise et que l'on peut retrouver jusque dans les propos d'une Arendt qui se refuse en tant que femme à se poser en situation d'avoir à commander, il y a des intuitions géniales.
Mais notre interrogation n'est pas la même que la sienne : Freud se demandait comment se construisait l'identité féminine - et ceci déjà était un progrès incontestable que de ne pas cantonner l'identité en une essence immuable et éternelle ; je veux quant à moi tenter de comprendre ce lien entre intériorité et moralité mais une intériorité où se jouent, certes, éducation, famille, mode de vie, mais surtout notre rapport au monde et à l'autre. Est-ce pour ceci que m'irrite tant la référence aux valeurs dont se rengorgent les professionnels de tout poil ? oui sûrement ! Ces valeurs que l'on invoque à satiété, jusqu'à l'obscénité parfois, dans les milieux professionnels tiennent leurs sens et vigueur du domaine privé ; s'affadissent et pervertissent sitôt instrumentalisées par le domaine public.
Tel est sans doute le sens de la moralité : de l'intimité où elle gagne son authenticité vers le public où elle tente de s'inscrire et réaliser. Toute inversion de ce chemin serait douteuse.
Tel est aussi tout le dilemme où se trouve toute philosophie : ou bien, suivant ainsi la démarche initiée dès le XVIIIe, on tente de comprendre les phénomènes dans leur émergence historique, politique, sociale etc : de les considérer comme des processus résultant de conflits dialectiques ou bien au contraire, à l'instar de la procédure métaphysique, on cherche à les appréhender en tant que tels, en eux-mêmes, indépendamment du contexte où ils de déploient. Or, pour la moralité, le dilemme est très simple : ou bien on considère les préceptes moraux comme l'intériorisation des normes sociales - c'est après tout ainsi que Freud entendra le Sur-Moi - ou bien au contraire on la considérera comme une volonté d'extérioriser dans ses actes, projets et volontés, des valeurs que l'on posent en soi comme absolues.
Intériorisation ou extériorisation ?
La morale est décidément affaire de semi-conducteurs !