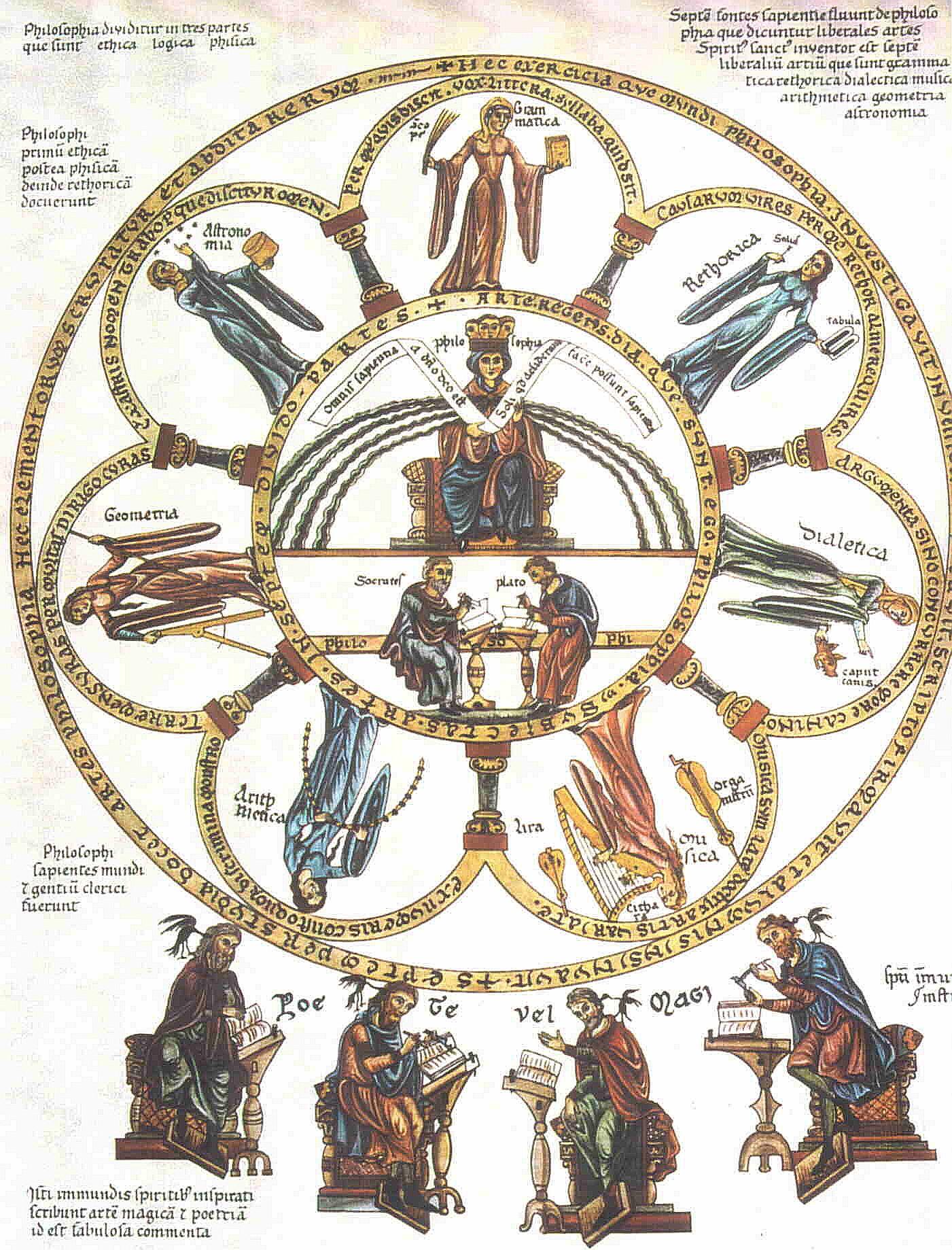| Introduction | Livre I | précédent | suivant |
|---|
la question de la langue et de la cité
Mythe assurément que celui de cette langue originaire mais dont après tout on chercha longtemps les traces, suggéré par le verset mais aussi par cette idée simple qu'elle dut bien avoir été celle avec laquelle Dieu s'adressa aux hommes. Ici aussi le récit est troublant ; pour la première fois Dieu semble tout sauf bienveillant. En effet, vouloir que l'homme obéisse suppose qu'il entende et comprenne l'interdit, accepte sa faute et la rachète. Ici, en inscrivant la diversité des langues, en empêchant les hommes de s'entendre et donc de rien construire ensemble, en leur interdisant de faire oeuvre commune, Dieu parait plus percevoir l'homme sinon comme un ennemi que comme un concurrent qui par sa puissance le menacerait. Comme s'il n'était qu'une parole qui vaille, celle descendante qui va de Dieu vers l'homme et que celle, horizontale, d'entre les hommes, était naturellement une catastrophe ou un blasphème. On assiste en réalité dans les premiers livres de l'AT à une série de refondations, l'homme prenant successivement une série de mauvais chemins qui l'éloigneraient de Dieu : l'inédit de cet épisode étant que la dispersion remplace désormais la destruction. Les hommes ne meurent plus de leurs fautes mais; comme dans l'épisode initial, sont dispersés ou expulsés.
 Mais ce qu'avait vu Aristote c'est combien langue et cité avait partie liée : il n'est pas d'organisation sociale non plus qu'économique, pas de division sociale des tâches sans elle. Autre façon de dire que la langue est d'essence politique au moins autant que la cité est consubstantiellement dialogue. En faisant de la cité une composante de la nature humaine, Aristote se met aux antipodes d'une philosophie de l'individu qui naîtra plus tard : pour lui, l'homme n'est pas un être complet tant qu'il n'est pas politique ; inachevé, source de violences et de discordes ; seul la cité lui permet de donner toute sa mesure et de se réaliser à l'inverse d'un Rousseau, par exemple, pour qui la tendance première de l'homme est plutôt, par peur, de fuir son prochain et ne s'y résolvant, sous la condition d'un contrat qui asseoie ses droits naturels, que lorsque les circonstantes l'y contraignent. Pièce isolée dans un jeu de tric trac l'homme sans cité n'est rien, pas même l'ombre de lui-même.
Mais ce qu'avait vu Aristote c'est combien langue et cité avait partie liée : il n'est pas d'organisation sociale non plus qu'économique, pas de division sociale des tâches sans elle. Autre façon de dire que la langue est d'essence politique au moins autant que la cité est consubstantiellement dialogue. En faisant de la cité une composante de la nature humaine, Aristote se met aux antipodes d'une philosophie de l'individu qui naîtra plus tard : pour lui, l'homme n'est pas un être complet tant qu'il n'est pas politique ; inachevé, source de violences et de discordes ; seul la cité lui permet de donner toute sa mesure et de se réaliser à l'inverse d'un Rousseau, par exemple, pour qui la tendance première de l'homme est plutôt, par peur, de fuir son prochain et ne s'y résolvant, sous la condition d'un contrat qui asseoie ses droits naturels, que lorsque les circonstantes l'y contraignent. Pièce isolée dans un jeu de tric trac l'homme sans cité n'est rien, pas même l'ombre de lui-même.
C'est d'ici, semble-t-il, qu'il faut comprendre la pesanteur métaphysique de la cité. Elle est ce qui signe la spécificité humaine qui lui interdit de se penser comme un animal anodin. A part, parce qu'animal dialoguant, il trouve dans la cité cette assise qu'il ne trouve pas dans la terre.
On ne peut ainsi pas faire que la conception que l'on se fait de la cité, de ce que plus tard on nommera civilisation, ne comporte pas, plus ou moins implicite, un sous-bassement sinon une approche métaphysique : dans tous les cas de figure, l'homme ne parvient pas à se penser comme un être anodin, mais bien plutôt comme un être distinct de tous les autres vivants. Ou bien, il tient sa spécificité de sa procession divine ou bien de la conscience qu'il a et de sa capacité à abstraire. Dans les deux cas, le hante l'exil. Il n'est pas de ce monde et cherche, en rachetant sa faute originelle, à revenir au Père ; il n'a de place que dans cette construction qu'est la cité. Exister, trouver sa juste place dans le monde revient toujours à (re)trouver une place perdue ; une patrie égarée.
Il n'est pas d'ici et n'a pas non plus de maintenant : tout entier tourné vers un avenir à construire ou un passé à retrouver, l'homme semble n'être jamais présent au monde mais en quête incessante d'une province perdue ou d'une terre promise.
la question de la cité
Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sennaar, et s'y étaient arrêtés.
La langue n'a d'ailleurs pas vraiment d'autre moyen de marquer la différence que par la distance : ainsi la toute puissance divine est indiquée par la juxtaposition du lux fiat au lux fit. L'impuissance vertigineuse l'eût été par l'écart immense entre le désir ou la volonté et leur résultante.
L'humanité, au fond, doit faire face à deux écueils, aussi dangereux l'un que l'autre : l'absence de différence ; le trop-plein de différence. L'absence ? et c'est, selon Girard, le conflit, par le jeu du désir mimétique ! la masse qui s'egaye et met à bas toute organisation sociale. L'absence et c'est laisser se dérouler le jeu des instincts et de l'argument de la nature qui incline toujours dans le même sens de l'inertie et du conservatisme. Le trop plein ? et c'est l'impossibilité de nouer quelque lien que ce soit, le rejet de l'autre, voire l'ethnocentrisme dans sa version douce ou dure qui conduit à la xénophobie. Est-ce un hasard que Aristote emploie l'expression brandon de discorde ?
L'humilité extrême qui débouche sur la négation de soi dont la forme noble est l'abnégation et celle, vile, l'obéissance servile et aveugle au maître, qui trouve son expression la plus abjecte dans la référence d'Eichmann à Kant.
Déterminé deux fois avons nous écrit : horizontalement dans son rapport à l'autre ; verticalement dans son rapport au monde. Dans les deux cas, l'affirmation de soi incite à la fuite ; à l'exil. Au moins à l'écart
Différer c'est étymologiquement disséminer, éparpiller, porter en sens divers, répandre des bruits mais aussi être tiraillé, tourmenté
Si Aristote fait, par nature, de l'homme un animal politique, il le lie néanmoins à la parole. Loin de n'être que la résultante d'une circonstance qui eût contraint l'homme à s'unir aux autres pour survivre comme ce sera le cas chez Rousseau par exemple, la socialité humaine au contraire est, chez Aristote, ce qui permet à l'homme de se réaliser, de se parachever. Seul, l'homme n'est pas homme, mais un monstre ou un dieu.