| index | précédent | suivant |
|---|
La grande méprise
La science des choses extérieures ne me consolera pas de l’ignorance de la morale au temps d’affliction, mais la science des mœurs me consolera toujours de l’ignorance des sciences extérieures. Pascal, 67
Dans la très récente ITV que le très prolixe - surtout depuis le début de la crise sanitaire - E Morin donne au Monde ce week-end, cette question étonnante :
Nous avions une vision unitaire de la science. Or, les débats épidémiologiques et les controverses thérapeutiques se multiplient en son sein. La science biomédicale est-elle devenue un nouveau champ de bataille ?
Mais de quoi parle-t-on en fin de compte ? De la science ou de notre vision de la science ? De la chose elle-même ou de la vulgarisation pour gazettes empressées. Manie peut-être que de se braquer sur les mots ! tic sans doute que de chercher, pont-aux-ânes de la philosophie, quelle réalité se cache derrière ces apparences qui font si aisément se tordre de rire les servantes de Thrace !
C'est que les sciences attisent leur lot de clichés, de banalités, d'idées reçues : les choses vont-elles mal, une crise quelconque entrave-t-elle le déroulement habituel de nos vies sociales que nous les en incriminons … à moins que nous n'en attendions le salut suprême. Une telle ambivalence ne cache rien de bon ; traduit au contraire sans doute une réelle méconnaissance ; en tout cas un lien trop passionnel pour être raisonné.
Nos récit sont emplis de ces braves scientifiques mécompris, injustement oubliés à moins qu'ils ne fussent persécutés ; contraints de lutter contre les préjugés, l'intolérance dogmatique de l'Eglise ou du pouvoir en place ( Galilée bien sûr mais tant d'autres …) sans oublier la figure du savant fou, tellement prisée par la BD, les romans fantastiques ou de science-fiction, le cinéma.
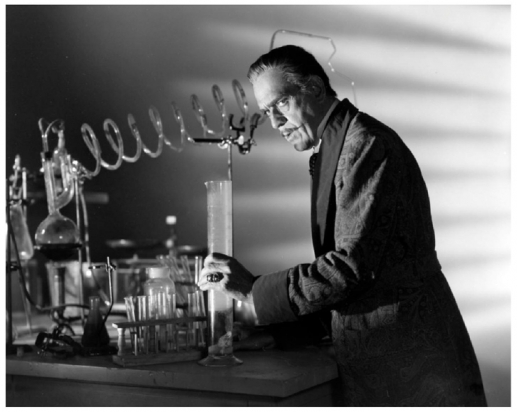 Car ce n'est pas seulement l'intérêt qui fait s'entre-tuer les hommes. C'est aussi le dogmatisme. Rien n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir raison. Rien ne cause autant de destruction que l'obsession d'une vérité considérée comme absolue. Tous les crimes de l'histoire sont des conséquences de quelque fanatisme. Tous les massacres ont été accomplis par vertu, au nom de la religion vraie, du nationalisme légitime, de la politique idoine', de l'idéologie juste ; bref au nom du combat contre la vérité de l'autre, du combat contre Satan. Cette froideur et cette objectivité qu'on reproche si souvent aux scientifiques, peut-être conviennent-elles mieux que la fièvre et la subjectivité pour traiter certaines affaires humaines. Car ce ne sont pas les idées de la science qui engendrent les passions. Ce sont les passions qui utilisent la science pour soutenir leur cause. La science ne conduit pas au racisme et à la haine. C'est la haine qui en appelle à la science pour justifier son racisme. On peut reprocher à certains scientifiques la fougue qu'ils apportent parfois à défendre leurs idées. Mais aucun génocide n'a encore été perpétré pour faire triompher une théorie scientifique. A la fin de ce XXe siècle devrait être clair pour chacun qu'aucun système n'expliquera le monde dans tous ses aspects et tous ses détails. Avoir contribué à casser l'idée d 1 une vérité intangible et éternelle n est peut-être pas l'un des moindres titres de gloire de la démarche scientifique
Car ce n'est pas seulement l'intérêt qui fait s'entre-tuer les hommes. C'est aussi le dogmatisme. Rien n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir raison. Rien ne cause autant de destruction que l'obsession d'une vérité considérée comme absolue. Tous les crimes de l'histoire sont des conséquences de quelque fanatisme. Tous les massacres ont été accomplis par vertu, au nom de la religion vraie, du nationalisme légitime, de la politique idoine', de l'idéologie juste ; bref au nom du combat contre la vérité de l'autre, du combat contre Satan. Cette froideur et cette objectivité qu'on reproche si souvent aux scientifiques, peut-être conviennent-elles mieux que la fièvre et la subjectivité pour traiter certaines affaires humaines. Car ce ne sont pas les idées de la science qui engendrent les passions. Ce sont les passions qui utilisent la science pour soutenir leur cause. La science ne conduit pas au racisme et à la haine. C'est la haine qui en appelle à la science pour justifier son racisme. On peut reprocher à certains scientifiques la fougue qu'ils apportent parfois à défendre leurs idées. Mais aucun génocide n'a encore été perpétré pour faire triompher une théorie scientifique. A la fin de ce XXe siècle devrait être clair pour chacun qu'aucun système n'expliquera le monde dans tous ses aspects et tous ses détails. Avoir contribué à casser l'idée d 1 une vérité intangible et éternelle n est peut-être pas l'un des moindres titres de gloire de la démarche scientifique
 F Jacob a beau vouloir blanchir les chercheurs de tout fanatisme ou indifférence à l'endroit de l'humain qu'ils négligeraient au profit de la seule passion de la découverte et arguer qu'aucun massacre ou génocide n'eût été commis pour justifier une théorie scientifique, il omet un peu vite, mais peut-il faire autrement, que nombreux néanmoins participèrent avec plus ou moins de ferveur à l'aventure nazie. Indifférents souvent au contexte, on les retrouvera après guerre aux USA - comme W von Braun inventeur des V1 et V2 mais aussi initiateur de tout le programme spatial américain. C'est lui que caricature si habilement le Dr Folamour de Kubrick.
F Jacob a beau vouloir blanchir les chercheurs de tout fanatisme ou indifférence à l'endroit de l'humain qu'ils négligeraient au profit de la seule passion de la découverte et arguer qu'aucun massacre ou génocide n'eût été commis pour justifier une théorie scientifique, il omet un peu vite, mais peut-il faire autrement, que nombreux néanmoins participèrent avec plus ou moins de ferveur à l'aventure nazie. Indifférents souvent au contexte, on les retrouvera après guerre aux USA - comme W von Braun inventeur des V1 et V2 mais aussi initiateur de tout le programme spatial américain. C'est lui que caricature si habilement le Dr Folamour de Kubrick.
Amusant au reste de constater que c'est le même reproche qu'on adressera à Heidegger : s'intéresser plus à la question de l'Etre, et de l'oubli de l'Etre que du destin de l'homme. C'est assez suggérer que la méprise est ancienne. Thalès tombe dans le puits … et fait rire ! Etranger au monde d'un côté ; mécompris de l'autre. Il en va des relations entre le commun et les science comme dans ces (mauvaises) histoires de couples où les partenaires s'invectivent d'autant plus qu'ils ont cessé depuis longtemps de s'écouter …
 Sans doute Jacob arguerait-il que ce serait ici confondre le chercheur et l'homme. La question se posera tout autant pour les artistes et ceux exerçant des professions intellectuelles qui ne partirent pas ; ne se turent pas et parfois firent comme si de rien n'était.
Sans doute Jacob arguerait-il que ce serait ici confondre le chercheur et l'homme. La question se posera tout autant pour les artistes et ceux exerçant des professions intellectuelles qui ne partirent pas ; ne se turent pas et parfois firent comme si de rien n'était.
C'est assez dire qu'avant la question épistémologique, se pose la question morale. Mais elle importe au moins autant du côté du chercheur que du côté du public.
Car derrière la méprise, je renifle une imposture.
De l'impossibilité d'un savoir unifié
Curieuse question ; étonnante expression que cette vision unitaire … surprenante réponse de Morin.
Je crois que le cerveau humain a une exigence fondamentale: celle d’avoir une représentation unifiée et cohérente du monde qui l’entoure ainsi que des forces qui animent ce monde. Les mythes, comme les théories scientifiques répondent à cette exigence humaine. Dans tous les cas, et contrairement à ce qu’on pense souvent, il s’agit d’expliquer ce qu’on voit par ce qu’on ne voit pas, le monde visible par un monde invisible qui est toujours le produit de l’imagination; Par exemple, on peut regarder la foudre comme l’expression de la colère divine, ou comme une différence de potentiel entre les nuages et la Terre; on peut regarder une maladie comme le résultat d’un sort jeté à une personne, ou comme le résultat d’une infection virale, mais, dans tous les cas, ce qu’on invoque comme cause ou système d’explication, ce sont des forces invisibles qui sont sensées régir le monde. Par conséquent, qu’il s’agisse d’un mythe ou d’une théorie scientifique, tout système d’explication est le produit de l’imagination humaine. La grande différence entre mythe et théorie scientifique, c’est que le mythe de fige. Une fois imaginé, il est considéré comme la seule explication du monde possible. Tout ce qu’on rencontre comme événement est interprété comme un signe qui confirme le mythe. Une théorie scientifique fonctionne de manière différente. Les scientifiques s’efforcent de confronter le produit de leur imagination (la théorie scientifique) avec la “réalité” c'est-à-dire l’épreuve des faits observables. De plus, ils ne se contentent pas de récolter des signes de sa validité, ils s’efforcent d’en produire d’autres, plus précis, en la soumettant à l’expérimentation. Et les résultats de celle-ci peuvent s’accorder ou non avec la théorie. Et si l’accord ne se fait pas, il faut jeter la théorie et en trouver une autre.
Ainsi le propre d’une théorie scientifique est d’être tout le temps modifiée ou amendée.
F Jabob
Il n'est pas une leçon de philosophie, pas une leçon d'épistémologie, pas un regard jeté sur l'évolution des connaissances depuis 40 ans qui n'aille dans le même sens : LA science n'existe pas ; il y a des sciences … qui ne s'accordent d'ailleurs pas toutes entre elles.
 Que ce soit un projet, assurément ; l'exigence fondamentale du cerveau humain (Jacob) ou l'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides (Levi-Strauss) ce n'est pas impossible ; mais c'est une affaire logique d'abord : comment concevoir la vérité autrement que comme une, intangible et universelle ?
Que ce soit un projet, assurément ; l'exigence fondamentale du cerveau humain (Jacob) ou l'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides (Levi-Strauss) ce n'est pas impossible ; mais c'est une affaire logique d'abord : comment concevoir la vérité autrement que comme une, intangible et universelle ?
Mais nous nous laissons si souvent prendre au piège du langage comme le suggérait Nietzsche : à moins d'en faire un être, la vérité n'est qu'une valeur logique nous permettant d'accréditer ou non un énoncé, une proposition. De la faire nôtre. Vérité n'est pas ce soleil que l'on contemple hors de la caverne et qui éblouit tant !
Mais nous nous laissons assurément prendre au piège de nos structures mentales. Kant l'avait vu : pour que le réel nous soit donné aux sens et devienne pensable, encore doit-il passer préalablement par le crible de formes a priori - pour la sensibilité - de catégories - pour l'entendement. La chose telle qu'elle est, en soi et donc indépendante de nous et de notre pensée - ainsi que la suppose le matérialisme - cette chose ne nous est pas accessible. Exit le monde ! mais ajoutons exit la conscience qui elle-même ne se peut réflechir que par les mêmes sas !
Nous nous laissons assurément prendre au piège des mots comme de nos modes de raisonnement qui quantifiant, parce que la raison ne peut procéder autrement, ramène toujours au même et néglige les différences. Il y a un pari là dessous : ne tenant compte que de ce qui est pensable, nous présumons que ces petites différences qualitatives sont négligeables … en tout cas suffisamment anecdotiques pour ne pas rendre faux le savoir que nous nous formons du réel.
Cet échec de l’effort déductif n'est pas pour nous surprendre. Nous savons que la raison ne procède que d'identité en identité ; elle ne peut donc tirer d'elle-même la diversité de la nature. Contrairement au postulat de Spinoza, l'ordre de la nature ne saurait être entièrement conforme à relui de la pensée. S'il l'était, c'est qu'il y aurait identité complète dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que la nature n'existerait pas. En d'autres termes, l'existence même de la nature est une preuve péremptoire qu'elle ne peut être entièrement intelligible. Le principe d'identité est la plus vaste des hypothèses que nous puissions formuler, puisqu'il s'applique à la totalité du monde sensible ; mais son action, en tant qu'hypothèse, ne ressemble à celle d'aucune autre. En effet, pour toute autre hypothèse, nous pouvons, en la formulant, nourrir au moins l’illusion qu'elle s'appliquera à tous les phénomènes qu'elle est chargée d'expliquer. Mais ici nous savons d'avance que nous sommes condamnés à échouer. Et cela, non seulement en ce qui concerne le domaine entier des faits dévolus à cette hypothèse, et qui est, en l'espèce, l'univers, mais dans l'explication de chaque fait particulier. Aucun phénomène, même le plus insignifiant, n'est complètement explicable. Nous avons beau «ramener» le phénomène à d'autres, lui en substituer de plus en plus simples : chaque réduction est un accroc fait à l'identité, à chacune nous en abandonnons un lambeau, et finalement il reste, des deux côtés de notre explication, ces deux énigmes qui ne sont d'ailleurs que les deux faces d'une seule : la sensation et l'action transitive .
Aucun phénomène, même le plus insignifiant, n'est complètement explicable. Nous avons beau «ramener» le phénomène à d'autres, lui en substituer de plus en plus simples : chaque réduction est un accroc fait à l'identité, à chacuue nous en abandonnons un lambeau, et finalement il reste, des deux côtés de notre explication, ces deux énigmes qui ne sont d'ailleurs que les deux faces d'une seule : la sensation et l'action transitive. (…) La véritable voie a été indiquée par Kant : Il y a bien accord entre notre entendement et la réalité, mais cet accord est partiel, puisque, en fin de compte, nous nous heurtons aux contradictions que nous appelons les antinomies. Meyerson, Identité et réalité p 365
Sans doute idéalisons-nous enfin notre entendement qui, pour puissant et fécond qu'il soit, ne peut pas fonctionner sans se donner des principes, des axiomes, des règles qu'il est bien obligé de poser et ne pourra jamais justifier. Identité, contradiction, tiers exclu, évidemment. Temps et déterminisme où l'identité trône également en maître - les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sans ses normes l'entendement s'épuise ; sans ces principes, la raison est impotente. Alors quoi tout ce qui est réel est rationnel ? D'où tenons-nous que la rationalité épuise le réel ? D'où tenons-nous que les règles qui ordonnancent notre pensée soient les mêmes que celles qui organisent le réel ?
Tout plaide pourtant dans le même sens - d'ailleurs heureux : nous ne parvenons qu'à des vérités partielles et provisoires. Quand bien même n'admettrions-nous que ce qui fut vérifié et prouvé, nous ne pouvons pourtant être certains que de nos erreurs. Il n'est jamais de certitude que négative au point qu'une théorie qui ne pourrait être falsifiée ne peut être considérée comme scientifique. (Popper)
Enfin, ce qui n'est pas rien, les savoirs sont éclatés en domaines distincts qui se recoupent parfois, se chevauchent même quelquefois mais ne coïncident pas. Oui, et sans doute ceci fut-il nécessaire, les connaissances se développèrent en se spécialisant et toutes les théories de la connaissance, histoire des sciences ou épistémologies font le même constat : depuis les mathématiques, de la logique à la physique, puis de la biologie aux sciences humaines, chaque domaine apporta son lot d'innovations mais aussi de problèmes à résoudre et de démarches souvent très différentes. En physique il n'est même pas de cohérence entre Newton, Einstein et théorie des quanta …
Non, décidément les sciences n'apportent pas de parole unique ! Non plus d'ailleurs qu'une démarche unique.
Une illusion obstinée
Mais alors d'où la persistance d'une telle illusion ?
 Passons outre l'argument psychologique voire anthropologique d'un besoin sinon de certitudes au moins de ce que Comte nommait théorie quelconque et qui faisait Nietzsche douter que nous fussions jamais résolument athées - comme si nous n'avions fait en la matière que troquer une croyance contre une autre, les dogmes religieux contre un credo scientiste guère plus prudent et nuancé, bref des chaînes contre d'autres chaînes ; ou que nos passions - peur de l'incertitude, orgueil et mégalomanie - fissent peu de cas de la tempérance précautionneuse et si besogneuse des sciences.
Passons outre l'argument psychologique voire anthropologique d'un besoin sinon de certitudes au moins de ce que Comte nommait théorie quelconque et qui faisait Nietzsche douter que nous fussions jamais résolument athées - comme si nous n'avions fait en la matière que troquer une croyance contre une autre, les dogmes religieux contre un credo scientiste guère plus prudent et nuancé, bref des chaînes contre d'autres chaînes ; ou que nos passions - peur de l'incertitude, orgueil et mégalomanie - fissent peu de cas de la tempérance précautionneuse et si besogneuse des sciences.
Force est de constater que jamais sans doute dans l'histoire humaine l'écart n'aura été aussi grand entre ce que sait le commun et ce à quoi est parvenu la pointe avancée des sciences. Après tout quand au XIIe on affirmait que le soleil se levait ou se couchait, bref qu'il tournait autour de la terre, que les corps lourds tombaient quand les corps légers s'envolaient, on énonçait, certes avec des mots simples des idées que l'on retrouvait dans la Physique d'Aristote, des faits qui se constataient avec une irréfragable évidence. Or, en progressant, le savoir scientifique se révèle à la fois ardu et décevant : de plus en plus complexe, abstrait, mathématisé bref difficile d'accès en même temps que de plus en plus spécialisé et provisoire, de moins en moins universel et stable. Que cette distance, qui ne va pas se réduisant, favorise les contresens n'a rien d'étonnant finalement. On peut toujours se gausser de l'inculture des uns et des autres - ce serait rapidement méprisant et particulièrement inutile - même si on peut constater que l'éducation, pourtant poussée de plus en plus loin, semble malaisément parvenir à la combler - même chez ceux qui sont pourtant supposés transmettre l'information et donc la saisir peu ou prou !
Une partie de la réponse réside sans doute dans cette victoire de l'esprit techniciste finalement assez peu sensible à la recherche fondamentale ou à la passion de la connaissance, prompte plutôt à transformer les savoirs en recettes applicables et sûres, en techniques efficaces, en brevets vendables. Critique déjà posée par le sulfureux Heidegger : la notion de techno-science est assez juste si l'on veut dire par là qu'on privilégiera, dans les recherches, celles susceptibles d'applications concrètes visibles, probables et profitables à court-terme. D'avoir laissé la méthode prendre le pas, les sciences auraient cessé de penser, auraient perdu leur sol natal philosophique et cesseraient de s'interroger sur ce qui est pour se contenter de scruter comment est ce qui est. Remarque finalement assez proche de la thèse comtienne d'un esprit positif qui cesserait enfin de se poser la question pourquoi, typiquement théologique, au profit de la question comment. Danger qui gagnerait les universités et laboratoires divers où l'on fermera volontiers les unités de lettres, d'art, de philosophie ou de sciences humaines en défaut d'utilités. Heidegger fait ce même constat : le primat de la méthode, si fécond par ailleurs, produit une véritable technicisation des sciences non pas tant en ce qu’elle utiliserait des outils techniques pour parvenir à produire des connaissances mais en ce qu’elle se fût organisée de manière technique : parcellisation des tâches, rationalisation des procédures, abstraction et mécanisation accrue. D’où une spécialisation de plus en plus forte des domaines de recherche et donc des chercheurs. D'où la nécessité d'échanges accrus entre les chercheurs, certes, mais publier ses recherches et ses résultats sur la place commune, ne garantit pas qu'on soit compris surtout entre domaines très éloignés.
C'est ce même constat que fait Morin : La science est ravagée par l’hyperspécialisation, qui est la fermeture et la compartimentation des savoirs spécialisés au lieu d’être leur communication
 On ne dira jamais assez l'ambivalence où nous enferme l'incompatibilité entre action et pensée. Dire que je ne puis agir sans stopper, au moins provisoirement, les doutes ou les nuances que je puis nourrir signifie que l'acteur, le technicien, l'ingénieur ou l'enseignant, au moment où il agit, fait comme si son savoir était absolument certain et définitif. La suprématie du pragmatisme, cette course à l'efficacité et à la production - que ce soit de marchandises ou de connaissances - empêche que ce temps de la réflexion puisse encore se produire et invariablement, transforme le savoir en recettes, qui plus est, en recettes locales. On sera passé, sans toujours le réaliser de la recherche au prêt-à-penser. Deux phénomènes ainsi concourent au même résultat et l'aggravent: la division des champs de la connaissance en autant de parcelles étroites et souvent closes sur elles-mêmes qui interdisent d'avoir une vue d'ensemble ; la hantise du résultat, de la performance, de l'efficacité qui interdit de penser - tout juste de fonctionner !
On ne dira jamais assez l'ambivalence où nous enferme l'incompatibilité entre action et pensée. Dire que je ne puis agir sans stopper, au moins provisoirement, les doutes ou les nuances que je puis nourrir signifie que l'acteur, le technicien, l'ingénieur ou l'enseignant, au moment où il agit, fait comme si son savoir était absolument certain et définitif. La suprématie du pragmatisme, cette course à l'efficacité et à la production - que ce soit de marchandises ou de connaissances - empêche que ce temps de la réflexion puisse encore se produire et invariablement, transforme le savoir en recettes, qui plus est, en recettes locales. On sera passé, sans toujours le réaliser de la recherche au prêt-à-penser. Deux phénomènes ainsi concourent au même résultat et l'aggravent: la division des champs de la connaissance en autant de parcelles étroites et souvent closes sur elles-mêmes qui interdisent d'avoir une vue d'ensemble ; la hantise du résultat, de la performance, de l'efficacité qui interdit de penser - tout juste de fonctionner !
Mis à part le fait que la bureaucratie est par essence anonyme~ toute action qui s'exerce sans relâche entraîne une dilution de la responsabilité. Il existe en anglais une formule idiomatique : « stop and think » - -arrête-toi et réfléchis. Aucun homme ne peut réfléchir sans s'arrêter. Si vous contraignez quelqu'un à une activité sans relâche, ou s'il se laisse contraindre, c'est toujours la même histoire. Vous aurez toujours affaire à la même chose, à savoir que la conscience, de la responsabilité ne peut pas se former. Elle ne peut se former qu'au moment où l'on réfléchit - non pas sur soi-même, mais sur ce qu'on fait. Arendt
En réalité, sans le dire, tout va dans le sens de ce scandaleux la science ne pense pas de Heidegger.
Sauf à considérer qu'ici, ce ne serait pas seulement la science en elle-même qui ne penserait pas, mais les scientifiques comme les techniciens, condamnés qu'ils se seraient eux-mêmes à produire de plus en plus, de plus en plus vite et de manière de plus en plus collective et parcellaire.
Un peu comme si se voyait ici restaurée la place centrale de la philosophie, non pas nécessairement au sens de princeps mais comme carrefour, qui seule aurait cette capacité de faire prendre du recul aux scientifiques comme aux techniciens en les aidant à poser les problèmes de manière globale et non seulement parcellaire. La chose n'a rien d'original, certes. Le recours à la philosophie comme outil de tempérance contre dogmatisme et fanatisme, voici ce que Voltaire avait déjà conçu et avant lui, Montaigne, Aristote … Sans doute a-t-on commis une grosse erreur lorsqu'on a commencé non pas tant à accorder la prééminence qu'à concéder l'hégémonie aux sciences dures ; erreur aggravée en voulant les séparer et opposer à de pseudo-sciences sociales et humaines. On en paie le prix ! Dès lors autant manque aux sciences dures ce fonds de culture philosophique indispensable pour éviter toute instrumentalisation, autant, à l'inverse, manque aux philosophes - et plus généralement à tous les chercheurs en sciences humaines - ce minimum de connaissances en sciences dures qui leur éviterait les contresens les plus effrayants
Mais il ne faut jamais oublier que la tendance est forte et concerne tous les domaines : au plus fort de sa suprématie intellectuelle le marxisme n'hésita pas à s'ériger en science rejetant dan l'idéologie tout ce qui n'allait pas dans son sens ! Lyssenko a laissé des traces ! Diamat aussi et l'opprobe jetée sur la science bourgeoise. Attitude ancienne disait Levi-Strauss ! Aux anathèmes d'antan, aux invectives, aux renégats, mécréants et autre hérétiques d'antant, on hurle désormais à l'idéologie. Ce demeure une affaire d'exclusion …
Il est dangereux de trop faire voir à l’homme combien il est égal aux bêtes, sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui trop faire voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l’un et l’autre. Mais il est très avantageux de lui représenter l’un et l’autre.
Il ne faut pas que l’homme croie qu’il est égal aux bêtes, ni aux anges, ni qu’il ignore l’un et l’autre, mais qu’il sache l’un et l’autre.
L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.
S’il se vante, je l’abaisse ; s’il s’abaisse, je le vante ; et le contredis toujours, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il est un monstre incompréhensible.
Que l’homme maintenant s’estime à son prix. Qu’il s’aime, car il y a en lui une nature capable du bien ; mais qu’il n’aime pas pour cela les bassesses qui y sont. » PASCAL, Pensées,Rien assurément n'est plus effrayant que l'absence de pensée ! or comment penser sans références, repères ; culture et volonté de leur donner un sens. J'ai toujours estimé que si les sciences parvenaient, au mieux, à dire comment sont les choses, comment est le monde en revanche elles étaient incapables de donner sens et valeur à notre présence au monde - tout simplement parce que ce n'était pas leur objet. Mais à l'inverse rien n'est plus angoissant que ces pièges que la pensée se tend à elle-même et qui la rendent incapable de même seulement repérer les pires horreurs, et susceptibles même de les justifier !
Pascal n'avait pas tort. Mais qui pourrait garantir jamais qu'en faisant la bête on parviendrait à faire l'ange ?
J'aime assez ce monstre incompréhensible ! grevé d'autant de pesanteurs qu'exhaussé parfois de grâce ; imprévisible au moins autant qu'incompréhensible ; s'égarant souvent dans de bien glauques turpitudes mais susceptible quelquefois d'étonnante gloire.
Rien n'est plus effrayant que l'absence de pensée ? Mais rien n'est plus angoissant que l'emprise impérieuse d'une pensée orgueilleuse, exclusive ! (Arendt)
La solution n'est pas dans un juste milieu ; pas même dans ce délicieux jeu de contrepoids qui voudrait que l'on rabaisse quand trop de vanité et vante à l'inverse qu'on on s'abaisserait trop. Je ne suis même pas certain qu'il s'y puisse enrouler une boucle de rétroaction.
 Je crains bien qu'il ne soit pas de malédiction plus sombre en même temps que d'espérance plus fragile que la pensée. Elle jette l'homme hors de toute quiétude, à l’extérieur du monde, en face de l'être, à l'extrême pointe à la fois du blasphème et de la provocation. Tant pensée que technique s'avèrent vite des provocations dès lors qu'elle se déploie : comment développer son savoir-faire sans aussitôt désenchanter le monde et en chasser les dieux ? comment penser l'être sans aussitôt se piquer de le dominer et toiser l’Être avec telle ὕϐρις que même la mécréance paraît vétille ? comment vouloir être libre sans provocation ?
Je crains bien qu'il ne soit pas de malédiction plus sombre en même temps que d'espérance plus fragile que la pensée. Elle jette l'homme hors de toute quiétude, à l’extérieur du monde, en face de l'être, à l'extrême pointe à la fois du blasphème et de la provocation. Tant pensée que technique s'avèrent vite des provocations dès lors qu'elle se déploie : comment développer son savoir-faire sans aussitôt désenchanter le monde et en chasser les dieux ? comment penser l'être sans aussitôt se piquer de le dominer et toiser l’Être avec telle ὕϐρις que même la mécréance paraît vétille ? comment vouloir être libre sans provocation ?
En tout être qui pense ou même seulement cherche à penser, même humblement, même prudemment, il y a une voix qui susurre puis bien vite vocifère sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! (Mt, 27,40) … je n'arrive pas à oublier que dans tout appel il y a une provocation. Une tentative de supplanter le λόγος originel et d'en finir pour que plus rien ne subsiste de ce qui fut caché depuis la fondation du monde !
Que le propre de l'homme soit ainsi osciller d'entre ange et bête, que la conséquence logique soit qu'en ce qu'il entreprend il titube d'entre pesanteur et grâce et en accable tout ce qu'il touche ceci nous le savions depuis toujours … mais ce que révèle cette méprise endémique c'est que le danger sourde précisément de la source qui eût du sauver.
Qu'il est douloureux, déjà, de comprendre combien la pensée échoue à être antidote ! Qu'il est désespérant de réaliser qu'elle n'évite même pas de hurler avec les loups …
Je le sais, je le sens, cette méprise invraisemblable au sujet des sciences n'est pas qu'une question de vérité ou d'erreur ; n'est pas affaire de logique ; n'est pas plus question de passion ou de maîtrise de passion - il fut tant d'inquisiteurs au cœur froid - et n'est donc pas affaire de psychologie.
Mais de morale !
L'omniprésence du moi
Quoiqu’on en ait, en définitive, quelque position que l'on prenne, quelque action que l'on entreprenne, ce sera toujours une affaire de sujet, d'individu, de conscience qui aura pris la décision soit de faire soit de laisser faire. C'est ce que répéta à l'envi Arendt : dès que la justice se met en marche, c'est bien la responsabilité d'un homme qu'elle engage ! pas d'un groupe. Tout se joue ici ! Dans notre incapacité à ignorer notre moi. Peu le relèvent : nul ne peut faire fi de soi non plus que s'en débarrasser. Je puis, contraint souvent, volontairement parfois, quitter mon pays d'origine et chercher ailleurs de quoi nourrir mes projets ; je puis quitter ma famille - ce qui est finalement le sort commun de toutes épousailles ; je puis quitter mon épouse ou changer de compagne, me brouiller avec un vieil ami ou tout simplement le perdre de vue. Une seule chose m'est néanmoins impossible : me débarrasser de moi-même. Voici autre illustration de la forteresse que nous sommes à nous-mêmes. Car il y a un pendant à l’impossibilité qui m'est faite de ressentir ce que perçoit l'autre, de véritablement compatir et de ne pouvoir communiquer avec lui que par le truchement d'une raison qui me ballade du même au même : cette solitude radicale qui me fait, aux instants décisifs, être irrémédiablement face à moi-même, seul à éprouver, seul à juger … seul à décider. Arendt, évoquant la responsabilité ultime telle qu'elle peut se poser dans des situations extrêmes et à propos du cas Eichmann selon quoi il vaudrait mieux subir que commettre une injustice, dit autrement qu'il vaut mieux en fin de compte être victime que bourreau.
Ainsi, ou réfute ce qu’elle disait tout-à-l’heure par ma bouche, et prouve-lui que commettre l’injustice et vivre dans l’impunité après l’avoir commise, n’est pas le comble de tous les maux, ou si tu laisses cette vérité subsister dans toute sa force, je te jure, Calliclès, par le dieu des Égyptiens[22], que Calliclès ne s’accordera point avec lui-même, et sera toute sa vie dans une contradiction perpétuelle. Cependant il vaudrait beaucoup mieux pour moi, ce me semble, que la lyre dont j’aurais à me servir fût mal montée et discordante, que le chœur dont j’aurais fait les frais détonnât, [482c] et que la plupart des hommes fussent d’un sentiment opposé au mien, que si j’étais pour mon compte mal d’accord avec moi-même, et réduit à me contredire.
Gorgias, 482c
Ce principe, énoncé dans le Gorgias, est immédiatement associé à un autre : l'impossibilité d'être en contradiction avec soi-même, ce qu'Arendt nomme le devoir de se tenir compagnie. Il s'agit ici d'un principe que Socrate ne parvient pas plus à démontrer que son interlocuteur, le contraire. Indémontrable mais irréfragable ; normatif parce qu'à l'instar du principe de contradiction dont il est une forme morale, il rend le reste possible ou si l'on préfère, rien n'est possible sans lui.
Visible de manière criante dans les situations extrêmes - c'est bien en ceci que le cas Eichmann fut exemplaire - il implique que même dans les cas d'absolue impuissance, même donc lorsque il est impossible de s'unir à qui que ce soit pour résister, demeure néanmoins cette obligation, incontournable, de consentir ou de refuser. Ne pas le faire revient à se réfugier derrière le paravent du nous, à reporter la responsabilité sur le groupe, et donc, de renoncer à soi. Nous ne pouvons nous soustraire à ce dialogue intérieur qui est le commencement de la pensée non plus qu'aller à l'encontre de nous-mêmes. Le choix n'était pas, dans ces années terribles, entre l'héroïsme de la résistance et l'adhésion enthousiaste ; il était le plus souvent entre l'aveu d'impuissance qui constate au moins qu'à cela l'on ne veut pas participer et ces yeux que par veulerie l'on ferme en se réfugiant derrière l'irresponsabilité du groupe. Jaspers l'avait parfaitement vu, tout acte, en définitive est individuel et la responsabilité en conséquence- celle qu'engage tout tribunal. Libre à nous, médiocrement, de ne pas nous poser de question, de jouer la logique du fonctionnaire qui s'attache à participer à tout prix, et donc à détourner le regard de soi, mais ce détour est un renoncement à sa propre humanité et vaut, qu'on le veuille ou non, adhésion. A la fin, quoiqu'on fasse ou ne fasse pas, s'impose le choix. Notre liberté est peut-être une grâce ; elle est d'abord pesanteur et nous arrime au monde.
L'épaisseur donc je parle, ce compagnonnage obligé est un tribunal intérieur. Quoiqu'on fasse ou veuille : L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. Nul n’échappe à son propre regard. Yourcenar, évoquant l'homme parle de son horrible et sublime faculté de choix : mais est-ce une faculté ou plutôt une obligation, une de ces nécessités à quoi l'on ne saurait se soustraire, pas même morale mais qui enclenche toute morale ?
A chacune de ces formes d'épaisseur sous quoi se couvre notre moi, correspond un récit et l'on n'aurait aucun mal, que ce soit dans la mythologie ou les textes bibliques, à en trouver d'infinies occurrences. A ces strates d'intimités partagées autant que calculées, nos confessions oui sans doute mais à peu près tous nos écrits - hormis parfois les textes scientifiques - et tout ce que la culture peut compter d'œuvres pour ce qu'il ne se peut pas qu'elle ne disent plus, et s'agissant de nous beaucoup plus, qu'elles ne laissent transparaître. De cette matière dont nous sommes pétris mais de laquelle nous ne cessons de vouloir nous distinguer, nos silences, nos mystères, nos mensonges peut-être même sans quoi il n'est pas de désir possible. De cette impossibilité de nous dépasser autant que de nous contredire, les aléas erratiques de nos cheminements tant il demeure exact que nos actes, eux aussi sont des récits qui nous traduisent ou trahissent.
C'est là peut-être le plus surprenant : au plus profond et silencieux de l'intime … le monde - l'extrême ! Fait du même bois ! Celui-ci ne parle jamais que de nous ; autant que, nous confessant, nous ne parlons jamais que de lui. Notre secret, si vide pourtant, est d'avoir cru pouvoir nous en distinguer ; notre erreur d'avoir imaginé le dominer jamais et nous ériger contre lui. Espaces infinis silencieux, selon Pascal, et si effrayants : mais l'espace clos de mon intimité l'est tout autant pour qui ne veut pas considérer le jeu de miroir , espaces en réalité bien plus bavards qu'on ne l'imagine. De l'artiste au chercheur, nous ne cessons d'être au chevet des bruissements du monde qui ne sont que les échos de nos propres vagissements..
Peut-être ne sommes nous qu'aux aubes de notre histoire d'ainsi, tel Narcisse, vouloir en tout scruter notre propre image. Mais nous sommes si seuls ! Aristote nous l'avait dit : nous avons pris le détour de la forme pour contourner ce que le bois a de dirimant mais sommes-nous pour autant sortis de notre bulle ? le monde est rationnel ? la belle affaire, nous l'avons supposé tel !
 Nous ne sortons jamais de nous-mêmes et ne parvenons que si difficilement à voir dans le monde autre chose que l'hypostase de nos propres désirs. Sans doute est-ce J Bosch qui eut raison d'ainsi se représenter la création sous la forme d'une sphère si étroitement fermée sur elle-même.
Nous ne sortons jamais de nous-mêmes et ne parvenons que si difficilement à voir dans le monde autre chose que l'hypostase de nos propres désirs. Sans doute est-ce J Bosch qui eut raison d'ainsi se représenter la création sous la forme d'une sphère si étroitement fermée sur elle-même.
Bien sûr, à l'extérieur, le créateur au coin supérieur gauche mais surtout, à l'extérieur, moi qui contemple le tableau. Voici tout notre dilemme - et je le devine intime : nous n'avons d'autre choix, nous qui tentons de nous affirmer, que d'exclure le tiers et, ainsi, soit de désenchanter le monde en le dégradant en objet disponible, soit d'usurper la place du créateur et donc de braver les dieux.
Le voici, au plus secret et silencieux, la parole d'impuissance, le choix impossible à porter cependant. Je ne voudrais participer en rien à ce grand parasitage. Comment exister sans ruiner le monde ni blasphémer les dieux ?
Est-il question plus morale que celle-ci ?
C'est la seule question qui vaille qui montre que la pensée finalement renvoie à l'acte et ce dernier comme en écho à la pensée : nous nous méprenons autant sur ce que nous savons que ce que nous faisons ; sur nos sciences que nos techniques.
