| index | précédent | suivant |
|---|
Le grand fleuve humain
je me suis bien rendu compte, à force d'analyser l'actualité chaque jour pendant huit ans, que cela supposait un certain nombre d'hypothèses parfois inconscientes. Je me suis bien rendu compte, aussi, qu'au fond, toutes ces hypothèses (et mon horreur ·de ne pas comprendre, elle aussi) tout se ramenait à ceci : j'avais confiance dans l'homme. Je le sentais en marche, à travers ses passions, ses malheurs, ses drames, ses crimes, ses joies, en marche tout de même. Il était parti - oh ! en titubant - il était parti à la conquête de quelque chose. Parfois il semblait reculer - mais ce n'était jamais vrai. Le grand fleuve humain coulait toujours, emportait toujours les obstacles.
Claude Terrien
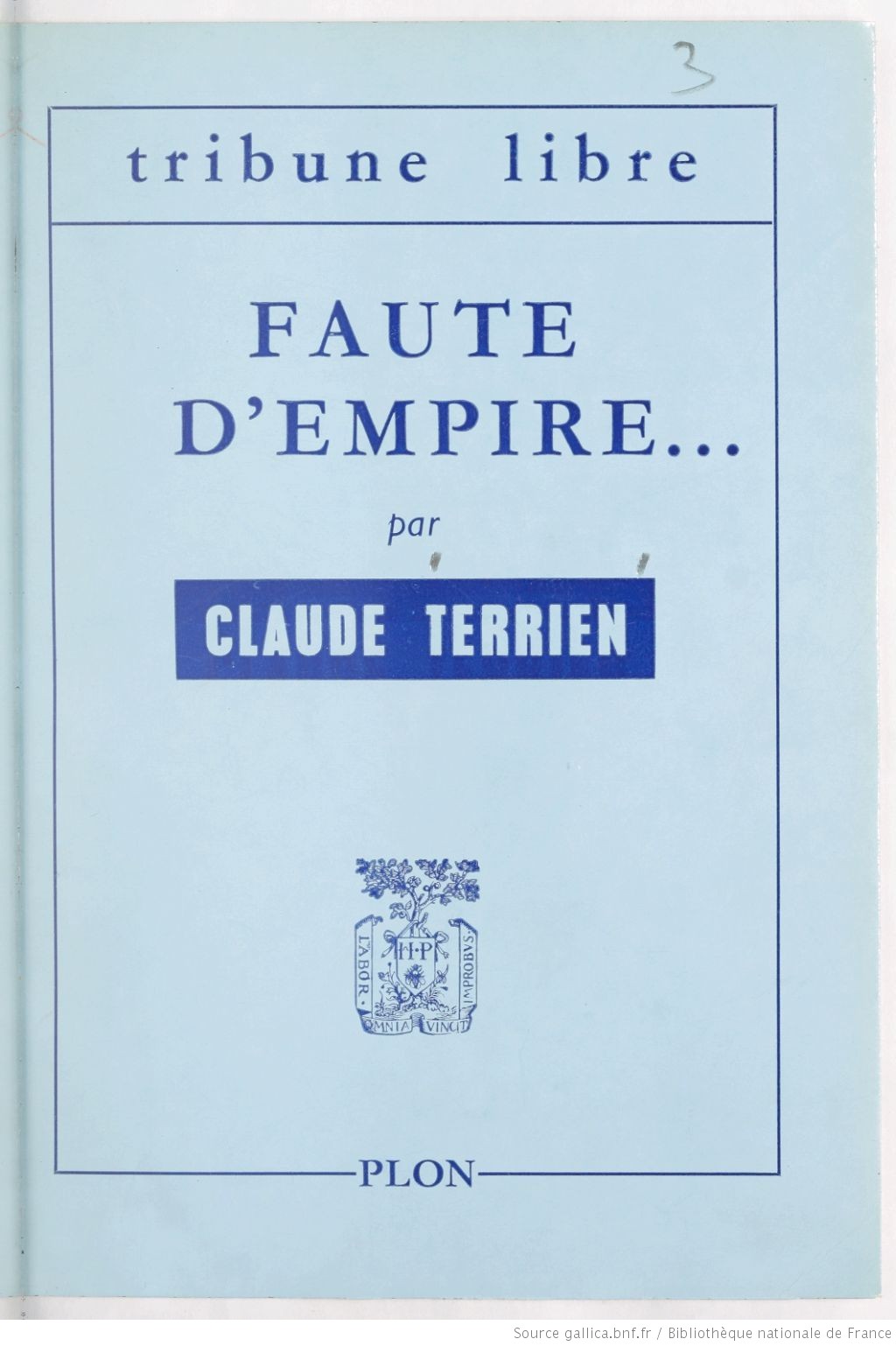 Ce passage, issu de Faute d'empire … comment illustrer mieux la pente vertigineuse dévalée depuis un demi-siècle ? ou mesurer mieux l'incroyable illusion de cette période qui crut pouvoir tout dominer ; tout résoudre - période où jamais ne fut plus vraisemblable ni en fin de compte plus désastreuse la formule cartésienne : devenir comme maître et possesseur de la nature.
Ce passage, issu de Faute d'empire … comment illustrer mieux la pente vertigineuse dévalée depuis un demi-siècle ? ou mesurer mieux l'incroyable illusion de cette période qui crut pouvoir tout dominer ; tout résoudre - période où jamais ne fut plus vraisemblable ni en fin de compte plus désastreuse la formule cartésienne : devenir comme maître et possesseur de la nature.
Depuis … ce torrent d'articles, plus anxiogènes les uns que les autres qui nous menacent de canicules de plus en plus fréquentes ; d'érosions du littoral ; de catastrophes diverses et variées dont les moindres ne seraient pas les famines provoquées, les migrations inéluctables, les guerres qui s'en suivraient.
Sans doute - du moins est-ce la consolation de certains - faut-il cette peur organisée pour que puisse se déclencher la prise de conscience et s’enclencher les premières actions résolues. On voudrait le croire ainsi qu'il ne fût pas trop tard.
Ce qu'on mesure difficilement ce sont bien les conséquences de cette radicale inversion de la temporalité, inédite depuis la Renaissance. Il ne faut jamais oublier, en effet, que le temps linéaire, initié par les créationnismes hébraïque puis chrétien, à défaut d'être tragique - il ne pouvait plus l'être depuis la brisure du cycle grec - était fondamentalement dramatique : à mesure qu’on s'éloignait de l'instant de la création, et donc du moment pur de l’Éden, on aggravait culpabilité, fautes et s'approchait du jugement. Temps étale, conservateur par essence, où tout changement paraissait offense à l'être et victoire satanique. C'est bien celui-ci qui fut bouleversé par l'âge classique puis par les Lumières. Tout-à-coup l'âge d'or basculait à la fin de l'histoire et il nous appartenait de le préparer, de le construire. L'humanisme n'a pas d'autre sens ! et je ne vois décidément pas avantage à y mettre fin - toutes les autres optiques étant désastreuses.
Mais mesure-t-on, ce que cette fin de l'idéologie du progrès comporte ? Et si, politiquement, je devine cette effrayante montée des extrêmes droites, insolemment racistes et n'en éprouvant désormais aucune gêne, comme une des conséquences de cette inversion, que je lis avec effroi la promotion de régimes illibéraux qui ne sont en fin de compte que des tyrannies pas même masquées, que j'observe le repli sur de pseudo-certitudes techniques voire le fatalisme que traduit cette quasi-impossibilité à faire groupe et se mobiliser pour autre chose que de vaines et parfois douteuses hystéries sportives, j'ai, je l'avoue, quelque difficulté à trouver motif d'optimisme.
Oh, sans doute, mon âge y contribue et je veux bien considérer avec faveur les mouvements qui agitent ici ou là les jeunes générations ; je ne puis néanmoins ne pas m'inquiéter de la lourde pénalité que nous leur infligeâmes en leur laissant un monde en capilotade et un humanisme totalement dépenaillé …
Regardons y de plus près : il y a dans les propos de Cl Terrien quelque chose d'à la fois logique et terrifiant :
Oui, au premier abord, cela pouvait passer pour une sorte de patriotisme . Faute d'empire, la puissance. Faute de sujets, des clients.
 Comment ne pas songer à l'étonnant mépris que de Gaulle toujours nourrit, en même temps que sa sacralisation de la France, à l'égard des français toujours suspects de se vautrer dans la facilité ; dans le manque de dignité. Il est évident qu'après les heures de gloire, les conflits épiques des années 40-44, le retour sur terre, à une réalité plus ordinaire - relancer l'appareil d’État, l'économie, reconstruire un pays détruit … - avait à la fois quelque chose de nécessaire mais de trivial, où les petits intérêts, les concussions, les ambitions médiocres et les partisans de tout poil chasseraient bientôt les compagnons, les chevaliers …
Comment ne pas songer à l'étonnant mépris que de Gaulle toujours nourrit, en même temps que sa sacralisation de la France, à l'égard des français toujours suspects de se vautrer dans la facilité ; dans le manque de dignité. Il est évident qu'après les heures de gloire, les conflits épiques des années 40-44, le retour sur terre, à une réalité plus ordinaire - relancer l'appareil d’État, l'économie, reconstruire un pays détruit … - avait à la fois quelque chose de nécessaire mais de trivial, où les petits intérêts, les concussions, les ambitions médiocres et les partisans de tout poil chasseraient bientôt les compagnons, les chevaliers …
Comme si l'économie n'était qu'un succédané, une sorte de pis-aller de la grandeur ; ou que la réussite économique, victoire à la Pyrrhus ne fût jamais que la décadence de la Nation … On comprends alors mieux ce que Hegel voulut dire en affirmant que les peuples heureux n’ont pas d'histoire ! Comme s'il n'était d'histoire que tragique, violente ; fracassée. Que seules les guerres, cataclysmes et destructions diverses en fussent le moteur - et non comme le crut Marx, la lutte des classes - et que violence, mort et haine y fussent triomphantes à jamais.
 Et voilà comment, messieurs, vous aboutissez à cette double contradiction : d’une part, tandis que tous les peuples et tous les gouvernements veulent la paix, et malgré tous les congrès de philanthropie internationale, la guerre peut naître d’un hasard toujours possible ; et d’autre part, alors que s’est développé partout l’esprit de démocratie et de liberté, se développent aussi les grands organismes militaires qui, au jugement des penseurs républicains qui ont fait notre doctrine, sont toujours un péril chronique pour la liberté des démocraties. Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir enfin la guerre entre les peuples, c’est d’abolir la guerre entre les individus, c’est d’abolir la guerre économique, le désordre de la société présente, c’est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime de concorde sociale et d’unité. Et voilà pourquoi, si vous regardez, non pas aux intentions, qui sont toujours vaines, mais à l’efficacité des principes et à la réalité des conséquences, logiquement, profondément, le parti socialiste est dans le monde aujourd’hui le seul parti de la paix.
Et voilà comment, messieurs, vous aboutissez à cette double contradiction : d’une part, tandis que tous les peuples et tous les gouvernements veulent la paix, et malgré tous les congrès de philanthropie internationale, la guerre peut naître d’un hasard toujours possible ; et d’autre part, alors que s’est développé partout l’esprit de démocratie et de liberté, se développent aussi les grands organismes militaires qui, au jugement des penseurs républicains qui ont fait notre doctrine, sont toujours un péril chronique pour la liberté des démocraties. Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir enfin la guerre entre les peuples, c’est d’abolir la guerre entre les individus, c’est d’abolir la guerre économique, le désordre de la société présente, c’est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime de concorde sociale et d’unité. Et voilà pourquoi, si vous regardez, non pas aux intentions, qui sont toujours vaines, mais à l’efficacité des principes et à la réalité des conséquences, logiquement, profondément, le parti socialiste est dans le monde aujourd’hui le seul parti de la paix.
Jaurès 7 mars 1895 sur l'armée démocratique
J'entends bien le grand rêve républicain : il était de bonheur, selon St Just ; il était au moins de concorde. Substituer à la lutte de tous contre chacun, un dialogue, une conciliation. En quelque sorte mettre en place tous les outils permettant de rendre impossible la lutte, la guerre ; possible le groupe, l'entraide. Mais ce rêve politique s'est lui-même soldé par la guerre. Mais ce rêve politique s'est traduit en querelles économiques. On ne dira jamais assez combien les concepts utilisés par l'économie moderne et les diverss stratèges du management sont tous des termes militaires, guerriers ; violents. L'économie, sublimation de la guerre ? Oui, peut-être mais alors ne jamais oublier qu'un rien peut faire échouer cette sublimation. Oui la société capitaliste est foncièrement guerrière ; tragiquement violente ; stupidement exterminatrice.
Mais quoi alors pourrait encore faire taire la bête qui rugit en nous ?
Il y avait décidément dans le pacifisme de Jaurès quelque chose qui n'avait rien à voir avec la faiblesse encore moins avec le refus de combattre. Il y avait un refus qu'on n'a jamais assez analysé ni voulu approfondir de la dialectique marxiste qui, pour être sophistiquée, n'en était jamais que la valorisation implicite du travail du négatif - donc de la guerre. Jaurès voulut un socialisme militant, pas guerrier ; inventer - le réinventer sans doute - un socialisme à la française.
Il n'était pas audible. Il en mourut !
J'entends comme en sourdine, l'écho effrayant des « c'est une bonne guerre qu'il leur faut » de la racaille fasciste ou, simplement, des vieillards acariâtres - des vieux cons, quoi !
Je revois ces hommes, qu'on eut sans cesse proclamés grands qui emmenèrent périodiquement leur peuple à la bataille quitte à l'épuiser : qu'avait donc de grand un Napoléon qui non seulement acheva précipitamment la Révolution mais ramena indirectement la royauté après avoir pillé l'Europe et balayé son peuple ? un François Ier qui pilla l'Italie ? un Jules César ? Un Clemenceau qui pourtant rata sa paix après avoir réussi sa guerre ? Curieuse Histoire qu'on nous vante - et vent - qui n'est jamais que celle de nos guerres et cadavres amoncelés … pour rien !
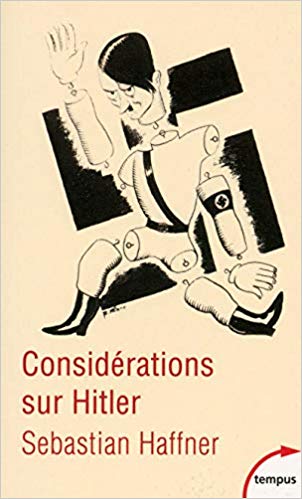 Et je n'évoque pas un Hitler - S Haffner en a subtilement parlé - qui fut très près d'anéantir totalement, en tout cas de sacrifier son peuple en une guerre totale au nom d'une idée, non seulement perverse évidemment, mais mortifère et pour le punir de n'être pas parvenu à la réaliser. Ou un Staline, prédisposé à affamer son peuple, à l'enfermer, à le réduire à masse soumise à sa folie meurtrière…
Et je n'évoque pas un Hitler - S Haffner en a subtilement parlé - qui fut très près d'anéantir totalement, en tout cas de sacrifier son peuple en une guerre totale au nom d'une idée, non seulement perverse évidemment, mais mortifère et pour le punir de n'être pas parvenu à la réaliser. Ou un Staline, prédisposé à affamer son peuple, à l'enfermer, à le réduire à masse soumise à sa folie meurtrière…
Il y a toujours, dans ces délires de pouvoir, quelque chose de cette chosification que Sartre avait bien entendue - qui en réalité se solde toujours par une néantisation. Dont la pensée techniciste n'est jamais que l'antichambre … ou la dégradation.
Voici toute la question de la légitimité du politique et du dégoût que parfois il peut inspirer.
Mettons de côté les petitesses humaines que la sotte ambition ou l'appétit dévorant peuvent susciter - la démocratie n'a pas, malheureusement, l'exclusivité des chéquards du scandale Panama, des tripatouillages d'un Stavisky, pour ne pas évoquer les financements récents de campagnes électorales, les médiocres abus de biens sociaux …: elle ne peut seulement pas éviter qu'à la fin ils n'éclatent - et ne considérons que la méfiance, radicale, je veux dire provenant des racines mêmes de la pensée, d'un M Serres à l'égard de la politique confrontée à cet enthousiasme effréné ressenti par ma génération qui vit dans le marxisme et parfois dans l'extrême-gauche trotskiste ou maoïste, une issue, un avenir ; un espoir.
"À la table du Président, des riches et des puissants, dans les salons des grands et de quelques moins grands de ce monde, dites-vous toujours que si Dieu existe, il n’est pas ici ni là. Leur puissance s’installe en raison d’un reste animal de violence, par ce reliquat bestial dans nos têtes et nos corps, en raison de notre servitude volontaire. Cette pensée assure que le plus élevé dans le grade ou la renommée se réduit, sur la terre, à un fantôme de paille ou une poupée de son. Qu’aussi haut qu’il se monte du col, ses deux pieds se posent, comme les vôtres, sur le même sol."
M Serres, La confession fraternelle, Empan, 2002/4 no48, p. 11-16.
Dans le projet politique de la Révolution, dans la pensée d'un Rousseau et jusque dans celle d'un Marx, il y a bien cette idée que la cité peut être un truchement sinon de bonheur en tout cas de réussite si, à la fois, les citoyens sont libres de prendre leurs destins en main, et surtout, de le faire ensemble. Cette idée que la cité n'est pas mauvaise en soi, mais au moins protectrice et parfois épanouissante si elle est le projet commun de tous. Voici le leitmotiv des Lumières où l'idée de progrès prend sa source et sa vigueur : l'homme, dès lors qu'il cesse de céder aux sirènes de la superstition et refuse de se soumettre à la force, est capable de grandes choses - pour lui, pour l'autre ; pour le monde. Voici précisément cette idée qui s'est étiolée quelque part dans les brumes polonaises, dans les barbelés sibériens ; désormais dans les surchauffes climatiques.
Est-ce à dire qu'il n'y ait plus d'espérances collectives ? que le plus beaux desseins que l'humanité se soit formés dussent inéluctablement s'achever dans la noirceur arithmétique d'un utilitarisme aussi dévastateur que pernicieusement sournois et moralement sordide ; que, précisément le collectif ait épuisé toutes ses ressources et qu'il ne soit plus de grandeur ou de salut possible que dans un repli prudent dans une vie intérieure autant méditative que morale ?
 Serait-ce Nietzsche qui eût finalement raison qui soupçonnait que la volonté de puissance invariablement cachait une volonté de néant ravageuse et dévastatrice ? Ou Freud, qui, de manière semblable, traquait Thanathos derrière Éros ? comme si nos rêves de grandeur, nos aspirations à la noblesse d'âme, au courage voire au sacrifice ne pouvaient jamais être à notre portée, ni à notre mérite mais dussent se retourner invariablement contre nous, contre le monde ; contre la vie ?
Serait-ce Nietzsche qui eût finalement raison qui soupçonnait que la volonté de puissance invariablement cachait une volonté de néant ravageuse et dévastatrice ? Ou Freud, qui, de manière semblable, traquait Thanathos derrière Éros ? comme si nos rêves de grandeur, nos aspirations à la noblesse d'âme, au courage voire au sacrifice ne pouvaient jamais être à notre portée, ni à notre mérite mais dussent se retourner invariablement contre nous, contre le monde ; contre la vie ?
Devrait-ce être ceci, je comprendrais mieux mon aversion pour l'avaricieuse pensée d'un Jérémy Bentham où, à chaque étape de raisonnement l'on perçoit à peine étouffé le cliquetis de ses intérêts bien calculés, l'étouffement acharné de ce qui demeure encore de noble en l'humain !
Est-ce moi, et l'obsession de mon âge à m'en aller quérir du sens qui vaille ? est-ce mon penchant pour la philosophie qui m'interdit de ne pas me poser question à la racine ? ou bien subitement une cruelle désillusion ?
Je vois, derrière tout ceci - ces grands mots qui font les belles idéologies et les grands massacres tels Nation, Humanisme, liberté, bonheur égalité - poindre la seule question qui m'eut jamais tenaillé : qu'est-ce vivre pour un être qui se voudrait à hauteur d'homme ?
Autre manière au reste de poser les questions kantiennes : que puis-je connaître, que dois-je faire ; que puis-je espérer ?
Serait-ce que vivre se réduisît à respirer, boire, manger, travailler ; s'employer à se reproduire, faire semblant d'aimer … et disparaître ? Serait-ce que les modèles sociaux qui s’invitent à notre table ne fussent pas seulement des modèles mais de comminatoires injonctions ? Notre existence se résumerait vraiment à cette loqueteuse accumulation de biens - en fin de compte inutiles, tout juste agréables - et à ce vain bavardage qui tenterait vainement de lui donner quelque acceptable aspect ?
Quoi ne serions-nous décidément que cette viandeuse machine tout juste bonne à tout ramener à de la viande ?
En rentrant, j' entends se refermer sur moi, désormais captif de ma charge, toutes les portes du palais.
Mais, en même temps, je vois s'ouvrir l'horizon d'une grande entreprise. Certes, par contraste avec celle qui m'incomba dix-huit ans plus tôt, ma tâche sera dépouillée des impératifs exaltants d'une période héroïque. Les peuples et, d' abord, le nôtre n'éprouvent plus ce besoin de s'élever au-dessus d'eux-mêmes que leur imposait le danger. Pour presque tous - nous sommes de ceux-là - l'enjeu immédiat est, non plus la victoire ou l'écrasement, mais une vie plus ou moins facile. Parmi les hommes d'Etat avec qui j' aurai à traiter des problèmes de l'univers, ont disparu la plupart des géants, ennemis ou alliés, qu'avait fait se dresser la guerre. Restent des chefs politiques, visant à assurer des avantages à leur pays, fût-ce bien sûr au détriment des autres, mais soucieux d'éviter les risques et les aventures. Combien, dans ces conditions, l'époque est-elle propice aux prétentions centrifuges des féodalités d'à présent : les partis, l'argent, les syndicats, la presse, aux chimères de ceux qui voudraient remplacer notre action dans le monde par l'effacement international, au dénigrement corrosif de tant de milieux, affairistes, journalistiques, intellectuels, mondains, délivrés de leurs terreurs ! Bref, c'est en un temps de toutes parts sollicité par la médiocrité que je devrai agir pour la grandeur.
Et, pourtant, il faut le faire ! Si la France dans ses profondeurs m'a, cette fois encore, appelé à lui servir de guide, ce n'est certes pas, je le sens, pour présider à son sommeil.
Ch de Gaulle, Mémoires d'espoir
Serions-nous réduit à cette amertume glauque du vieil autocrate, réduit à gérer l'intendance quand tout l'avait appelé aux grands vents de l'Histoire ? enclin presque à regretter les troubles de la guerre, de la révolte et de la désobéissance, de l'insurrection et de l'incertitude, au moment même où en ce début 59 il entrait à Elysée, pour pratiquement y mourir, pour dix années où il aura eu, sans doute, plus de pouvoir et de prestige que ses prédécesseurs.
Il faut relire Malraux et ses Chênes qu'on abat, Claude Mauriac en son incroyable Malraux et de Gaulle pour comprendre ce qu'il y eut, certes de fascination bien plus que d'admiration, de dévouement bien plus que de service, mais surtout d'épique dans cette aventure , assumée comme telle, où autour du Connétable un cercle étroit de chevaliers et de compagnons permirent le plus beau coup de bluff de notre histoire.
Épique, oui ! comme s'il nous fallait avouer que l'humain n'est grand que dans le malheur, la guerre ou la tragédie. Peut-être est-ce alors l'ordinaire, l'implacable normalité qui fût l'épreuve la plus dure pour l'humain : quand rien ne vous menace, ni tente ; quand rien ne vous suggère de dévier votre parcours et que nous bifurquons nonobstant, quand même nos petites filouteries ou humbles lâchetés passent inaperçues, oui c'est bien à ce moment là que la vertu prend tout son sens. Sartre l'avait deviné en suggérant qu'il ne fût pas plus grande liberté que sous l'Occupation : oui, dans les grandes croisées de l'histoire, les choix, même douloureux s'imposent souvent d'eux-mêmes.
Mais dans l'ordinaire ? quand il n'est rien à gagner ? ni à perdre du reste ? pourquoi s'obliger au soleil quand l'ombre permet toutes les facilités ? pourquoi de grands idéaux quand le train-train misérable de la succession des contraintes ordinaires semble y suppléer presque aisément.
Qu'est-ce qu'être normal ? A cette question, dit-on, Freud répondit aimer et travailler ! De la contrainte, de la dure réalité à quoi se confronter et, pour compenser, mais rien qu'un peu, du plaisir, mais vraiment en juste mesure de peur que nous nous y perdions.
Etonnant jeu de compensation et non boucle de rétroaction - ce qui eût encore été compréhensible. Cette normalité où j'entends notre humanité, s'avère si fragile ; si constamment tendue entre deux gouffres qui incessamment la menacent.
Nous voici bien loin de ce grand fleuve humain triomphant qu'espérait Cl Terrien.
Pour autant, ne nous y trompons pas, hors l'humanisme il ne saurait y avoir de voie praticable. Même la foi, même la méditation la plus intime ; même le retrait ou la quête désespérée d'être à hauteur de la grâce divine ne vous permet d'échapper à la seule question qui vaille ; à la seule vocation qui soit nôtre
Qui es-tu, homme et qu'as-tu fait de ton talent ?