| index | précédent | suivant |
|---|
- >2016 -> Souveraineté
Lié ou liant ?
Ce qui fait tenir ensemble une cité telle est la troisième question que nous nous étions proposé de poser. Je reste convaincu, pour dresser une sorte de bilan provisoire, que le rapport que nous entretenons avec le peuple est hanté de représentations et de discours - pas même de souvenirs. Ce peuple, dont on ne sait jamais si l'évoquant, on y vise le sujet politique, une réalité sociale ou économique, est décidément trop une abstraction et fonctionne trop comme une transcendance pour qu'on en ait une idée claire ou, en tout cas, qu'elle ne soit pas traversée d'images et de bruits, construite sur le promontoire de nos préjugés, hantée de nos peurs ou de nos espérances.
Deux images d'abord, contradictoires
14 juillet 1790
Celle de la Fête de la Fédération de Juillet 90 qui consacre l'unité nationale et la ferveur pour une révolution qui n'a encore ni déçu ni inquiété. Est-ce étonnant ? Michelet lui consacre deux chapitres ! Voici peuple aimable et aimant ; peuple pacifique qui retrouve, car le mouvement fut spontané qui partit des provinces, les canons religieux les plus élémentaires pour entonner le grand chant de l'unité.
Michelet n'a pas tort :
Le Champ-de-Mars voilà le seul monument qu'a laissé la Révolution ... L'Empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui seul l'Arc-de-Triomphe ; la Royauté a son Louvre, ses Invalides ; la féodale Église de 1200 trône encore à Notre-Dame : il n'est pas jusqu'aux Romains, qui n'aient les Thermes de César. Et la Révolution a pour monument... le vide …
Michelet Préface de 1847
Il faut le relire, il n'a pas d'envolée lyrique assez puissante pour évoquer ce moment - rare - de l'histoire lui qui pourtant fit de la Révolution, une véritable épopée où ce qu'il appelle l'esprit de la Révolution ne manque jamais de souffler ; fort.
Lui [l'esprit de la Révolution], il sait; et les autres n'ont pas su. Il contient leur secret, à tous les temps antérieurs. En lui seulement la France eut conscience d'elle-même. Dans tout moment de défaillance où nous semblons nous oublier, c'est là que nous devons nous chercher, nous ressaisir. Là se garde toujours pour nous le profond mystère de la vie, l'inextinguible étincelle.
La Révolution est en nous, dans nos âmes; au dehors, elle n'a point de monument. Vivant esprit de la France, où te saisirai-je, si ce n'est en moi ? Les pouvoirs qui se sont succédé, ennemis dans tout le reste, ont semblé d'accord sur un point, relever, réveiller les âges lointains et morts… Toi, ils auraient voulu t'enfouir... Et pourquoi ? Toi seul, tu vis.
Tu vis! … Je le sens, chaque fois qu'à cette époque de l'année mon enseignement me laisse, et le travail pèse, et la saison s'alourdit… Alors, je vais au Champ-de-Mars, je m'assieds sur l'herbe séchée, je respire le grand souffle qui court sur la plaine aride. Michelet, ibid.C'est bien à une communion spirituelle à quoi on assiste ici. L'esprit de la Révolution fonctionne à peu près comme la parole vivante descendue des hauteurs du Sinaï. C'est le même récit. Un récit de fondation, et l'on a assez dit qu'il s'agissait d'un moment, où à l'écart de la cité, en un lieu jusqu'à présent vide, et qui finalement le restera, un lieu qui n'est empli que des souvenirs ou bien des ultimes échos d'une incroyable parousie la naissance d'une Nation ! Tout y est ici de l'ordre du religieux - en tout cas du sacré. Le peuple de Paris avait pris en main les travaux de terrassement et l'on vit même le roi lui-même donner un symbolique coup de pioche et La Fayette en manche de chemise y travailler comme tout un chacun. Le peuple, toutes classes mêlées avait tenu à en être : on y vit le peuple du faubourg St Antoine aux côtés de nobles et de moines. L'image parfaite de l'union en train de se réaliser.
« Moi, roi des Français, je jure d'employer le pouvoir qui m'est délégué par la loi constitutionnelle de l'État, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois ».
Rien n'y manqua non plus durant la fête, jusque et y compris l'humeur ombrageuse et pluvieuse du ciel : le serment que l'on prêta sur la Constitution, La Fayette en tête pour les gardes nationaux, le président de l'Assemblée puis enfin le roi lui-même avant que ce ne fut la foule unie dans le même élan. Le tout précédent un Te Deum ; tout y fut même la messe dite par Talleyrand entouré de plus de 300 prêtres.
Douze cents musiciens jouaient, à peine entendus ; mais un silence se fait: quarante pièces de canon font trembler la terre. A cet éclat de la foudre, tous se lèvent, tous portent la main vers le ciel… 0 roi ! ô peuple ! attendez ... Le ciel écoute, le soleil tout exprès perce le nuage ... Prenez garde à vos serments !
Ah! de quel cœur il jure, ce peuple ! Ah ! comme il est crédule encore!. .. Pourquoi donc Je Roi ne lui donne-t-il pas ce bonheur de le voir jurer à l'autel ? Pourquoi jure-t-il à couvert, à l'ombre, à demi caché ? Sire, de grâce, levez haut la main, que tout le monde la voie !
Un bien joli moment, assurément, édifiant comme seules peuvent l'être ces histoires presque magiques où semblent se jouer à l'unisson le rêve d'un avenir meilleur et la fidélité à un passé qu'on ne peut décidément pas renier. Pas encore en tout cas. A peine ce petit regret, soufflé par Michelet, d'un Roi prêtant serment à l'écart sur son estrade plutôt que devant la foule comme si se dessinaient déjà réticences et complots qui demain écornifleront la foi nouvelle. A peine ce tout petit filet de nostalgie, incrusté dans le récit qu'il brosse de la fête, une nostalgie par avance en quelque sorte, celle de l'historien qui n'ignore pas combien l'histoire rarement ménage de telles éclaircies qu'elle camoufle en ces recoins isolés presque oubliés comme si elle craignait qu'on en abuse, mais mitonne bien plutôt ces détestables mais incontournables salmigondis de haines, de crises, de heurts ou d'opposition qui nous font entendre plus souvent les airs de la tragédie et ont fait dire à Hegel que les peuples heureux n'ont pas d'histoire ; qui est celle aussi de l'homme qui au moment même où il l'écrit, aura vu passer puis trépasser les espérances de la Révolution de 1848.
La farandole immense qui s'est formée peu à peu de la France tout entière, elle s'achève au Champ-de-Mars, elle expire … Voilà l'unité ! Adieu l'époque d'attente, d'aspiration, de désir, où tous rêvaient, cherchaient ce jour!... Le voici! que désirons-nous? pourquoi ces inquiétudes ? Hélas ! l'expérience du monde nous apprend cette chose triste, étrange à dire, et pourtant vraie, que l'union trop souvent diminue dans l'unité. La volonté de s'unir, c'était déjà l'unité des cœurs, la meilleure unité peut-être.
Il faut l'écouter ce petit air triste et sans doute désabusé, précisément parce qu'il s'incruste dans le récit presque par inadvertance, comme un soupir, non pas vraiment le dernier, mais un souffle, oui, qui s'interpose en contre-point de cet esprit de la Révolution qu'il appelle. Ce n'est pas que Michelet eût perdu la foi : elle n'est en tout cas plus celle naïve de ce peuple qui naît. Ce qu'il voit ce n'est pas seulement cet épuisement du rêve dans le réel - ce que tout le monde, sans le dire, a toujours su ; que l'on sait au moins depuis Don Juan illustrant jusqu'à la dureté des pierres combien la quête vaut mieux que la conquête ; qu'un désir réalisé est un désir mort.
Ce qu'il entrevoit dans cette nuance glissée entre union et unité n'est autre que le peuple qui passe … Regardons bien, le voici qui avance, rassemblé : il mime une agora mythique ; une ecclesia mystique. Simplement. Il n'y vient pas pour agir - cela viendra plus tard et bien plus tragiquement - non plus que pour voter : on sait bien avec Rousseau combien ce rêve antique est illusoire ; il vient seulement pour consacrer le lieu, un moment - et se consacrer lui-même en tant que Nation. Mais bientôt il passe ; il est passé sitôt qu'arrivé comme tout esprit qui, comme on sait, souffle où il veut. Moment de grâce, fugace, ou d'incarnation, plus rêvée que réelle. Demain l'ordinaire, le quotidien, les troubles et les divisions. Demain, il sera passé et redeviendra ce spectateur qu'il n'a jamais cessé d'être. L'union diminue dans l'unité, écrit-il : voici bientôt que le peuple s'épuise. Michelet devine ce qu'il y a de miraculeux en ces instants de fondation ; sait ce qu'il y a de renoncements, de paresse, de volonté de néant aussi dans l'affairement ordinaire. La tragédie commence à l'instant même de la liesse.
L'insurrection d'Août 92
et les massacres de Septembre
Mais le peuple ne présente pas que cette image aimable. En contrepoint, comme un négatif photographique, le peuple en armes, en colère, en révolte. Ce peuple-ci a tout d'hideux et se présente presque toujours, telle une bête fauve, prompte à toutes les exactions, à toutes les extrémités ; à toutes les horreurs. L'image vient de loin même si elle porte en son sein, le mépris ou la défiance de qui prétend n'en pas être : le bourgeois, le noble.
Les meurtres des victoires s'exercent ordinairement par le peuple et par les officiers du bagage ; et ce qui fait voir tant de cruautés inouïes, aux guerres populaires, c'est que cette canaille de vulgaire, s'aguerrit et se gendarme, à s'ensanglanter jusques aux coudes et à déchiqueter , un corps à ses pieds, n'ayant ressentiment d'autre vaillance: « Le loup et les ours répugnants s'acharnent sur les mourants, comme toutes les bêtes de race vile » ; comme les chiens couards, qui déchirent en la maison et mordent les peaux des bêtes sauvages qu'ils n'ont osé attaquer aux champs
Montaigne, Essais II, 27 citation d'Ovide Tristes III, v 35Il n'est qu'à lire Montaigne : la comparaison animalière n'est jamais loin pour fustiger l'irruption du peuple qui ne saurait être que désastreuse ; détestable. D'entre le XVIe et le XVIIIe, les Lumières : on imputera plutôt la violence populaire à la naïveté ou à l'ignorance et non plus à la bestialité mais, identiquement, le peuple acteur de l'histoire se présente toujours sous l'aune de la furie, de la violence ; comme une catastrophe. Michelet qui suit, presque heure par heure, la tragédie qui se noue en ces journées d'Août 92. Ce qui constitue le second grand moment de la Révolution, qui consacre au reste la fin de la monarchie, c'est d'abord l'irruption du peuple et la défaillance des pouvoirs constitués. L’Assemblée est finissante et attendant que la suivante soit élue (la Convention ne le sera qu'en Septembre) ne prend pas de réelle décision ; la Cour, depuis Varennes, est désavouée par le peuple et comme à son accoutumée se sent plus encline aux petites manœuvres et manigances diverses qu'à une opposition frontale. La Commune de Paris prend le relais : avec elle le peuple.
Il y avait dans cette Commune des éléments très divers. Une partie, la meilleure, étaient des hommes simples, grossiers, naïvement colériques, qui n'étaient pas incapables de sentiments généreux; malheureusement, ils suivirent jusqu'au bout la pensée brutale et stupide : En finir avec l'ennemi. Mais le meurtre ne finit rien. Les autres étaient des fanatiques, fanatiques d'abstractions, géomètres politiques, prêts à rogner par le fer ce qui dépassait la ligne précise du contour qu'ils s'étaient tracé au compas. Enfin, et c'était le pire élément, il y avait des bavards, des harangueurs étourdiment sanguinaires (de ce genre était Tallien), il y avait de méchants petits scribes, natures basses et aigres, irrémédiablement mauvaises, sans mélange et sans retour, parce qu'elles étaient légères, sèches, vides, de nulle consistance. Ces fouines à museau pointu, propre à tremper dans le sang, se caractérisent par deux noms : l'un, Chaumette, étudiant en médecine et journaliste; l'autre, Hébert, vendeur de contremarques à la porte des spectacles, qui rimait des chansonnettes, avant de devenir horriblement célèbre sous le nom de Père Duchéne.
Les uns émus de pitié pour les familles en deuil, pour ce grand désastre privé et public, voulaient justice et vengeance, une punition exemplaire ; si la Loi ne la faisait pas, ils allaient la faire eux-mêmes. Les autres, émus d'intérêt pour des hommes désarmés qui, fussent-ils coupables, ne devaient, après tout, être frappés que par la Loi, voulaient à tout prix sauver leurs ennemis, sauver l'humanité, l'honneur de la France.
[...]
Rien n'étonne. de la Commune, quand on sait l'étrange oracle qu'elle commençait à consulter. Le 10, au soir, une troupe effroyable de gens ivres et de polissons avaient, à grand bruit, apporté à l'Hôtel de Ville l'homme des ténèbres, !'exhumé, le ressuscité, le martyr et le prophète, le divin Marat. C'était le vainqueur du 10 Août, disaient-ils. Ils l'avaient promené triomphalement dans Paris, sans que sa modestie y fit résistance. Ils l'apportèrent sur les bras, couronné de lauriers, et le jetèrent là, au milieu du grand Conseil de la Commune. Plusieurs rirent; beaucoup frémirent; tous furent entrainés. Lui seul il n'avait aucun doute, ni hésitation, ni scrupule. La terrible sécurité d'un fol qui ne sait rien ni des obstacles du monde, ni de ceux de la conscience, reluisait en sa personne. Son front jaune, son vaste rictus de crapaud souriait effroyablement sous sa couronne de laurier.Je ne me lasse pas de ces pages : on y sent un Michelet, résolument républicain, déchiré entre l'effroi ressenti devant ce peuple jeté dans les rues et prompt à tous les excès, à toutes les horreurs et la nécessité où la théorie le pousse, mais le désir tout autant, de préserver à ce peuple l'innocence et la pureté qui sied à un principe. Bien sûr un ensemble mêlé, certes des éléments troubles, concède-t-il, mais tout autant d'âmes généreuses promptes à pardonner et protéger jusqu'à ses ennemis. Un peuple généreux en somme, naïf, sans doute, trop impulsif assurément et tellement enclin à suivre le premier meneur venu un tant soit peu brillant.
C'est bien plutôt à ces meneurs, fanatiques et aux bavards qu'il s'en prend , à ces aiguillons de désordre que représentent invariablement dans une foule, la cohorte des ratés et frustrés, juste un peu plus cultivés que la foule, juste assez en tout cas pour l'enivrer et la mettre en mouvement. Le principe chez Michelet est toujours sauf d'un peuple bon ; ne demeure que cette impétuosité qu'une colère patiemment mûrie met aisément en branle, un peuple presque par avance pardonné d'avoir été trahi par la Cour et l'Assemblée, par ceux-là même qui eussent du les défendre.
La métaphore animalière pointe presque spontanément mais ce sera toujours pour fustiger les meneurs, les agitateurs, les faux prophètes : fouines à museau pointu pour Hébert. Même si Marat a droit quant à lui au simulacre caricatural du triomphe romain - mais il était tellement plus dangereux - la référence au bestiaire ne tarde pas à surgir, sous la forme à la fois rusée, hypocrite et gluante du crapaud ! Le peuple, quand il est abusé, ne peut l'être que par forces sournoises, maléfiques contrefaisant le prophète. Le principe restera sauf : certes faible, aisément candide, ignorant et spontanément porté vers les ivresses diverses mais pauvre, ce qui explique beaucoup et pardonne presque tout, le peuple est bon même si les circonstances parfois semblent pouvoir le corrompre.
Du Tiers exclu
Car c'est bien de l'infraction à cet antique principe aristotélicien dont il s'agit ici, appliqué au politique. La constitution, comme toutes, avait distribué les rôles entre les pouvoirs, exécutif dévolu au Roi d'une part, et législatif, qu'exerce l'Assemblée issue du suffrage populaire. Que cette constitution s'avéra impraticable non seulement parce qu'elle reposait sur un assentiment sinon contraint en tout cas duplice du Roi mais surtout parce qu'il rendait possible un conflit insoluble entre les deux pouvoirs qu'aucune instance ne pût tempérer, cela, oui apparaît aujourd'hui mais pouvait-on, en 89, abolir une monarchie trop forte encore, ce à quoi du reste les esprits n'étaient pas encore disposés, ou la réduire à un pur rôle symbolique ce à quoi elle ne pouvait se résoudre. Les jeux classiques de dialogue, d'opposition, de pouvoirs et de contre-pouvoirs sont supposés, en tout ordre politique, régir le quotidien des affaires : un dialogue-confrontation à l'intérieur de l'assemblée autant qu'à l'extérieur dans ses rapports avec la Cour - et même ce que ces affaires peuvent contenir parfois d'extraordinaire, d'exceptionnel. Ici, rien de tout cela et la guerre menaçante qui impliquera bientôt de proclamer la Patrie en danger, la trahison du Roi (Varennes), l'incapacité de l'Assemblée de procéder à son accusation et le lâche subterfuge consistant à le proclamer victime, le tout saupoudré des atermoiements inévitables d'une chambre indécise et qui le sera d'autant plus que son mandat s'achève et qu'elle n'est supposée qu'expédier les affaires courantes quand même elle détint encore, de droit, les clés de la légitimité, tout ceci mit bout à bout, ne pouvait que constituer un mélange explosif.
Elle vota que les communes auraient droit de faire partout des visites domiciliaires pour savoir si les suspects n'avaient pas des armes cachées. C'était armer la nouvelle puissance, dont on se défiait tant tout à l'heure, d'une inquisition sans bornes. Il était trois heures de nuit. En cette séance de vingt-sept heures, l'Assemblée vaincue, près de la royauté vaincue, en réalité avait abdiqué. Cette éclipse du premier pouvoir de l'État, du seul, après tout, qui fùt reconnu de la France, était effrayante dans la situation. Le combat n'avait pas fini; il durait encore dans les coeurs, ils restaient gonflés de vengeance.En quoi explosif ? C'est ceci qu'il importe de scruter : en l'irruption du peuple dans le jeu ! De deux, il se fera à trois : le peuple, directement, parfois par l'entremise de la Commune de Paris qui se proclame elle-même insurrectionnelle. L'extra-ordinaire pourfend l'ordinaire : le tiers subitement est inclus. S'inclut lui-même et met tout à bas ; renverse invariablement la table … et toute logique. Insurrection est révélateur qui dit en latin le surgissement, le fait de s'élever ou, plus simplement de se lever. Dans ces jours d'Août 92, d'un côté le Roi, affaibli, bientôt réfugié dans l'enceinte de l'Assemblée ; celle-ci, indécise ; enfin le peuple, dans la rue, agité sans doute par la Commune mais qui crainte de la menace extérieure et rage contre la Cour, n'avait assurément pas besoin d'elle pour se mouvoir, tout au plus pour coordonner son action. L'effroi de Michelet est révélateur ; son explication classique, qui servira souvent en forme sinon d'excuse en tout cas de circonstances atténuantes : le peuple n'est intervenu, avec tous les excès sans doute inévitables que parce que le politique, en ses instances ordinaires, avait fait défaut. Sauveur d'une situation tragique, même si sauveur macabre.
Bien sûr, la prise des Tuileries est une attaque frontale contre la légitimité royale, mais elle constitue aussi pour la première fois une opposition radicale à l'Assemblée qui se sera refusé à sanctionner le Roi et à mettre fin à la monarchie. Prendre les Tuileries où il siégeait c'était évidemment remettre en cause le Roi et l'obliger d'ailleurs à se mettre sous la protection de l'Assemblée, mais le faire sous l'égide de la Commune insurrectionnelle de Paris c'était en plus s'opposer directement à l'Assemblée, à moins que ce ne fût pour l'aider à avoir le courage qu'elle n'eut pas en cédant à la fiction absurde de l'enlèvement du Roi, fiction imaginée par La Fayette le même qui avait quelques temps plus tôt fait tirer sur la foule au Champ de Mars. Les conséquences, on le sait, furent après élections qui présidèrent à la formation de la Convention, la fin de la monarchie constitutionnelle - et de ce point de vue constitue effectivement une seconde révolution ou en tout cas la seconde grande étape de la Révolution - mais aussi le maintien tout au long de son existence et jusqu'au 9 Thermidor d'un contre-pouvoir influent et menaçant, à côté de l'Assemblée : la Commune Insurrectionnelle de Paris.
Les massacres de septembre s'en déduisent presque mécaniquement : suite d'exécutions sommaires dans les prisons où la foule, essentiellement à Paris, se venge de tous les traîtres à la Patrie, déclarée en danger, ils représentent la pointe extrême de la violence populaire et l'exemple même de la ligne de partage qui se dessinera plus tard entre les libéraux et la gauche radicale puis pose finalement le problème de ce bloc auquel faisait allusion Clemenceau : tout prendre ou tout laisser de la Révolution ? en réalité à droite on fera le tri ; à gauche on encensera ou on jettera un voile pudique sur cet épisode d'une violence extrême qui n'est que le commencement de la Terreur.
Détestable dégât collatéral, presque inévitable ou horreur inscrite dans le logiciel même de la Révolution ? c'est bien toute la question qui divisera la postérité tant politique qu'historiographique.
Il est clair que l'intermède politique n'a pas du arranger les choses : on se situe dans cette période d'inter-règne entre une Législative finissante mais qui de droit dispose encore du pouvoir, au moins celui s'expédier les affaires courantes, et une Convention pas encore élue - elle le sera le 20 - mais pour autant on ne peut seulement expliquer ces massacres par la seule vacance du pouvoir. En réalité, et c'est notamment l'explication que donne S Wahnich, on peut bien y voir une vengeance populaire suscitée par les atermoiements de la classe politique incapable de juger les traîtres (les hésitations sur la constitution civile du clergé, la destitution du roi, les procès des royalistes après le 10 août). La question posée ici n'est pas de savoir si cette violence était justifiée, légitime ou même seulement nécessaire : irrationnelle, elle l'était, autant que totalement contre-productive tant elle laissera de traces dans l'histoire politique ; pour autant elle marque, pour la seconde fois en quelques jours, le conflit tragique entre le peuple et la représentation nationale.
Or, avec Septembre, ce qui surgit ce n'est pas seulement un peuple qui va faire le travail que ne fait pas l'assemblée ; c'est surtout un peuple violent, irrationnel, immaîtrisable et immaîtrisé, un peuple qui suscite peur et effroi, et qui va laisser des traces dans l'imaginaire politique renforçant encore plus la défiance générale qu'une certaine bourgeoisie aura toujours nourrie à son égard, le considérant toujours plus ou moins comme une bête brute, vulgaire qu'au mieux une saine éducation devrait pouvoir contenir ; qu'au pire, il faut maintenir à l'écart tant il s'avère dangereux. On est ici au plus loin de la représentation idyllique d'un peuple souverain, bienveillant et unificateur. On n'oubliera pas de sitôt ce peuple assoiffé de sang : il est l'ombilic de la démocratie qui à la fois s'appuie sur le peuple mais ne cesse jamais vraiment de s'en méfier ou défier.
Les voici ces deux images, contrastées à souhait entre un peuple bestial, assoiffé de sang et cet autre, naturellement bon comme l'eût écrit Rousseau. Principe même de la République, le peuple ne peut qu'être magnifié, sanctifié : comme tout principe il est ce qui justifie tout et rend tout possible. C'est donc la société qui le corrompt, cette société mal fagotée, mal instituée, inachevée. On cherchera encore du côté du politique, à côté de l'éducation populaire d'ailleurs, la solution au problème. Mais quand même ce délire de violences, de haines et d'ivresses.
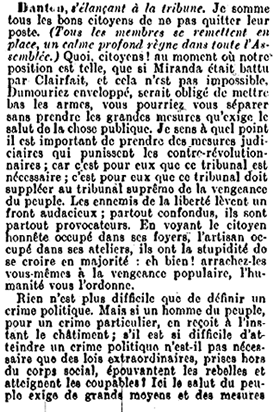
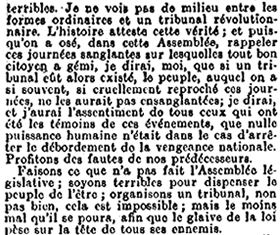 Il faut, à cet égard, relire ce que Danton déclarera le 10 mars 93 à la tribune de la Convention - à la fin de son intervention :
Il faut, à cet égard, relire ce que Danton déclarera le 10 mars 93 à la tribune de la Convention - à la fin de son intervention :
Soyons terribles, pour dispenser au peuple de l'être
Car Danton dit deux choses également importantes : d'abord que la violence populaire est toujours le résultat d'une défaillance du politique ce qui est une autre manière de rappeler que l'état normal des choses politiques est bien celui où il s'en remet à la représentation nationale et que son irruption dans le champ politique est toujours une provisoire - et souvent dangereuse - exception qui ne saurait être fondatrice. Mais il dit aussi l'absolue pureté et innocence du peuple qui est réaffirmé en sa dignité de principe sacré. Au fond, la distribution des rôles est assez claire dans l'esprit de Danton : c'est à l'Assemblée, c'est au politique de faire quand il le faut, le sale travail, mais de toute manière de traduire politiquement les demandes du peuple pour lui permettre de demeurer dans le ciel pur des idées et des principes. Prises ensemble ces deux choses disent l'essentiel du politique qui pourraient prêter à sourire tant la révolution se voulut à l'écart de tout préjugé religieux où elle n'a cessé de considérer une large part de la source des troubles dont la société souffrait, si ne s'y jouait pourtant la cohérence de tous les rites de fondation.
On ne fonde jamais sur rien et tous les rites de fondation le disent : au départ, il y a toujours une mise à mort, un cadavre que l'on enterre. Freud crut y déceler le meurtre du père ; Girard, la crise mimétique par excellence et la logique sacrificielle qui préside à toute sortie de conflit gémellaire. Mais au fond qu'importe ! ils sont raison tous les deux : au début, au fond, que l'on enterre, il y a toujours un cadavre, une mise à mort ; une mise hors-jeu et c'est cela aussi que l'on nomme principe.
La langue le dit.
Celui qui bâtit, d’abord creuse : les fondations. Fundationes désigne les assises par quoi on affermit un édifice. La métaphore est classique, implicite ici d’entre ce qui est fragile et se bâtit sur le sable et ce qui s’édifie sur le roc. L’acte même de fonder est le signe de la force. Le grec dit, pour fondation, καταβολη désignant à la fois le contraire de ana c'est-à-dire un mouvement vers le bas et βαλλω : jeter, lancer mais aussi frapper. Le terme est manifestement ambivalent qui dit à la fois le mouvement vers le haut et vers le bas ; qui dit à la fois la construction et la destruction. Volvo vient de ελυω qui signifie rouler. C’est ce terme qu’utilise Jean dans l’Apocalypse : révéler des choses cachées depuis la fondation du monde ( καταβολη κοσμου ) Le cosmos c’est l’ordre, l’organisation et donc la discipline, mais aussi la construction.
On est là au centre de ce qui importe : avec le même suffixe on a symbole, diabole, catabolisme et anabolisme ; avec le même préfixe : catastrophe. Celle-ci est ainsi l’action de se détourner vers le bas pour éviter les coups. Quand Romulus creuse le sillon, il y eut non seulement le cadavre préalable de son frère mais surtout celui, enterrée vivante de sa mère. Quand Moïse fonde Israël, il y a non seulement les cadavres de tous ceux qui furent massacrés après l'épisode du veau d'or mais il y a le sien aussi, lui qui mourut aux portes de la Terre Promise, tant il est vrai que le principe qui régit un ordre ne peut pas lui-même faire partie de cet ordre. Le christianisme lui-même s'érige sur un cadavre, d'ailleurs escamoté, subrepticement enseveli, celui du Christ lui-même, et de son double Jean le Baptiste. L'ordre suppose le principe, mais toujours le tue. L'ordre politique qui se veut défenseur du droit, et grand canalisateur de la violence, n'y peut parvenir qu'en expulsant violemment la violence elle-même, en s'arrogeant le monopole de la violence légitime. En expulsant la violence, il expulse en même temps le peuple. Ce pourquoi, le peuple, double gémellaire du politique, ne peut subsister face à lui.
Cette expulsion, qui est originaire, qui est de l'ordre de la fondation, représente l'endroit exact où le politique jouxte le sacré. Je n'ai jamais su s'il valait mieux parler de la bordure sacré du politique ou de la bordure politique du sacré : peut-être ne s'agit-il finalement que d'une question de position. D'une question qui montre à la fois combien le politique ne saurait se dispenser d'une transaction sacrée ; mais aussi combien, inéluctablement le sacré débouche, à un moment ou à un autre, sur une transaction politique - ce que l'histoire a amplement montré.
S Wahnich évoque la brûlure du geste sacré : non, on ne fréquente pas impunément ces moments fondateurs qui recèlent toujours en leur sein quelque chose de la terreur eschatologique ou de la lutte apocalyptique visant à l'enchaînement de Satan. Pour que la République puisse se fonder, il fallut bien arracher au monarque sa pourpre sacrée et son exécution, par l'incroyable transgression de l'ordre ancien qu'elle impliquait, sera devenue l'acte tellement fondateur, si dramatique, que plus aucun retour en arrière ne sera plus ni possible ni même concevable. En faisant se refermer les eaux de la Mer Rouge sur les troupes de Pharaon, Moïse, lui aussi, empêcha que tout retour en Égypte fût possible. La grande colère du Christ en chassant les marchands du Temple, la transgression du Shabbat - fût ce pour accomplir des miracles- aura été une autre manière de refermer le chemin derrière soi. Il n'est pas de fondation qui n'obstrue la route derrière soi. Et même s'il n'est pas d'avenir pour un peuple qui n'aurait pas d'histoire, il n'empêche que cet avenir n'est perceptible que pour celui qui l'aura définitivement recluse dans le passé.
On comprend mieux alors pourquoi les constituants de 89 durent prendre le risque aporétique d'un peuple abstrait, si difficilement lisible : c'était le prix à payer au sacré de la fondation. On comprend mieux la gêne éprouvée par les jacobins devant cette violence effrénée, incontrôlable, qu'ils ne purent ni totalement approuver ni surtout réprouver sans se dédire, sans surtout bafouer les principes de leur légitimité. Rien ne leur fit jamais autant peur que, non tant le peuple en lui-même que la dissolution de celui-ci en ses divisions, ses peurs.
Mais on gardera présent à l'esprit ce moment si délicat où le peuple se dresse en face de ses élus : on se trouve ici non dans le cas d'une opposition contre-révolutionnaire mais dans celui d'un élan à redonner au mouvement. Le peuple se lève, non pour en finir, mais pour aller de l'avant, pour se substituer à une Assemblée qui ne va pas assez loin. C'est le moment où le peuple entre dans l'arène ; rentre dans le jeu. Cet instant, explosif, où le principe cesse d'être extérieur au système qu'il légitime et où, normalement, c'est le système qui explose.
C'est cette explosion qu'il faudra étudier.
Au bilan
(provisoire)
Pourquoi estimant un homme l'estimez-vous tout enveloppé et empaqueté? [ ... ] Il le faut juger par lui-même, non par ses atours. [ ... ] Quelle âme a-il ? Est-elle belle, capable, et heureusement pourvue de toutes ses pièces? [...] Un tel homme est cinq cent brasses au-dessus des Royaumes et des duchés : il est lui-même, à soi, son empire. [ ... ] Comparez-lui la tourbe de nos hommes, stupide, basse, servile, instable, et continuellement flottante en l'orage des passions diverses qui la poussent et repoussent; pendant toute d'autrui : il y a plus d'éloignement que du Ciel à la terre
Montaigne, Essais I, 42
Deux images donc, tellement contradictoires qu'elles paraissent s'appeler l'une l'autre. Mais après tout ni plus ni moins que celle d'Alexandre face à Diogène ; ou que celle d'un Moïse porteur du 5e commandement mais organisant nonobstant le massacre des fautifs. Deux images pourtant qui marquent notre postérité politique où, décidément, selon que l'on excipe plutôt des charmes de la première ou bien exhibe la seconde, l'on finit par se placer de part et d'autre d'une ligne où droite et gauche ont encore un sens.
Deux images qui confrontées l'une à l'autre obligent bien à prendre en charge nos contradictions mais surtout à comprendre que, sous l'apparence benoîte d'une politique qui feint de se cantonner à de la simple gestion, gît qui brame parfois aux périodes tempétueuses, un rapport au sacré, incontournable et qui, ici comme ailleurs revêt les formes ambivalentes du sublime et de la crainte.
Montaigne dit le rêve humaniste et rationnel d'un regard qui ne fût la dupe d'aucune illusion ni d'aucune passion. Il oublie simplement que cet homme qu'il appelle de ses vœux, lui aussi il le place à cinq cent brasses au-dessus et n'échappe ainsi ni à la vénération d'un sacré qu'il situe simplement ailleurs ni à la détestation de l'homme ordinaire - où finalement il rejoint sans y pouvoir mais le préjugé commun.
