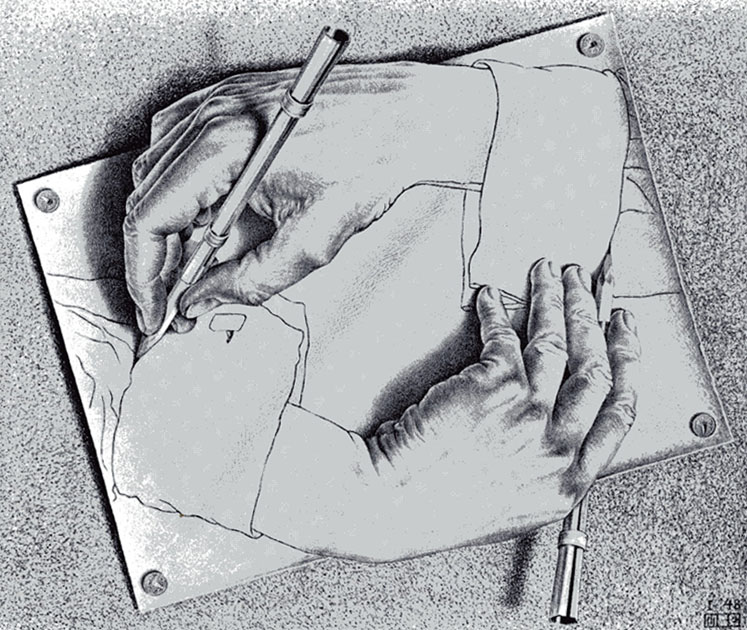| index | précédent | suivant |
|---|
De Libération :
| 1 |
|---|
| 2 |
| 3 |
Libération du 28 Août Migrants et réfugiés : des mots aux frontières bien définies
Libération du 3 Sept Une image, un tournant
Libération du 3 Sept Les photos «qui changent le monde» changent-elles vraiment le monde ?
Migrants et réfugiés : des mots aux frontières bien définies LAURE ANDRILLON
Libération du
28 AOÛT 2015
FOCUS Face aux vagues de migrations actuelles, l'usage d'un terme ou d'un autre, qui recouvrent des réalités juridiques et symboliques différentes, n'est pas anodin.
Tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Loin d’être synonymes, ces termes souvent utilisés indifféremment renvoient à des statuts juridiques bien distincts. Le migrant effectue une migration volontaire pour des raisons économiques, politiques ou culturelles, et relève du droit national. Le réfugié relève en revanche du droit international, sa migration étant considérée comme contrainte par la situation de son pays d’origine. Est réfugiée une personne qui a obtenu l’asile d’un autre Etat, conformément à la convention de Genève signée en 1951 et ratifiée par 145 Etats membres des Nations Unies. Si la demande d’asile est normalement individuelle, et doit être appuyée par des éléments qui la justifient, l’ONU considère qu’«il n’est pas possible –et il ne le sera jamais– de mener des entretiens individuels avec tous les demandeurs d’asile qui traversent la frontière», et reconnaît par conséquent des groupes de migrants comme des réfugiés prima facie, sans que soient attendues d’eux des preuves. Comme le rappelle William Spindler, porte-parole du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), «il est tout simplement inexact de parler de migrants syriens, alors que la Syrie est en guerre».
Il y a un an déjà, certains médias se demandaient s’il fallait nommer réfugiés ou migrants ces enfants non accompagnés qui fuyaient l’Amérique centrale pour chercher refuge aux Etats-Unis via la frontière mexicaine. Si la question ressurgit avec autant de force à propos de la situation actuelle en Méditerranée, c’est parce que les médias comme les hommes politiques utilisent régulièrement l’expression «crise des migrants» pour y faire référence. Adrian Edwards, porte-parole du HCR, explique à Libération que cette expression est «factuellement erronée, potentiellement nocive pour l’attitude du public à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés, et d’autant plus que, faisant office d’expression fourre-tout, son utilisation s’entérine».
«ON TRAITE COMME DES DÉLINQUANTS DES GENS QUI FUIENT LA GUERRE»
La distinction juridique a pourtant des conséquences très concrètes : du fait de la convention de Genève, le réfugié ne peut être renvoyé dans son pays d’origine, à l’inverse du migrant sans papiers. Dans un article du New York Times, la journaliste Somini Sengupta dit n’être pas surprise par le fait que «beaucoup d’hommes politiques en Europe préfèrent qualifier toute personne qui arrive sur le continent de migrant». D'ailleurs, le Premier ministre britannique, David Cameron, a été beaucoup critiqué en juillet pour avoir évoqué une «nuée de migrants traversant la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure», alors que l’ONU affirme que la grande majorité des arrivées sur les côtes européennes concerne des réfugiés et non des migrants. Pour Eric Fassin, contacté par Libération, la confusion lexicale est «révélatrice d’un recul idéologique des droits humains. A Calais ou à la Chapelle, on traite comme des délinquants des gens qui fuient la guerre en Syrie et ailleurs».
Le 20 août, Barry Malone a annoncé au nom du journal qatari Al-Jezira qu’il ne parlerait plus de «migrants méditerranéens», pour marquer son refus de «donner du poids à ceux qui ne veulent y voir que des migrants économiques». L’enjeu n’est pas seulement juridique ou politique, il est aussi affectif. «Le terme générique “migrant” ne suffit plus pour décrire l’horreur qui se déroule en Méditerranée. Il a évolué de ses définitions dans le dictionnaire pour devenir un outil qui déshumanise et distancie, un euphémisme péjoratif», écrit Barry Malone. Il ne s’agit pas seulement d’adopter un lexique précis, mais de trouver un mot qui soit à la hauteur du drame qui se déroule aux portes de l’Europe. Le journaliste met en cause la connotation qui est venue teinter le mot migrant de peur, de xénophobie et de «racisme voilé».
MIGRANT OU IMMIGRÉ ?
Epargner cette connotation aux réfugiés ne doit pas faire oublier qu’elle pèse encore sur les migrants, et qu’il importe de se garder de tout manichéisme. «S’il est important de rétablir la distinction entre migrants et réfugiés, il ne faudrait pas pour autant qu’elle serve à opposer les bons réfugiés aux mauvais migrants, comme si chercher du travail pour échapper à la misère ailleurs que dans son pays était en train de devenir un délit», explique Eric Fassin à Libération. C’est en ce sens que la Britannique Judith Vonberg, doctorante et militante auprès d’organisations de protection de réfugiés, souhaite «reprendre possession du mot «migrant» pour éviter de «donner du crédit aux voix oppressives qui nous affirment que les migrants ne méritent pas notre compassion».
Certains avancent que «migrant» est préférable à «immigré», jugeant que le préfixe, suggérant quelque chose d'invasif, est péjoratif en plus d'être superflu. Eric Fassin voit au contraire dans ce nouveau réflexe langagier le signe qu’«il n’est plus jamais question d’intégration» : «quand on dit migrant, on ne dit pas immigré. Autrement dit, on n’envisage ces gens qu’à la frontière ; on n’imagine plus qu’ils puissent trouver leur place dans notre société. Tout se passe comme si leur parcours n’avait plus de destination ; c’est en quelque sorte un déplacement sans finalité : ils sont réduits à une errance. Le vocabulaire redouble ainsi la frontière».
«Libre à chacun d’utiliser le terme qu’il veut, mais étant donné l’importance des implications de ces termes, nous demandons simplement qu’une réflexion soit menée sur le sens qui se cache derrière les mots que nous choisissons», conclut le porte-parole du HCR Adrian Edwards. Pour donner à ceux qui échouent quotidiennement sur nos rives leurs vrais noms, il convient de faire preuve d’autant d’exigence de précision que de vigilance aux connotations.
Laure ANDRILLON
Une image, un tournant
DIDIER PÉRON
Libération
3 SEPTEMBRE
ANALYSE Iconique, la photo insoutenable de l’enfant échoué renverse les opinions, jusque-là indifférentes. Décryptage d’une photo déjà historique.
La photo prise par la reporter Nilüfer Demir de l’agence turque Dogan News sur la plage de Bodrum semble interrompre l’incessante tempête du visuel en continu et nous plonger dans le silence figé d’un moment décisif : la rencontre entre deux solitudes - deux pauvres humains ensemble et néanmoins séparés par un irrémédiable, l’un à jamais empêché de vivre, l’autre impuissant à le ressusciter, saisis dans la lumière pure d’un instantané d’aube tragique. Une vidéo de la situation a aussi été mise en ligne par la même agence qui, bien entendu, ne banalise pas la situation. On y voit des flics s’activant sur le lieu d’un drame et non, comme ici, ce bloc silencieux que la perspective profonde des vagues et le trait du rivage au fond enserre dans une plénitude douloureuse.
Identification. Chacun veut croire, soudain, qu’une image, une seule, possède le pouvoir magique de faire basculer les opinions occidentales tétanisées par la hantise d’invasion de migrants. Et qu’elle peut, par la contagion des larmes et de la honte, prêter aux différents gouvernements européens ce génie du bon accueil qui leur a jusqu’ici cruellement manqué.
Les réseaux sociaux ont amplifié ces phénomènes de olas virtuelles où chaque individu est comme traversé par une même onde électrisante d’émotion synchrone. Plus de 1 000 noyés en une semaine en avril dans les eaux méditerranéennes, 71 cadavres de migrants en décomposition dans un camion abandonné en Autriche : personne, aucun parti, aucun organe de presse, aucun citoyen, ne peut ignorer les situations atroces qui se multiplient depuis des mois.
Cependant, de même qu’il faut de longues séances de psychanalyse au névrosé non pas pour «connaître» mais bien«prendre conscience» de la gravité des maux qui le rongent, il faut à l’inconscient collectif le choc d’une identification pour que cesse une forme d’insensibilité statistique ou de fatalisme courroucé. «Si ces images extraordinairement puissantes d’un enfant syrien mort échoué sur une plage ne changent pas l’attitude de l’Europe face aux réfugiés, qu’est-ce qui le fera ?» s’insurge en page d’accueil le site de The Independent, tandis que le Monde éditorialise en ces termes : «Peut-être faudra-t-il cette photo pour que l’Europe ouvre les yeux.»
Implicites. Citons encore Alain Mingam, photojournaliste, lauréat du World Press et président du prix photo AFD, qui, interrogé par Libération déclare : «Cette image peut réveiller les consciences, comme toutes celles qui ont marqué l’histoire. La petite fille brûlée au napalm prise par le photojournaliste Nick Ut en 1972 avait, par exemple, eu un impact terrible à l’époque.»
Mais, il faut, hélas !, aussi pouvoir interrompre la ferveur que suscite l’icône pour en interroger les implicites. Car si ce garçonnet mort marque une limite, comme si ce spectacle obligeait à un sursaut moral tant l’intolérable était désormais atteint, on peut se demander si les clichés, largement diffusés, de grappes de migrants juchés sur des bateaux, agrippés à des grilles, d’individus coursés par des flics mais aussi de cadavres de victimes adultes éparpillés sur d’autres grèves, étaient, de fait, de mauvais objets, des mauvais passeurs d’émotion. Qu’il nous faut encore et toujours recourir au reflet de notre propre enfance (ou celle de nos progénitures libres d’aller où elles veulent) pour se sentir concernés. Avec le risque de continuer à ne pas accepter que le chaos de la migration et de la guerre multipolaire devrait nous rendre attentifs, ouverts ou interpellés par tout ce que nous ne reconnaissons pas immédiatement comme étant le plus proche, le plus simple, le plus innocent.
Didier PÉRON
 Les photos «qui changent le monde» changent-elles vraiment le monde ?
Les photos «qui changent le monde» changent-elles vraiment le monde ?
FRANTZ DURUPT
Libération du
3 SEPTEMBRE 2015
ANALYSE La photo d'Aylan Shenu, réfugié syrien mort noyé, s'inscrit dans la tradition des clichés où l'enfance cristallise les drames humanitaires. Des images qui, souvent, accompagnent des changements plus qu'elles ne les provoquent.
Les images qui «changent le monde» ont-elles vraiment changé le monde ? Et l’image d’Aylan Shenu, un enfant syrien dont le corps a été rejeté par la mer sur une plage turque, va-t-elle «éveiller nos consciences» ? C’est ce qu’espère, par exemple, Alain Mingam, photojournaliste et lauréat du World Press, dans un entretien à Libération.fr.
 Mais ne risque-t-on pas de projeter dans cette image un pouvoir qu’elle n’a pas ? Historiquement, elle renvoie à d’autres icônes, d’autres drames : on pense, forcément, à la photo de Kim Phuc, enfant vietnamienne, victime d’une bombe au Napalm, pleurant nue devant l’objectif de Nick Ut. Le 8 juin 1972, ce photographe de l’Associated Press capture l’instant où deux avions de l’armée sud-vietnamienne avaient bombardé, par erreur, une pagode où se trouvaient des compatriotes. Le lendemain, le New York Times imprime le cliché en bas à gauche de sa une, tandis que d’autres journaux hésitent, notamment en raison de la nudité visible à l’image. Le 12 juin, la photo est presque partout, et le président Richard Nixon doute de sa véracité. Le cliché vaudra à son auteur un prix Pulitzer en 1973, et deviendra le symbole de l’injustice de ce conflit.
Mais ne risque-t-on pas de projeter dans cette image un pouvoir qu’elle n’a pas ? Historiquement, elle renvoie à d’autres icônes, d’autres drames : on pense, forcément, à la photo de Kim Phuc, enfant vietnamienne, victime d’une bombe au Napalm, pleurant nue devant l’objectif de Nick Ut. Le 8 juin 1972, ce photographe de l’Associated Press capture l’instant où deux avions de l’armée sud-vietnamienne avaient bombardé, par erreur, une pagode où se trouvaient des compatriotes. Le lendemain, le New York Times imprime le cliché en bas à gauche de sa une, tandis que d’autres journaux hésitent, notamment en raison de la nudité visible à l’image. Le 12 juin, la photo est presque partout, et le président Richard Nixon doute de sa véracité. Le cliché vaudra à son auteur un prix Pulitzer en 1973, et deviendra le symbole de l’injustice de ce conflit.
 On pense aussi à la photo, prise au Soudan en 1993 par Kevin Carter, d’une enfant prostrée, un vautour en arrière-plan, au moment où sévissent la famine et la guerre civile. En 1994, ce cliché aussi a valu un Pulitzer à son auteur, qui s’est suicidé la même année.
On pense aussi à la photo, prise au Soudan en 1993 par Kevin Carter, d’une enfant prostrée, un vautour en arrière-plan, au moment où sévissent la famine et la guerre civile. En 1994, ce cliché aussi a valu un Pulitzer à son auteur, qui s’est suicidé la même année.
Ces images sont devenues iconiques. En 2011, une enquête a pourtant conclu de la seconde qu’elle avait donné lieu à des interprétations excessives. Non seulement la fillette était en fait un garçon, mais en plus il était, au moment du cliché, déjà pris en charge par Médecins du Monde. Il survivrait à la famine, mais pas au paludisme, dont il est mort en 2007, rappelait L’Humanité en 2014.
De la photo de Kim Phuc, on dit régulièrement qu’elle a été un déclencheur dans la décision de l’administration Nixon de mettre fin à la guerre au Vietnam. Mais «malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça se passe», tempère André Gunthert, chercheur en histoire visuelle à l’École des hautes études en sciences sociales. En réalité, dit-il, «une image iconique accompagne un changement qui se manifeste déjà par ailleurs». Au moment où l’Associated Press diffuse la photo de Kim Phuc, l’opinion américaine est déjà en train de basculer pour la fin de la guerre au Vietnam.
UN MOMENT DE BASCULEMENT
La photo d’Aylan Shenu, publiée par l’agence Reuters, et très documentée par ailleurs (on connaît le nom de l’enfant, son parcours, sa famille…), paraît elle aussi à un moment de basculement. Alors que les réfugiés meurent dans la mer Méditerranée depuis longtemps (on en a dénombré 3 500 l’année dernière, plus de 2 000 depuis le début de cette année), elle est prise et publiée au moment où, en Allemagne, Angela Merkel affiche une volonté politique d’accueil qui tranche avec les réticences françaises. En Grande-Bretagne, où de nombreux quotidiens en ont fait leur une – y compris, d’ailleurs, ceux qui militent habituellement pour le refus des réfugiés –, l’opposition à l’intransigeante politique de David Cameron se fait plus pressante.
Surtout, analyse André Gunthert, la photo s’inscrit «dans une grammaire visuelle exploitée consciemment par la photographie humanitaire depuis plus d’un siècle» : celle de l’enfant victime. Kim Phuc la Vietnamienne, la petite Soudanaise affamée, mais aussi le jeune Mohammed al-Durah, tombé sous les balles israéliennes devant une caméra de France 2 : à chaque fois la présence d’un enfant rappelle que «le problème concerne l’humanité tout entière». «Ces images sortent à un moment précis, qui correspond à une manifestation des dimensions morales», souligne André Gunthert. Ce que les médias ne se permettent pas d’écrire, une image le dit à leur place. Ou plutôt, ils le font dire à l’image.
Car la réception de ces images, instantanément interprétées comme des symboles des drames dans lesquels elles s’inscrivent, «s’appuie sur une culture visuelle très ancienne», dit André Gunthert, ajoutant que «pour produire une image lisible, il faut limiter l’information.» Cet enfant mort sur une plage pourrait, hors contexte, s’être noyé pour d’autres raisons. Mais chacun a compris instantanément ce qui avait tué Aylan Shenu, et a pu analyser que cette photo signifiait l’échec de la politique migratoire européenne.
Il n’en va pas toujours ainsi. En 2014, de nombreuses photos avaient déjà montré l’horreur de la guerre en Syrie, sans pour autant provoquer un choc amenant à une réaction internationale, relevait Slate.fr. La faute à un conflit difficile à appréhender, où les rôles entre bons et méchants ne sont pas si clairement définis que cela, mais aussi à… un trop grand nombre d’images. «Chaque jour aux Etats-Unis, 4 000 photographies sont publiées toutes les secondes», expliquait alors Fred Ritchin, doyen de l’école de Centre International de la photographie, cité par Slate. «On ne sait plus où regarder. Pendant la guerre du Vietnam, une photographie pouvait se retrouver en Une et rester pour une journée entière, les gens en parlaient. Aujourd’hui, sur les sites internet, les photographies restent quelques minutes avant d’être remplacées par une autre image.»
TWITTER, ACCÉLÉRATEUR
 Un an plus tard, la photo d’Aylan Shenu, qui n’est pas la première à montrer les souffrances des enfants réfugiés, a pourtant réussi à s’imposer à la presse, notamment parce qu’elle a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. «Twitter a acquis une fonction d’accélération et de validation dans la sélection des icônes», analyse ainsi André Gunthert. Impossible pour les médias d’ignorer une image partagée massivement sur les réseaux sociaux, cristallisant le jugement moral d’une partie de l’opinion. Mais impossible aussi de ne pas noter que cette photo, en raison justement de sa dimension très symbolique, permet à chacun d’y projeter ce qu’il veut. C’est ainsi qu’un Eric Ciotti, député Les Républicains qui défend depuis des mois une politique migratoire intransigeante consistant à refuser les réfugiés en les qualifiant de «clandestins», peut à bon compte tweeter, ce jeudi matin, son «écœurement face à l’inaction de la communauté internationale».
Un an plus tard, la photo d’Aylan Shenu, qui n’est pas la première à montrer les souffrances des enfants réfugiés, a pourtant réussi à s’imposer à la presse, notamment parce qu’elle a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. «Twitter a acquis une fonction d’accélération et de validation dans la sélection des icônes», analyse ainsi André Gunthert. Impossible pour les médias d’ignorer une image partagée massivement sur les réseaux sociaux, cristallisant le jugement moral d’une partie de l’opinion. Mais impossible aussi de ne pas noter que cette photo, en raison justement de sa dimension très symbolique, permet à chacun d’y projeter ce qu’il veut. C’est ainsi qu’un Eric Ciotti, député Les Républicains qui défend depuis des mois une politique migratoire intransigeante consistant à refuser les réfugiés en les qualifiant de «clandestins», peut à bon compte tweeter, ce jeudi matin, son «écœurement face à l’inaction de la communauté internationale».
De tout cela, faut-il pour autant déduire la publication et le relais de ces photos comme inutiles ? Non, car ces images «deviennent des marqueurs historiques», dit André Gunthert : «on ne se souvient pas de la fin de la guerre au Vietnam, car la photo de Kim Phuc en est devenue l’icône». La photo d’Aylan Shenu pourrait connaître le même sort pour la crise des réfugiés, et «c’est loin d’être négligable».
Frantz DURUP