LES HYPOTYPOSES ou
INSTITUTIONS PYRRHONIENNES DE
SEXTUS EMPIRICUS.
LIVRE TROISIEME
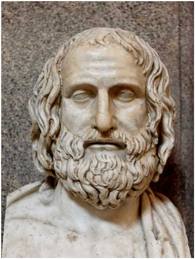 CE que nous avons dit , dans le livre précédent, sur la Logique qui fait une partie de ce que l'on appelle la philosophie, peut suffire pour ces courtes Institutions. Maintenant nous parcourerons avec une semblable méthode l'autre partie de la Philosophie, que l'on appelle la Physique. Nous n'attaquerons pas néanmoins en détail & en particulier toutes les assertions des Dogmatiques, & nous tâcherons seulement de renverser les chefs les plus généraux , avec lesquels tout le reste se trouvant enveloppé , sera suffisamment réfuté. Nous commencerons par les questions sur les principes ou sur les causes : & comme la
CE que nous avons dit , dans le livre précédent, sur la Logique qui fait une partie de ce que l'on appelle la philosophie, peut suffire pour ces courtes Institutions. Maintenant nous parcourerons avec une semblable méthode l'autre partie de la Philosophie, que l'on appelle la Physique. Nous n'attaquerons pas néanmoins en détail & en particulier toutes les assertions des Dogmatiques, & nous tâcherons seulement de renverser les chefs les plus généraux , avec lesquels tout le reste se trouvant enveloppé , sera suffisamment réfuté. Nous commencerons par les questions sur les principes ou sur les causes : & comme la
plupart des Philosophes tombent d'accord qu'entre ces principes, les uns sont matériels & les autres efficients ; nous commencerons par les efficients, qui passent pour être plus nobles que les matériels.
Chap. I. De Dieu.
Comme plusieurs Dogmatiques assurent que Dieu est une cause très efficace, nous examinerons premièrement cette question qui regarde Dieu, avertissant le Lecteur avant toutes choses, que, quoique nous n'établissions aucun Dogme , nous disons néanmoins qu'il y a des Dieux, nous les honorons, & leur attribuons une providence; & qu'ainsi ce que nous disons ici, n'est que contre la témérité des Dogmatiques. Nous devons connaître la nature des choses, que nous concevons dans notre esprit : nous devons savoir , si ces choses sont des corps, ou si elles font incorporelles. Nous en devons aussi connaître les formes ou les figures & en avoir des idées. Personne, par exemple, ne saurait concevoir dans son esprit ce que c'est qu'un cheval , s'il ne connaît auparavant la forme & la figure d'un cheval. Ensuite ce que l'on conçoit dans son esprit, il le faut concevoir comme existant dans quelque endroit.
C’est pourquoi, quelques uns d'entre les Dogmatiques disant que Dieu est corporel, & d'autres qu'il est incorporel : les uns qu'il est en forme humaine, & d'autres que non: les uns qu'il est dans un lieu, & les autres qu'il n’est pas dans un lieu : & derechef de ceux qui disent que Dieu est dans un lieu, les uns le plaçant dans le monde & les autres dehors : comment pourrons-nous connaître ce que c’est que Dieu si on ne saurait s'accorder ni sur sa nature, ni sur si forme, ni sur le lieu où il est ? Que ces Dogmatiques s’accordent tous auparavant à dire d'une même bouche que Dieu est d'une telle manière; qu'ensuite ils nous en donnent une description & qu'alors enfin ils exigent de nous que nous connaissions ce que c’est que Dieu. Mais étant entre eux discordants, d'une manière qu'on ne saurait juger de quel côté est la vérité, ils ne nous fournissent sur ce sujet, quoi que ce soit, que nous puissions concevoir comme une chose avouée & indubitable.
Imaginez-vous, disent-ils, quelque chose d'incorruptible & d'heureux, & pensez que c’est là Dieu. Mais cela est insensé. Car, comme celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas s'imaginer des attributs qui lui conviennent, en tant qu'il est Dieu: ainsi, parce que nous ne connaissons pas la nature de Dieu, nous ne pouvons pas nous imaginer ni connaître les propriétés & les attributs qui lui conviennent. Ensuite qu'ils nous disent ce que c’est qu'une chose heureuse. Est-ce qui agit conformément à la vertu, & ce qui pourvoit aux choses qui lui sont assujetties? est-ce ce qui n’est dans aucune action, qui n'a aucune affaire, & qui ne se mêle aussi de rien? Car ces Philosophes, ayant entre eux, sur ces questions, des controverses qui n'ont jamais pu être décidées, ils ont fait que cette chose heureuse & Dieu par conséquent est pour nous une chose impénétrable. Je dis plus. Quand on pourrait concevoir ce que c’est que Dieu, il faut néanmoins s'abstenir de décider s'il existe ou s'il n'existe pas; vu les dissensions des Dogmatiques sur la question de Dieu. Car qu'il y ait un Dieu, cela n’est point évident; & si cela se présentait de soi-même, les Dogmatiques seraient convenus entre eux pour dire d'un commun accord, ce que c’est que Dieu, quel il est, & où il est: au lieu que tout au contraire leurs disputes, dont il est imposable de juger définitivement, sont cause que cela ne nous paraît point être évident, & nous paraît au contraire avoir besoin de démonstration. Car celui qui dit qu'il y a un Dieu, prouve cela ou par quelque chose d'évident, ou par quelque chose d'obscur. Ce n’est point par quelque chose d'évident : car si ce qui démontre qu'il y a un Dieu est évident ; comme ce qui est démontré, est connu, & par conséquent compris aussi, avec la chose qui le démontre, il sera évident par conséquent qu'il y a un Dieu, puisque cela se connaîtra ensemble avec une chose évidente qui le démontre. Mais qu'il y ait un Dieu, cela n’est point évident, comme nous l'avons fait voir : donc on ne le peut démontrer par une chose évidente.
On ne pourra pas démontrer non plus par une chose obscure, qu'il y a un Dieu. Car cette chose obscure par laquelle on démontrera qu’il y a un Dieu, ayant besoin d'être démontrée elle-même; si on dit quelle est démontrée par quelque chose d'évident, elle ne sera pas obscure. Il ne sera pas obscur non plus, mais évident qu'il y a un Dieu. Donc cette chose obscure, que l’on prend pour prouver qu'il y a un Dieu, n’est pas démontrée par une chose évidente. Mais elle n’est pas non plus démontrée par une chose obscure ; & celui qui voudra dire cela, tombera dans le progrès à l'infini, parce que nous demanderons toujours une démonstration de cette chose obscure que l'on apportera en confirmation d'une preuve précédente. Donc on ne peut pas prouver qu'il y a un Dieu, ni par l'évidence de la chose en elle même, ni par quelque autre chose. Ce qui étant ainsi; on ne peut pas connaître s'il y a un Dieu.
Ajoutons ceci. Celui qui dit qu'il y a un Dieu, dit aussi ou qu'il a soin par sa providence des choses qui sont dans le monde, ou qu'il n'y a point de providence, ou bien il dira que cette providence s'étend sur toutes choses, ou seulement sur quelques unes. Mais si Dieu pourvoyait à toutes choses, il n'y aurait point de maux ni de vices. Or on dit que toutes choses font remplies de défauts. Donc on ne peut pas dire que Dieu pourvoie à toutes choses.
Que si Dieu pouvait à quelques choses seulement, pourquoi à celles-ci, & non pas à celles-là? Car ou il veut & il peut pourvoir à toutes choses ; ou il le veut & ne le peut pas; ou il le peut & ne le veut pas ; ou il ne veut ni ne le peut.
S'il le voulait & le pouvait, il pourvoirait à toutes choses. Or il ne pourvoit pas à toutes, (corne cela paraît par ce qui a été dit.) Donc il n’est pas vrai qu'il veut & qu'il peut pourvoir à toutes choses.
S'il veut pourvoir à toutes choses, & ne le peut, cette cause pour laquelle il ne pourra pas pourvoir aux choses auxquelles il ne pourvoit pas, fera que cela surpassera ses forces. Mais il est absurde de s'imaginer un Dieu, dont les forces cèdent à quoi que ce soit.
S'il peut pourvoir à toutes choses, & ne le veut pas, il pourra passer pour envieux & malin.
Et si enfin il ne le veut ni ne le peut, il est malin & ses forces sont débiles, ce qu'il n'appartient qu'à des impies de dire de Dieu. Donc Dieu ne pourvoit point aux choses qui sont dans le monde.
Or si Dieu ne pourvoit rien, si on ne voit de lui aucun ouvrage, ni aucun effet, Personne ne saurait dire par où il connaît qu'il y a un Dieu, puisqu'il ne paraît point par lui même, & qu'on ne le connaît par aucuns effets. Voilà donc encore des raisons qui prouvent que l'on ne peut pas connaître s'il y a un Dieu.
Au reste ces mêmes raisons nous donnent lieu de conclure que ceux qui assurent trop affirmativement qu'il y a un Dieu, ne sauraient peut-être éviter de tomber dans une impiété. Car s'ils disent que sa providence s'étend à toutes choses, ils diront qu'il est l'auteur des maux : & s'ils disent que sa providence s'étend seulement à quelques choses, ou qu'elle ne s'étend à rien, ils seront obligés de dire, ou que Dieu est envieux, ou que son pouvoir est faible : toutes choses que l'on ne saurait dire sans une impiété manifeste.
Réflexions du Traducteur sur le Chapitre précédent.
Je ne dois pas laisser passer ce chapitre sans y apporter, un bon correctif, qui détruise dans l'esprit du Lecteur, l'indignation qu'il pourrait avoir conçue contre Sextus, & peut-être aussi contre moi, en voyant toutes ces objections contre l'existence de Dieu. Pour cet effet je le prie de faire avec moi les réflexions suivantes.
(I.) Lorsque, soit par la Raison, soit par la foi, on est une fois pleinement convaincu de l'existence d'un Dieu tel que les Chrétiens le reconnaissent, toutes les difficultés des Philosophes sur ce fondement de la Religion, se réduisent à peu près à celles qui ont été proposées une infinité de fois par rapport au mal Physique, ou aux maux auxquels les animaux & les hommes, créatures d'un Être infiniment bon, sont exposées; par rapport au mal moral ou aux crimes qui inondent la face de la terre, sous un Dieu infiniment saint qui pourrait arrêter tous ces horribles désordres ; & par rapport aux peines éternelles des damnés. Mais ces difficultés là ne doivent faire, & ne font effectivement aucune peine, qui mérite d’en parler aux Chrétiens qui sont une fois bien persuadés, du souverain empire, & de la souveraine perfection de Dieu. Aussi, avons-nous contre ces objections, des réponses de plusieurs Théologies de toutes Sectes, & de tous Systèmes, qui satisfont parfaitement ceux qui les ont faites : c’est tout ce que l’on peut demander. Car il n'est pas possible que les réponses de quelqu’un satisfassent parfaitement tous les autres; & il suffit que depuis les Sociniens jusqu'aux Supralapsaires, chacun dans son Système soit content de sa propre réponse.
(II.) Les livres de Cicéron de la nature des Dieux, doivent paraître plus dangereux, que ce chapitre de Sextus, quand on y joindrait ce qu'il a écrit sur le même sujet dans son premier livre contre les Physiciens p. 551 & suiv. Cependant Mr. l’Abbé d'Olivet a publié une très belle traduction française de ces livres, & les a mis ainsi entre les mains de tout le monde, sans se soucier des scrupules de ceux qui craignent peut-être, que la Religion Chrétienne ne soit pas établie sur des fondements assez fermes & assez solides, pour pouvoir résister aux attaques des Académiciens ou des Pirroniens. Mais rassurons ces Personnes pieuses, & montrons leur que ni le Cotta de Cicéron, ni Sextus Empiricus, ne font aucune brèche au Système de la Religion Chrétienne, puisqu'ils ne combattaient aucune idée de Dieu qui fût pareille à celle que nous en avons, et qu'ils ne disputaient que contre des Philosophes, qui n'avaient pas plus d'idée de Dieu, que s'ils eussent été des Athées. Est-il surprenant de voir, que les Académiciens & les Pirroniens qui examinaient toute leur vie les opinions des Dogmatiques, méprisassent leurs décisions sur la nature des Dieux, quand ils n'en trouvaient pas une qui fût soutenable, pas une qui n'eût des défauts essentiels ; sans compter, que toutes ces différentes Sectes de Dogmatiques se détruisaient les unes les autres par leurs dissensions, ce qui confirmait les Académiciens & les Pirroniens dans leurs doutes?
Ceux qui voudront voir un beau détail sur les erreurs des Philosophes touchant la Divinité, peuvent lire l'excellent traité que M. l'Abbé d'Olivet a joint à sa traduction. Ce traité se trouve à la page 255 du troisième tome, & est intitulé: Remarques du Traducteur sur la Théologie des Philosophes Grecs, (Suppléez par rapport aux Entretiens de Cicéron sur la nature des Dieux.)
Je ne puis m'empêcher pour la justification de Sextus, & plus encore pour la mienne, de transcrire ici un beau morceau de ce traité. Voici donc comme Mr. l'Abbé d'Olivet raisonne sur la fin, p. 309 & suiv.
« Par ce mot Dieu, je veux dire, un Esprit infini, dont la nature est indivisible et incommunicable ; dans lequel sont réunies toutes les perfections imaginables & possibles, sans aucun mélange et imperfection ; qui a tiré du néant l’Univers, & qui est distinct réellement & substantiellement de tout ce qu'il a créé. »
« Par ce mot Athée, j'entends, un homme v qui ne croit pas, qui ne connaît pas un Dieu tel que nous le définissons. Or c’est ne pas, croire, c’est ne pas connaître un Dieu, que d'en avoir une idée, ou qui lui retranche quelqu’une de ses qualités essentielles, ou qui lui en attribue d'incompatibles avec celles qu'il a nécessairement.
« Un Athée n’est donc pas simplement un homme, qui nie cette proposition « Dieu existe ». Car si on se contentait de la prendre dans un sens vague & indéterminé, les Païens & les Chrétiens la recevraient également ; mais en y attachant des idées bien différentes.
« On ne trouve (dit M. Bayle continuat. des pensées diverses tom. I. p. 80.) ni aucun Peuple, ni aucun particulier qui ne connaisse une cause de toutes choses. Les Athées, sans en excepter un seul, signeront sincèrement cette thèse ci : Il y a une cause première, universelle, éternelle, qui existe nécessairement & qui doit être appelée Dieu
« Tout est de plein pied jusques là. Mais de là vous devez, conclure que ce n’est point dans cette thèse si évidente y que consiste le vrai état de la question. Un formulaire que les Sectateurs de la fausseté peuvent signer conjointement avec ceux de la vérité, est une chose captieuse, & nécessairement défectueuse.
« Ainsi pour décider si les anciens Philosophes doivent être mis au nombre des Athées, il ne suffit point de trouver dans leurs écrits le nom & l'existence de Dieu, ni même quelques unes de ses qualités, mais à la rigueur, il faut n'y pas trouver, ou, qu'ils lui en ont ôté d’essentielles, ou qu'ils lui en ont attribué d’incompatibles avec celles qu'il a nécessairement.
Mr. l'Abbé d'Olivet, après avoir récapitulé tout de fuite les erreurs des Philosophes, continue ainsi :
« Tous les anciens Philosophes auraient donc proféré cet acte de foi, Je crois l’existence de Dieu, sans entendre par là ce qu'entendent le Juif & le Chrétien. Réduisons les termes à leur juste valeur, & nous verrons que cette proposition, signifie dans la bouche de Straton, ou dans celle d'Epicure. Je crois l’existence d'une Nature inanimée : dans celle des Stoïciens. Je crois l’existence d’un Principe intelligent quoique matériel & dans celle d'Anaxagore ou de Platon, Je crois l’existence d’un Esprit infini, qui a formé l’univers, mais qui ne l’a pas créé.
« Ainsi, quand on résout cette proposition suivant les règles de la Logique, on voit que l'attribut ne répond jamais à notre idée & qu'il change toujours en même temps que le sujet. De là il s’ensuit que les traits de cet ouvrage, qui ont quelque air d'impiété, n'ont point ici pour objet le vrai Dieu., mais la chimère que les Philosophes mettaient à la place du vrai Dieu... »
Ce que M. l'Abbé d'Olivet dit ici en faveur des livres de Cicéron de la nature des Dieux, je le dis de ce chapitre des Institutions Pirroniennes & de toutes les objections de Sextus contre l'existence de Dieu. Sextus n'attaque point dans ses livres le système de Chrétiens, qui lui était inconnu, mais seulement les rêveries des Philosophes Païens sur la Divinité: à quoi j'ajouterai que quand même les pensées de quelques-uns d'eux auraient été aussi orthodoxes, aussi conformes à la saine Religion, que celles des Chrétiens à cet égard, elles n'auraient toujours été que problématiques, comme toutes les autres opinions des Philosophes, jusques à ce que la révélation & la foi eût fixé leur Raison chancelante & mal assurée sur cet article.
(III.) Il n'y a donc aucun lieu de récrier contre Sextus qui n'avait aucune connaissance de la Religion Chrétienne, lorsqu'il attaque les Dogmatiques contre l'existence de Dieu. Ces objections étaient accablantes contre eux, qui, ou n'admettaient point de providence ; ou ne reconnaissaient point de liberté, ou ne croyaient point que les Dieux fissent aucun mal aux hommes, ni dans cette vie, ni dans une vie à venir; ou ne croyaient point la création de la matière, comme c'était l'opinion commune de tous; ou n'avaient aucune idée d'un Être purement spirituel; ou croyaient Dieu corporel, &c. & qui tous n'avaient aucune certitude de foi ni sur cet article de l’existence de Dieu, ni sur aucun autre.
Mais à l'égard des Chrétiens, la raison & la révélation leur fournissent des preuves incontestables de l'existence de Dieu, & de ses souveraines perfections, corne, de sa sagesse, de sa bonté, de son admirable providence, de sa justice & de sa sainteté; & si eu égard à quelques objections, ils se trouvent un peu embarrassés, ce qui peut fort bien être, il n'y a point de doute que Dieu ne permette ces petits nuages d'obscurité, pour éprouver leur foi, & pour leur donner lieu de ressembler d'autant plus au Père des Croyants, au fidèle Abraham, qui, comme le dit saint Paul, Crut sous espérance, contre toute espérance, c’est-à-dire, crut en espérant contre tout sujet d’espérer.
Chap. II. De la Cause.
Mais que les Dogmatiques ne nous attaquent pas comme si nous blasphémions, dans l’embarras où ils se trouveraient de répondre réellement & directement à nos difficultés, nous disputerons plus en général de la cause efficiente ou active en tâchant auparavant de nous représenter ce que c’est que la Cause. Je dis donc, qu'à considérer ce que les Dogmatiques disent sur ce sujet, Personne ne saurait se former dans l’esprit une juste idée de la cause: parce qu'outre les notions discordantes & absurdes qu'ils en donnent, les controverses & les disputes qu'ils ont entre eux sur ce sujet, nous réduisent à ne pouvoir pas concevoir quelle est la nature de ce que l'on appelle Cause. Les uns disent que la cause est quelque chose de corporel, & les autres qu'elle est incorporelle. Cependant on peut juger que, suivant l'opinion la plus commune, la cause est une chose telle, qu'en conséquence de son opération, l'effet suit & est fait. Par exemple, le soleil, ou la chaleur du soleil est la cause à la cire d'être liquéfiée, ou bien elle est la cause de la liquéfaction de la cire. Car ils disputent entre eux là dessus: les uns disant que la cause est la cause des noms ou des appellations comme de la liquéfaction ; & les autres qu'elle est la cause des choses attribuées, ou des catégorèmes (comme ils parlent) comme d'être liquéfié. En fuyant donc l'opinion la plus commune & celle qui est adoptée par la plus grande partie des Dogmatiques, la cause est ce en vertu de l'opération duquel l'effet arrive, ou est produit. Or entre ces causes, quelques Philosophes (qui sont en plus grand nombre que les autres) disent que les unes sont contenantes ou contiennent avec elles leur effet, les autres font des causes conjointes, & les autres font des causes aidantes.
Ils disent que les causes contenantes sont celles qui font présentes avec leur effet, qui étant ôtées, l'effet est ôté, & qui étant, diminuées, l'effet diminue. C’est ainsi qu'ils disent que l’application d'une corde à nœud coulant est la cause de l'étranglement.
Ils disent que la cause alliée ou conjointe, est celle qui avec une autre cause, contribue avec une égale efficace, à la production de l'effet. C’est ainsi qu'ils disent qu'un chacun des bœufs qui traînent une chaîne, est la cause du mouvement de la charrue,
Enfin ils ajoutent que la cause aidante est celle qui ne fournit que de petites forces, & qui ne contribue qu'à ce que l’effet suive facilement, comme lorsque deux hommes portent avec peine un fardeau, un troisième survenant, les soulage, en le portant avec eux.
Quelques-uns ont dit que quelques choses présentes sont des causes d'effets à venir ; comme une violente chaleur pour avoir été exposé au soleil, est la cause de la fièvre. Mais d'autres n'ont pas voulu admettre ces dernières causes: parce que la cause étant du nombre des choses qui sont relatives à quelle chose, c'est-à-dire, étant relative à son effet, ne peut pas le précéder, entant que cause. Pour nous, incertains sur toutes ces choses, voici ce que nous disons.
Chap. III. S'il y a quelque Cause de quelque chose.
Il est probable qu'il y a quelque cause. Car comment y aurait-il dans le monde de l’augmentation & de la diminution, de la génération & de la corruption ? Comment y aurait-il, généralement parlant, du mouvement? D'où viendraient tous les effets de la nature & ceux qui viennent de l’esprit. D'où viendrait le gouvernement de tout le monde & toutes les autres choses, sinon de quelque Cause?
Quand même il n’y aurait rien de tout cela qui fût véritablement & tel de sa nature, nous devons dire néanmoins qu'il y a quelque cause qui fait que ces choses là nous paraissent telles, qu'elles ne sont pas.
De plus. S'il n'y avait pas quelque cause, toutes choses viendraient tumultuairement & au hasard, de toutes choses. Les chevaux naîtraient des fourmis. A Thèbes en Egypte il y aurait de grosses pluies & des neiges: & les pays méridionaux qui sont sujets à ces orages, n'y seraient plus sujets; s'il n'y avait quelque Cause qui fait que le froid est violent dans les parties méridionales, & que les parties orientales sont arides & brûlantes.
Enfin, si quelqu’un prétend qu'il n'y a point de Cause, il ne peut se soutenir quelque parti qu'il prenne. Car s'il avoue qu'il dit cela tout simplement & sans Cause, on ne le croira pas: & s'il dit qu'il y a quelque cause pour quoi il dit cela, en voulant renverser l'existence de la Cause, il l'établit : puisqu'il apporte une Cause pour laquelle il n'y a point de Cause. Voilà les raisons pour lesquelles il est probable qu'il y a quelque Cause.
Cependant il sera aisé de voir qu'un homme qui nie qu'il y ait quelque Cause de quoi que ce soit, ne dit rien qui ne soit vraisemblable, quand nous aurons rapporté quelques raisons entre plusieurs, pour prouver cela. Premièrement donc il est impossible de s'imaginer une cause, avant que d'avoir connu son effet, en tant que son effet. Car nous ne pouvons pas connaître qu'une chose est la Cause d'un effet, que lorsque nous connaissons l'effet, en tant qu'il est l'effet de cette cause. Et nous ne pouvons pas non plus connaître l'effet d'une Cause, en tant qu'effet de cette Cause, si nous ne connaissons la Cause de cet effet, en tant qu'elle en est la Cause. Car nous ne pouvons pas penser que nous connaissions que c’est là l'effet de cette Cause, à moins que nous n'ayons compris ou connu cette Cause, en tant que Cause de cet effet. Si donc, pour nous imaginer ce que c’est que la Cause, il faut avoir connu l'effet auparavant; & si, afin que nous connaissions l'effet, il faut (comme je l'ai dit,) avoir connu auparavant la Cause : ce Diallèle, ce moyen de doute, nous fait voir que ces deux choses là sont telles que nous ne pouvons pas nous les imaginer, puisqu'il ne nous est pas possible de nous former une idée de la Cause en tant que Cause, ni de l'effet entant qu'effet. Et l'un ayant besoin d'être prouvé & connu par l'autre réciproquement, nous ne pouvons pas savoir lequel des deux nous devons nous imaginer le premier. D'où il suit que nous ne saurions dire certainement que quelque chose soit la Cause de quelque autre.
Mais quand quelqu’un accorderait que l’on peut se former quelque idée de la Cause, néanmoins eu égard aux controverses des Philosophes sur ce sujet, on doit dire qu'il est impossible de, savoir si la Cause existe. Car celui qui dit qu'il y a une Cause de quelque chose, avouera en même temps ou qu'il dit cela tout simplement, & sans y être mu par aucune Cause probable, ou qu'il est de ce sentiment pour quelques Causes. S'il le dit tout simplement, il ne méritera pas qu'on le croie pas plus que celui qui dirait tout simplement qu'il n'y a point de Cause de qui que ce soit. Que s'il produit quelques raisons pour lesquelles il croit que quelque chose est Cause de quelque autre chose, il entreprendra de prouver ce qui est en question par une chose qui est également en question. Car pendant qu'il est question de savoir s'il y a quelque Cause de quelque chose, il dira, (comme s'il y avait certainement une Cause) qu'il y a une Cause pour laquelle il y a une Cause. De plus comme il est question entre nous de l'existence de la Cause, il faudra aussi qu'il produise une Cause de la Cause, dont il se sera servi pour prouver qu'il y a une Cause ; & ensuite une cause de cette seconde Cause, & ainsi à l'infini. Or il est impossible de fournir une infinité de Causes. Donc il est impossible de prononcer avec certitude que quelque chose est la cause de quelque chose.
Ajoutons encore ceci. Ou la Cause produit son effet lorsqu'elle est Cause, ou elle le produit lorsqu'elle n’est pas Cause. Ce n'est pas lorsqu'elle n’est pas Cause. Que si c’est lorsqu'elle est Cause, il faut qu'elle ait eu l’existence auparavant en qualité de Cause, & qu'elle ait été auparavant Cause, & qu'ensuite elle produise l'effet que l'on dit être fait & produit par elle lorsqu'elle est Cause. Mais comme la Cause est du nombre de ces choses qui ont relation à quelque chose savoir à l’effet, il est évident qu'elle ne peut exister entant que Cause avant son effet. Donc la Cause non pas même lorsqu'elle est Cause, ne peut point produire l'effet dont on dit qu'elle est Cause. Or si la Cause, ni lorsqu'elle n’est pas Cause, ni lorsqu'elle l’est, ne fait & ne produit rien, il s'ensuit qu'elle ne fait rien du tout, & que par conséquent il n'y a point de Cause. Car on ne peut pas concevoir dans son esprit une Cause en tant que Cause, à moins qu'elle ne produise quelque effet. Ce qui fait que quelques-uns disent qu'il faut ou que la Cause coexiste avec son effet, ou qu'elle existe devant, ou qu'elle existe après.
Mais maintenant si nous disons que la Cause existe (en tant que Cause) après la production de son effet, j'appréhende que cela ne soit trop ridicule. Elle ne peut pas aussi exister avant son effet puisque l’on dit qu'on la conçoit en même temps avec lui, (Comme le relatif se conçoit avec son corrélatif) car les Dogmatiques disent eux mêmes que les relatifs, en tant que relatifs, coexistent & s’aperçoivent ensemble les uns avec les autres par l'entendement. Et enfin elle ne peut pas coexister non plus avec son effet. Car comme elle est effective ou efficiente, & comme ce qui est fait, doit être fait par quelque autre chose déjà existante, il est nécessaire que la Cause soit auparavant Cause, & qu'alors elle fasse son effet. Donc si la Cause n'existe ni avec son effet, ni devant, ni après, peut-elle avoir quelque existence en aucune manière?
Il est évident encore (si je ne me trompe) que l'idée de la Cause est entièrement renversée par ces mêmes raisons que nous avons dites, en prenant la chose ainsi: Si nous ne pouvons pas nous former une idée de la Cause, avant celle de son effet, parce que la Cause est relative à son effet ; & si néanmoins, afin que nous la connaissions comme Cause de cet effet, il est nécessaire que nous nous l'imaginions avant son effet, il est impossible que nous concevions une idée de la Cause, ni de l’effet, parce qu'il est impossible de s'imaginer quoi que ce soit avant une chose avant laquelle nous ne pouvons nous imaginer quoi que ce soit.[1]
Nous concluons donc encore de ce raisonnement, qu'à la vérité les raisons par lesquelles nous avons prouvé qu'on doit reconnaître quelque Cause, sont probables; mais que celles-là le sont aussi, qui prouvent qu'on ne doit point décider que quoi que ce soit, soit une Cause.
Or nous ne pouvons pas préférer quelques-unes de ces raisons aux autres ; parce que nous n'avons ni signe, ni règle de jugement, ni démonstration qui puissent nous autoriser dans cette préférence, comme nous l'avons enseigné ci-dessus. Il est donc nécessaire que nous nous abstenions de décider pour ou contre l'existence de la Cause, & que nous convenions qu'il n’est pas plus vrai de dire qu'elle existe, que de dire quelle n'existe pas eu égard au moins aux raisons des Dogmatiques.
Chap. IV. Des Principes Matériels.
En voilà assez pour le présent sur la Cause efficiente. Il faut dire maintenant quelque chose des Principes que l'on appelle matériels. Or je dis d'abord qu'eu égard aux disputes des Dogmatiques sur ce sujet, il est aisé de voir que ces Principes là sont incompréhensibles, & qu'on ne peut point savoir ce que c'est.
Férécides de l'île de Siro a dit, que la terre était le Principe de toutes choses. Thalès de Milet, que c'était l'eau. Anaximandre son disciple, que c'était l'infini. Anaximène & Diogène d'Apollonie, que c'était l'air. Hippasus de Métapont, que c'était le feu. Xénophane de Colophon, que c'était la terre & l'eau. Oenopide de Chio, que c'était le feu & l'air. Hippon de Rhége, que c'était le feu & l'eau. Onomacritus dans ses vers d'Orphée, que c'était le feu, l'eau & la terre. Empédocle & les Stoïciens que c'était le feu, l'air, l'eau & la terre. (Car qu'est-il besoin de faire mention d'une certaine matière destituée de toutes qualités & monstrueuse que quelques-uns[2] imaginent, & dont ils avouent eux mêmes, qu'ils ne la conçoivent pas ?) Ceux qui suivent Aristote le Péripatéticien, disent, que ces Principes sont le feu, l'air, l'eau, la terre & un corps qui tourne[3] en rond. Démocrite, & Epicure disent que ce sont des Atomes. Anaxagore de Clazomène dit que ce font des Homoéoméries. Diodore surnommé Cronus, que ce font des corps très petits, & qui n'ont point de parties. Héraclide du Pont, & Asclépiade de Bithynie, que ce sont des molécules[4] informes. Ceux qui suivent Pythagore, que ce sont des nombres. Les Mathématiciens, que ce font les extrémités des corps. Straton le Physicien, que ce font les qualités.
Maintenant donc la discorde des Philosophes sur les Principes matériels étant telle que je viens de dire & encore plus grande, ou bien nous embrasserons tous ces systèmes différents que nous avons importés, & d'autres encore, ou bien nous acquiescerons seulement à quelques uns. Les embrasser tous, cela n’est pas possible. Car nous ne pourrons pas être en même temps de l’avis d'Asclépiade, qui dit que les éléments sont fragiles, & qu'ils ont une certaine qualité; & de celui de Démocrite qui dit que ces éléments sont indivisibles & sans aucune qualité & de celui d'Anaxagore[5] qui attribue, toutes les qualités sensibles à ses Homoéoméries. Que si nous préférons quelqu’un de ces systèmes aux autres, ou nous le préférerons simplement & sans démonstration, ou nous le préférerons avec démonstration. Sans démonstration, nous n'y acquiescerons pas. Mais si nous apportons une démonstration, il faut quelle soit vraie. Or on n’accordera pas qu'elle soit vraie, à moins qu'elle n'ait été jugée telle par une règle de Jugement qui soit vraie ; & il faudra montrer que la règle de jugement est vraie par une démonstration jugée vraie. Donc si pour faire voir la vérité de la démonstration qui préfère quelque opinion discordante des autres, il faut que la règle de jugement par laquelle on en juge soit démontrée ; & si pour démontrer la règle de jugement il faut que la démonstration de cette règle aie été jugée, il se trouvera que l’on tombera dans le moyen du Dialléle, qui arrêtera tout court la preuve parce que la démonstration a toujours besoin d’une règle de jugement démontrée, & la règle de jugement d’une démonstration jugée telle.
Que si quelqu’un veut toujours juger de la règle de jugement par une autre règle de jugement, & démontrer la démonstration par une autre démonstration, il sera réduit au progrès à l'infini.
Si donc nous ne pouvons acquiescer ni à toutes les opinions discordantes touchant les éléments, ni à quelqu’une d'elles nous devons nous abstenir d'acquiescer à quelque sentiment que ce soit touchant ces éléments.
Ces choses pourraient être plus que suffisantes pour faire voir l’incompréhensibilité des éléments & des Principes matériels ; néanmoins pour réfuter les Dogmatiques plus amplement, nous nous arrêterons avec une juste mesure sur le sujet : et parce que les opinions sur les éléments sont en grand nombre, & presque infinies (Comme nous l’avons fait voir), nous n’entreprendrons pas de disputer contrer chacune en particulier, à cause de la brièveté que nous nous sommes proposée dans cet ouvrage ; mais nous les réfuterons néanmoins toutes assez par ce que nous dirons. Car comme quelque opinion qu'une Personne voudra choisir dans toutes les Sectes, se réduira à reconnaître des Principes corporels ou des Principes incorporels, nous croyons qu'il suffit de faire voir & que les corps, & que les choses incorporelles sont choses incompréhensibles. Car par là il sera évident que les éléments font aussi incompréhensibles.
Chap. V. Si on peut concevoir ce que c’est que les Corps.
Quelques-uns disent que le Corps est ce qui peut être agent & patient. Mais eu égard à cette notion, le Corps est incompréhensible. Car la cause ne se peut concevoir (comme nous l'avons enseigné:) Or comme nous ne pouvons pas dire si quelque chose est une cause, nous ne pouvons pas dire non plus s'il y a quelque chose qui soit le sujet passif de l’action d'une cause ou de quelque chose ; parce que ce qui est le patient doit souffrir, ou recevoir l'action d'une cause. Puis donc que la cause est incompréhensible & que la chose patiente est incompréhensible aussi, il s'ensuit que le Corps sera incompréhensible.
Quelques-uns disent que le Corps est ce qui a trois dimensions, avec la force de résister. Car ils disent que le point est ce qui n'a aucune partie; que la ligne est une longueur sans largeur ; & la surface une longueur avec une largeur; & que quand cette surface a reçu la profondeur avec la force de résister, c’est là le Corps (dont nous parlons maintenant, lequel consiste en longueur, largeur & profondeur & en vertu de résister. Mais il est facile de réfuter aussi ceux qui parlent ainsi. Car ou ils diront que le Corps n’est rien outre ces choses là, ou ils diront qu'il est encore quelque autre chose, outre le concours de ces choses. De manière que hors la longueur, la largeur, & la profondeur, & la vertu de résister, le Corps ne serait rien.
Mais si ces choses sont le Corps, & que l'on fasse voir qu'elles n'existent point, on ôtera par même moyen le Corps. Car ôter toutes les parties d'un tout, le tout est ôté. On pourrait s'y prendre de diverses manières pour renverser ces choses, mais nous nous contenterons maintenant de dire que, s'il y a des extrémités du Corps, ou elles sont des lignes, ou des surfaces ou des Corps. Si on dit qu’il y a quelque surface ou quelque ligne, ou bien on dira que chacune des choses susdites existent séparément, ou bien qu'on les voit seulement autour de ce que l’on appelle des Corps. Mais je ne crois pas qu'une Personne de bon sens, puisse rêver jusqu'à dire, ou qu'une ligne, ou qu'une surface existe par elle mène. Que si on dit qu’on les voit seulement dans les Corps, & que chacune de ces choses n'existe pas par elle-même ; premièrement on accordera par là, que les Corps n'en sont point composés ni faits ; car il aurait fallu, je pense, que ces choses là eussent premièrement existé, & qu'ensuite s'étant réunies, elles eussent composé des Corps. Outre cela elles ne subsistent pas même dans ce qu'on appelle des Corps : ce que nous nous contenterons de prouver en proposant quelques difficultés que l’on peut faire sur le contact ; (quoiqu'on pût prouver la même chose en plusieurs autres manières.
Si les Corps qui font joints ensemble, se touchent mutuellement, ils se touchent mutuellement par leurs extrémités, c’est-à-dire par leurs surfaces. Donc les surfaces ne s'uniront pas totalement l’une à l'autre par ce Contact[6] ; autrement ce fera une confusion que ce contact, & la séparation de deux Corps qui se touchent fera un déchirement ; ce qui ne se voit pas. Mais si une surface touche, par de certaines parties, la surface d'un Corps qui y est joint, & si elle est unie par d'autres parties toutes différentes au Corps dont elle est l’extrémité certainement Personne ne saurait apercevoir, non pas même dans le Corps, une longueur ou une largeur qui n’ait point de profondeur, ni par conséquent une surface.
Tout de même, si on joint (par supposition) deux surfaces l'une à l’autre par leurs extrémités, suivant ce que l'on appelle leur longueur, c’est-à-dire, suivant des lignes; ces lignes, par lesquelles on dit que ces surfaces se touchent l’une l'autre, ne s'uniront point l'une à l'autre, car, elles se confondraient. Or si chacune de ces lignes touche, par de certaines parties appartenant à la largeur, la ligne qui lui est contigüe; & si par d'autres parles elle est unie avec la surface dont elle est une extrémité, elle ne sera plus destituée de largeur[7] ainsi il n'y aura point de ligne. Mais s'il n'y a dans le Corps ni ligne, ni surface, il n'y aura aussi dans le Corps ni longueur, ni largeur, ni profondeur.
Que si quelqu’un dit que ces extrémités sont des Corps, la réponse sera facile. Car si la longueur est un Corps il faudra y distinguer trois dimensions, dont chacune étant Corps, chacune aura encore trois dimensions qui feront encore des Corps, qui auront aussi trois dimensions & ainsi toujours à l'infini. De manière qu'un Corps sera d'une grandeur infinie, étant divisé en une infinité de Corps : ce qui étant absurde, il s'ensuit que ces distinctions en longueur, largeur & profondeur, ne sont pas des Corps. Mais si elles ne sont ni des Corps, ni des lignes, ni des surfaces, on peut croire qu'elles se font rien du tout.
On ne peut pas concevoir non plus ce que c'est que la vertu de résister: car si on peut la concevoir, ce fera par le contact. Si donc nous faisons voir que le contact est inconcevable, il sera évident que l’on ne peut pas concevoir la vertu de résister. Or voici comme nous raisonnons pour prouver que le contact est inconcevable.
Les choses qui se touchent mutuellement ou se touchent les unes les autres par quelques parties, ou par toute leur substance. Par toute leur substance, cela ne se peut, car, si cela était, elles feraient unies & confondues[8] ensemble, & on ne pourrait pas dire qu'elles se toucheraient seulement. Mais je dis que les parties ne sont point touchées non plus par les parties. Car les parties de ces choses, sont bien à la vérité parties, par rapport aux tous dont elles sont les parties, mais en même temps elles sont des tous par rapport à leurs propres parties à elles, & ainsi ce sont des tous qui sont parties d'autres tous. Mais les tous qui ne toucheront pas des tous par toute leur substance, (selon ce qui a été dit) ne toucheront pas non plus des parties par leurs parties ; parce que les parties des tous étant des tous elles mêmes, par rapport à leurs propres parties, elles ne se toucheront pas par toute leur substance & selon leur totalité, & elles ne se toucheront pas non plus par le contact des parties par les parties.[9]
Que si nous ne concevons pas que le contact se fasse par toute la substance, ni par les parties, le contact sera une chose inconcevable ; & ensuite la vertu de résister dans le Corps, & le Corps lui même feront aussi inconcevables, Car si le Corps n’est rien autre chose que ces trois dimensions, avec la force de résister, & s'il est vrai que nous ayons fait voir que chacune de ces choses est incompréhensible, le Corps sera aussi inconcevable. Ainsi eu égard à la définition du Corps, on ne peut pas savoir si le Corps existe.
II faut encore ajouter ceci à ce que nous avons proposé. On dit qu'entre les choses qui existent, les unes sont sensibles, & les autres intellectuelles; que celles là s'aperçoivent par les Sens & celles ci par l'entendement & que les Sens sont des facultés purement & simplement passives, mais que l'entendement parvient de la perception ou de la connaissance des choses sensibles à la connaissance des choses intellectuelles. Si donc le Corps est quelque chose, ou il est sensible, ou il est intellectuel. Or il n’est pas sensible, car il paraît qu'on le connaît par l’assemblage de la longueur, de la profondeur, de la largeur, de la vertu de résister, de la couleur, & de quelques autres choses, avec lesquelles il est vu ou aperçu : mais les Philosophes disent que les Sens sont des facultés simplement passives.[10] Que si on dit que le Corps est une chose intellectuelle, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose dans là nature, par où on puisse parvenir à la connaissance des Corps intellectuels. Or il n'y a que ce qui est Corps, & que ce qui est incorporel ; & de ces deux choses, l'incorporel est à la vérité intellectuel par lui-même:[11] mais le Corps n’est pas une chose sensible, comme nous l'avons déjà fait voir : donc comme il n'y a rien de sensible dans la nature, d'où on puisse parvenir à la connaissance du Corps, le Corps n’est point une chose intellectuelle. Mais s'il n’est ni sensible ni intellectuel, & si, outre le sensible & l’intellectuel, il n'y a rien; il faut dire, en suivant ce raisonnement, qu'il n’est pas même vrai que le Corps existe. Voilà les raisons pour lesquelles, en opposant ces arguments qui détruisent le Corps, à ce qu'il paraît à nos Sens qu'il y a des Corps, nous concluons que nous devons ne rien nier ou affirmer dogmatiquement touchant le Corps.
Au reste, de l’incompréhensibilité du Corps, suit l’incompréhensibilité de ce qui est incorporel. Car les privations sont conçues comme des privations d'habitudes, telles que sont l'aveuglement à l'égard de la vue, la surdité à l'égard de l'ouïe, & ainsi des autres. Ainsi afin que nous connaissions la privation, il faut que nous concevions auparavant l'habitude, dont cette privation est dite être la privation. Car si une Personne ne conçoit pas ce que c’est que la vue, elle ne peut pas dire que celui-là ou celui ci est privé de la vue, c'est-à-dire qu'il est aveugle. Si donc l'incorporel est la privation du Corps, & s'il est impossible de concevoir les privations des habitudes, à moins que l'on ne conçoive ces habitudes; il est évident que comme nous avons montré que le Corps est inconcevable, l'incorporel, qui est la privation du Corps, sera aussi inconcevable. Car ou l'incorporel peut être aperçu par les Sens, ou il peut être aperçu par l'entendement. Mais soit qu'il puisse être aperçu par les Sens, on ne peut pas le concevoir, à cause de la différence des Animaux, des hommes, des Sens & des circonstances, & à cause des mélanges & des autres choses que nous avons rapportées, en traitant des dix moyens de l'Epoque. Soit qu'on puisse apercevoir l’incorporel par l'entendement, il n’est pas néanmoins encore concevable. Car comme ce n’est pas une chose accordée, que les Sens conçoivent les choses par eux mêmes, & que néanmoins il semble que ce n’est que par la perception des Sens que nous parvenons à la connaissance des choses intellectuelles, on n'accordera pas non plus que l’esprit puisse connaître par lui-même les choses intellectuelles, ni par conséquent les incorporelles.
Certainement, quiconque dit qu'il conçoit l'incorporel, doit faire voir qu'il le conçoit ou par les Sens, ou par la raison. Ce ne peut être par les Sens. Car il paraît que les Sens aperçoivent par une impression & par quelque chose qui les pique on qui les frappe ; comme la vue, (soit qu'elle se fasse par une émission d'un cône des rayons de l'œil, soit par des écoulements & des influences d'images, envoyées des objets, (soit par des écoulements des rayons & des couleurs:) & comme l’ouïe (soit que l'air frappé ou des émissions de la voix, se portent aux oreilles, & frappent l'air subtil qui dans l'oreille sert à l'ouïe, de manière que ces choses soient cause de la perception de la voix.) C’est de la même manière que les odeurs se portent aux narines, & les saveurs à la langue, & que les choses qui émeuvent l’attouchement, frappent ce Sens. Mais les choses incorporelles ne sont pas capables de causer une telle impression; & ainsi elles ne peuvent être aperçues par les Sens.
Elles ne peuvent pas être non plus aperçues par la Raison. Car si la Raison est un dit, & est incorporelle,[12] (comme disent les Stoïciens) celui qui dit que les choses incorporelles se conçoivent par la raison, usurpe comme preuve, ce qui est en question : car lorsqu'il est question de savoir si on peut concevoir quelque chose d'incorporel, lui, supposant simplement & sans preuve quelque chose d'incorporel, il veut prouver par ce prétendu incorporel, non prouvé & non conçu, que l'on peut concevoir tes choses incorporelles. Or la raison elle-même, (si elle est incorporelle) est du nombre des choses dont il est question. Comment donc qui que ce soit pourra-t-il faire voir, que cet incorporel usurpé, savoir, la Raison, est connue avant l'autre incorporel auquel il la veut faire servir de preuve? S'il prouve cela par quelque autre incorporel, nous demanderons encore une démonstration qui prouve que l'on conçoit cet incorporel: & cela jusqu'à l'infini. Que s'il veut le prouver par quelque chose de corporel, c’est aussi une question de savoir si on peut concevoir le Corps. Par quoi donc démontrerons-nous que l'on conçoit le Corps, que l'on prend pour démontrer la compréhensibilité de la raison qui est incorporelle? Si nous disons, par le Corps, nous sommes réduits au progrès à l'infini : & si nous disons que c'est par quelque chose d'incorporel, nous tombons dans se moyen du Dialléle. Ainsi la Raison démentant l’inconcevable, & étant incorporelle, on ne peut pas dire que l’on puisse concevoir par son moyen une chose incorporelle.
Mais si la raison est corporelle, comme on dispute savoir si on connaît, ou si on ne connaît pas les Corps, à cause de leur écoulement & de leur changement continuel, comme disent les Philosophes, en sorte qu'ils ne sont pas démontrables, & que quelques Philosophes nient leur existence: (d’où vient que Platon appelle les Corps des Êtres qui naissent toujours, & qui n'existent jamais;) je ne sais pas comment on peut décider la controverse du Corps ; n'y ayant pas d'apparence qu'elle puisse être jugée ni par quelque chose de corporel, ni par quelque chose d'incorporel, à cause des raisons de douter qui ont été dites un peu auparavant. D'où il s'ensuit que l'on ne peut pas connaître les Corps, même par la raison. Mais si les Corps ni ne tombent point sous les Sens, ni ne sont point connus par la raison, il suit qu'ils ne peuvent être connus ou conçus en aucune manière.
Maintenant si l'on ne peut rien affirmer ni sur l’existence des Corps, ni sur les choses incorporelles, il faut aussi s'abstenir de rien affirmer touchant les éléments, & peut-être aussi touchant les choses qui sont au delà des éléments ; parce qu'entre ces choses là, les unes font corporelles & les autres sont incorporelles, & que l’on a proposé des raisons de douter, touchant les unes & les autres. Cependant, comme on doit s'empêcher de rien décider touchant les principes efficients, & touchant les matériels, pour les raisons que l’on a vues, la question des principes demeure toujours douteuse.
Chap. VI. Du mélange des Choses.
Que l’on laisse là, si l’on veut, ce que nous avons dit sur les Principes; comment est-ce que les Dogmatiques peuvent dire qu'il se fait des choses composées des premiers éléments, s'il ne se fait ni attouchement ou contact, ni mélange ou mixtion en aucune manière. Car j'ai prouvé un peu auparavant, que le contact n’est rien, lors que je disputais sur l'existence du corps. Maintenant je proposerai en peu de mots quelques considérations qui font voir que la manière du mélange, (si l’on s’arrête à ce que les Dogmatiques en disent) n’est pas même possible. Car on dit bien des choses sur le mélange, & ce ferait un travail presque immense de rapporter toutes les différences de sentiments qui se trouvent chez les Dogmatiques sur cette matière. Ce qui fait que tout d'abord, à ne considérer que cette controverse, où il est impossible de juger de quel côté est la vérité, on peut conclure que cette question est incompréhensible.
Pour nous, comme nous ne voulons pas maintenant les réfuter chacun en particulier, à cause de la loi que nous nous sommes prescrite d'être courts dans cet ouvrage, nous croyons que ce que nous allons dire pourra être suffisant.
On dit que les choses qui sont mêlées ou composées ensemble, consistent en substance, & en qualités. ainsi on dira ou que les substances se mêlent, & non pas les qualités : ou les qualités & non pas les substances: ou, ni les substances ni les qualités, ou les unes et les autres. Mais si ni les substances ni les qualités ne sont mêlées ensemble, nous ne pourrons pas concevoir ce que c’est que le mélange. Car comment pourra-t-on apercevoir les mixtes, par quelqu’un des Sens, si les mixtes, comme on les appelle, ne sont contempérés où mêlés en aucune des manières précédentes.
Si on dit que les qualités sont simplement adjacentes les unes proches des autres, & que les substances sont mêlées, cela paraît absurde. Car nous n'apercevons pas que les qualités qui sont dans les mixtes soient séparées, & nous sentons au contraire qu’il ne s'en est faite, pour ainsi dire, qu'une de leur mélange.
Si quelqu’un prétend que les qualités se mêlent, & non pas les substances, il dira là des choses insoutenables. Car les qualités ne subsistent que dans les substances. C’est pourquoi ce serait aussi une chose ridicule de dire que les qualités séparées de leurs substances, se mêlent ensemble, & que les substances destituées de leurs qualités demeurent à part sans se mêler. Il ne reste donc plus que de dire que les qualités & les substances des choses mêlées, se pénètrent réciproquement, & sont ce que l’on appelle le mixte en se mêlant ainsi. Mais cela est encore plus absurde que ce qui a été dit ci-dessus des mélanges; & une pareille mixtion est impossible. Si, par exemple, sur dix cotyles[13] d'eau on mêle une cotyle de suc de ciguë, on dit que la ciguë est mêlée avec toute l'eau. Car si quelqu’un prend la moindre partie de cette mixtion, il trouvera qu'elle est remplie de la vertu de la ciguë. Or si la ciguë se mêle avec chaque partie de l'eau, & si par la compénétration des substances & des qualités, elle est coétendue toute entière avec toute l'eau, afin que la mixtion se fasse ainsi : comme les choses qui sont coétendues les unes avec les autres, par toutes leurs parties réciproquement, occupent chacune un lieu égal à l'autre, & sont ainsi égales entre elles, il arrivera qu'une cotyle de ciguë sera égale à dix cotyles d'eau ; de manière qu'il faudra que toute la mixtion soit de vingt cotyles, ou de deux seulement, suivant la supposition de cette manière de mixtion : & derechef si on jette une cotyle d'eau sur vingt cotyles, il faut que ce mélange fasse la mesure de quarante cotyles, ou bien seulement la mesure de deux. Et la raison de cela est que nous pouvons nous imaginer qu'une cotyle en est dix, parce qu'elle est autant étendue que dix cotyles, & que dix cotyles n'en font qu'une, parce qu'elles lui font également coétendues.
De plus, si on ajoute toujours une cotyle, on pourra conclure de la même manière que ces vingt cotyles que l'on voit, devront faire vingt mille cotyles & plus, (selon cette manière de mixtion,) & qu'elles n'en devront faire aussi que deux : chose la plus absurde que l’on puisse dire. D'où il s'ensuit que cette manière de mixtion que l'on suppose ici, est tout à fait absurde.
Maintenant, si le mixte ne peut se faire, ni par le mélange des substances seules entre elles, ni par celui des qualités seules ni par celui des substances & des qualités ensemble, ni par celui d'une substance seule avec les qualités seules d'une autre; & si, outre ces choses, on ne peut concevoir, aucune manière de mélanges il s'ensuit que l'on ne peut pas concevoir ni connaître la manière en laquelle se fait un composé, ni en général celle en laquelle se fait quelque mixtion que ce soit.
Si donc ces choses que l’on appelle les éléments, ne peuvent faire des corps composés, ni en s'unissant par le contact, ni en se mêlant & en se compénétrant les unes avec les autres ; il est évident que tous les raisonnements des Dogmatiques sur la nature, sont des choses que l’on ne peut point connaître, si on veut raisonner juste, en suivant leurs propres principes.
Chap. VII. Du Mouvement.
Outre ce que nous avons dit contre les éléments, on peut remarquer encore par les difficultés que l'on fait sur les Mouvements, que la Philosophie naturelle des Dogmatiques doit passer pour impossible. Car il faut absolument que les corps composés soient faits par quelque Mouvement des éléments & du principe effectif. Si donc nous faisons voir qu'il n'y a aucune espèce de Mouvement, dont on puisse être certain, il sera évident, qu'encore que l'on accordât tout ce que nous avons réfuté ci-dessus, c’est en vain néanmoins que les Dogmatiques veulent expliquer, ce qu'ils appellent la partie naturelle de la Philosophie.
Chap. VIII. Du Mouvement d'un lieu à un autre.
Ceux qui paraissent avoir discouru d'une manière plus complète touchant le Mouvement, en distinguent six espèces. Le Mouvement local: le changement naturel ou l'altération: l'augmentation : la diminution: la génération : la corruption. Nous examinerons chacune de ces espèces de Mouvement en particulier, en commençant par le Mouvement local.
Ce Mouvement est, selon les Dogmatiques, celui par lequel, ce qui se meut, passé, ou tout entier ou selon quelque partie, d'un lieu dans un autre. Tout entier, comme dans ceux qui marchent; ou selon quelque partie, comme une sphère qui se meut sur son centre, car la sphère demeurant toute entière dans une même place, ses parties changent leurs places,
Au reste il y a eu, si je ne me trompe trois opinions principales & plus communes sur le Mouvement. Bias & quelques autres Philosophes croient qu'il y a du Mouvement : mais Parménide & Mélissus & quelques autres le nient: & les Sceptiques prétendent qu'il n’est pas plus vrai de dire qu'il y en a, que de dire qu'il n'y en a pas ; que selon les apparences il semble qu'il y a du Mouvement, mais qu'il n'y en a pas quand on veut examiner les raisons des Philosophes.
Pour nous, nous exposerons premièrement les disputes de ceux qui croient qu'il y a du Mouvement, & de ceux qui affirment que le Mouvement n’est rien; après quoi, si nous trouvons que les raisons de leur discordance sont d'un poids égal de part & d'autre, nous serons obligés de dire, qu'eu égard aux raisonnements des Dogmatiques, il n'est pas plus vrai de dire qu'il y a du Mouvement, que de dire qu'il n'y en a point. Nous commencerons par ceux qui disent qu'il y a du Mouvement.
Ces Philosophes s'appuient principalement sur l'évidence de la chose. Si (disent-ils) il n’y a point de Mouvement, comment le Soleil se transporte-t-il d'Orient en Occident, & comment, fait-il les différentes saisons de l'année, qui arrivent selon qu'il est plus proche, où plus loin de nous? Ou comment des vaisseaux partant d'un port, abordent-ils à un autre port, qui est fort éloigné du premier? Comment est-ce que celui qui nie le Mouvement, sort-il de chez lui & y revient-il? Ils disent qu'on ne peut pas réfuter ces raisons là C’est pourquoi un Philosophe Cynique à qui on avait proposé un argument contre le Mouvement, ne répondit rien, mais se levant de sa place, il commença à se promener, montrant par son action & par effet, qu'il y avait du Mouvement Voilà de quelle manière ces Philosophes, qui croient le Mouvement, tâchent d'imposer silence à ceux qui sont d'un sentiment contraire.
Mais ceux qui nient l'existence du Mouvement se servent de ces raisonnements. Si quelque chose se meut, ou elle se meut d'elle même, ou elle est mue par quelque autre: si c’est par quelque autre, ce que l'on dit être mu par une autre chose, ou sera mu sans aucune cause, ou sera mu par quelque cause. Mais on dit que rien ne se fait sans cause: si donc il est mu par quelque cause, la cause par laquelle il est mu, sera sa cause motrice;[14] ce qui conduit dans le progrès à l'infini, comme nous avons fait voir en disputant sur la cause. Autrement, ce qui meut agit, & ce qui agit est mu : donc ce qui meut aura besoin d’un autre moteur, & le second moteur aura besoin d'un troisième & ainsi: jusqu'à l'infini, de manière que le Mouvement sera sans commencement; ce qui est absurde. Donc ce qui est mu n'est pas mu par un autre.
Mais il n’est pas mu non plus par lui-même. Car comme tout ce qui meut, meut ou en poussant en devant, ou en tirant, ou en poussant en haut, ou en comprimant par en bas; il faudra que ce qui se pousse soi-même, se meuve en quelqu’une de ces manières. Mais s'il se meut en poussant en devant, il sera derrière soi-même; s'il se meut en tirant par derrière, il sera avant soi-même; si, en poussant en haut, il sera au-dessous de soi; & si c’est en comprimant de haut en bas, il sera au dessus de soi. Or il est impossible qu'une chose soit au dessus d'elle-même, ou devant, ou au-dessous, ou derrière. Donc il est impossible que quelque chose soit mue par elle même. Mais si: rien n'est mu ni par soi-même ni par une autre chose, il s'ensuit que rien ne se meut, que rien n'est mu.
Que si quelqu’un a recours à l’impulsion de l’âme, & à la détermination libre de la volonté, il doit être averti qu'il y a une controverse parce que l'on dit être en notre pouvoir, & que cette dispute là ne saurait être décidée parce que nous n'avons pas encore trouvé une règle de vérité.
Il faut encore dire ceci. Si quelque chose se meut, ou elle se meut dans le lieu où elle est, ou dans celui où elle n’est pas. Ce n’est pas là où elle est, car elle y demeure en repos,[15] si elle y est. Ce n'en pas non plus là où elle n’est pas : car là où une chose n’est pas, elle ne peut ni y agir, ni y pâtir. Donc rien ne se meut. Voilà le raisonnement de Diodore surnommé Cronus ou Saturne. On en a donné plusieurs solutions dont nous nous contenterons de rapporter celles qui sont les plus fortes; pour ne pas passer les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet ouvrage; y ajoutant le jugement, que nous croyons que l’on doit faire de cet argument.
Il y en a donc quelques-uns qui disent que quelque chose peut se mouvoir dans le lieu où elle est; & que, preuve de cela, les sphères qui tournent sur leur centre, se meuvent en demeurant dans le même lieu.
Pour leur répondre, il n’y a qu'à appliquer ce que nous avons dit, (après Diodore,) à chacune des parties de la sphère, & ainsi faire voir que suivant cette prétendue solution, les parties mêmes ne sont pas mues, (car l’argument de Diodore garde toute sa force à l’égard de ces parties:) d'où on conclura que rien ne se meut y non pas même dans le lieu où il est,
Nous ferons la même chose contre ceux qui disent que ce qui est mu, est dans deux lieux savoir & dans celui où il est & dans celui où il va. Car nous leur demanderons quand c’est, que ce qui est mu se transporte du lieu où il est, dans un autre : si c’est quand il est dans le lieu où il est, ou si c’est quand il est dans le lieu où il va. Mais quand il est dans le premier de ces lieux, il ne va pas dans le second; car il est encore dans le premier, & quand il n’est pas dans ce premier lieu, il n'en sort pas pour aller dans un autre. Ajoutez qu'ici on prend comme preuve, ce qui est en question. Car ce que l’on suppose être en mouvements ne peut pas agir là où il n’est pas, & on n'accordera pas sans démonstration qu'il ait une tendance pour quelque lieu, quand on n'accordera pas qu'il soit mu.
Il y a des Personnes qui raisonnent ainsi. Le lieu se prend en deux manières; l'une en une signification étendue, comme ma maison est mon lieu : l'autre en une signification plus resserrée & plus exacte, comme, par exemple, l'air qui m'enveloppe en me touchant dans toute la superficie de mon corps. On dit donc que ce qui est mu, se meut dans un lieu, non pas dans un lieu pris en ce sens étroit & exact, mais dans un lieu pris dans l'autre sens plus ample & plus étendu.
Nous pouvons répondre, en subdivisant ce lieu pris en un sens large, que le corps qui est dit être mu, est dans un endroit de ce lieu, comme dans un lieu pris en un sens exact & étroit, & qu'il n’est pas dans un autre endroit, comme il n’est pas dans toutes les autres parties de ce lieu pris en un sens large: & ensuite nous conclurons que puisque rien ne peut être mu ni dans le lieu où il est ni dans celui où il n’est pas, rien aussi ne peut être mu dans le lieu pris ainsi abusivement en un sens large. Car ce lieu pris en un sens large consiste en deux lieux, savoir en celui où le corps mu est exactement, & en celui où il n’est pas exactement ; & nous avons démontré qu'il ne peut être mu, ni dans l'un ni dans l’autre de ces deux lieux.
Mais on peut proposer encore cet argument Si quoi que ce soit se meut, il se meut ou par une application de sa première partie à une première partie de l'espace; ou en parcourant un espace divisible tout ensemble, en même temps & sans succession. Or quoi que ce soit ne peut are mu ni par une application de sa première partie à une première partie de l'espace ni en parcourant tout un espace divisible, tout à la fois & sans succession, comme nous le ferons voir. Donc rien n’est mu.
Il est évident que rien ne peut être mu par une application de sa première partie à la première partie de l'espace, & ainsi successivement. Car si les corps sont divisibles à l’infini, aussi bien que les lieux & les temps pendant lesquels on dit que les corps font mus, il n’y aura point de Mouvement; parce qu'il est impossible que dans des infinis on puisse trouver quelque chose de premier, qui soit le commencement du Mouvement, de ce que l'on dit être mu.
Que si les choses susdites ne font pas divisibles à l'infini, si; elles se réduisent à des points indivisibles, et si toutes les choses qui se meuvent, parcourent chacune une première partie indivisible du lieu, en une première partie indivisible du temps, toutes les choses qui se meuvent ont toutes une égale vitesse, comme le cheval le plus prompt à la course & une tortue : ce qui est encore plus absurde que ce qui précède. Donc le Mouvement ne se fait point successivement & ne commence point de la première manière que nous avons dite.
Mais il ne se fait point non plus tout entier dans tout un espace divisible, & sans succession. Car si les apparences doivent rendre témoignage des choses obscures, (à ce que l’on dit;) comme il est nécessaire que pour faire le chemin d'une stade, on en fasse auparavant la première partie, & ensuite la seconde, & les autres de même; il faut donc que tout ce qui se meut, se meuve par quelque chose de premier & suivant une certaine succession.
Si on dit que ce qui est mu, traverse l’espace tout entier en même temps, tout à la fois, et sans succession, il s'ensuivra que toutes les parties du lieu, où on dit qu'il est mu, seront dans toutes les parties ensemble de ce corps mu : & si une partie de ce lieu dans lequel il est mu, est froide, & une autre chaude ; si (par supposition) une partie est noire, & l'autre blanche, en sorte que chacune puisse donner sa couleur à ce qui s'y rencontre, ce qui est mu, sera en même temps chaud & froid, noir & blanc ce qui est absurde. Mais ensuite qu'on nous dise combien, quelle partie de l'espace ce qui se meut, parcourt ainsi tout à la fois & sans succession? Si on dit que cette partie est indéfinie, on accordera par là que quelque chose peut être mue tour à la fois & sans succession par toute la terre. Que si on veut éviter cette absurdité, que l'on nous définisse la grandeur de l'espace divisible qui est ainsi parcouru tout entier sans succession.
Mais de vouloir définir exactement un lieu divisible tel que ce qui est mu sans succession, ne puisse pas parcourir un espace plus grand, ne fût-il plus grand, que de la moindre partie qui se puisse imaginer; outre que cela n’est que hasard, que cela est téméraire & peut-être aussi ridicule; on retombe toujours par là dans la difficulté précédente. Or tous les corps mus auront une vitesse égale, parce qu'ils auront tous également les passages de leurs mouvements par des lieux déterminés.
Que si on prétend que ce qui est mu, parcourt sans succession un espace qui est petit à la vérité, mais qui n’est pas exactement déterminé, nous supposerons nous même, une grandeur de cet espace, & alors par le Sorite nous pourrons y ajouter toujours une très petite quantité d'espace. Car si ceux contre lesquels nous disputerons, s'arrêtent & se fixent à quelque grandeur déterminée, que nous leur aurons proposée par le Sorite, ils retomberont dans la détermination d'un lieu divisible parcouru sans succession, ce qui n'est qu'une fiction monstrueuse. Et s'ils accordent toutes les additions du Sorite, nous les réduirons à la nécessité d'avouer, qu'une chose se peut parcourir toute la grandeur de la terre toute ensemble & sans succession. Donc les choses que l'on dit être mues, ne parcourent pas tout à la fois & sans succession, un espace divisible.
Or si rien n’est mu ni en parcourant un lieu divisible pris tout ensemble & non par parties, ni en commençant à être mu par quelque chose de premier, il n'y a absolument rien qui se meuve. Voilà ce que disent, entre plusieurs autres choses, ceux qui nient le Mouvement local ou passager. Pour nous, comme nous ne pouvons pas réfuter ces raisons là, non plus que l'évidence apparente, qui fait, que d'autres disent qu'il y a du Mouvement, voyant que l'évidence & les raisons ne s'accordent point, nous ne voulons pas décider s'il y a ou s'il n'y a point de Mouvement.
Chap. IX. De l'Augmentation & de la Diminution.
Cette même raison nous empêche de juger aussi s'il y a ou s'il n'y a pas de l'Augmentation & de la Diminution. Car l’évidence de la chose semble prouver l’existence de l'une & de l'autre, & les raisons semblent la détruire, comme on peut le voir par ceci.
Il faut que ce qui est augmenté, soit augmenté en grandeur, & quant à l'Être & quant à la substance: (Car si quelqu’un voyant que l’une est augmenté, dit que l'autre est augmentée aussi, il ne dira pas vrai.) Or comme la substance n’est jamais dans un état stable ; comme elle est dans un flux & reflux continuel, &que l’une vient à la place de l'autre pour former un composé, il s’ensuit que ce que l’on dit être augmenté, n'a point sa première substance, ni une substance ajoutée avec cette première, mais une substance toute autre.[16] C’est comme si quelqu’un apportait (par exemple) une pièce de bois de six coudées, à la place d'une pièce de trois coudées, qui était auparavant, & qu'il dît qu'il a augmenté la pièce de trois coudées, il ne peut pas dire cela sans mentir : (parce que cette pièce de bois là, est toute autre que celle-ci.) Tout de même aussi, dans tout ce que l'on dit être augmenté, une première matière s'écoulant, & une autre entrant en sa place successivement, si ce que l'on dit être ajouté, l’est effectivement, on ne saurait dire que ce soit là une Augmentation, & il faut dire plutôt que c’est un changement total.
On peut dire la même chose de la Diminution. Car comment peut-on dire que ce qui ne subsiste en aucune manière, ait été diminué. De plus, s'il se fait quelque Diminution, c’est par un retranchement, & s'il se fait quelque Augmentation, c’est par une addition : or ni la soustraction, ni l'addition ne sont rien : donc ni la Diminution ni l'Augmentation ne sont rien aussi.
Chap. X. Du Retranchement & de l’Addition.
Voici un raisonnement par lequel on veut prouver que la soustraction ou le Retranchement n’est rien. Il ne se peut faire de Retranchement qu'en ôtant ou l'égal ; ou le plus grand du plus petit; ou le plus petit du plus grand. Or il ne se fait point de Retranchement en aucune de ces manières, comme nous le prouverons. Donc il ne se peut point faire de Retranchement.
La preuve qu'il ne se fait point de Retranchement en aucune de ces manières est celle-ci. Il faut que ce qui est retranché de quelque chose, y soit contenu auparavant le Retranchement. Mais l'égal n’est pas contenu dans l'égal, comme six ne sont pas contenus dans six. Car il faut que ce qui contient, soit plus grand que ce qui est contenu : & il faut que ce dont on ôte quelque chose, soit plus grand que ce qui est ôté, afin qu'il reste quelque chose après la soustraction. Car il semble que c’est là la différence qu'il y a entre soustraire ou retrancher & entre ôter entièrement le tout.)
Le plus grand n’est pas contenu non plus dans le plus petit, comme six ne font pas contenus dans cinq; (car cela est absurde).
Par la même raison le plus petit n’est pas contenu dans le plus grand: car si cinq sont contenus dans six, comme le plus petit nombre dans le plus grand, aussi quatre seront contenus dans cinq, & trois dans quatre, & deux dans trois, & un dans deux, & ainsi il arrivera que cinq, quatre, trois, deux, un, seront contenus dans six, lesquels étant ajoutés ensemble, font quinze. D'où on conclut que ce nombre est contenu dans six, si on accorde que le plus petit est contenu dans le plus grand.
Tout de même on trouvera que trente cinq sont contenus dans quinze[17] qui sont contenus dans six ; & en continuant ainsi le calcul on trouvera des nombres infinis dans six. Or de dire que des nombres infinis soient contenus dans six, cela est absurde. Donc il y a aussi de l'absurdité à dire que le plus petit soit contenu dans le plus grand.
Si donc il faut que ce qui est ôté de quelque chose, soit contenu dans cette chose dont on le retranche, & si ni l'égal n’est contenu dans l'égal ni le plus grand dans le plus petit, ni le plus petit dans le plus grand : certainement rien n’est retranché de rien.
De plus. Si quelque chose est retranchée de quelque chose, il faut que l'on retranche, ou le tout de la partie, ou la partie de la partie, ou le tout de la partie, ou la partie du tout. Dire que l'on ôte le tout du tout, ou de la partie, cela répugne à la raison. Ce qui étant ainsi, il reste que l'on dise que l’on retranche la partie du tout, ou de la partie; ce qui est absurde. En voici la preuve.
Pour ne point quitter les nombres, qui rendront la chose plus claire, supposons, (par exemple) que nous avons le nombre dix, & que l'on en retranche une unité : cette unité ne peut être retranchée, ni de tout le nombre dix, ni de la partie restante du nombre dix, ou (pour le dire plus clairement) du nombre neuf. Donc elle n’est point ôtée : car si l'unité est ôtée de tout le nombre dix, comme le nombre dix n’est autre chose que dix unités, & comme il n’est pas une de ces unités, mais l'assemblage de toutes ces unités; il faut ôter l’unité, de chaque unité pour la pouvoir ôter de tout le nombre dix. Premièrement donc rien ne peut être ôté de l'unité; car les unités sont indivisibles, & ainsi de cette manière on n'ôtera pas l’unité du nombre dix.[18]
Mais quand quelqu’un accorderait que de chaque unité, on peut en ôter une unité, dans le nombre dix, cette unité ôtée aura dix parties : & l'unité sera composée de dix parties. Maintenant comme il reste dix autres parties, desquelles on a ôté dix unités que l’on appelle une unité, ces unités restantes avec celles qui sont ôtées seront vingt.[19] Or il est absurde qu'un soit dix, & que dix soient vingt, & que ce qui est indivisible, (selon les Dogmatiques eux-mêmes) soit divisé. Il est donc absurde de dire que l’on ôte une unité du nombre dix.
On ne peut pas non plus ôter une unité du nombre neuf qui reste. Car ce dont on ôte quelque chose, ne demeure pas entier: mais le nombre neuf, après le Retranchement de cette unité, demeure entier.[20] Outre cela, le nombre neuf n'étant autre chose que neuf unités, si on dit que l’on ôte une unité de ce nombre tout entier, on ôtera tout le nombre;[21] si on dit que l'on ôte une unité des huit unités restantes, qui font l'autre partie de neuf, les mêmes absurdités suivront ; & si on dit que l’on ôte l'unité de la dernière unité, il faudra dire, que l'unité est divisible, ce qui est absurde. Donc on n’ôtera pas non plus une unité de neuf.
Or si une unité n’est ôtée, ni de dix, ni de quelque partie de dix, on ne peut donc retrancher la partie, ni du tout, ni d'une partie.
Concluons donc & disons que si ni le tout n’est retranché du tout, ni la partie du tout, ni le tout de la partie, ni la partie de la partie; il s’ensuit que rien ne peut être retranché de rien.
L'Addition est encore une de ces choses que les Sceptiques croient impossibles. Car ce qui est ajouté (disent-ils) ou est ajouté à soi-même, ou à un sujet préexistant, ou à une chose composée de ce qui est ajouté & d'un sujet préexistant. Or rien de tout cela n’est vrai. Donc rien n’est ajouté à rien. Soit (par exemple) une quantité de quatre cotyles, & que l'on y ajoute une cotyle. Je demande à laquelle de ces quatre elle est ajoutée. Ce n’est pas à elle même, cela ne se peut; (car ce qui est ajouté est autre chose, que ce à quoi il est ajouté; mais rien n’est autre chose que foi même). Cette cotyle n’est pas ajoutée non plus à ce qui est composé des quatre cotyles & de celle qui est ajoutée. Car peut-elle être ajoutée à un composé qui n’est pas encore? De plus si la cotyle qui est ajoutée, est ajoutée à quatre cotyles & à une cotyle, cela fera une quantité de six cotyles, savoir de quatre cotyles & d’une cotyle, choses auxquelles on ajoute, & d'une cotyle ajoutée.
Que si une cotyle est ajoutée à toutes les quatre cotyles seules; comme ce qui est autant étendu qu'une autre chose, est également étendu, il est évident que si une cotyle est également étendue avec quatre cotyles, elle doublera la quantité des quatre cotyles; tellement que le tout fera huit cotyles: ce qui ne se voit pas.
Donc si ce que l’on dit être ajouté, n’est ajouté ni à soi-même, ni à un sujet préexistant, ni à ce qui est composé de ces deux; choses; & si cette énumération est entière, certainement rien n’est ajouté à rien.
Chap. XI. De la Transposition.
La Transposition se trouve renfermée[22] & proscrite avec l'existence de l'addition & de la soustraction, & du mouvement local; (laquelle existence nous avons détruite,) cette Transposition étant une espèce de changement, qui par un mouvement passager ôte une chose d'une autre, & l'ajoute à une autre.
Chap. XII. Du Tout & de la Partie.
Le Tout & la Partie se trouvent aussi renversés, dès là que l’on nie l'addition, & le retranchement. Car il paraît que le Tout se fait par un concours par une addition des Parties : & que le Tout cesse par le retranchement d'une ou de quelques choses. Mais outre cela s'il y à quelque Tout, ou il est autre chose que ses Parties, ou ses Parties elles-mêmes sont le Tout. Or il ne paraît pas que le Tout soit autre chose que ses Parties ; (car si on ôte les Parties, il ne reste rien, qui nous puisse faire croire que quelque autre chose que les Parties, soit le Tout.) Que si les Parties elles-mêmes sont le Tout, le Tout ne sera qu’un nom, & qu'une dénomination vaine, & il n'aura aucune existence propre. Comme la distance n’est autre chose que les choses distantes entre elles, & comme un charpente n’est autre chose que des pièces de bois qui sont jointes ensemble : ainsi un Tout ne sera rien absolument.
Mail je dis que les Parties ne seront rien, aussi. Car si elles font Parties, ou elles sont parties du Tout, ou elles sont Partie les unes des autres, ou chacune est Partie d'elle-même. Elles ne sont pas Parties du Tout, parce que le Tout n’est rien autre chose que les Parties, & ainsi elles seraient Parties d'elles-mêmes: ce qui n’est pas par la raison que chacune des Parties passe pour être nécessaire à la perfection du Tout.
Elles ne sont pas non plus Parties les unes des autres, parce que la Partie paraît être contenue dans ce dont elle est Partie, & qu'il est absurde de dire que (par exemple) la main soit contenue dans le pied.
Enfin chaque Partie n’est pas Partie d’elle-même. Car de cette manière elle se contiendrait elle même, & elle serait & plus grande & plus petite qu'elle même.
Donc si les Parties, comme on les appelle, ne sont Parties, ni du Tout, ni d’elles-mêmes, ni les unes des autres, elles ne sont Parties de rien: & si elles ne sont Parties de rien, elles ne sont pas même des Parties; parce que les choses qui font relatives[23] à quelque autre chose se détruisent mutuellement. Ce que nous avons dit dans ce chapitre, doit être considéré comme une digression ; & d'ailleurs nous avons déjà fait mention du Tout & de la Partie dans un autre endroit.
Chap. XIII. Du Changement naturel.
Il y a des Personnes qui n'avouent pas que ce que l'on appelle Changement naturel, existe : & voici comme ils prouvent leur pensée. Si quelque chose est changée, elle est ou corporelle ou incorporelle. Mais on doute parmi les Philosophes s'il arrive du changement à l'une & à l'autre de ces choses. Ainsi ce que l'on dit du Changement naturel, sera de même révoqué en doute. Ensuite si quelque chose souffre du Changement, elle le souffre par l'effet d'une cause, & elle est: un sujet passif. Or on renverse par des arguments, l'existence de la cause avec laquelle le patient est détruit aussi, n'ayant rien dont il reçoive l'action. Donc rien ne change.
De plus. Si quelque chose est changée, ou ce qui existe est changé, ou ce qui n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas n'a point de subsistance & ne peut, être ni agent ni patient. Donc il ne peut être le sujet passif de quelque Changement. Que si c’est ce qui existe qui est change; ou il est changé en tant qu'il est un Être, ou en tant qu'il n’est pas un Être. Mais, entant qu'il n’est pas un Être, il n’est pas changé, car il n'existe pas, s'il est un non-être: & s'il est changé en tant qu'il est un Être, il deviendra autre chose qu'un Être qu'il est, c’est-à-dire, qu'il deviendra un non-être. Que si ni l'Être n’est change, ni le non-Être non plus, & qu'outre ces deux choses il n'y ait rien, il faut dire que rien n’est changé.
Quelques autres raisonnent encore ainsi Ce qui est changé, doit être changé dans quelque temps. Mais rien n’est changé dans le temps passé, ni dans le temps futur, ni dans le temps présent, comme nous le ferons voir. Donc rien n’est changé. Rien ne souffre de Changement dans un temps passé ou futur, parce qu'aucun de ces deux temps n’est présent, & que rien ne peut être agent ou patient dans un temps qui n'existe pas. Mais rien, ne peut aussi souffrir de Changement dans le temps présent : car peut-être que le temps présent aussi n’est rien ; mais, pour laisser cette dispute maintenant, disons ceci : le temps présent est indivisible. Or il est impossible de concevoir que dans un temps indivisible, un morceau de fer (pat exemple) passe de la dureté à la mollesse, ou qu'il arrive aucune autre sorte de Changement. Car il paraît que ces Changements là ont besoin d'un temps continu. Si donc rien ne souffre de Changement ni dans le temps passé, ni dans le futur, ni dans le présent, il faut dire que rien ne souffre de Changement.
Ajoutons encore ceci. S'il y a quelque Changements et que l'on dise que ce Changement consiste dans de simples perceptions passives des Sens, il semble que cela ne suffit pas : car il paraît que pour connaître un Changement, il faut connaître ce que la chose changée était avant son Changement, & ce qu'elle devient par son Changement. Que si on dit que le Changement peut être connu par entendement, comme il y a eu parmi les Anciens des disputes que l’on ne saurait décider, touchant l’existence des choses qui peuvent être connues par l'entendement, (comme non l'avons fait voir souvent ;) nous ne pourrons rien dire de certain sur l'existence du Changement.
Chap. XIV. De la Génération et de la Corruption.
L'Addition et le Retranchement & le changement naturel étant renversés, la Génération et la Corruption tombent en même temps. Car sans ces mouvements rien ne peut ni être engendré, ni être corrompu. Par exemple, du nombre dix corrompu par le retranchement d'une unité, il arrive que le nombre neuf est engendré ; & le nombre dix est engendré du nombre neuf corrompu par l'addition d'une unité; & le vert de gris est engendré d'un cuivre corrompu par un changement. Ainsi ces mouvements étant renversés, la Génération & la Corruption sont peut-être renversées aussi.
Cependant il y en a qui raisonnent encore de cette manière. Si Socrate a été engendré, il a été engendré, ou lorsqu'il n'était pas, ou lorsqu'il était déjà. Si on dit qu'il a été engendré lorsqu'il était déjà, il a été engendré deux fois: & s'il a été engendré lorsqu'il n'était pas, Socrate était & n'était pas, & cela en même temps. Il était, puisqu’il était le sujet passif de la Génération, & il n'était pas, parce qu'on le suppose ainsi.
Tout de même. Si Socrate est mort, ou bien il est mort quand il vivait, ou bien il est mort quand il était mort. Mais lorsqu'il vivait, il n'était pas mort, (car autrement un même homme vivrait & serait mort.) Il n’est pas mort non plus lorsqu'il était mort : autrement il serait mort deux fois. Donc Socrate n’est pas mort. On peut par ce même raisonnement renverser la Génération & la Corruption, à l'égard de toutes les choses que l'on dit être engendrées ou corrompues.
Il y en a qui font cette objection. Si quelque chose est engendrée, où c’est un Être, ou c’est un non-être. Mais un non-être n’est pas engendré ; (car ce qui n’est pas, n’est susceptible d'aucun accident, ni par conséquent d'être engendré.) Et un Être n’est pas engendré non plus. Car si un Être est engendré, ou bien il est engendré en tant qu'il est un Être, ou bien en tant qu'il n’est pas un Être. Mais en tant qu'il n’est pas un Être, il n’est pas engendré. Que s'il est engendré en tant qu'il est un Être, comme ce qui est engendré, est engendré d'un autre ; ce qui est engendré d’un Être, fera autre chose qu'un Être, laquelle autre chose qu'un Être, est un non-être. Donc ce qui est engendré fera un non-être ; ce qui est contraire à la raison. Si donc, ni ce qui est, n'est point engendré, ni ce qui n’est pas, rien du tout n’est engendré
On peut dire de la même manière qu'il n'y a point de Corruption. Car si quelque chose se corrompt, ou c’est un Être qui est corrompu ou c’est un non-être. Mais un non-être n’est pas corrompu; car il faut que ce qui est corrompu soit, pour être le sujet passif de quelque chose. Ce n’est pas non plus un Être. Car s'il est corrompu, ou il est corrompu de manière qu'il demeure dans son Être, ou de manière qu'il n'y demeure pas, S'il est corrompu de manière qu'il demeure dans son Être, il fera en même temps un Être & un non-être : car comme il se corrompt non pas en tant qu'un non-être, mais en tant qu'un Être, en tant qu'il est corrompu, il sera autre chose qu'un Être, & par conséquent il ne sera pas un Être & cependant il sera un Être, parce que l'on dit qu'il se corrompt en demeurant toujours dans son Être. Or il est absurde de dire qu'une même chose soit un Être & un non-être. Donc l'Être n’est pas corrompu en demeurant dans son Être.
Que si on dit que l'Être n’est pas corrompu en demeurant dans son Être, mais qu'il est réduit premièrement au non-être, & qu'ensuite il est corrompu, alors il faudra dire que ce n’est plus un Être, mais un non-être qui est corrompu, ce que nous avons montré être impossible. Si donc ni l'Être ni le non-être ne peut être corrompu, & qu’outre ces deux choses il n’y ait rien, rien n’est corrompu.
Ce que nous avons dit jusqu'ici contre les différents mouvements, suffit pour ces courtes Institutions, & nous prouve assez que la Physique des Dogmatiques ne peut subsister, & est inconcevable à l’esprit.
Chap. XV. De l’état permanent des Êtres.
Quelques Sceptiques proposent des doutes sur l’état permanent des corps; (cette matière vient bien après celle des mouvements: & voici comme ils raisonnent. Ce qui est dans état toujours changeant, & toujours en mouvement, n’est pas dans un état permanent. Or tout corps est dans un mouvement continuel, suivant les sentiments des Dogmatiques, qui disent que le corps est une substance fluide, dont il s’exhale toujours quelque chose & à laquelle quelque chose est toujours ajoutée: (de manière que Platon a dit que les Corps ne sont point, mais qu'ils naissent, ou qu'ils se produisent & s'engendrent plutôt[24] & qu'Héraclite compare l'état changeant de notre corps au cours d'un fleuve rapide.) Donc aucun corps n’est dans un état permanent. Car ce que l’on dit être dans un état permanent, semble devoir être retenu dans son état par les corps qui l'environnent; mais ce qui est retenu est patient, or il n'y à point de tel sujet passif, parce qu'il n'y a point d'agent ou de cause, comme nous l'avons enseigné, donc rien ne persiste dans un même état.
D'autres font ce raisonnement. Ce qui est dans un état permanent ou en repos souffre, ou est le sujet passif d'une action.[25] Mais ce qui est le sujet passif d'une action est mu. Donc ce qui est dans un état permanent est mu; mais s'il est mu, il n’est pas dans un état permanent.
Ces mêmes raisonnements font voir que ce qui est incorporel, n’est pas non plus dans un état permanent : car s'il est dans un état permanent, il est le sujet passif de l’action de quelque cause; ce qui n’est propre qu'aux Corps. Or ce qui est incorporel ne peut être le sujet passif de l’action de quelque cause.[26] Donc il n'est pas dans un état permanent. Donc rien n’est dans un état permanent. Ces choses suffisent pour la dispute de l'état permanent des Êtres. Mais comme les mouvements & le reste ne sauraient être conçus, sans la connaissance du lieu & du temps, il faut passer à l’examen de l'un & de l'autre : car si on fait voir qu'il n’y a ni lieu, ni temps, il sera évident que tous ces mouvements ne sont rien. Commençons pas le lieu.
Chap. XVI. Du Lieu.
Le Lieu se prend en deux manières, ou proprement ou abusivement. Il se prend abusivement, quand on le prend dans un sens large & étendu; dans ce sens, ma ville est mon Lieu. Et il se prend dans un sens propre, quand on le prend pour celui qui contient exactement une chose, ou qui nous contient exactement. Il n’est ici question que du Lieu proprement dit, ou qui contient exactement. Quelques-uns ont dit qu'il y a un tel Lieu, d'autres l'ont nié, & d'autres n'ont rien voulu décider là dessus.
Ceux qui disent qu'il y a un Lieu, se fondent sur l'évidence de la chose. Qui est-ce, disent-ils, qui peut dire qu'il n'y a point de Lieu? Lorsqu'il voit les parties du Lieu, comme sont le droit, le gauche, le haut, le bas, le devant, le derrière, lorsqu'il est quelque fois dans un Lieu, ou dans un autre; lors qu'il voit que j'enseigne maintenant, où mon maître[27] enseignait ; & lorsqu'il conçoit que le Lieu des corps légers de leur nature est différent de celui des corps naturellement pesants; enfin lorsqu'il entend dire aux Anciens,[28] Le Chaos a été avant toutes choses. Car on dit que le Chaos est le Lieu des choses, parce qu'il comprend tout ce qui y est.
Certainement (disent-ils encore,) s'il y a quelque corps, il y a aussi un Lieu, car un corps ne peut être sans Lieu. Et s'il y a un principe efficient, & un principe matériel du corps, il faut qu'il y ait aussi quelque chose ou le corps soit, ce qui est le Lieu. Mais il y a un principe efficient & un principe matériel du corps. Donc il y a aussi un Lieu, où est le corps.
Mais ceux qui nient qu'il y ait un Lieu, n'accordent pas qu'il ait des parties,[29] & ils raisonnent ainsi. Le Lieu n’est autre chose que ses parties, & celui qui veut prouver qu'il y a un Lieu, parce qu'il suppose que ses parties existent, entreprend de prouver ce qui est en question par cela même qui est en question. Ils disent encore que c’est se moquer de dire que quelque chose soit, ou ait été dans un Lieu, lorsque l’on n'accorde en aucune manière qu'il y ait un Lieu : qu'ensuite ceux qui argumentent ainsi pour le Lieu, usurpent pour preuve l'existence du corps, de laquelle on ne convient pas : que l’on prouve que le principe efficient, & le principe matériel, n'existent pas plus que le Lieu: & qu'enfin Hésiode n’est pas un auteur digne de foi dans des matières de Philosophie.
C’est ainsi que ceux qui rejettent le Lieu; répondent aux raisons par lesquelles on prétend l’établir & prouvent en même temps qu'il n'existe point. Ils tournent à leur avantage les opinions des Dogmatiques, qui paraissent être les plus fortes & avoir le plus de poids, comme sont celles des Stoïciens & des Péripatéticiens. Voici comme ils raisonnent :
Les Stoïciens disent que le vide est ce qui peut être occupé, ou rempli par un Être, mais qui n’est pas occupé: ou bien, que c'est un espace vide de corps, ou un espace qui n’est pas occupé par un corps ; & que le Lieu est un espace occupé par un Être, lequel espace est égal à l'Être qui l'occupe. Par le mot d'Être ils entendent un corps, & par celui d’espace ou de région ils entendent un intervalle qui est en partie occupé, & en partie non occupé par le corps : quoique quelques-uns aient dit que l'espace ou la région est le Lieu d'un grand corps, de manière que l'espace ou la région, & le lieu ne sont différents l'un de l'autre que par la grandeur.
Voici donc ce que l'on leur objecte. Quand ils disent que le Lieu est un intervalle ou espace qui est occupé par le corps, comment[30] peuvent-ils dire que le Lieu est encore un espace ? Veulent-ils dire qu'il est égal à la longueur du corps qui y est contenu, ou à la largeur, ou à la profondeur, ou à ces trois dimensions là ? S'ils disent que le Lieu n'a qu'une de ces dimensions, il n’est donc pas égal à ce dont il est le Lieu, outre que ce Lieu contenant, n'ayant qu'une dimension, il sera une partie dé ce qu'il contient; ce qui est tout à fait contraire à l'évidence,
Que si ce Lieu a trois dimensions, comme il n'y a point de vide dans ce Lieu, ni aucun autre corps, auxquels on puisse attribuer ces dimensions; & que le corps que l'on dit être dans ce Lieu, n’est pas composé de ces dimensions là, mais des siennes, (car ce corps est longueur, largeur, & profondeur, & puissance de résister, qui est ajoutée à ces dimensions:) il s'ensuivra, que ce Lieu est chimérique, que le corps lui même sera son Lieu, & qu'il sera en même temps le contenant & le contenu; ce qui est absurde. Donc ce Lieu supposé n'a point de dimensions, & par conséquent le Lieu n’est rien.
Voici un autre raisonnement. On ne voit pas trois dimensions à double dans aucune des choses que l’on dit être dans un Lieu, mais seulement une longueur, une largeur, & une profondeur. Ces dimensions appartiennent-elles au corps seul, ou au Lieu seul, ou au corps & au Lieu tout ensemble ? Si elles appartiennent au Lieu seul, le corps n'aura ni longueur, ni largeur, ni profondeur qui lui soient propres, & ainsi le corps ne sera pas corps, ce qui est absurde. Si ces dimensions appartiennent & au Lieu & au corps tout ensemble; comme le vide n'a rien autre chose par son essence, que ces trois dimensions, & que ces trois dimensions du vide, sont aussi celles du corps, (puisqu'on suppose qu'elles appartiennent & au Lieu & au corps:) il s'ensuivra que le corps consistera dans les mêmes choses que le vide. Car l'égard de la puissance de résister, on ne peut rien assurer de certain touchant son existence, comme nous l'avons enseigné auparavant. Or comme les dimensions ne se voient que dans ce que l'on appelle corps, dimensions qui appartiennent au vide, & qui sont communes au vide, le corps sera du vide ; ce qui est absurde;
Que si enfin ces dimensions appartiennent au corps seul, le Lieu n'aura aucunes dimensions, & par conséquent il ne sera pas même Lieu. Donc si en aucune des manières précédentes on ne trouve point que le Lieu ait des dimensions, il n'y a point de Lieu.
On ajoute encore cette difficulté. Quand un corps entre dans le vide, & que du vide il s'en fait un Lieu, ou le vide demeure ou il se retire, ou il se corrompt. S'il demeure, une même chose sera vide et pleine. Que s'il se retire en vidant la place & en passant ailleurs, ou s’il est corrompu par un changement, le vide sera un corps; car ce sont là des propriétés passives du corps. Or il est absurde de dire qu'une: même chose soit vide & pleine ; ou que le vide soit un corps. Donc il est pareillement absurde de dire que le vide puisse être occupé par un corps r & devienne un Lieu.
Ces raisons là font voir aussi qu’il n’y a point de vide, puisqu'il ne peut être occupé par un corps, pour devenir un Lieu ; contre ce que les Stoïciens disent, que ce vide est ce qui peut être occupé par un corps. L’existence de l’espace tombe encore avec le Lieu & le vide. Car si on dit que l’espace ou la région des lieux & des choses, est un Lieu grand & spacieux, il périt avec le Lieu : & si on dit que l’espace est ce qui est en partie occupé par le corps, & qui en partie a des dimensions vides, il périt avec le Lieu & avec le vide. Voilà ce que l’on dit entre plusieurs autres choses contre l’opinion des Stoïciens, qui est différente de celle des autres touchant le Lieu.
Mais les Péripatéticiens disent que le Lieu n’est autre chose que les extrémités du corps contenant, en tant que contenant : tellement que mon Lieu est une surface d’air, laquelle se forme autour de mon corps. Mais si c'est là le Lieu, une même chose sera & ne sera pas. Car lorsqu'un corps doit être dans un Lieu, comme rien ne peut être dans ce qui n'existe pas, il faut que le Lieu existe premièrement, afin que le corps y soit placé: (& ainsi le Lieu sera, avant que le corps, qui est dit être dans un Lieu, y soit placé.) Mais comme d'un autre côté, le Lieu est fait par la surface du corps contenant, laquelle se forme autour du corps contenu; le Lieu ne peut exister avant que le corps y soit & ainsi alors le Lieu n'existera pas avant le corps placé. Or il est absurde de dire qu'une chose soit & ne soit pas. Donc le Lieu n’est pas l'extrémité du corps contenant, en tant que contenant.
De plus. Si le Lieu est quelque chose; ou il est fait, ou il n’est pas fait. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas fait, car il est fait, (à ce que disent les Péripatéticiens,) quand il se forme autour du corps qui y est compris. Mais il n’est pas fait non plus: car s'il est fait, ou bien il est fait lorsque le corps est déjà dans le Lieu où on dit qu'il est, ou bien il est fait lorsque le corps n’est pas dans le Lieu. Or il ne se fait pas lorsque le corps est déjà dans le Lieu; (car il y a déjà un lieu dans lequel le corps est placé:) & il ne se fait pas non plus lorsque le corps n'est pas dans un Lieu ; car, (à ce que disent les Péripatéticiens) ce qui contient se forme autour de ce qui est contenu, & par ce moyen le Lieu se fait;: mais une chose ne peut pas se former & se disposer autour d'une chose qui n’est pas au dedans d'elle: donc si le Lieu ne se fait point, ni lorsque le corps est dans un Lieu, ni lorsqu'il n'y est pas, & qu'outre cela on ne puisse concevoir autre chose, le Lieu n’est point fait ou produit. Mais s'il n’est ni fait, ni non fait, il n'est pas.
Mais voici des objections plus générales, que l’on peut faire encore. Si le Lieu est quelque chose, ou il est corporel, ou il est incorporel. Or on doute de l'existence de ces deux choses. Donc aussi on doute du Lieu.
Le Lieu ne peut être connu qu'avec le corps, dont il est le Lieu. Mais ce que l’on débite de l'existence du corps, est tout douteux. Donc aussi ce que l’on dit du Lieu.
Le Lieu de chaque chose n’est pas éternel. Mais si on dit qu'il se fait, ou qu'il s'engendre, on ne peut pas être certain qu'il existe; parce que la génération n'existe pas.
On pourrait faire plusieurs autres difficultés ; mais pour éviter la longueur, nous ajouterons, que d'un côté les raisons, & d'un autre l'évidence de la chose, imposent silence aux Sceptiques, qui sont des Philosophes modérés & peu hardis. C’est pourquoi nous n'embrassons aucun parti, par rapport aux sentiments des Dogmatiques, & nous nous abstenons de rien déterminer touchant le Lieu.
Chap. XVII. Du Temps.
Nous nous trouvons disposés à l’égard de la question du Temps, de même qu'à l'égard de celle du lieu. Car, si on s'en reporte aux apparences, il paraît que le Temps est quelque chose: mais quand on examine ce que l’on en dit, il ne paraît pas avoir rien de réel. Les uns disent que le Temps est une durée[31] du mouvement du Temps; (J'appelle Temps le monde :) & d'autres disent qu'il est le mouvement même du monde.[32] Aristote, ou Platon selon d'autres, dit que le mouvement est le nombre[33] de ce qui est précédent & consécutif dans le mouvement. Straton, ou, selon d'autres Aristote, dit que le Temps est la mesure du mouvement & du repos. Epicure (comme le dit Démétrius de Lacédémone), enseigne que le Temps est l'accident des accidents, c'est-à-dire, qu'il est ce qui vient à la suite[34] des jours, des nuits & des heures, des accidents & propriétés passives & non passives du mouvement & du repos. A l'égard de la substance du Temps, quelques uns ont dit qu'il est corporel, (comme Enésidémus,) & qu'il n'est point différent de l’Être & de la matière première : & les autres ont dit qu'il est incorporel. Il faudra donc dire, ou que toutes ces opinions différentes sont vraies ou qu’elles sont toutes fausses: ou que quelques-unes sont vraies, & quelques unes fausses. Mais elles ne peuvent pas être toutes vraies ; (car plusieurs de ces opinions sont opposées les unes aux autres.) D'un autre coté les Dogmatiques n'accorderont pas qu'elles soient toutes fausses. Et de plus si on accorde qu'il est faux que le Temps soit corporel, & qu'il est faux aussi qu'il soit incorporel, on accordera par même moyen, que le Temps n'existe pas. Car outre le corporel et l'incorpore, il n'y a rien. Enfin, de savoir quelles sont celles qui sont vraies & quelles sont celles qui font fausses, cela n’est pas possible; soit à cause des raisons également fortes que l’on propose pour soutenir ces différents sentiments, soit parce que nous n'avons pas de règle indubitable de jugement, ni de démonstration certaine. Voilà donc les raisons qui font que nous ne pouvons rien assurer touchant le Temps. Ensuite, comme on prétend que le Temps ne peut subsister, si l’on ôte le mouvement & repos; il s’ensuit que quand nous avons renversé ces choses, nous avons par cela même renversé le Temps.
Cependant voici ce que quelques-uns objectent contre le Temps. Si le Temps existe, ou il est fini, ou il est infini: s'il est fini, il a commencé depuis quelque Temps, & il finira à quelque Temps: & par conséquent il y avait un Temps, lorsqu'il n'y avait point de Temps, & lorsqu'il n'avait pas encore commencé: & il pourra y avoir quelque jour un Temps, lorsqu'il n'y aura plus de Temps, c'est-à-dire lorsqu'il aura cessé d'être. Donc le Temps n’est pas fini.
Que si le Temps est infini, comme le Temps est ou passé, ou présent, ou futur, on demandera si le futur & le passé existent, ou s’ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, il ne restera que le présent, qui est le Temps le plus court que l'on puisse s'imaginer; d'où il s'ensuivra que le Temps est fini: ainsi voilà les mêmes difficultés qu'auparavant. Que si le passé existe, le futur existe aussi, donc l'un & l'autre est présent : or il est absurde de dire que le passé & que le futur est présent : donc le Temps n’est pas infini. Mais si le Temps n’est ni fini ni infini, il n’est rien en aucune manière.
Voici un autre argument. Si le Temps existe, ou il est divisible, ou il est indivisible. Mais il n’est pas indivisible; (car on le divise en présent, passé & futur, comme le disent les Dogmatiques eux-mêmes,) Il n’est pas non plus divisible, car tout ce qui est divisible, est mesuré par quelque partie de soi-même, la chose mesurante parcourant chacune des parties de la chose mesurée, comme lorsque nous mesurons une coudée avec un pouce. Mais le Temps ne peut pas être mesuré par quelqu’une de ses parties: car, par exemple, si le présent mesure le passé, il sera dans le passé, & par conséquent il sera passé; ce qu'il faut dire aussi du futur, si le présent mesure le futur. Et si le futur mesure les autres Temps, il sera présent & passé; & de même si c’est le passé qui mesure les autres, il sera présent & futur ; ce qui est contraire à la raison. Donc le Temps n’est pas divisible. Or s'il n’est ni indivisible, ni divisible, il n’est point du tout.
De plus. On dit que le Temps se divise en trois; l'un est passé, l'autre présent, et l'autre futur. De ces trois parties, le passé & le futur n'existent pas: (car si le Temps passé & le futur existent maintenant, l'un & l'autre est présent.) Or je dis que le présent n'existe pas non plus. Car si le Temps présent existe, ou il est indivisible, ou il est divisible. Mais il n’est pas indivisible; & voici comme je le prouve. On dit que les choses qui souffrent quelque changement, sont changées dans le Temps présent. Or rien n’est changé dans un Temps indivisible; (car le fer ne passe pas de la dureté à la mollesse dans un Temps indivisible, & il faut dire la même chose des autres changements.) Donc le Temps présent n’est pas indivisible. Mais il n’est pas divisible non plus. Car jamais il ne se peut faire que l’on le divise en des Temps présents, parce qu'à cause de la fluidité rapide des choses qui sont dans le monde, il se change en Temps passé, (à ce que l’on dit) d'une manière qui n’est pas concevable. Il ne se peut pas faire non plus que le présent soit divisé en Temps futur, & en Temps passé ; car de cette manière, le présent serait nul, parce qu'il aurait une de ses parties qui n’existerait plus, & une autre qui n'existerait pas encore. D'où on peut conclure que le présent ne peut pas être la fin du Temps passé & le commencement du Temps futur ; car de cette manière il serait, & il ne serait pas : il serait, parce qu'on le suppose présent, & il ne serait pas, parce que ses parties n'existeraient pas. Donc le présent n’est pas divisible. Que si le Temps présent n’est ni indivisible, ni divisible, il n'y a point de Temps présent. Or s'il n’y a ni Temps présent, ni passé, ni futur, il n'y a point de Temps : car ce qui consiste en ce qui n'existe point, n’est point existant.
On se sert encore de ce raisonnement contre le Temps. Si le Temps existe, ou il est engendré & corruptible, ou il n’est point engendré & il est incorruptible. Or il n'est pas vrai qu'il ne soit pas engendré, ou fait, & qu'il soit incorruptible; puisque l'on dit que selon quelque partie il est passé, & n'est plus, & que selon quelque partie, il est futur, & n’est pas encore. Mais il n’est pas vrai non plus qu'il soit fait & qu'il soit corruptible. Car les choses qui font faites doivent être faites de quelque Être réel; & celles qui se corrompent, doivent être changées en quelque Être réel aussi, selon les suppositions des Dogmatiques eux mêmes. Si donc il se change par manière de corruption, en Temps passé, il se change en un non-être; & s'il se fait du Temps futur, il est fait d'un non-être: car ni le passé ni le futur n'existent point. Or il est absurde de dire, que quelque chose soit faite d'un non-être, & se change en un non-être. Donc le Temps n’est pas fait & n’est pas corruptible. Mais s'il n’est ni non fait & incorruptible, ni fait & corruptible, il n'existe point du tout.
De plus. Tout ce qui est fait, paraît être fait, dans un Temps : donc le Temps est fait, il est fait dans un Temps. Il faut donc dire ou qu'un Temps est fait dans lui-même, ou qu'un Temps est fait dans un autre. Mais s'il est fait dans lui même, il sera & ne sera pas. Il ne sera pas, parce que, comme ce dans quoi quelque chose est faite, doit exister avant ce qui est fait dans cette chose ; il s’ensuit que le Temps qui est fait dans soi-même n'existe pas encore, puisqu'il se fait: mais s'il est fait dans soi-même, il est déjà avant que d'être fait. Donc un Temps ne se fait point dans soi-même. Mais un Temps n’est pas fait non plus dans un autre Temps; car si le présent est fait dans le futur, le présent sera le futur, & s'il est fait dans le passé, il sera passé : ce qu'il faut dire des autres Temps. Donc un Temps ne se fait point dans un autre Temps. Que si un Temps n’est point fait dans lui même, ni dans un autre Temps, le Temps n’est point fait. Mais nous avons montré ci-dessus qu'il n’est pas non plus non-fait: donc n'étant ni fait ni non-fait, il n'existe nullement; puisqu'il faut que les choses qui existent quelles qu'elles soient, soient ou faites ou non-faites.
Chap. XVIII Du Nombre.
Comme on ne peut pas connaître le Temps, sans connaître aussiu le Nombre, il est à propos d'en dire aussi quelque chose. Ce n’est pas qu'en suivant la coutume, nous ne disions (sans néanmoins établir aucun Dogme,) que nous nombrons quelque chose, & que nous ne voulions bien entendre dire que le Nombre est quelque chose ; mais c’est que la curiosité des Dogmatiques nous engage à entreprendre contre eux cette dispute.
Car premièrement les Pythagoriciens disent que les principes ou les éléments du monde sont des Nombres. Ils prétendent que les choses qui paraissent aux Sens, en sont composées : & que les éléments doivent être simples, & qu'ainsi ils ne font pas évidents aux Sens. Ils ajoutent qu'entre les choses obscures, les unes sont corporelles, comme les vapeurs & les molécules ; & les autres incorporelles, comme les formes, les idées, & les Nombres: que les corps sont composés qu'ils consistent en longueur, largeur & profondeur & en vertu de résister, ou aussi en pesanteur ; que les éléments sont non seulement obscurs, mais encore incorporels : que si on considère les choses incorporelles, chacune a quelque Nombre; que chacune est ou un, ou deux, ou un plus grand Nombre. D'où ils concluent, que les éléments de toutes choses sont des Nombres obscurs & incorporels, lesquels Nombres on peut remarquer en toutes choses : que ce ne sont pas simplement les Nombres, qui sont les éléments des choses, mas que c’est aussi l'Unité, & le Deux indéfini,[35] qui se fait par l'addition de l'Unité ; par la participation duquel Deux, tous les Deux particuliers deviennent des Deux : que de ces principes viennent les autres Nombres, que l’on peut observer dans les choses nombrées : que le point, par exemple, représente l'Unité ; que la ligne représente le Deux, parce que l'on conçoit qu'elle est entre deux points; que la superficie représente un Trois, comme étant le flux d'une ligne en largeur, vers quelque autre marque, située de travers :[36] & que le corps représente un Quatre, parce qu'il se fait par une surface qui s'élève vers un point posé au dessus de cette surface.
Voilà de quelle manière ils changent en vaines imaginations le corps & tout le monde: à quoi ils ajoutent que le monde est gouverné conformément à de certaines proportions harmoniques, comme, par exemple, selon la proportion harmonique nommée diatessaron qui est une proportion sesquitierce, comme celle de huit à six: ou selon le diapente, qui est une proportion sesquialtère, comme celle de neuf à six: ou selon le diapason qui est une proportion double, telle que celle de douze à six.
Ce sont là les rêveries qu'ils débitent. Ils veulent que le Nombre soit différent des choses nombrées, & voici comme ils raisonnent. Si l’animal est un en tant qu’animal, la plante n’étant pas animal, ne sera pas une: or la plante est aussi une: donc l'animal est un non pas en tant qu'animal, mais eu égard à quelque autre chose que l'on y considère, à laquelle chaque Être participe, & à cause de laquelle cet Être devient un. Outre cela si les choses nombrées sont le Nombre; comme ces choses nombrées sont des hommes, & des bœufs, (par exemple,) & des chevaux, les hommes, les bœufs & les chevaux seront un Nombre:[37] & ainsi le Nombre sera blanc, ou noir, ou barbu, s'il arrive que ceux qui sont nombrés soient tels, ce qui est absurde. Donc le Nombre n’est pas les choses nombrées; mais il a une subsistance qui lui est propre, outre celle des choses nombrées, selon laquelle il est considéré dans les choses qui sont nombrées, & en est un élément.
Quand donc on voit ces Philosophes raisonner ainsi, pour prouver que le Nombre n’est pas la même chose que les choses nombrées, cela fait naître une difficulté & un doute contre le Nombre. Si le Nombre existe, dit-on, ou bien il est les choses nombrées, ou bien il est outre cela quelque autre Être, hors de ces choses. Mais (comme les Pythagoriciens le prouvent:) il n'est pas les choses nombrées; & comme nous le prouverons, il n’est pas autre chose que les choses nombrées. Donc le Nombre n’est rien.
Pour prouver évidemment que le Nombre n’est rien au dehors ou au-delà des choses nombrées, nous nous arrêterons seulement à l'unité, afin que ce que nous avons à dire soit plus clair. Voici notre raisonnement. Si l'unité est quelque chose par elle même, de manière que chacune des choses qui y participe devienne une; ou cette unité sera une, ou elle sera autant d'unités, qu'il y a de choses qui sont participantes de l'unité. Si elle est une, je demande si chacune des choses qui y participent, participe à l'unité toute entière, ou seulement à quelque partie de l'unité ; car si un homme, par exemple, a l'unité toute entière, il n'y aura plus d'unité à laquelle un cheval ou un chien ou quelque autre chose que l'on appelle une, puisse participer : supposons qu'il y ait plusieurs hommes nus, s'il n'y a qu'un habit, & que l'un de ces hommes s'en revête, les autres demeurent nus, & sans habit. Que si chaque chose participe seulement à quelque partie de l'unité, premièrement l'unité aura quelque partie, & par conséquent elle aura une infinité de parties & elle sera divisée à l'infini, ce qui est absurde. Ensuite comme une partie du Nombre dix, par exemple deux, n’est pas dix ; ainsi une partie de l'unité ne sera pas l'unité, & par conséquent rien ne participera à l'unité. Donc l'unité, à laquelle on dit que les choses singulières participent, n'est pas une.
Que si les unités, sont égales en Nombre aux choses nombrées, dont on dit que chacune est une ; & si chaque chose, qui est dite une, est une par la participation d'une de ces unités, il y aura une infinité d'unités participées. Or, ou ces unités elles-mêmes participent à une souveraine unité, ou à des unités égales en Nombre avec elles, & à cause de cela elles sont des unités : ou bien elles ne participent à une ni à plusieurs unités, ce qui fait qu'elles sont des unités sans participation à l'unité. Mais si ces unités peuvent être unités sans participation, tout de même chaque chose sensible pourra être une sans participer à l'unité; ce qui renverse cette unité que l'on veut que nous considérions par elle même. Que si on dit que ces unités, font unités par participation; ou elles participent toutes à une seule unité, ou chacune à une unité particulière : si elles participent toutes à une seule, il faudra dire ou qu'elles participent chacune à cette seule toute entière, ou que chacune participe à une partie de cette unité : & de cette manière les mêmes absurdités que ci-dessus, restent. Que si chaque unité participe à une unité particulière, il faudra encore considérer l’unité de chacune de ces unités, & après ces unités, des autres unités, & ainsi à l’infini. Donc si pour concevoir s’il y a quelques unités abstraites, qui existent par elles-mêmes, par la participation desquelles chaque chose soit une, il faut concevoir des unités infiniment infinies que l’esprit puisse saisir: & si d'ailleurs il est impossible de concevoir des unités infinies à l’infini qui puissent tomber dans la pensée ; il est impossible d'assurer positivement qu'il y ait quelques unités abstraites, compréhensibles à l’esprit, & que chacune des choses qui sont, soit une, par la participation d'une unité particulière. Il est donc absurde aussi de dire, qu'il y a autant d'unités que de choses qui participent à ces unités. Or si l’unité, comme on l’appelle, n’est point une, par elle-même, & hors des choses; & s’il n’est pas vrai qu'il y ait autant d’unités hors des choses, qu'il y a de choses qui participent à l’unité; l'unité n'existe point par elle même & hors des choses, & de même il n'y aura aucun Nombre qui existe par soi-même & hors des choses car le raisonnement que nous avons fait contre l’unité, qui nous a servi d'exemple, peut être appliqué à tous les Nombres.
Maintenant, si le Nombre n’est rien par lui même & hors des choses, comme nous l'avons enseigné, & si aussi le Nombre n’est pas les choses nombrées, comme le font voir les Pythagoriciens, il faut dire qu'il n'y a point de Nombre.
Mais de plus, ceux qui croient que le Nombre est quelque chose au-delà & hors des choses nombrées, comment diront-ils que le Nombre deux est fait de l'unité ? Car lorsque nous mettons une unité avec une autre unité, il faut dire, ou que quelque chose est ajoutée au-dehors à ces unités, ou que quelque chose en est retranchée de même, afin qu'il en résulte le Nombre deux, ou que rien n'y est ni ajouté ni retranchée. Si rien n'y est ni ajouté ni retranché, ce ne sera pas le nombre deux; car ces unités quand elles font séparées l’une de l'autre, n'ont ni l'une ni l'autre une raison d'unité qui leur survienne de dehors, (comme nous l'ayons prouvé ;) & maintenant rien ne leur est ajouté ni retranché de dehors, (suivant la supposition présente.) Donc le Nombre deux ne sera pas une addition de l'unité avec l'unité, puisqu'il ne s’est fait ni addition ni retranchement de dehors, qui y ait introduit le Nombre deux, que l'on veut être différent des choses nombrées. Que s'il se fait un retranchement, non seulement ce ne sera pas le Nombre deux, mais encore les unités seront diminuées. Si au contraire le Nombre deux est ajouté de dehors à ces unités, afin que de ces unités il se fasse le Nombre deux, ce qui paraissait être deux, sera maintenant quatre: car on a supposé une unité, & une autre unité, auxquelles le Nombre deux étant ajouté de dehors, il en résulte le Nombre quatre. Il faudra raisonner de même à l'égard des autres Nombres, que l’on dit être faits par addition.
Puis donc que les Nombres, que l’on dit être composés des Nombres les plus simples, ne sont faits ni par retranchement ni par addition ni sans retranchement ni sans addition, il ne se pourra faire aucune production ou génération du Nombre qu'ils disent être à part, & subsister dans les choses nombrées. Cependant les Pythagoriciens prétendent que les Nombres sont produits, & enseignent qu'ils sont composés & faits des Nombres les plus simples, comme par exemple de l’unité, & du Deux indéfini (ou universel.) Donc le Nombre ne subsiste pas à part & par soi-même hors des choses. Mais si le Nombre ne se voit & ne s'aperçoit point à part, ni hors des choses, & si néanmoins il ne consiste pas seulement dans les choses nombrées, il n'y a point de Nombre, à en juger par ce que les Dogmatiques disent avec trop de curiosité sur cette matière.
Notre dessein dans ces courtes Institutions, ne nous permet pas d'en dire davantage sur cette partie de la Philosophie, que l'on appelle la Physique, ou la science naturelle.
Chap. XIX. De la Partie morale de la Philosophie.
Il nous reste à parler de la Partie morale., qui consiste à, juger du bien & du mal moral & des choses indifférentes : ainsi pour discourir en peu de mots sur cette partie, dont nous prétendons toucher seulement les principaux chefs, nous proposerons quelques doutes sur l’existence, ou la réalité du bien & du mal moral, & des choses indifférentes; après que nous aurons donc quelque notion de ces choses,
Chap. XX. Définition du Bien en général suivant les Stoïciens.[38]
Les Stoïciens disent que le Bien est l’utilité, ou ce qui n'est pas différent de l’utilité. Par l'utilité ils entendent la vertu, & par ce qui n’est pas différent de l'utilité, ils entendent l’honnête Homme & l'ami.[39] Car la vertu étant la partie principale & dominante de l'âme disposée d'une certaine manière, & une action honnête étant une opération conforme à la vertu, c’est là l'utilité. Mais un honnête homme & un ami n’est pas différent de l’utilité, parce qu’une partie de l’honnête homme est l'utilité, qui est la partie principale & dominante de l’âme. Pour expliquer cela, ils disent que les tous ne sont pas les mêmes choses que leurs parties; (car l'Homme n’est pas sa main:) mais qu'ils ne sont pas d'autres choses que leurs parties, & qu'ils n'en sont pas différents, (car ils ne peuvent subsister sans leurs parties:) & ainsi ils disent que les tous ne font pas autres que leurs parties: d'où ils concluent que l’honnête homme étant le tout, par rapport à la principauté de son âme, (laquelle principauté ils appellent l'utilité) il n’est pas autre que l'utilité, il n'en est pas différent.
Chap. XXI. Des Biens & des Maux & des choses indifférentes.[40]
Les Stoïciens disent ensuite que le Bien se prend en trois manières différentes : que suivant la première, le Bien est la source & le premier principe de l'utilité, ce qui est la vertu elle-même: que suivant la seconde, le Bien est ce par où il arrive que nous recevons de l'utilité, comme la vertu & les actions vertueuses, que suivant la troisième, le Bien est ce qui peut nous apporter de l'utilité, comme la vertu & les actions vertueuses, l’honnête homme & le bon ami, les Dieux & les bons Démons : de sorte que la seconde signification du Bien comprend la première, & que la troisième comprend la seconde & la première.
Quelques-uns disent que le Bien est ce qui est désirable par soi-même. D'autres que c’est ce qui contribue à la félicité & ce qui en est la perfection. Et à l'égard de la félicité, les Stoïciens disent qu'elle consiste à passer doucement & tranquillement le Temps de la vie. Ce sont là les choses que l'on nous apprend pour nous donner une notion du Bien. Mais dire que le Bien est ce qui apporte de l'utilité, ou ce qui est désirable par soi-même, ou ce qui contribue ou aide à la félicité, ce n’est pas là faire voir ce que c’est que le Bien, c’est seulement nous donner quelques unes de ses propriétés ou de ses accidents; ce qui est ridicule. Car ou ces choses là conviennent au seul Bien, ou elles conviennent aussi à d'autres choses. Si elles conviennent à d'autres choses aussi, ces définitions du Bien ne font pas exactes, parce que ces accidents sont communs à d'autres choses. Et si ces accidents conviennent au Bien seul, ils ne peuvent toujours point nous faire avoir une notion du Bien ; car comme un homme qui n'a aucune connaissance d'un cheval, ne sait pas même ce que c’est que le hennissement, il est évident que jamais il ne parviendra à avoir une notion d'un cheval par ce qu'on lui dira du hennissement, ou en entendant même un hennissement, à moins qu'il ne voie un cheval hennir. Tout de même si une Personne demande ce que c'est que le Bien, par cela même qu'elle ignore ce que c'est, elle ne peut pas connaître ce qui est propre au Bien seulement, en sorte que par la connaissance de cette propriété il lui soit possible de se former une notion & une idée du Bien même. Car il faut premièrement apprendre ce que c’est que la nature du Bien, & ensuite on pourra connaître, ce qui apporte de l'utilité, ce qui est désirable par soi-même, & ce qui est la cause de la félicité.
En effet, les Dogmatiques eux-mêmes nous font voir par leur conduite que ces accidents là ne suffisent pas pour avoir une notion exacte de la nature du Bien. Car ils conviennent bien à la vérité que le Bien est utile, qu'il est désirable (d'où vient qu'il est appelé ἀγαθὸν, comme qui dirait ἀγωγὸν, c'est-à-dire, attirant ou engageant ;) qu'il est la cause de la félicité: mais quand on leur demande ce que c’est que ce Bien à qui ces propriétés conviennent, les voilà tous dans une guerre irréconciliable les uns contre les autres; les uns disant que c’est la vertu, les autres la volupté, les autres l'exemption de douleur, & les autres quelque autre chose. Or si les définitions précédentes faisaient voir ce que c’est que le Bien en lui même, les Philosophes ne seraient pas en discorde là dessus, tout de même que s'ils ne connaissaient pas quelle est la nature du Bien. C’est ainsi que ceux qui font les plus estimés parmi les Dogmatiques, ne sauraient s'accorder entre eux sur la notion du Bien.
Leurs dissensions sont toutes semblables sur la question du Mal ; les uns disant que le Mal est ce qui est nuisible, ou ce qui n’est pas autre que nuisible : les autres, que c’est ce qui par soi-même doit être fui: les autres, que c’est ce qui est cause du malheur. Par lesquelles définitions ils ne représentent pas la nature ou l'essence du Mal, mais quelque chose qui lui est peut-être propre; ce qui fait qu'ils tombent dans les mêmes incertitudes qu'auparavant.
[41]Les Stoïciens disent qu'une chose peut être indifférente en trois manières : suivant la première, ce qui est indifférent, est ce à quoi on ne se porte point par inclination, & dont on ne se détourne point aussi par la fuite: c'est ainsi que l'on n’est porté ni à affirmer ni à nier que le nombre des étoiles ou des cheveux de la tête est pair. Suivant la seconde manière, une chose indifférente est ce que l'on recherche ou que l’on évite, sans être néanmoins porté à désirer ou à fuir plutôt ceci que cela: c’est ainsi que deux pièces égales de monnaie dont on doit choisir l’une, dont indifférentes; car on est porté à en choisir une, mais non pas une plutôt que l'autre. Suivant la troisième manière, une chose est indifférente, lorsqu'elle ne contribue ni au bonheur ni au malheur, comme la santé, les richesses, &c. Car, selon les Stoïciens, une chose dont on peut user quelquefois bien, quelquefois mal, est indifférente. On peut voir là dessus les dissertations de ces Philosophes dans leurs traités de morale auxquels ils nous renvoient.
Cependant on peut voir ce que l'on doit penser de ces définitions des choses indifférentes, par ce que nous avons dit des Biens & des Maux, & remarquer que les Dogmatiques ne nous conduisent à la connaissance d'aucune de ces choses. Ce qui n’est pas surprenant néanmoins, parce qu'il leur est facile de se tromper dans des choses qui n'existent peut-être point : car quelques-uns prétendent prouver par les raisonnements suivants qu'il n'y a ni Bien, ni Mal, ni aucune chose indifférente.
[42]Chap. XXII. S'il y a quelque chose qui soit de sa nature bonne, ou mauvaise, ou indifférente.
Le feu, qui par sa nature échauffe, paraît à tout le monde avoir la vertu d'échauffer, & la neige étant rafraichissante de sa nature, paraît à tous être rafraichissante & ainsi toutes les choses qui de leur nature émeuvent, ou affectent d'une certaine manière, affectent de la même manière tous ceux qui sont dans un état conforme à leur nature. Or aucune de ces choses que l'on appelle des Biens, n'émeut & n'affecte point de la même manière tous les hommes, & n’est point considérée de tous comme un Bien; (comme nous le ferons voir.) Donc il n'y a aucune chose bonne de sa nature.
Je dis qu'aucune des choses que l'on appelle des Biens, ne touche point de la même manière tous les hommes. Car, (pour ne point parler d'une populace grossière & ignorante, qui fait le plus grand nombre, parmi laquelle, les uns croient, que le Bien consiste à avoir une forte constitution de corps; les autres à jouir des voluptés charnelles; les autres, à se gorger de vin & de bonne chère; d'autres, à jouer ; quelques uns, à posséder plus de richesses que les autres, & quelques-uns enfin dans d'autres choses pires que celles là:) parmi les Philosophes mêmes quelques-uns, comme les Péripatéticiens, disent qu'il y a trois sortes de Biens, les uns, qui appartiennent à l'âme, comme les vertus : les seconds, qui appartiennent au corps, comme la santé, & autres choses semblables: & les autres, qui sont au dehors de nous, comme les amis, les richesses & autres choses pareilles.
Les Stoïciens reconnaissent aussi trois sortes de Biens : les uns, qui appartiennent à l'âme, comme les vertus: d'autres, qui font au dehors de l'âme, comme l'honnête homme & l'ami: & d'autres qui ne sont ni au dedans ni au dehors de l'âme, comme l'Homme de bien par rapport à lui même. Mais quant aux choses qui appartiennent au corps, ou qui sont extérieures au corps, & que les Péripatéticiens considèrent comme des Biens, les Stoïciens nient qu'elles soient des Biens.
Il y a eu aussi des Philosophes qui ont embrassé la volupté comme un Bien; au lieu que d'autres la mettent absolument au rang des Maux;[43] de manière qu'un de ces Philosophes s'écriait : J’aimerais mieux être insensé que de m'abandonner à la volupté.
Disons donc que puisque les choses qui nous émeuvent par leur nature, affectent & émeuvent d'une même manière tous les hommes, & que puisque nous ne sommes pas affectés de la même manière à l'égard des choses que l’on appelle des Biens, rien n’est un Bien de sa nature. Or enfin nous ne pouvons ajouter foi ni à toutes les opinions précédentes que nous avons expliquées; à cause qu'elles se combattent les unes les autres; ni à quelqu’une en particulier: car si quelqu’un dit qu'il faut ajouter foi à cette Secte-ci, & non pas à celle-là; dès là qu'il est combattu par les raisons de ceux qui pensent autrement que lui, il devient partie intéressée dans cette controverse, & par conséquent il faut choisir un autre juge que lui, qui le juge lui même & il ne peut pas usurper le droit de juger les autres. Mais comme nous n'avons ni règle de vérité & de fausseté dont on convienne unanimement, ni démonstration reconnue pour telle, à cause qu'il est impossible de liquider les difficultés que nous avons sur ces deux chose, il faudra qu'il s'abstienne de décider, & il ne pourra pas prononcer affirmativement qu'une chose soit un Bien par sa nature, ou par elle même.
Quelques-uns font cette objection. Le Bien est ou le désir que nous avons d'une chose, ou la chose même que nous désirons. Or le désir que nous avons d'une chose, n’est pas par lui même un Bien ; car si cela était, nous nous contenterions de ce désir, & nous ne travaillerions pas à obtenir ce que nous désirons, dans la crainte que nous aurions d'être privés du plaisir de le désirer, quand nous l'aurions obtenu. Par exemple, si c'était un Bien de désirer de boire, nous ne rechercherions pas à boire; car quand nous avons obtenu, ce que nous désirions, nous cessons de le désirer: (dites la même chose à l'égard du désir de manger, de celui des plaisirs charnels & des autres.) Donc le désir n’est pas un Bien par lui même; & je ne sais pas s'il n’est pas plutôt une chose fâcheuse & incommode: car celui qui a faim, cherche de la nourriture pour se délivrer de ce désir incommode; & celui qui a l'amour en tête, ou qui a soif n'en agit pas autrement.
Or maintenant, je dis que ce que l’on désire n’est pas non plus un Bien : car ou il est hors de nous, ou il est au dedans de nous. Mais s'il est au dehors de nous, ou il excite en nous un mouvement agréable, une certaine disposition qui nous plaît, & enfin quelque forte de délectation, ou il ne nous affecte en aucune manière. S'il n'a rien pour nous de délectable, il ne sera pas un Bien, il ne nous engagera pas à le désirer, & il ne sera désirable en aucune sorte.
Que si cet objet étranger produit en nous une certaine disposition douce, & une certaine affection qui nous plaise, il ne sera pas désirable par lui-même, mais à cause de cette affection ou disposition qui se fait en nous par son moyen. Donc ce qui est désirable par soi-même, ne peut point être un objet étranger & hors de nous. Mais il n’est pas non plus en nous: car, s'il y est, ou il est dans le corps seul, ou dans l'âme seule, ou dans l'un & dans l'autre. S'il est dans le corps seul il ne parviendra pas jusqu'à notre connaissance ; car les connaissances sont attribuées à l'âme, & le corps en tant que tel est privé de Raison. Que s'il atteint aussi jusqu'à l'âme, il paraîtra désirable à l'âme, en vertu d'une affection de l'âme qui lui est agréable: car ce qui est jugé être désirable, est jugé tel par l'esprit selon les Dogmatiques, & non pas par le corps qui est privé de raison.
Il faut donc se retrancher à dire que le Bien appartient à l'âme seulement. Mais cela est impossible aussi, (eu égard à ce que disent les Dogmatiques;) car peut-être que l'âme n'existe pas : outre que, si elle existe, il n’est pas possible de concevoir ce que c'est, comme je l'ai prouvé en parlant de la règle de la vérité. Or comment peut-on dire qu'une chose se fait dans une autre chose que l'on ne conçoit pas ? Mais pour ne pas insister là-dessus, comment peut-on dire que le Bien est aussi dans l'âme? Car si, par exemple, on fait consister avec Epicure la fin & le souverain Bien dans la volupté, & si on prétend que l’âme n’est qu'un composé d'Atomes, (de même que toutes les autres choses :) comment peut-on concevoir que dans cet assemblage d'Atomes, il y ait de la volupté, & de l'approbation, & une vertu de juger que ceci est désirable & bon, & que cela est mauvais & doit être fui ? Certainement il n'y a Personne qui puisse dire cela.
[44]Les Stoïciens au contraire dirent que les Biens de l'âme sont de certains arts ou les vertus. Ils disent que l'art est[45] un système de conceptions ou de connaissances exercées ensemble, & que les conceptions se font dans la partie supérieure ou dominante de l'âme. Or il n'est pas possible de concevoir, comment tant de compréhensions qui sont nécessaires pour composer un art, sont renfermées & ramassées dans la principauté de l’âme; (laquelle âme est, selon ces mêmes Stoïciens, un souffle léger, ou une matière très subtile :) une seconde impression devant effacer celle qui la précède, parce que cette matière subtile est fluide, éparse, & sans consistance; & que l’on dit qu’à chaque impression l’âme est mue toute entière. Car de dire avec Platon que la faculté que l’âme a de former des images ou des idées, que l’âme qui, selon ce Philosophe, est un mélange bizarre de substance divisible & indivisible, & de natures toutes différentes, puisse nous faire discerner le Bien démonstrativement, cela est ridicule ; aussi bien que d'attribuer ce pouvoir à des nombres, comme font les Pythagoriciens. D'où je conclus que le Bien n’est pas non plus dans l’âme.
Que si ni le désir du Bien n’est pas un Bien, s'il n'y a au dehors de nous aucun objet qui soit désirable par foi même, si le Bien n’est ni dans le corps ni dans l’âme, comme je l'ai prouvé, il n'y a quoi que ce soit qui soit un Bien par sa nature : &, par une fuite nécessaire de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a aussi rien qui soit un Mal par soi-même & de sa nature. Car des choses qui paraissent aux uns être des Maux, sont recherchées avec empressement par d'autres Personnes, corne, par exemple, les plaisirs déshonnêtes; l’injustice, l'avarice, l'intempérance & d'autres chose semblables. C’est pourquoi, si ce doit être une propriété des choses qui sont bonnes ou mauvaise par leur nature, d'affecter tous les hommes de la même manière, & si au contraire les choses que l'on appelle des maux, n'affectent pas tous les hommes d'une même manière, il faut dire qu'il n'y a rien qui de soi-même & par sa nature soit un Mal.
Je dis maintenant qu'il n'y a aussi rien qui soit indifférent par sa nature, ou que du moins on ne peut rien décider là dessus, à cause des disputes que les Philosophes ont entre eux sur cette question. Car, par exemple, les Stoïciens disent qu'entre les choses indifférentes les unes sont bonnes en quelque manière par extension & par préférence; & les autres mauvaises de même par réjection ; & que d'autres ne sont ni préférées ni rejetées : que les choses indifférentes, préférées, sont celles qui ont quelque dignité suffisante, comme la santé & les richesses: que les choses indifférentes, rejetées, sont celles qui n'ont pas une dignité suffisante, comme la pauvreté & la maladie : & que celles qui ne sont ni préférées ni rejetées, sont, par exemple, d'étendre ou de plier le doigt.
D'autres disent que parmi les choses indifférentes, rien n’est ni préféré ni rejeté; mais que chaque chose indifférente paraît quelquefois préférée, & quelquefois rejetée, selon de différentes circonstances. Car, si, disent-ils, un Tyran dresse des embûches aux riches, & laisse vivre les pauvres en repos, il n'y a Personne alors qui n'aime mieux être pauvre que riche, de manière qu'alors les richesses passent pour des choses indifférentes rejetées.
Voici donc comme je raisonne. S'il y avait quelque chose qui fût indifférente par sa nature, tous la croiraient indifférente: mais les uns appellent Bien, & les autres appellent Mal, ces choses que d'autres appellent indifférentes: donc il n'y a rien qui soit indifférent par sa nature.
Si quelqu’un dit que le courage est désirable de sa nature, parce que les lions sont naturellement courageux, auxquels on ajoutera, si l’on veut, les taureaux, & quelques hommes, & les coqs, nous dirons qu'en raisonnant de même, il faudra mettre aussi le manque de courage entre les choses qui sont désirables de leur nature, parce que les cerfs & les livres, & plusieurs animaux y sont portés par leur instinct naturel ; & la plupart des hommes sont aussi bien peu courageux : car il arrive rarement que l’on s'expose à la mort pour sa patrie, & que l'on ne soit retenu dans une occasion dangereuse par une certaine crainte molle ; & il est rare de voir que quelqu’un pousse par un grand courage entreprenne une action hardie, la plupart des hommes évitant ces choses. C’est aussi par là que les Epicuriens prétendent prouver, que la volupté est désirable par elle même : car ils disent que dès que les animaux sont nés, lorsqu'ils ne sont pas encore gâtés par l'éducation, ils tendent tout droit à la volupté par leur inclination naturelle, & fuient les douleurs. Mais on pourrait leur répondre que ce qui est une cause efficace de plusieurs maux, ne peut pas être bon par sa nature, & que la volupté est la cause de plusieurs maux : que la douleur qui, selon eux, est un mal par elle-même, est attachée à quelque plaisir que ce soit. Un ivrogne, par exemple, sent du plaisir quand il se remplit de vin; & un gourmand, quand il mange avec excès & un impudique, quand il ne garde aucune mesure dans ses voluptés charnelles ; mais toutes ces débauches amènent la pauvreté & les maladies, qui sont des maux, & des maux douloureux, selon l'opinion des mêmes Epicuriens : donc la volupté n’est pas naturellement un Bien.
Tout de même, ce qui produit des Biens, ne peut point passer pour un mal: mais la peine nous procure des plaisirs ; car nous acquérons les sciences avec le travail, & il y a tels gens qui ne peuvent posséder des richesses, & gagner l'affection de leur maîtresse, qu'en travaillant beaucoup, & la santé s'obtient aussi quelquefois par des douleurs : donc le travail n’est point un Mal de sa nature. Car si la volupté était naturellement un Bien, & le travail un Mal, tous seraient affectés d'une même manière à l'égard de ces choses, comme nous l'avons dit. Mais nous voyons plusieurs Philosophes qui embrassent le travail & la patience & qui méprisent la volupté.
On pourrait de même réfuter ceux qui disent qu'une vie vertueuse est naturellement une bonne chose ; on n'a qu'à leur opposer que quelques Philosophes ont embrassé une vie voluptueuse : cette controverse suffit seule pour réfuter ceux qui prétendent que quelque chose est telle ou telle de sa nature.
Chap. XXIII.[46] Suite du même sujet. S'il y a des choses qui soient de leur nature, bonnes, mauvaises, ou indifférentes.
Il ne fera pas maintenant hors de propos, de faire considérer ici, en peu de mots quelques opinions particulières sur les choses honnêtes ou déshonnêtes, sur les choses licites ou illicites, sur les lois & les coutumes, sur la piété envers les morts, & sur d'autres choses semblables : car par ce moyen nous trouverons qu'il y a parmi les hommes une grande diversité de sentiments, sur quantité de pratiques toutes différentes.
Chez nous, par exemple, c'est une chose son seulement honteuse, mais encore criminelle, de s'abandonner à la Pédérastie; mais on dit que cela n'est point honteux chez quelques peuples d'Allemagne ou de Germanie;[47] que cela ne passait point autrefois pour honteux chez les Thébains & que Mérion[48] Roi de Crète était nommé Mérion, comme pour signifier la vilaine coutume des Crétois à cet égard ; & quelques-uns croient que le violent amour qu'Achille avait pour Patrocle n'était autre chose qu'un amour & un commerce impur. Il n'y a rien de surprenant dans tout cela, quand on pense que les Philosophes Cyniques, Zénon[49] de Citium, & Cléanthe & Chrysippe disent que c’est là une chose indifférente.
Ce serait parmi nous une infamie, d'avoir commerce publiquement avec nos propres femmes;, mais chez quelques Peuples des Indes cela ne passe point pour malhonnête : car ils caressent & connaissent leurs femmes sans façon devant tout le monde ; & le Philosophe Cratès n’en usait pas autrement, comme nous l’apprenons par son histoire.
C’est chez nous une infamie aux femmes de se prostituer; mais cela est honorable chez plusieurs Peuples d'Egypte : car on dit que chez ces Peuples, celles qui ont eu commerce avec un plus grand nombre d'Hommes, portent par ornement des espèces de jarretières, autour des chevilles de leurs pieds pour marque de leur gloire. Et même chez quelques uns de ces Peuples, les filles avant que de se marier gagnent leur dot en se prostituant, & se marient ensuite. Et ne voyons-nous pas des Stoïciens qui disent qu'il n'y a point de mal à avoir commerce avec une femme débauchée, & à gagner sa vie par un trafic de prostitution.
C’est une chose honteuse & flétrissante, chez nous d’être stigmatisé : mais plusieurs Egyptiens & plusieurs Sarmates, marquent ou stigmatisent leurs enfants.
Chez nous il serait indécent & malhonnête à des hommes de porter des pendants d'oreilles ; mais chez quelques Peuples étrangers (comme chez les Siciens) c’est une marque de noblesse jusque là & que quelques-uns voulant renchérir sur cette marque de distinction, percent les narines des jeunes garçons, & y attachent des anneaux d'or ou d'argent, ce qu'aucun de nous ne vaudrait jamais faire.
Jamais un homme parmi nous ne voudrait porter un habit bigarré de diverses couleurs ; ou un habit long jusqu'aux talons; mais cela qui nous paraît indécent, passe pour être fort l’honorable chez les Perses. Denis Tyran de la Sicile ayant envoyé à Platon, & à Aristippe qui étaient alors chez lui, à chacun un habit de cette sorte, Platon le refusa & dit : Je ne saurais me résoudre étant homme, à porter un habit de femme ; mais Aristippe le reçut en disant : Une femme chaste ne se déshonore point, en prenant quelque licence dans les fêtes des Bacchanales. Ainsi une même chose paraissait honteuse à l'un de ces Philosophes, & ne paraissait pas telle à l'autre.
Il n’est pas permis chez nous d’épouser sa mère ou sa sœur, mais les Perses & les Mages même, qui semblent faire une profession plus particulière de la sagesse chez eux, se marient avec leurs mères : & les Egyptiens épousent leurs sœurs & comme dit un poète : Jupiter parlait à Junon sa sœur, qui était aussi sa femme.;
Zénon de Cittium prétend qu'if n'y a point de mal de matris naturam sua affricare natura: comme on ne saurait dire qu'il y ait aucun mal à frotter sa mère dans quelque autre partie de son corps. C'est pourquoi Chrysippe, dans son ouvrage de la république, enseigne qu'il est permis à un père d'avoir des enfants de sa fille, & à une mère, d'en avoir de son fils, & à un frère d'en avoir de sa sœur ; & Platon, s’exprimant d'une manière plus générale a prouvé que les femmes doivent être: communes. C’est une chose exécrable de se souiller, mais Zénon de Cittium approuve cela : & nous apprenons que quelques uns ont usé de cette mauvaise & sale pratique, comme de quelque chose de bon.
C’est parmi nous une chose illicite, de manger de la chair humaine : mais il y a de certaines Nations barbares chez lesquelles tous universellement regardent cela comme une chose indifférente. Et qu'est-il besoin de parler de Peuples barbares, lorsque l’on nous dit que Tidée mangea un jour la cervelle de son ennemi; & lorsque les Stoïciens nous disent que ce n'est point une chose contraire à la Raison de manger, soit de la chair des autres, soit de la sienne propre?
La plupart des hommes, & nous par conséquent, nous croyons que ce serait une impiété de souiller l'autel d'un Dieu de sang humain : mais les Lacédémoniens se fouettent si violemment sur l’autel de Diane, que le sang coule en abondance sur l'autel. Mais quoi, n'y a-t-il pas quelques Peuples qui immolent un homme à Saturne?[50] Et les Scythes ne sacrifient-ils pas à Diane les étrangers qui sont chez eux? Au lieu que nous croyons que ce serait un crime de souiller les temples de sang humain,
Nos lois veulent que l’on punisse les adultères : mais il y a quelques Peuples chez lesquels c’est une chose indifférente d’avoir commerce avec les femmes des autres; & il y a quelques Philosophes qui disent que c’est une chose indifférente de se mêler avec la femme d'autrui.
La loi ordonne chez nous aux enfants d’avoir soin de leurs parents mais les Scythes les égorgent quand ils ont passé soixante ans. Et pourquoi s’étonnerait-on de cela ? quand on pense que Saturne coupa à son père les parties naturelles, que Jupiter précipita Saturne dans ses Enfers, que Minerve avec Junon & Neptune entreprit de charger de chaînes son père Jupiter ; & que Saturne avait résolu de tuer ses propres enfants ? Solon a donné une loi aux Athéniens, par laquelle il a permis à un chacun de tuer son propre fils sans aucune forme de procès. Au lieu que chez nous les lois nous défendent de faire mourir nos enfants. Et les Législateurs des Romains veulent que les enfants soient fournis à la puissance de leurs pères, aussi bien que les esclaves, & elles ne veulent pas que les enfants soient les maîtres de leurs propres biens? mais leurs pères, jusqu'à ce que les enfants aient été mis en liberté, tout comme les esclaves que l’on achète : mais d'autres Peuples ont rejeté cette coutume, comme une tyrannie.
Il y a une loi qui ordonne de punir ceux qui commettent un homicide ; cependant les Gladiateurs sont souvent honorés après avoir tué des hommes.
Les lois défendent de fouetter des hommes libres ; néanmoins les Athlètes, après en avoir fouetté ou même tué, reçoivent des couronnes & des récompenses honorables.
La loi chez nous ordonne à un chacun de nous contenter d'une seule femme : mais chez les Thraces & chez les Gétules qui sont des Peuples de Lybie, chacun en a plusieurs.
C’est chez nous une chose criminelle et contraire aux lois de voler ou de piller mais cela ne passe point pour infâme chez plusieurs Peuples barbares : & même on dit que cela était glorieux autrefois parmi les Peuples de Cilicie, jusques là qu'ils jugeaient dignes de marques de distinction & d'honneur ceux qui périssaient en commettant leurs brigandages. Et Nestor (dans Homère) après voir bien reçu Télémaque & ceux qui étaient avec lui leur parle ainsi : Quel est le sujet de votre voyage? est-ce quelque affaire, ou si vous parcourez ces mers, comme font les Pirates. Si c'eût été un mal (selon Nestor) de pirater, il ne les aurait pas reçus avec tant d’honnêteté & de bienveillance, parce qu'il aurait pu les soupçonner d'être des écumeurs de mer.
C'est une chose contraire aux lois et injuste chez nous de dérober: mais ceux qui disent que Mercure est un Dieu fort adonné au larcin, donnent lieu de croire qu'il n'y a point d'injustice à cela. Car comment un Dieu pourrait-il être mauvais ? Ajoutez à cela ce que l’on dit que les Lacédémoniens ne punissaient pas les larrons, parce qu'ils avaient dérobé ; mais parce qu’ils s'étaient laissé surprendre en dérobant:
Un homme lâche & qui a abandonné son bouclier, est puni selon la loi chez plusieurs Peuples, (c'est pourquoi une Lacédémonienne donnât un bouclier à son fils qui partait pour la guerre, lui parla ainsi : rapporte le, mon fils, lui-dit-elle, ou que l'on te rapporte dessus. Au contraire Archilochus se vante d'avoir abandonné son bouclier & d'avoir pris la fuite, & voici ce qu'il dit là dessus dans ses poésies; quelque Trace se pare à présent de mon bouclier que j'ai abandonné dans un buisson ; mais enfin je me suis sauvé la vie.
Lorsque les Amazones avaient accouché de quelques enfants mâles, elles les rendaient boiteux, afin qu'ils fussent incapables de faire aucune action de force, comme les autres hommes : & elles faisaient elles-mêmes la guerre : au lieu que nous, nous croyons que la droite raison & l’ordre veulent que l’on observe une conduite toute contraire à celle-là.
La Déesse Cybèle, la mère des Dieux, ne reçoit pour ses Prêtres que des Eunuques: Or étant une Déesse, comme elle est, jamais elle ne les aurait voulu recevoir, si c'était une chose mauvaise de sa nature de n'avoir pas ce qui est essentiel au sexe masculin.
Toutes les questions que l’on peut faire sur le juste & l’injuste, & sur ce qui constitue véritablement une grande âme, sont sujettes à de semblables irrégularités. Celles encore qui regardent la piété & les Dieux, font des sources abondantes de controverses & de discordance.
La plupart des Hommes croient qu'il y a des Dieux, mais il y en a aussi qui le nient comme Diagoras de Mélos, Théodore, & Critias d'Athènes. Et à l'égard de ceux qui disent qu'il y a des Dieux, les uns adorent ceux de leur pays, & les autres adorent des Dieux tels que les différentes Sectes des Philosophes se les forgent & se les imaginent. Et voici quels sont ces Dieux.
Aristote dit que Dieu est incorporel, & qu'il est l'extrémité du ciel.[51] Les Stoïciens, que c’est un esprit (une matière subtile) qui pénètre & qui s'étend jusques dans des lieux sales, que l’on ne saurait voir qu'avec horreur. Epicure dit qu'il est fait comme un homme. Xénophane dit que c’est un corps sphérique, immuable & impassible.
Après cela. Quelques-uns attribuent à Dieu une providence sur les choses humaines, & d'autres ne reconnaissent point cette providence. Car Epicure dit qu'un Être heureux & incorruptible n'a point d'affaire lui-même, & ne se mêle point des affaires des autres. Voilà la raison pour laquelle pour se conformer aux coutumes & aux lois, les uns disent qu'il n'y a qu'un Dieu, & les autres qu'il y en a plusieurs, tellement qu'ils ne se font point de difficulté de donner dans les opinions des Egyptiens, qui attribuent aux Dieux, des figures de chiens, ou de faucons, & qui honorent comme Dieux, des bœufs, des crocodiles & toutes fortes d'autres choses.
De là vient encore que toutes les choses qui appartiennent aux sacrifices & au culte des Dieux, sont tout à fait différentes. Telles pratiques qui sont pieuses, dans de certains temples, sont impies dans d'autres. Or s'il y avait quelque chose qui fut par elle même & de sa nature, pieuse ou impie, on n'aurait point ces différences de sentiments.
Dans le temple de Sérapis, par exemple, jamais on n'oserait immoler un cochon ; mais on l'immole fort bien à Hercule & à Esculape. C’est un crime de sacrifier une brebis à Isis ; mais on l'immole à la Déesse que l'on appelle la mère des Dieux, & à d'autres Dieux. Il y en a qui sacrifient un homme à Saturne & d'autres croient que c’est là une impiété. A Alexandrie on sacrifie un chat à Horus & un ver (nommé σίλφη) à Tétis ce que jamais Personne ne ferait parmi nous. On sacrifie un cheval à Neptune, mais cet animal est odieux à Apollon, surtout à celui qui est surnommé Didiméen. C’est une action pieuse de sacrifier des chèvres à Diane, mais non pas à Esculape.
Je pourrais rapporter plusieurs autres choses semblables que je passe sous silence; parce que je m'étudie à être court : & je remarque que si quelque sacrifice était de sa nature pieux ou impie, tous en jugeraient unanimement de la même manière suivant ce qu'il serait.
Si nous examinons maintenant les distinctions dans le boire & dans le manger, qui sont des suites du culte des Dieux, & que les Hommes observent fort religieusement, nous trouverons une diversité toute pareille à celle que nous venons de remarquer. Un Juif ou un Prêtre Egyptien mourront plutôt que de manger du porc. Un Libyen croit que c’est le plus énorme de tous les crimes de manger de la brebis. Chez les Syriens il y en a qui croiraient faire un grand crime, s'ils mangeaient des pigeons, & d'autres, s'ils mangeaient de la chair des victimes. C’est une chose pieuse de manger du poisson dans de certains temples, & dans d'autres ce serait une grande impiété. Que si on consulte les Sages d'Egypte, ou ceux qui passent pour tels, les uns croient que c’est une profanation ou une souillure de manger la tête d'un animal; d'autres, d'en manger l'épaule; d'autres, d'en manger le pied; & d'autres, d'en manger je ne sais quelle autre partie. A Péluse aucun de ceux qui sont initiés dans les mystères du Jupiter du mont Casius en Egypte, ne mangerait jamais des oignons : & un Prêtre de la Vénus de Libye ne voudrait pas seulement goûter de l'ail. On s'abstiendra dans de certains temples, de manger de la menthe; dans d'autres, de manger d'une certaine herbe odoriférante, appelée ἠδυόσμος: & dans d'autres de manger de l’ache. Enfin il y a des Personnes qui disent qu'elles aimeraient mieux manger la tête de leurs pères, que de manger des fèves. Voilà pourtant toutes choses indifférentes chez des autres Peuples & pour des autres Personnes.
Nous croyons parmi nous que c’est une espèce de profanation & de souillure de manger de la chair de chien : mais on dit que quelques Thraces mangent fort bien des chiens & peut-être cela a-t-il été aussi autrefois en usage chez les Grecs : ce que l'on pourrait prouver, parce que Dioclès qui était issu de la famille des Asclépiades, ordonne pour de certaines maladies de manger des jeunes chiens. Il y en a qui, (comme je l'ai dit,) mangent indifféremment & sans distinction de la chair humaine, ce qui passerait chez nous pour une espèce d'impureté que nous contracterions en faisant cela. Or si, & ces choses par lesquelles on honore pieusement & saintement les Dieux, & ces autres qui font illicites & contraires à la Religion, étaient par leur nature, ce qu'elles paraissent être à quelques-uns, & non à d'autres, tous en feraient le même jugement.
On peut dire la même chose sur la piété envers les morts. Les uns ensevelissent les morts entiers, & les cachent en terre, croyant que ce serait une impiété, de les laisser exposés aux yeux du soleil ; mais les Egyptiens ôtant les entrailles, embaument les morts & les gardent chez eux sans les enterrer. Les Peuples d’Ethiopie que l’on appelle Ichtyophages (ou mangeurs de poissons) jettent les morts dans les étangs pour servir de nourriture aux poissons & les Hircaniens les exposent pour être dévorés par les chiens : & quelques Indiens les donnent aussi à manger aux vautours. On dit que c’est la coutume des Troglodites de mener le mort sur quelque lieu élevé, là où lui ayant ramené & lié la tête avec les pieds, ils l'accablent de pierres, en l’insultant & se retirent enfin après l'avoir couvert d'un monceau de pierres.
Il y a quelques Peuples barbares qui immolent ceux d'entre eux qui ont passé soixante ans, & qui les mangent ensuite; & ceux qui meurent jeunes, ils les enterrent. Quelques uns brûlent les morts; & après les avoir brûlés, les uns ramassent les os, les enferment & les gardent soigneusement ; & les autres les laissent là épars à l'aventure. On dit que les Perses suspendent leurs morts, qu'ils les salent avec du nitre, & qu'ensuite ils les enveloppent avec des bandes.
Nous voyons avec quel deuil & quels regrets quelques-uns honorent leurs morts. La plupart en effet croient que la mort est une chose horrible, & que l'on doit fuir avec soin. Mais il y a aussi des Personnes qui ne sont point du tout de ce sentiment là. Voici comme Euripide parle de la mort : Qui peut savoir si, ce que nous appelons maintenant vivre, n’est pas un état de mort, & si nous ne regardons pas comme un état de mort, ce qui est vivre effectivement ailleurs que sur cette terre ? Voici aussi ce que dit Epicure : La mort, dit-il, est pour nous une chose étrangère & qui ne nous fait absolument rien; car ce qui est dissous n'a plus de sentiment, & ce qui n'a plus de sentiment, ne nous fait absolument rien. On ajoute ce raisonnement : si nous sommes composés de corps & d'âme, & si la mort est la dissolution du corps & de l'âme, lorsque nous sommes il n'y a point de mort, (car nous ne sommes point dissous alors) & lorsque c’est la mort, nous ne sommes plus; car il est évident que jusque cette composition du corps & de l’âme n'existe plus, nous qui sommes ce composé, nous n'existons plus.
Héraclite dit que, soit que nous vivions, soit que nous mourions, c’est toujours la vie & la mort dans chacun de ces états. La raison de cela, est que, pendant que nous vivons, nos âmes sont mortes, & ensevelies en nous, & lorsque nous mourons, nos âmes revivent, & jouissent de la vie.
Il y en a qui vont jusque croire que la mort vaut mieux pour nous que la vie. C’est la pensée d'Euripide dans les paroles suivantes : Il faut, dit-il, s'assembler pour pleurer & plaindre un homme qui naît, en considérant à combien de maux il va être exposé ; mais un homme qui par la mort est arrivé à la fin de ses travaux, il faut que ses amis l'en louent, & l'en félicitent en lui rendant les derniers devoirs. C’est encore dans cette pensée que quelqu’un disait : Certainement le plus grand avantage qui pût arriver aux mortels, ce ferait de ne point naître, & de ne point voir la lumière de ce soleil rapide: & quand un homme est né, le meilleur pour lui serait de passer aussitôt dans le sépulcre, & d'être couché bien avant dans la terre.
On fait ce qui est dit de Cléobis & de Biton[52] & ce qu'Hérodote rapporte d'eux en faisant mention d'une prêtresse Argienne. On raconte que chez quelques Peuples de Thrace, à la naissance d'un enfant, les proches parents s'assemblent pour déplorer son malheur.
La mort ne doit donc pas être mise au rang des choses qui sont terribles de leur nature, ni la vie au rang de celles qui sont des biens par elles-mêmes ; & aucune des choses que nous avons reportées ci-dessus n’est point par sa nature telle ou telle, mais seulement par opinion & relativement à quelque chose. C’est ainsi que chacun peut raisonner sur les coutumes & les opinions différentes, qu'il tirera des Auteurs qui en ont écrit, & que nous n'avons pas voulu reporter dans le dessein que nous avons d'être courts.
Que si à l'égard de quelques opinions, nous ne pouvons pas prouver d'abord que les hommes soient partagés en de différents sentiments, il faut dire qu'il se peut faire que quelques Nations que nous ne connaissons pas, ne s'accordent pas avec les autres hommes sur ces matières. Car, de même que nous assurerions faussement que c’est une chose avouée & reconnue pour indubitable parmi tous les hommes, qu'il n’est pas permis de se marier avec ses sœurs, supposé que nous ignorassions que c’est la coutume des Egyptiens de se marier avec leurs sœurs; tout de même nous ne pouvons pas dire qu'il n'y ait point quelque différence de sentiments sur des choses, sur lesquelles nous ne sentons pas encore cette différence, parce qu'il se peut faire (comme je l'ai dit) qu'il y ait chez des Peuples inconnus, quelque discordance de sentiments sur ces choses.
Un Sceptique donc, considérant cette bizarrerie d'opinions & de pratiques différentes, s'abstient de juger & de décider que quoi que ce puisse être soit par sa nature bon ou mauvais, permis ou illicite, & s'éloigne en cela de la témérité des Dogmatiques: & au reste: il se conforme, sans poser aucun Dogme, aux établissements reçus dans la conduite ordinaire des hommes. Cela fait que dans les choses qui dépendent des opinions, il ne se passionne pour aucun parti, & qu'à l'égard de celles où il est contraint de souffrir, ses souffrances sont modérées. Car il souffre en qualité d'Homme capable de sentiment : mais comme il n'adopte pas outre cela cette opinion, que ce qu'il souffre soit naturellement un mal, il conserve une certaine modération d'âme dans les choses qu'il souffre.
Il est évident qu'une semblable opinion serait pire que la souffrance, comme on peut s'en convaincre, par l'expérience, qui nous apprend que quelquefois ceux à qui on coupe un membre, ou qui souffrent quelque autre chose semblable, supportent cela avec patience & que ceux qui sont présents à ces opérations tombent en défaillance, parce qu'ils se persuadent que ce qui se fait là est un mal.
Lorsque l'on croit fermement que quelque chose est naturellement bonne ou mauvaise, limite ou illicite, on se sent agité de divers troubles. Car un Homme qui est dans cette persuasion, souffre, & lorsque les choses qu'il croit être véritablement & naturellement des maux, lui arrivent, & lorsqu'il jouit de celles qui lui paraissent être des biens, soit parce que son esprit s'élève & s'enfle par trop de joie, soit parce qu'il craint de perdre ces biens : outre que dans la crainte où il est, d'être exposé à ce qu'il croit être naturellement des maux, il tombe dans de grandes inquiétudes. Au reste si quelques-uns voulaient soutenir que l'on ne peut pas perdre les biens, nous leur imposerions silence par le doute que la discordance des sentiments fait naître sur cette question.
Voici donc comme nous raisonnons. Si ce qui cause un mal, est un mal, & doit être fui, & si cette persuasion par laquelle une Personne s'imagine que ces choses-ci sont bonnes de leur nature, & celles-là mauvaises, cause des inquiétudes ; il faut dire que c’est une chose mauvaise, de se persuader que quoi que ce soit, soit naturellement bon ou mauvais. En voilà assez pour le présent sur le Biens & les Maux & les choses indifférentes.
Chap. XXIV. S'il peut y avoir quelque Art pour la conduite de la vie.
Tout ce que j'ai dit ci-dessus fait voir évidemment qu'il n'y a point d'Art qui puisse nous diriger dans la vie : car s'il y avait un tel Art, il consisterait dans la connaissance des biens & des maux & des choses indifférentes : mais ces choses n'existant pas, cet Art pour la conduite de la vie ne peut exister non plus.
D'ailleurs, comme les Dogmatiques ne sauraient s'accorder entre eux pour nous donner d'un commun consentement un seul & unique Art de conduite ; comme les uns en supposent un, & les autres un autre tout différent; ils sont exposés & à leurs propres controverses, & au raisonnement que nous tirons de leur discordance; raisonnement que j'ai assez poussé en parlant du bien.
Supposons néanmoins que tous s'accordassent à dire qu'il y a un Art de conduite, & que cet Art est, par exemple, cette célèbre Prudence, (qui certainement ne fait que rêver chez les Stoïciens, & qui néanmoins paraît être plus puissante que les autres vertus:) Je prétends qu'avec tout cela ils ne diront que des absurdités. Je le prouve. La Prudence est une vertu, & il n'y a que le Sage qui possède la vertu: donc les Stoïciens qui ne sont pas des Sages, n'auront pas cette prudence ou cet Art qui apprend à bien vivre.
De plus. Il ne peut point y avoir d'Art tel qu'ils le définissent, Donc il n'y aura point d'Art qui apprenne à bien vivre, si nous voulons nous en rapporter à ce qu'ils disent de l'Art. Car ils disent que l'Art est un système ou un assemblage de compréhensions, & que la compréhension consiste à accorder son assentiment à la fantaisie[53] compréhensive. Or on ne saurait trouver ce que c’est que cette fantaisie compréhensive : car toute fantaisie n’est pas compréhensive; & de plus on ne saurait distinguer quelle est celle des fantaisies qui est compréhensive. Ce que je prouve ainsi.
Nous ne pouvons pas juger par toutes fortes de fantaisies ou d'idées simplement & sans preuve, quelle est celle qui est compréhensive ou vraie & quelle est celle qui ne l’est pas : nous avons donc besoin d'une idée vraie ou compréhensive pour reconnaître & distinguer une idée compréhensive : mais cela nous jette dans le progrès à l'infini, parce que l’on nous demandera une idée compréhensive qui nous fasse distinguer comme compréhensive celle que nous avons prise pour distinguer la première, & ainsi de suite. Lors donc que les Stoïciens nous donnent une pareille notion de la fantaisie ou de l'idée compréhensive, ils ne raisonnent pas. Car ils disent que la fantaisie compréhensive tire son origine d'un Être, & en même Temps ils disent que cet Être est ce qui peut mouvoir la fantaisie compréhensive: par là ils tombent dans le Diallèle,[54] cercle vicieux qui n’est qu'un moyen de doute. Voici donc en peu de mots tout mon raisonnement. Afin qu'il y ait un Art de bien vivre, il faut auparavant qu'il y ait un Art : mais afin qu'il y ait un Art, il faut qu'il y ait auparavant une compréhension, & afin qu'il y ait une compréhension; il faut avoir compris ce que c’est que cette fantaisie compréhensive. Or on ne peut point trouver ce que c’est que cette fantaisie compréhensive. Donc on ne peut pas trouver ce que l’on appelle un Art de bien vivre.
On argumente encore ainsi. Il paraît que l'on ne peut connaître un Art que par des ouvrages qui émanant proprement de cet Art. Or il n'y a aucun ouvrage propre & particulier à l’Art de bien vivre; car quelque chose que ce puisse être que l’on voudra attribuer à cet Art, se trouvera reçu communément par la populace ignorante & malhabile sans aucun secours de cet Art; comme par exemple, qu'il faut honorer ses parents, rendre les dépôts, & autres choses semblables. Donc il n'y a aucun Art de bien vivre.
Quelques uns disent que nous connaissons ou que nous distinguons un ouvrage de prudence, parce que nous voyons qu’il est fait par un homme prudent, ou qu'il part d'une disposition prudente de l’âme : mais cela est facile à réfuter ; car cette disposition prudente de l’âme est une chose qui ne peut point être connue, parce qu'elle ne se fait point apercevoir évidemment ni par elle même, ni par ses ouvrages, puisque ces actions que l’on appelle des œuvres de prudence, font communes au vulgaire ignorant.
Dire aussi que nous connaissons qui font ceux qui possèdent l’Art de bien vivre, par l’égalité confiante que nous observons dans toute leur conduite, c’est dire une chose qui est au dessus de la nature humaine, & qui est plus à désirer qu'elle n’est vraie.
Car l'esprit des hommes,[55] habitants de la terre, est semblable aux jours que le père des hommes & des Dieux leur accorde.
Il faut donc se retrancher à dire que nous connaissons cet Art de bien vivre, par ces actions ou par ces œuvres que les Stoïciens nous décrivent dans leurs livres. Or comme les choses qu'ils nous débitent là dessus sont en grand nombre, & que d'ailleurs ces Philosophes disent à peu près les mêmes choses, je me contenterai d'en rapporter quelques unes pour servir d'exemples.
Zénon lui même Auteur de leur Secte dans ses diatribes ou disputes, en parlant de l'éducation des enfants dit, entre autres choses malhonnêtes, celle-ci : que l’on peut[56] dividere également ceux que l'on aime d'amour, comme ceux que l'on n'aime pas ainsi, les femelles comme les mâles; parce que les choses ne sont pas autres pour ceux que l'on aime d'amour que pour ceux que l'on n'aime pas ainsi, ni autres pour les femelles que pour les mâles, mais que les mêmes choses leur conviennent & leur sont bienséantes à tous.
Le même Zénon parlant de la piété envers les parents, dit à l'occasion d'Œdipe avec Jocaste qu'il n'était pas étonnant, quod fricaret matrem, car si sa mère étant malade il l'eût soulagée, en la frottant avec ses mains dans quelque autre partie de son corps, il n'y aurait eu rien de malhonnête dans cette action : or pourquoi trouvera-t-on malhonnête qu'il réjouît sa mère, & qu'il la soulageât en lui frottant quelques autres parties de son corps, & en ayant d'elle des enfants légitimes ?
Chrysippe dans son ouvrage de la République, n’est pas différent de Zénon. Voici ses propres paroles.
« Il me semble que l’on peut aussi régler ces choses, comme elles ont été établies d'une manière qui n’est pas mauvaise chez quelques uns : qu'une mère puisse avoir des enfants de son fils ; & un père, de sa fille; & un frère, de sa sœur de mère. »
Ce Philosophe dans les mêmes livres admet l’usage de manger de la chair humaine. Voici comme il parle. « Que si des corps vivants, on en coupe quelque partie, qui soit bonne à manger, il ne faut pas l'enfouir en terre, ni la jeter là, mais la manger, afin quelle devienne une partie de celles de notre corps. »
« Et dans ses livres du devoir, en parlant de la sépulture des parents, il dit ces propres paroles. Quand nos parents sont morts, nous devons leur faire des funérailles fort simples, car la corps (comme les ongles, ou les dents, ou les poils) ne devant plus être pour nous en aucune confédération, ni en aucune estime après la mort, il s'enfuit que si la chair en est bonne à manger, on pourra l'employer pour sa nourriture, (tout de même que si quelques parties de notre corps, un pied, par exemple, nous avaient été coupées, il conviendrait de nous en servir, comme de choses qui nous appartiennent en propre :) mais si la chair du corps mort d'un parent est mutilée on laissera cela en terre ; ou bien après avoir brûlé le corps, on en laissera là les cendres, ou on les jettera plus loin, sans s'en mettre en peine pas plus que des ongles ou des poils. »
Les Philosophes nous disent plusieurs choses semblables qu'ils n'oseraient jamais pratiquer aux mânes à moins qu'ils ne vécussent dans quelque république de Cyclopes ou de Lestrigons. Or s'ils ne font rien de tout ce qu'ils disent là & si les choses qu'ils font leur sont communes avec le vulgaire, il est évident qu'il n'y a aucune œuvre qui soit particulière, à ceux que nous croyons peut-être posséder l'Art de bien vivre. Donc s'il est nécessaire que l'on reconnaisse les Arts à quelques ouvrages particuliers; & si néanmoins nous ne voyons aucun ouvrage qui soit particulier à ce que l'on appelle l'Art de bien vivre, il s’ensuit qu'on ne peut pas connaître cet Art; & que par conséquent ou ne peut pas assurer qu'il existe
Chap. XXV. S’il y a dans les Hommes, quelque art qui serve à la conduite de la vie.
S'il y a dans les Hommes un Art qui serve à la conduite de la vie, ou il est dans eux naturellement, ou bien il y est par instruction & par enseignement. Si cet Art est naturellement dans les hommes, il y est ou en tant qu'ils sont Hommes, ou en tant qu'ils ne sont pas hommes. Or ce n'est pas en tant qu'ils ne sont pas hommes, car ils ne sont pas des non-Hommes: c’est donc en tant qu'Hommes. Mais si cela était, la prudence résiderait dans tous les Hommes, de sorte qu’ils seraient tous prudents, amateurs de la vertu & sages ; mais on dit que les hommes font pour la plupart mauvais. Donc ce ne peut pas être en tant qu'ils sont hommes, que l'Art de bien vivre réside en eux. Donc ce n’est pas non plus naturellement que cet Art réside en eux. Ajoutez à cela que comme les Stoïciens disent que l’Art est un système de compréhensions ou de connaissances exercées ensemble, il faut qu'ils disent & que les autres Arts, & que celui-ci dont il s'agit à présent, s'acquièrent par l'instruction. Or maintenant je dis qu'il ne s'acquiert pas par l’instruction ; car afin que, cela passe pour constant, il faut reconnaître, comme choses avouées & indubitables trois choses: savoir, la chose qui est enseignée, celui qui l'enseigne, & celui qui reçoit l'instruction. Mais aucune de ces choses n'existe. Donc cet Art acquis par l’instruction ne subsiste point.
Chap. XXVI. S'il y a quelque chose qui puisse être enseigné.
Ce qui est enseigné est ou vrai ou faux. S'il est faux, il ne peut pas être enseigné: (car les Philosophes disent que le faux n'existe point : or ce qui n'existe point ne peut pas être enseigné.) Mais je dis que si on suppose que ce qui est enseigné est vrai, rien ne peut être enseigné: car nous avons fait voir en parlant de la règle de vérité, qu'il n'y a rien de vrai. Donc, ni le faux ni le vrai ne peut être enseigné, & si, outre ces deux choix, il n'y a rien qui puisse être une matière d'instruction, il faut dire que rien n’est enseigné. Car je ne pense pas que quelqu’un veuille dire que ces deux choses-là ne pouvant être enseignées, il enseignera seulement des choses dont on doute.
De plus, ou ce qui est enseigné est évident, ou il est obscur. S'il est évident il n'a pas besoin d'être enseigné; car les choses évidentes sont également évidentes à tous.
Que si ce qui est enseigné est obscur, comme les choses obscures ne peuvent être connues, à cause de l'impossibilité qu'il y a de décider des controverses que les hommes ont entre eux sur ces choses obscures, (comme nous l’avons dit souvent) il est évident que ce qui est enseigné, étant obscur, il ne pourra pas être enseigné. Car comment une Personne peut-elle enseigner, ou concevoir par l’enseignement d'autrui une chose qui est inconcevable? Mais si ni ce qui est évident, ni ce qui est obscur, ne peut point être enseigné, rien n’est enseigné.
Voici encore un autre raisonnement. Ou ce qui est enseigné est corps, ou il est incorporel. Or l'une & l'autre de ces deux choses, soit qu'elle soit évidente, soit qu'elle soit obscure, ne peut être enseignée par les raisons que nous venons de dire. Donc rien n’est enseigné.
Autre objection. Ce qui est enseigné, ou est existant, on n'existe pas. Or ce qui n'existe pas ne peut pas être enseigné ; car si cela était, parce qu’il n’y a que ce qui est vrai, qui puisse être enseigné, (comme on le croit) il faudrait dire que ce qui n’est pas est vrai : & de plus comme il n'y a que le vrai qui puisse être enseigné, ce non-être qui serait enseigné serait vrai, & par conséquent il serait existant, car on dit que le vrai existe & est opposé à quelque[57] chose. Or il est absurde de dire que ce qui n'existe pas existe. Donc ce qui n'existe pas, n’est pas enseigné.
Mais je dis que ce qui existe n'est pas enseigné non plus, ou que ce qui est enseigné n’est pas un Être. Car si ce qui existe est enseigné, ou il est enseigné en tant qu'existant, ou il est enseigné en tant qu'il est quelque autre chose. Que si on dit qu'il peut être enseigné en tant qu'existant, il sera du nombre des Êtres qui étant évidents ne s'enseignent pas, & par conséquent il ne sera pas une chose qui puisse être enseignée ; car les choses que l'on nous enseigne doivent être des choses indubitables que nous n'avons pas encore apprises ou que nous ne connaissons pas encore. Donc un Être en tant qu'Être ne peut pas être enseigné. Mais je dis aussi qu'il ne peut pas être enseigné en tant qu'il est quelque autre chose qu'un Être. Car l'Être n'a point d’accident ou de propriété qui ne soit pas un Être. Donc si l'Être en tant qu’Être ne peut être enseigné, il ne sera point enseigné non plus en tant qu'il est quelque autre chose qu'un Être; parce que tout ce qui lui appartient est quelque Être. Outre cela soit que cet Être, que l’on dit être enseigné, soit évident, soit qu’il soit obscur, il ne pourra pas être enseigné par les raisons[58] susdites. Or si ni ce qui existe n’est point enseigné, ni ce qui n'existe pas, il n'y a rien qui puisse être enseigné.
Chap. XXVII. S'il y a quelqu’un qui puisse enseigner & quelqu’un qui puisse être enseigné.
Quand on a fait voir qu'il n'y a aucun Être, qui puisse être enseigné, le maître & le disciple tombent en même temps. Cependant on propose encore en particulier quelques raisons de douter contre l'artisan & contre l'apprenti :[59] les voici.
Ou l'artisan enseignera l'artisan ; ou l'apprenti, l'apprenti ; ou l'apprenti, l'artisan, ou l'artisan, l'apprenti. L'artisan n'enseigne pas l'artisan; car ni l'un ni l'autre en tant qu'artisan n'a pas besoin d'instruction. L'apprenti n'enseignera pas non plus l'apprenti ; cela n'est pas plus possible que de voir un aveugle conduire un autre aveugle. Ni l’apprenti n'enseignera pas l'artisan; cela ferait ridicule. Il reste donc à dire que l'artisan enseigne l'apprenti. Mais je dis que cela même ne se peut pas faire : en voici la preuve. Il ne peut point y avoir d’artisan, parce que l'on ne voit pas que Personne soit artisan par lui même & dès qu'il est né, & parce que Personne, d'ignorant qu'il est, ne peut devenir savant dans ce qu'il ignore. Car ou un seul précepte de l'art & une seule connaissance peut rendre artisan celui qui était apprenti, ou cela ne se peut : mais si une seule compréhension rend artisan celui qui était apprenti; premièrement nous pourrons dire que l’art n’est donc pas un système ou un assemblage de plusieurs compréhensions ; (car suivant cette supposition, pourvu qu'un homme apprenne un seul précepte de l'art, on pourra l’appeler artisan) mais en second lieu, si quelqu’un dit que celui qui aura appris quelques préceptes de l'art, & qui a encore besoin d un précepte, n’est encore qu'apprenti, faute de ce préceptes & que si cet apprenti ajoute encore ce précepte, il deviendra d'apprenti artisan par le moyen de cette seule compréhension : si, dis-je, quelqu’un raisonne ainsi, il parlera au hasard. Car jamais il ne pourra faire voir en particulier quel est celui qui étant encore apprenti, deviendra artisan, en apprenant encore un seul précepte de l’art. Personne ne sait le nombre des préceptes de chaque art, de manière que, quand on aura fait une énumération de ceux qui sont déjà connus, on puisse dire combien il en manque encore pour achever le nombre des préceptes de cet art. Donc la connaissance d'un seul précepte de l’art ne rend pas l’apprenti artisan.
Or si cela est vrai, comme Personne n'apprend pas tout à la fois tous les préceptes d'un art, mais chaque précepte à part & en particulier, on ne pourra pas dire que celui-là soit artisan qui apprendra chaque précepte à part & séparément des autres préceptes: car nous avons dit que la connaissance d'un seul précepte de l’art, ne rend pas l'apprenti artisan. Donc l'apprenti ne peut pas devenir artisan. De là on conclura au aussi qu'il n'y a point d'artisan ni Personne par conséquent qui puisse enseigner.
Mais je dis de plus que celui que l’on appelle disciple, qui ne saura pas un certain art, ne peut pas apprendre & comprendre les préceptes de l'art qu'il ignore. Car, comme celui qui est né aveugle, ne peut, en tant que tel, recevoir aucune connaissance ou perception des couleurs, ni celui qui est sourd de naissance, ne peut recevoir aucune perception de la voix: ainsi celui qui ignore un art, ne peut pas comprendre les préceptes de l'art qu'il ignore, parce que de cette manière il serait savant & ignorant dans l'art des mêmes choses; ignorant, parce qu'on le suppose tel, & savant, parce qu'il comprendrait les préceptes de l'art. D'où il s’ensuit que l'artisan ne peut pas enseigner l'apprenti.
Que si ni l'artisan n'enseigne l'artisan, ni l'apprenti, l'apprenti; ni l'apprenti, l'artisan ; ni l'artisan, l'apprenti ; & s'il n'y a rien outre cela : il n'y a donc ni maître ni disciple. D’où il suit que n'y ayant ni maître ni disciple, ce que l’on appelle un moyen d'enseigner est une chose superflue.
Chap. XXVIII. S'il y a quelque moyen d’instruction.
Voici néanmoins encore quelques raisons de douter que l'on propose contre le moyen d'enseigner. Le moyen d'enseigner est ou l'évidence ou le discours : or il n’est ni l'évidence ni le discours, comme nous le montrerons : donc le moyen d'enseigner n’est point praticable. Je dis que l'on ne peut pas enseigner par l'évidence, parce que l'évidence appartient aux choses qui se montrent; parce que ce qui se montre, est manifeste à tout le monde, parce que ce qui est manifeste à tous, peut être compris de tous; & enfin parce que ce qui peut être compris de tous indifféremment, n’est pas une matière de doctrine ou d'enseignement. Donc rien ne peut être enseigné par l'évidence.[60]
Maintenant je dis que rien n’est enseigné par le discours. Car ou le discours signifie quelque chose, ou il ne signifie rien. S'il ne signifie rien, il n’est pas propre pour enseigner : que s'il signifie, ou il signifie par sa nature, ou par établissement & par institution. Ce n'est pas par sa nature, parce que tous n'entendent pas tous ceux qui parlent, les Grecs n'entendent pas les étrangers, ni les étrangers les Grecs. Que si le discours signifie par établissement & par institution, il est évident que ceux qui auront connu auparavant les choses auxquelles on a donné des noms, concevront à la vérité ces choses là, mais ce ne sera pas parce que ces dénominations leur enseigneront des choses qu'ils ignoraient, & ce fera seulement parce qu'ils se remettront en mémoire des choses qu'ils savaient déjà. Mais ceux qui ont besoin d'apprendre des choses qu'ils ignorent & qui ne connaissent pas celles auxquelles on a donné des noms, ne concevront rien. Ainsi il ne peut y avoir aucun moyen d'enseigner. Car un maître qui enseigne doit donner à son disciple la connaissance ou la compréhension des préceptes de l'art qui est enseigné, afin que ce disciple connaissant les préceptes qui composent cet art, y devienne enfin habile & savant. Mais la compréhension ou la connaissance n’est rien & n'existe point, comme nous l'avons enseigné auparavant. Donc le moyen d'enseigner n'existe pas non plus. Que si rien n’est enseigné, s'il n'y a Personne qui puisse enseigner, ni Personne qui puisse recevoir l'enseignement, certainement il n'y a ni discipline ni enseignement aucun.
Voilà ce que nous avions à dire en général contre l'instruction & l’enseignement, Mais on peut faire l’objection suivante, particulièrement contre ce que l'on appelle l'art de la conduite. Nous avons montré ci-dessus que la chose qui est enseignée, c'est-à-dire, la Prudence, n'existe point. Or je dis maintenant, & que celui qui la peut enseigner, & que celui à qui elle peut être enseignée, n’existent point. Car ou le prudent enseignera au prudent l'art de bien vivre ; ou l'imprudent à l'imprudent ; ou l'imprudent au prudent; ou le prudent à l'imprudent. Or aucun de ceux-là ne la peut enseigner. Donc ce que l'on appelle Art de conduite, Art de bien vivre, ne peut être enseigné. Il est inutile de parler des trois premiers; mais à l'égard du dernier, voici ce que je dis. Si le prudent enseigne l'imprudent, comme la prudence est l'art des choses bonnes, mauvaises, & indifférentes, l'imprudent, n'ayant pas la prudence, ignore les choses bonnes, mauvaises, & indifférentes ; & comme il les ignore, lorsque le prudent lui enseignera les choses bonnes, mauvaises, & neutres, il entendra seulement ce que l'on lui dira, mais il ne le connaîtra pas ; car, s'il conçoit ces choses étant dans l'imprudence, l'imprudence renfermera la théorie des choses bonnes, mauvaises, & neutres. Or, selon les Dogmatiques, l'imprudence ne possède pas cette théorie; (car si cela était, un même homme serait prudent & imprudent.) Donc l'imprudent ne conçoit pas les choses qui sont dites ou faites par le prudent, au moins en tant que ces choses là appartiennent à l'Art de bien vivre. Mais s'il ne les conçoit pas, il ne peut pas être enseigné par le prudent; à quoi on doit ajouter qu'il ne peut être enseigné ni par le moyen de l'évidence ni par celui du discours ; comme nous l'avons dit auparavant.
Or maintenant si ce que l'on appelle un Art de conduite & de bien vivre ne peut être enseigné à Personne par l’instruction; & si cet Art ne réside dans qui que ce soit naturellement; il s'ensuit que cet Art que les Philosophes prétendent être nécessaire pour se conduire, & qu'ils ont toujours dans la bouche, est une chose qui ne se peut trouver,
Chap. XXIX. Si l’Art de bien vivre est utile à celui qui le possède.
Quand on accorderait par grâce que cet Art que les Dogmatiques assurent sans fondement appartenir à la conduite de la vie, se rencontre dans quelqu’un, on trouvera qu'il est plutôt nuisible, & qu'il est plutôt une cause de trouble dans ceux qui le possèdent qu'il ne leur est utile. D'abord pour laisser là plusieurs choses que nous pourrions dire, & nous contenter seulement de quelques unes ; cet Art de bien vivre pourrait paraître être utile au Sage, en lui donnant une certaine retenue ou continence pour rechercher le bien & se détourner du mal. Car le Sage qui, selon eux, est appelé retenu ou continent, est appelé continent, ou parce qu'il n'a aucune inclination pour le mal, ni aucune aversion pour le bien, ou parce qu'il a à la vérité des inclinations & des aversions déréglées, mais qu'il les surmonte. Mais en tant qu'il n’est point exposé aux mauvaises contrariétés des passions, on ne peut pas l'appeler continent ; car il ne s'abstient pas de ce qu'il n'a pas : & comme on ne saurait dire qu'un Eunuque est continent dans les plaisirs de l'amour, & qu’un homme qui a l'estomac mal disposé[61] est continent dans l'usage des viandes, (car ces gens là ne font point des efforts sur eux mêmes par la continence pour vivre comme ils font: tout de même il ne faut point dire que le Sage soit continent, parce qu'il n'a aucune mauvaise passion, contre laquelle on puisse dire qu'il sera continent,
Que si on dit qu'il est continent, parce qu'étant exposé aux mauvaises contrariétés des passions, il les surmonte par la raison: premièrement on accordera que la prudence ne lui servi de rien, puisqu’il est encore dans des troubles, & qu'il a besoin de secours. Mais ensuite il est plus malheureux que ceux qui ne sont point du nombre des Sages. Car s’il se sent porté violemment à quelque chose, il est troublé nécessairement ; & s'il surmonte la passion par la raison, cet effort qu'il fait est un mal qu'il porte avec lui, & par cet endroit il est plus troublé qu'un homme du commun qui ne souffre plus cette contrainte; car cet homme n’est troublé que quand il est agité par sa passion, & quand il a obtenu ce qu'il désirait, il cesse d'être troublé. Donc le Sage n’est point continent par vertu; ou, s'il est continent, il est le plus malheureux de tous les hommes; & par conséquent cet Art de conduite, comme on l'appelle, bien loin de lui avoir apporté quelque utilité, ne lui a causé que du trouble.
Au reste nous avons enseigné ci-dessus, que celui qui se flatte de posséder un Art de conduite, & de connaître par le moyen de cet Art les choses qui sont bonnes ou mauvaises par leur nature, s'expose à de grandes inquiétudes, autant lorsqu'il jouit des biens, que lorsqu'il souffre les maux. Concluons donc & disons que si l'existence des biens & des maux & des choses indifférentes n’est point une chose reconnue pour indubitable; que si l'Art de bien vivre, comme on l'appelle, n'existe peut-être pas aussi ; que si, (supposé qu'il existe,) il n'apporte aucun bien à ceux qui le possèdent, & ne sert qu'à remplir leur esprit d'inquiétudes : concluons, dis-je, que si toutes ces choses sont ainsi, c’est mal à propos que les Dogmatiques font tant les fiers & se donnent de si grands airs d'autorité dans la partie morale de leur Philosophie.
Après avoir parcouru, comme nous avons fait, (en peu de mots & conformément au dessein que nous avions d'être courts) la partie morale de la Philosophie, nous finirons ici & notre troisième Livre, & tout ce traité des Institutions Pirroniennes, en ajoutant encore ces mots.
Chap. XXX. Pourquoi le Philosophe Sceptique se sert quelquefois exprès de raisons faibles & peu probables.
Comme le Philosophe Sceptique aime les hommes, il souhaite autant qu'il peur, de guérir par la raison l'arrogance & la témérité des Dogmatiques. C’est pourquoi, de même que les Médecins des corps ont des remèdes dont la force est différente, & emploient les plus violents pour ceux qui sont attaqués d'une maladie plus forte, & les plus légers pour ceux qui sont légèrement malades ; ainsi les raisons que le Philosophe Sceptique propose ne sont pas toutes d'une même force. Il se sert de celles qui font les plus solides & qui ont le plus de vertu pour réfuter les opinions des Dogmatiques, envers ceux qui sont violemment affectés du mal de la précipitation & de la témérité, & il use de raisons plus légères envers ceux chez lesquels la maladie des Dogmatiques est plus légère, & plus facile à guérir, & qui peuvent être réfutés par des probabilités plus faibles. Voilà pourquoi le Philosophe Sceptique ne fait point de difficulté de proposer exprès des raisons qui quelquefois font plus fortes & quelquefois plus faibles; parce que ces raisons, toutes faibles qu'elles sont, lui paraissent souvent suffisantes pour parvenir au but qu'il se propose.
[1] Cela veut dire, qu'il est impossible que nous concevions ce que c’est qu'une Cause, parce que nous ne pouvons pas connaître une chose, comme Cause d'un certain effet, avant que de connaître si cet effet existe, & s'il existe en tant qu'effet de cette Cause; & que nous ne pouvons pas connaître l'effet, comme effet d'une certaine Cause, avant que de connaître l'existence de la Cause ; en tant que Cause de cet effet.
Disons-donc ce qui est: Nous sommes déjà persuadés, bien ou mal qu'une certaine Cause existe, quand nous nous imaginons que nous allons nous convaincre ou nous persuader de ion existence, en remontant de l'effet à cette Cause: sans cela, nous ne nous aviserions pas seulement d'y penser.
Ne rirait-on pas, si on entendait une troupe d'aveugles de naissance, raisonner ainsi: Lorsque nous sommes exposés à l'air, à la porte de nos maisons, & que nous sentons cette douce chaleur élémentaire qui nous échauffe & qui ranime nos Sens engourdis, nous nous élevons par la perception de ces bénignes influences à la connaissance de ce beau soleil, de cet astre lumineux, de ce feu brillant, qui est le père du jour, sans la lumière duquel nous serions, ensevelis dans l'horreur d'une nuit continuelle, & dans un froid mortel. Eh mes amis, leur dirait-on, qui vous a si bien sifflés? Que vous êtes d'habiles gens ! C’est dommage, que, quoique vous disiez vrai, vous ne savez pas plus ce que vous dites, que des perroquets à qui on aurait appris ce beau discours. Aves-vous aucune idée d'Astre, de Soleil, de feu brillant, de lumière, de mur & de nuit ? Et comment pourriez-vous assurer que le Soleil est la Cause de la chaleur que vous sentez, si quelqu’un ne vous avait dit, qu'il y a un Soleil, tel que vous le décrivez, qui en est la Cause? Pour connaître qu'un effet procède d'une certaine Cause, il faut auparavant connaître qu'il y a une telle cause : mais comment pouvez-vous connaître par vous mêmes, qu'une telle cause existe, si vous n'en avez aucune idée? Vous raisonneriez bien plus juste, si vous vous contentiez de dire qu'il y a quelque cause, qui vous est inconnue, de cette chaleur que vous ressentez, & qui ne vient point du-feu de vos foyers: mais en partant comme vous faites, vous croyez ce que l'on vous a dit, & vous ne raisonnez pas.
Si nous étions capables d'examiner nos pensées avec un esprit vraiment analytique, nous trouverions que la plupart de nos raisonnements supposent déjà comme prouvées & connues, les concluions que nous nous imaginons de prouver & de connaître par ces raisonnements là. On m'a élevé dans la croyance qu'il y a un Dieu, un esprit infini, présent partout sans être étendu, créateur des corps & des esprits, Cause unique d'une infinité d'effets tous différents, &c. & voilà ce qui fait que de la connaissance des ouvrages de la nature, je m'élève à celle du souverain créateur de toutes choses: mais si l'on ne m'en avait jamais parlé, en aurais-je la moindre idée ? Et d'ailleurs pourrais-je avoir la moindre assurance, de ne me pas égarer dans la recherche de cette cause première, quand je sais qu'il ne peut y avoir qu'une seule & unique opinion vraie, au lieu qu'il y aura certainement une infinité de chimères, & de fausses opinions que je pourrai prendre pour la vérité, comme cela paraît par toutes les idées fausses, impies, & extravagantes, que presque tous les Hommes, depuis les plus ignorants, jusques aux têtes les plus sages de la Grèce, ont eues de la Divinité ?
En un mot. Si je veux descendre de la Cause un certain effet, il faut auparavant que je lâche si cet effet existe, & s'il est l'effet de cette cause. Et si de l’effet je veux remonter à une certaine cause, il faut auparavant que j'aie l’idée de cette Cause, que je sache si elle existe, & si elle est bien la cause de cet effet. Ainsi dès qu'un certain effet ne paraît pas évidemment avec ce que l'on prétend en être la Cause, on ne peut pas savoir si cette cause l’a produit & quand la cause ne paraît pas évidemment avec ce que l’on dit qui en est l’effet, on ne peut pas savoir si cette Cause dont l’existence n’est pas évidente, & dont on n’a peut-être pas d’idée, est bien la cause de ce que l'on dit être son effet.
Sextus pousse cette objection plus loin, & d'une manière plus subtile que je n'ai fait : mais telle que je l'ai proposé, elle mérite assez que l’on y fasse attention.
[2] D'une certaine matière que quelques uns imaginent. Sextus entend parler ici d'une certaine matière première & dépouillée de toutes qualités, que quelques Stoïciens avaient imaginée, & dont ils disaient que leur Dieu suprême, qui n'était autre chose que l'Ether, ou un feu vital & intelligent, avait produit tous les Êtres. Il ne se peut rien de plus monstrueux que cette imagination. Voyez la continuation des pensées diverses sur la comète, §. LXVII.
[3] Et un corps qui tourne en rond. C’est ce que dans la Philosophie d'Aristote, on appelle la cinquième essence; c'est la matière incorruptible du ciel distinguée spécifiquement de celle des corps sublunaires.
[4] Ces molécules informes, étaient des petites mages ou des petits corps informes & divisibles, maïs qui ne pouvaient être connus, que par le raisonnement: lesquels petits corps, venant à se briser par leur choc mutuel, & par leur mouvement, qui leur était naturel, en une infinité de petits corps de diverses figures, ces parties se raccrochant ensuite, & s’ajoutant ensemble, en une infinité de manières, elles formaient tous les Êtres & tous les corps sensibles. Les Atomes de Démocrite, & d'Epicure étaient indivisibles & différaient en cela des molécules d'Asclépiade, qui se brisaient en toutes les manières. Voyez M. Fabricius sur cet endroit.
[5] Consultez l'article Anaxagore, (Diction. Hist. et crit.) Voici un abrégé de sa doctrine par M. l'Abbé d’Olivet, tom. 3, p. 256, De la Nature des Dieux. » Anaxagore enseignait, 1° Qu’avant la formation de l'Univers il y avait pêle-mêle, dans une matière infinie, une infinité de parties semblables, c'est-à-dire, de parties terrestres, de parties aériennes, de parties qui étaient du sang, des os, &c. 2° Que ces parties étaient toutes en repos, & ne feraient, ainsi mélangées, qu'un Chaos informe. 3° Qu'un esprit infini, puissant, sage, les mit en mouvement & joignant ensemble les corpuscules de même espèce, forma les Êtres particuliers, qui composent l’Univers.
Un homme qui raisonnera superficiellement, rejettera les Homoéoméries, mettra une matière éternelle en leur place & admettra un premier moteur, ou le Dieu d’Anaxagore. C’est ainsi que raisonnent les Sociniens, mais un homme qui raisonnera plus profondément, verra bientôt qu'il n'y a nulle liaison dans les parties de ce système. Voyez la continuation des pensées diverses sur la comète, tome 2, p. 499.
[6] Les surfaces ne s'uniront pas totalement l’une à l'autre par ce Contact. Cela veut dire que si je pose, par exemple, une pièce de glace de miroir plan, sur une autre pièce de miroir plan, les deux surfaces de ces deux pièces ne s'uniront pas si parfaitement, que des deux surfaces qui le touchent, il ne s'en fasse plus qu'une intérieure, commune aux deux Corps qui sont joints ensemble. Car autrement ce contact serait une confusion, et des deux pièces de glace, il ne s'en ferait plus qu'une.
[7] On prouvera de même qu’il n'y a pas de point indivisible. Que l’on suppose deux lignes situées toutes deux sur une seule ligne droite, & qui se touchent l'une l'autre par une de leurs extrémités, comme pourraient être deux aiguilles, qui, étant toutes deux couchées sur une ligne droite., se toucheraient chacune par leur pointe ; alors le point extrême de l'une touchera le point extrême de l'autre, par une autre partie, que celle par laquelle il est uni à la ligne dont il est supposé être l'extrémité; & ainsi il ne sera pas un point indivisible.
[8] Elles seraient unies & confondues ensemble, il y aurait plus : car elles se compénétreraient ensemble.
[9] Il est impossible de résoudre cet argument de Sextus, d'une manière qui satisfasse, si on admet la divisibilité de la matière à l'infini, ou l'existence de l'étendue. Si l'étendue existait, (dit M. Bayle Diction. Hist. & Crit, t. III. p. 909. Col 6.) il ne serait pas possible que ses parties se touchassent & il ferait impossible qu'elles ne se pénétrassent point. Ne sont-ce pas des contradictions très évidentes renfermées dans l'existence de l'étendue?
[10] Simplement passives. Qui ne font que recevoir l'impression ou l'action des objets, & qui ne peuvent pas inférer une chose de quelques autres: d'où il arrive que les Sens ne peuvent pas apercevoir la nature & l’essence du Corps, laquelle ne se peut déduire que par raisonnement, des choses sensibles avec lesquelles le Corps est aperçu. Il y a aujourd’hui de grands Philosophes qui prétendent que nous ne connaissons ni la nature ou la substance du Corps, ni celle de l'âme.
[11] Suivant la supposition présente.
[12] Car si la raison est un dit, & est incorporelle. Ce raisonnement est un argument contre les Stoïciens, qui disaient que les choses & les paroles étaient corporelles, mais que les dits, c'est-à-dire les conceptions & les idées, étaient incorporelles, comme étant des impressions dans la partie supérieure de l’âme.
[13] Sur dix Cotyles d'eau. La cotyle était une sorte de mesure, pour les choses liquides, comme pourrait être une chopine mesure de Paris.
[14] Sera sa cause motrice, qui devra avoir une autre Cause motrice & celle-ci une autre, & ainsi de suite à l'infini. Voyez là-dessus chap. 3, vers le milieu.
[15] Elle y demeure en repos. C’est-à-dire, elle n’en sort pas, puisqu'elle y est.
[16] Dans le corps d'un homme de 50 ans, il n’y a peut-être pas un atome de ce qu'il y avait dans son corps, lorsqu'il était à l'âge d'un an. Et si l'âme est corporelle, comme quelques Philosophes le conjecturent aujourd’hui, on ne peut pas prouver que cet homme de 50 ans, ait quoi que ce soit de reste de ce qu'il était à l’âge d'un an. La doctrine des monades, & celles de l'immortalité des germes ne sont guère plus soutenables, que celle de la matérialité de l’âme, par la même raison. Car quel privilège peuvent avoir ces monades ou ces germes, pour tenir bon dans le siège de l'âme de l'animal, pendant que des corpuscules incomparablement plus grossiers & plus terrestres s'exhalent & se dissipent de toutes les parties du corps? Qui sait si, par exemple, ce germe n'a pas cédé sa place à quelque autre germe? Et si le nouveau venu ne se souvenant pas d'avoir jamais pensé, ne s'imagine pas qu'il est la même âme qui était là avant lui, parce qu'il commence à penser suivant les habitudes déjà toutes formées du corps dans lequel il a pris la place du germe précédent?
[17] On trouvera que trente cinq sont contenus dans quinze. Il ne paraît pas que Sextus veuille dire tout à fait cela, comme on le peut voir en confrontant ce passage, avec ce qu'il dit liv. I contre les Physiciens p. 611. Voici donc son raisonnement.
6. contient 5. 4. 3. 2. 1. qui font 15
Or 5 contient 4. 3. 2. 1. qui font 10.
& 4 contient 3. 2. 1. qui font 6
& 3 contient 2. 1. qui font 3.
& 2 contient 1. qui fait 1.
Donc 6 contient 15. 10. 6. 3. 1. qui font 37.
Ensuite si vous raisonnez encore ainsi,
35 contient 34. 33. 32. 31. &c. qui font 595.
Or 34 contient 33. 32. 31 &c qui font 561.
& 33 contient 32. 31. &c. qui font 528.
& que vous continuiez le calcul, comme ci-dessus, vous aurez des nombres immenses, qui sont tous contenus dans 6 : s'il est vrai que 5 y soit contenu. Mais s’ils ne sont pas contenus dans 6, donc 5 n'y est pas contenu non plus. Voilà le raisonnement de Sextus. Il n’est pas nécessaire de dire que ce n’est là qu'une petite chicane.
[18] On n’ôtera pas l’unité du nombre dix. Parce qu'il faudrait ôter une unité d'une unité, ce qui ne se peut: ou une unité de chaque unité pour la retrancher de tout le nombre dix, ce qui est absurde; ou bien on ne peut pas ôter une unité du nombre dix, parce que ce nombre est un, & que l'unité est indivisible.
[19] Ces unités, restantes avec celles qui sont otées feront 20, parce que l'on suppose une soustraction qui laisse quelque chose ; & le moins qui peut relier de chaque unité, quand on en aura ôté de chacune une unité, sera une unité, & par conséquent ce qui restera sera dix, & ce qui aura été ôté sera dix; or dix et dix font vingt. Voilà une petite subtilité.
[20] Mais le nombre neuf...... demeure entier. Parce qu'il est question d'ôter l'unité, du nombre dix; & ôtez un de dix, reste neuf, & même ceux contre lesquels on dispute, veulent qu’en retranchant une unité du nombre dix : or dans quelque partie du nombre dix que l’on la prenne, il reste toujours neuf.
[21] On ôtera tout le nombre. Parce qu'ôtant une unité de chacune des unités qui constituent tout le nombre neuf, il ne reste tien : donc, si de tout le nombre neuf, on ôte une unité il ne reste rien, ou s'il reste quelque chose, il reste neuf unités qui avec les neuf retranchées font 8. C’est le même sophisme que ci-dessus.
[22] La Transposition se trouve renfermée &c. Cela veut dire que si on nie l'addition, la soustraction, & le mouvement local, on nie en même temps la Transposition, qui est une action par laquelle on ôte une chose d'une autre, & on l'ajoute à une autre ; ce qui ne se peut faire sans un mouvement passager de la chose transposée.
[23] Les choses qui sont relatives... se détruisent mutuellement. Cela veut dire que les Parties étant relatives à ce dont elles sont appelées les Parties, si ce dont elles sont dites les Parties, n’est rien, dès là elles ne sont plus Parties. Car les choses relatives, ou se prouvent réciproquement les unes les autres, ou se réfutent de même.
[24] On pourrait dire que les Corps sont dans un état continuel ou de formation & de perfection ou de destruction & de décadence. Cela est sensible dans les Corps des animaux, des arbres, & des plantes, et à l’égard des autres Corps, il y a de l’apparence qu'il en est de même, mais qu'il faut des siècles entiers pour en apercevoir les changements. Il faut 2 ans pour former un enfant de 2 ans (sans compter le temps de la formation dans le ventre de la mère) & il faut 50 ans pour un homme de 50 ans, & ainsi des autres Corps. La décadence des Corps est de même un état de changement continuel, qui se fait par degrés.
[25] Ce qui est dans un état permanent..., est le sujet passif d'une action. Parce qu'il est retenu dans cet état par l’action de quelque Corps. Une pierre, par exemple, ne demeure en repos contre la terre, que parce que la terre l'empêche en agissant contre elle, de passer plus outres; & elle ne monte pas en l’air, parce que l’air & la matière subtile la pousse contre terre. Un liquide ne demeure liquide que par l’action de quelques Corps; & il ne devient dur, que par l'action de quelques autres Corps, qui prévalent sur ceux qui causaient sa liquidité.
[26] Ce qui est incorporel ne peut être patient, c’est-à-dire, qu'il n’est pas capable de recevoir l'action d'aucune Cause, parce qu'il faudrait pour cela que l'agent pût agir sur lui, ou qu'il pût recevoir l'action de l’agent. Mais si l'agent est corporel il n'en peut pas recevoir l'action, parce qu'il ne peut pas être touché & si l'agent est incorporel, ni l'agent ne peut toucher le patient, ni le patient être touché par l'agent. Rien ne peut toucher ni être touché, s'il n’est corporel. Mais c’est un fait, dit-on, que l'âme est touchée par le Corps & le Corps par l’âme. Je n'en crois rien, mais si le fait est certain, l'âme est Corporelle; ou bien je ne sais ce que c’est ni que l'âme ni que le Corps.
[27] Où mon maître enseignait. Sextus parte de son maître Hérodote de Tarse, auquel il succéda, comme on le voit par ce passage.
[28] Hésiode.
[29] Des parties. C’est-à-dire des parties qui soient à droite ou à gauche, en haut ou en bas, &c.
[30] Comment peuvent-ils dire que le Lieu est encore un espace ? Cela veut dire qu'un espace ou un intervalle occupé n’est plus un espace, oui ne peut être dit espace à l'égard d'un corps, qu’en tant qu'il peut être occupé, mais non pas quand il est rempli & occupé actuellement par ce corps; parce qu’alors il n’est pas différent du corps même parce qu’il est occupé
[31] Un certain espace, une certaine quantité du mouvement de la machine ronde du monde, ou le monde lui-même.
[32] Quelques uns disaient que le Temps était le mouvement de l’Univers, ou du premier mobile ; & d'autres disaient que c’était le premier mobile. Plutarque attribue la première de ces deux opinions à Platon et la seconde à Pythagore.
[33] Ou la mesure numérale qui se remarque dans le mouvement.
[34] Ou ce qui accompagne les jours, les nuits & les heures &c. Toutes ces choses là sont des accidents, & ainsi le Temps qui accompagne ou qui est une suite de ces accidents, est l’accident des accidents. Epicure ne prenait pas ici les jours, les nuits et les heures comme des portions du Temps, mais comme des accidents, savoir les jours comme une illumination accidentelle de l’air, les nuits comme une obscurité accidentelle, et les heures comme des portions de cette illumination, ou de cette obscurité accidentelle de l'air : de sorte que sa pensée était que le Temps n'était rien par lui même, & ne consistait qu'en ce que de tous ces accident dont Sextus parle ici, on en concevait quelques-uns comme passés & d’autres comme présents & d’autres comme futurs: & voilà pourquoi il disait que le Temps était l'accident des accidents.
[35] Et le Deux indéfini. C’est-à-dire, le Deux universel, par la communication ou participation duquel tous les Deux particuliers, sont des Deux. Voilà un universale formale a parte rei, une certaine nature réelle & indépendante de la pensée, à laquelle tous les Êtres, qui ont une semblable forme ou une semblable nature, participent. Les Pythagoriciens voulaient que l'unité & les nombres soient des formes qui survenaient aux choses nombrées ou dénommées une, ou deux, ou trois &c.
[36] Suivant les Pythagoriciens, le point représentait l’unité, la ligne, qui est le flux d'un point à un autre point, représentait le Deux; la superficie, qui est le flux de la ligne vers un point hors de cette ligne, représentait le Trois; & le corps, qui est le flux de la superficie vers un point hors d'elle, représentait le Quatre
[37] Seront un nombre, c'est-à-dire, les hommes seront un Nombre, et les bœufs un Nombre, etc.
[38] Définition du Bien … suivant les Stoïciens. Mon exemplaire n'a point ce titre, mais celui-ci; Des biens et des maux, et des choses indifférentes. Mais, comme il n’est point parlé de tout cela dans ce chapitre, je l'ai intitulé comme l'on voit ici.
[39] L’honnête Homme & l'ami: Les Stoïciens confondaient l'ami avec l’honnête homme parce que le Sage ne doit choisir pour ami qu'un honnête hommes & qu'un ami n’est ami, ou ne doit être regardé comme tel, que quand il est honnête homme. Au reste cet honnête homme & cet ami n’est pas différent de l'utilité ou de la vertu ; parce que l'utilité ou la vertu étant la principale partie de l'âme de cet honnête homme affecté d’une certaine manière, il n’est pas différent de cette principale partie de lui même, quoiqu'il ne soit pas composé de cette seule partie.
[40] Des biens & des maux & des choses indifférentes. Le titre de ce chapitre dans mon exemplaire est celui-ci : Que le bien se dit en trois manières : mais le sommaire de ce chapitre, tel que je le mets ici, me paraît plus naturel. Au reste des Chapitres 21 & 22 de mon exemplaire, je n'en fais qu’un, parce que mon titre les comprend tous deux.
[41] Le Chap. 22 dans mon exemplaire commence ici. Il traite des choses indifférentes ou neutres, c'est-à-dire, de celles qui ne sont comprises ni parmi les Biens ni parmi les Maux.
[42] Je joins à ce chapitre qui est le 23, dans mon exemplaire, une grande partie du chap. 24, parce que le sommaire de ce chapitre-ci s'étend jusques là.
[43] D'autres la mettent au rang des Maux. Les Cyniques, par exemple, Antisthène, qui était de cette Secte, est l’auteur de cette pensée, que Sextus rapporte ici aussitôt.
[44] Dans mon exemplaire, le chapitre 24 commence ici, mais mal; car c’est ici la suite de la même matière qui est traitée dans le chapitre 23 & qui est ici le 22.
[45] Ils disent que l'art est un système. C’est-à-dire, un assemblage, un amas de conceptions. &c.
[46] C’est ici le reste du chap. 24 dans mon exemplaire.
[47] De Germanie. M. Fabricius croît qu'il faut lire de Carmanie ou de Caramanie, qui est une province de la Perse, parce que les Germains ou Allemands ont été loués par leur chasteté par plusieurs Auteurs, & par Corneille Tacite entre autres.
[48] Mérion ou Mérionés. Le mot Grec py, ou fAtfiùt signifie en Latin fémur, la cuisse; & ce mot vient peut-être de /M/JW qui signifie divido. Creditur itaque Meriones Rex Cretensium sic vocatus, quia Cretenses, pueros, id est, nasculos dividebant, seu impuris suis assultibus diducere femora cogebant.
[49] Zénon de Citium ou de Cittium, était le fondateur de la Secte des Stoïciens, Cléanthe & Chrysippe, étaient de la même Secte.
[50] À Saturne. Sextus veut parler ici des Carthaginois qui sacrifiaient des hommes à Saturne.
[51] Sextus veut dire qu'Aristote mettait Dieu au delà ou au dessus du ciel. Voici comme Velleius l’Epicurien parle de la doctrine d'Aristote, dans le premier livre de la nature des Dieux. (Je suis ici la traduction de M. L’Abbé d'Olivet tom. I. p. 47.) Aristote, dans son troisième Livre de la Philosophie, ne s'explique pas toujours d'une manière uniforme sur ce sujet, en cela disciple fidèle de Platon. Tantôt il veut que toute la Divinité réside dans l'intelligence. Tantôt, que le Monde soit Dieu, Après il en reconnaît quelque autre, qui est au dessus du Monde, dit-il, & qui a soin d'en régler, & d'en conserver le mouvement par une espèce de révolution. Ailleurs il enseigne que Dieu n’est autre chose que ce feu oui brille dans le Ciel comme sir le Ciel était autre chose lui même, qu'une partie de ce Monde, qu'il nous donnait tout à l'heure pour un Dieu? Remarquez que par cette Intelligence, dans laquelle Aristote veut quelquefois, que réside toute la Divinité, il faut entendre le principe intelligent, par lequel pensent tous les Êtres pensants, comme le remarque M. l'Abbé d’Olivet dans une note.
[52] De Cléobis & de Biton. Solon, dans Hérodote, liv. 1, raconte cette histoire à Crésus Roi de Lydie. Voici en peu de mots ce que c'est. La mère de ces deux jeunes hommes était une Prêtresse d'Argos, un jour de la fête de Junon, qu'il fallait que cette femme se rendît dans un temple, où elle devait sacrifier, les bœufs qui devaient traîner son char, ne se trouvant point, & son départ ne pouvant se retarder, ses deux fils traînèrent son char pendant tout le chemin qui était de quarante cinq stades. Le sacrifice se fit donc à l'ordinaire, & la Prêtresse transportée de joie a cause de la piété & de la vertu de ses fils, pria la Déesse Junon de leur accorder ce qui était le plus avantageux à l'Homme. L'effet de cette prière fut que Cléobis & Biton, s'étant endormis dans le temple, après le festin du sacrifice, ne se réveillèrent plus: les Dieux témoignant par là que la mort est plus avantageuse aux hommes, que la vie.
[53] A la fantaisie compréhensive. C’est-à-dire, aux idées vraies, ou aux perceptions de l’âme qui sont conformes aux choses.
[54] Ils tombent dans le Diallèle. Voici comment: Si l'idée vraie tire son origine d’un Être, on ne peut pas connaître cette idée, avant l'Être qui en est l'origine, & il faut nécessairement connaître cet objet, pour être assuré que l'idée que l'on a, y est conforme. Mais d'ailleurs l'idée étant produite par l'objet qui meut la faculté compréhensive, on ne peut pas connaître l'objet que par l'idée qui en est l'effet ou la copie ; & ainsi on ne peut connaître la vérité de l'idée, avant que d'avoir connu l'objet, auquel on dit qu'elle est conforme, ni connaître l'objet avant que de connaître si l'idée que l'on en a, y est ressemblante. Sextus dans son fécond livre contre les Logiciens p. m. 475, rapporte une définition de la fantaisie compréhensive (selon les Stoïciens) qui est un pur Diallèle. La voici: La fantaisie compréhensive est celle qui tirant son origine d'une chose qui existe, est conforme à cette chose qui existe. Le Diallèle saute ici aux yeux : car pour connaître ce que c’est que cette fantaisie compréhensive, il faut auparavant comprendre cette chose qui existe dont elle tire son origine, & cependant on ne peut comprendre cette chose que par la fantaisie compréhensive qui y est conforme. Voilà le Diallèle.
[55] Car l’esprit des Hommes &c. C’est ici un passage d'Homère Odyssée, liv. 18, qui signifie qu'il n'y a rien de plus journalier que l'esprit de l'Homme, & que jamais il ne le ressemble à lui même deux jours de suite, comme on ne voit pas deux jours qui se ressemblent.
[56] Que l'on peut dividere &c. Id est nefario libidinis venerea impetu cogere tam foemnas quam mares, ut femora diducant.
[57] Opposé à quelque chose, savoir, à ce qui est faux & qui n'existe pas, puisque le vrai qui lui est opposé existe.
[58] Par les raisons susdites. Parce que ce qui est évident n'a pas besoin d'être enseigné ; & que ce qui est obscur n'étant connu clairement ni à celui qui enseigné, ni à celui qui est enseigné, ne peut point être enseigné.
[59] Contre l’artisan & contre l’apprenti. Il faut entendre ici par artisan celui en général qui sait ce qu'il se mêle d'enseigner, & par apprenti celui qui ne sait point du tout l’art ou la science dont il veut s'instruire, ou qui n'en sait pas assez pour être maître. L'artisan, c’est le maître que l'on suppose être savant dans son art, & l'apprenti, c'est le disciple, ou qui est une table rase, ou qui n'a pas encore assez de connaissances par rapport à l'art ou à la science que l'on lui enseigne. Il est impossible d'assigner au juste les limites en deçà desquelles l'apprenti est encore apprenti, ou au-delà desquelles l'apprenti devient maître. Sextus n'oublie pas cela.
[60] Donc rien n'est enseigné par l'évidente. Sextus veut dire qu'il n’est pas besoin qu'un maître nous enseigne par l'évidence ce qui est évident. Personne n'a besoin de maître pour lui prouver par l'évidence qu'il y a un soleil, une lune, des étoiles, ou qu'il y a du mouvement: l'évidence seule fait cela sans le secours d'aucun maître. Donc l'évidence n’est pas un moyen d'enseigner, mais un moyen de connaître sans enseignement.
[61] Ou qui a du dégoût.
 μεταφυσικά
μεταφυσικά