Savoirs sur l’Homme (Naissance de la clinique)
Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires de France, © 1963. Extrait de Ibid., pages 622 et 623.
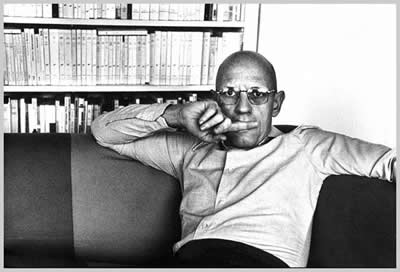 Il est important de déterminer comment et sur quel mode les diverses formes du savoir médical se réfèrent aux notions positives de « santé » et de « normalité ». D'une façon très globale, on peut dire que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la médecine s'est référée beaucoup plus à la santé qu'à la normalité ; elle ne prenait pas appui sur l'analyse d'un fonctionnement « régulier » de l'organisme pour chercher où il est dévié, par quoi il est perturbé, comment on peut le rétablir ; elle se référait plutôt à des qualités de vigueur, de souplesse, de fluidité que la maladie ferait perdre et qu'il s'agirait de restaurer. Dans cette mesure, la pratique médicale pouvait accorder une grande place au régime, à la diététique, bref, à toute une règle de vie et d'alimentation que le sujet s'imposait à lui-même. Dans ce rapport privilégié de la médecine à la santé se trouvait inscrite la possibilité d'être médecin de soi-même. La médecine du XIXe siècle s'ordonne plus, en revanche, à la normalité qu'à la santé ; c'est par rapport à un type de fonctionnement ou de structure organique qu'elle forme ses concepts et prescrit ses interventions ; et la connaissance physiologique, autrefois savoir marginal pour le médecin et purement théorique, va s'installer (Claude Bernard en porte témoignage) au cœur même de toute réflexion médicale. Il y a plus : le prestige des sciences de la vie au XIXe siècle, le rôle de modèle qu'elles ont mené, surtout dans les sciences de l'homme, n'est pas lié primitivement au caractère compréhensif et transférable des concepts biologiques, mais plutôt au fait que ces concepts étaient disposés dans un espace dont la structure profonde répondait à l'opposition du sain et du morbide. Lorsqu'on parlera de la vie des groupes et des sociétés, de la vie de la race, ou même de la « vie psychologique », on ne pensera pas seulement à la structure interne de l'être organisé, mais à la bipolarité médicale du normal et du pathologique. La conscience vit, puisqu'elle peut être altérée, amputée, dérivée de son cours, paralysée ; les sociétés vivent puisqu'il y en a de malades qui s'étiolent, et d'autres, saines, en pleine expansion ; la race est un être vivant qu'on doit dégénérer ; et les civilisations aussi, dont on a pu constater tant de fois la mort. Si les sciences de l'homme sont apparues dans le prolongement des sciences de la vie, c'est peut-être parce qu'elles étaient biologiquement sous-tendues, mais c'est aussi qu'elle l'étaient médicalement : sans doute par transfert, importation et souvent métaphore, les sciences de l'homme ont utilisé des concepts formés par les biologistes ; mais l'objet même qu'elles se donnaient (l'homme, ses conduites, ses réalisations individuelles et sociales) se donnait donc un champ partagé selon le principe du normal et du pathologique. D'où le caractère singulier des sciences de l'homme, impossibles à détacher de la négativité où elles sont apparues, mais liées aussi à la positivité qu'elles situent, implicitement, comme norme.
Il est important de déterminer comment et sur quel mode les diverses formes du savoir médical se réfèrent aux notions positives de « santé » et de « normalité ». D'une façon très globale, on peut dire que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la médecine s'est référée beaucoup plus à la santé qu'à la normalité ; elle ne prenait pas appui sur l'analyse d'un fonctionnement « régulier » de l'organisme pour chercher où il est dévié, par quoi il est perturbé, comment on peut le rétablir ; elle se référait plutôt à des qualités de vigueur, de souplesse, de fluidité que la maladie ferait perdre et qu'il s'agirait de restaurer. Dans cette mesure, la pratique médicale pouvait accorder une grande place au régime, à la diététique, bref, à toute une règle de vie et d'alimentation que le sujet s'imposait à lui-même. Dans ce rapport privilégié de la médecine à la santé se trouvait inscrite la possibilité d'être médecin de soi-même. La médecine du XIXe siècle s'ordonne plus, en revanche, à la normalité qu'à la santé ; c'est par rapport à un type de fonctionnement ou de structure organique qu'elle forme ses concepts et prescrit ses interventions ; et la connaissance physiologique, autrefois savoir marginal pour le médecin et purement théorique, va s'installer (Claude Bernard en porte témoignage) au cœur même de toute réflexion médicale. Il y a plus : le prestige des sciences de la vie au XIXe siècle, le rôle de modèle qu'elles ont mené, surtout dans les sciences de l'homme, n'est pas lié primitivement au caractère compréhensif et transférable des concepts biologiques, mais plutôt au fait que ces concepts étaient disposés dans un espace dont la structure profonde répondait à l'opposition du sain et du morbide. Lorsqu'on parlera de la vie des groupes et des sociétés, de la vie de la race, ou même de la « vie psychologique », on ne pensera pas seulement à la structure interne de l'être organisé, mais à la bipolarité médicale du normal et du pathologique. La conscience vit, puisqu'elle peut être altérée, amputée, dérivée de son cours, paralysée ; les sociétés vivent puisqu'il y en a de malades qui s'étiolent, et d'autres, saines, en pleine expansion ; la race est un être vivant qu'on doit dégénérer ; et les civilisations aussi, dont on a pu constater tant de fois la mort. Si les sciences de l'homme sont apparues dans le prolongement des sciences de la vie, c'est peut-être parce qu'elles étaient biologiquement sous-tendues, mais c'est aussi qu'elle l'étaient médicalement : sans doute par transfert, importation et souvent métaphore, les sciences de l'homme ont utilisé des concepts formés par les biologistes ; mais l'objet même qu'elles se donnaient (l'homme, ses conduites, ses réalisations individuelles et sociales) se donnait donc un champ partagé selon le principe du normal et du pathologique. D'où le caractère singulier des sciences de l'homme, impossibles à détacher de la négativité où elles sont apparues, mais liées aussi à la positivité qu'elles situent, implicitement, comme norme.
[…] Il restera sans doute décisif pour notre culture que le premier discours scientifique tenu par elle sur l'individu ait dû passer par ce moment de la mort. C'est que l'homme occidental n'a pu se constituer à ses propres yeux comme objet de science, il ne s'est pris à l'intérieur de son langage et ne s'est donné en lui et par lui une existence discursive qu'en référence à sa propre destruction : de l'expérience de la Déraison sont nées toutes les psychologies et la possibilité même de la psychologie ; de la mise en place de la mort dans la pensée médicale est née une médecine qui se donne comme science de l'individu. Et d'une façon générale, l'expérience de l'individualité dans la culture moderne est peut-être liée à celle de la mort : des cadavres ouverts de Bichat à l'homme freudien, un rapport obstiné à la mort prescrit à l'universel son visage singulier et prête à la parole de chacun le pouvoir d'être indéfiniment entendue ; l'individu lui doit un sens qui ne s'arrête pas avec lui. Le partage qu'elle trace et la finitude dont elle impose la marque nouent paradoxalement l'universalité du langage à la forme précaire et irremplaçable de l'individu. Le sensible, inépuisable à la description, et que tant de siècles ont voulu dissiper, trouve enfin dans la mort la loi de son discours. Elle donne à voir, dans un espace articulé par le langage, la profusion des corps et leur ordre simple.