| index | précédent | suivant |
|---|
- >2016
des années Bonheur ?
Cet article autour des années Pompidou (62-73) m’aura en tout cas fait irrésistiblement me souvenir de ce sketch de F Raynaud dont l'humour joliment désuet ressemble tellement à cette époque.
Ces années-là sont celles de la fin de mon enfance et de mon adolescence et si je n'en ai pas la nostalgie, je les sens bien et sais néanmoins combien elles ont contribué à me former. J'ai ainsi toujours été convaincu que le contexte économique plutôt favorable de cette période ne contribua pas pour peu dans le caractère collectif des contestations. Cette époque avait encore des réflexes sociaux : que ce soit pour l'approuver au nom des incontestables progrès qu'elle réalisait ou pour la critiquer à cause des indéniables injustices qu'elle perpétrait, cette société ne se voyait pas d'autre avenir que collectif. Les crises interminables se succédant les unes aux autres feront bientôt place à un sauve-qui-peut très individualiste que l'idéologie libérale bientôt souveraine finira par consacrer.
Je n'ignore pas que l'on puisse aussi arguer du contraire en considérant que l'individu ne peut précisément éclore que sur fond d’une société suffisamment aisée pour assurer l'essentiel de nos conditions de survie et que c'est plutôt dans les cas de grands dangers que l'élan collectif se soude. Les deux sont sans doute vrais ensemble, tout particulièrement en ces années qui sont bien des années charnières - il suffit de regarder des photos prises au hasard où les ultimes bidonvilles de l'après-guerre cèdent le pas devant la victoire annoncée du béton, pour que l'évidence saute aux yeux.
 1967 : à peine trente ans après le Front Populaire, la débâcle, vingt ans seulement après la Libération, cinq ans tout juste après la fin de la guerre d'Algérie. Un régime solide, avec toutes les apparences de la démocratie, sûr de lui avec à sa tête un héros emblématique, autoritaire, sachant en tout cas où il veut aller, qui une fois débarrassé des ultimes soubresauts des guerres coloniales, s'engageait résolument dans la voie d'une industrialisation à marche forcée en même temps que dans la restauration de sa place internationale. Restait sans doute de ces grands événements qui la précédèrent, le sentiment fort, et fortement politique, que c'était bien par une action collective que les choses pouvaient progresser et la culture très interventionniste d'un État, nécessairement fort, allait évidemment dans ce sens. Gaullistes d'un côté, marxistes de toute obédience de l'autre partageaient cette conviction et cette foi dans le politique.
1967 : à peine trente ans après le Front Populaire, la débâcle, vingt ans seulement après la Libération, cinq ans tout juste après la fin de la guerre d'Algérie. Un régime solide, avec toutes les apparences de la démocratie, sûr de lui avec à sa tête un héros emblématique, autoritaire, sachant en tout cas où il veut aller, qui une fois débarrassé des ultimes soubresauts des guerres coloniales, s'engageait résolument dans la voie d'une industrialisation à marche forcée en même temps que dans la restauration de sa place internationale. Restait sans doute de ces grands événements qui la précédèrent, le sentiment fort, et fortement politique, que c'était bien par une action collective que les choses pouvaient progresser et la culture très interventionniste d'un État, nécessairement fort, allait évidemment dans ce sens. Gaullistes d'un côté, marxistes de toute obédience de l'autre partageaient cette conviction et cette foi dans le politique.
C'est ceci qui a le plus changé ; qui a disparu. Il y eut assurément quelque naïveté à attendre tout, ou presque, d'un État qu'on n'hésita pas à qualifier de providence, mais lui seul paraissait pouvoir conférer quelque solidité et durée. C'était le temps où réforme signifiait amélioration et l'on n'imaginait pas, même en regrettant que ceci n'allât pas plus vite, que le mouvement général pût aller dans un autre sens que la prospérité accrue.
Ces années-là ne cherchaient pas de solution dans un retour au passé mais, résolument confiantes en l'avenir, s'efforçaient de tempérer les inévitables troubles provoqués par une mutation trop rapide - assurées qu'elles étaient de leurs forces mais aussi de la bienveillance du grand protecteur qui était à leur tête. Est-ce ceci qu'on appelle le bonheur ?
Il n'est pas étonnant, au regard de ce qui se sera passé depuis, qu'elles éveillent quelque nostalgie ; pour autant ce serait se méprendre, et confondre histoire avec émotion, que de supposer que tout y fût rose. Le mot crise n'attendit pas le premier choc pétrolier de 73 pour envahir journaux et ondes : il était déjà au centre des chroniques d'alors : crise internationale, du Moyen Orient ou du Viet-Nam, crise monétaire (dévaluation de la Livre) ; crise agricole etc …
Les choses allaient bien mais nous ne le savions pas. Au même titre qu'aujourd'hui nous sommes plus pessimistes - déclinistes ? - que les afghans ou pakistanais.
Quelques évidences
Ce qui me suggère plusieurs réflexions - parfois triviales - mais qu'il n'est pas sot de rappeler :
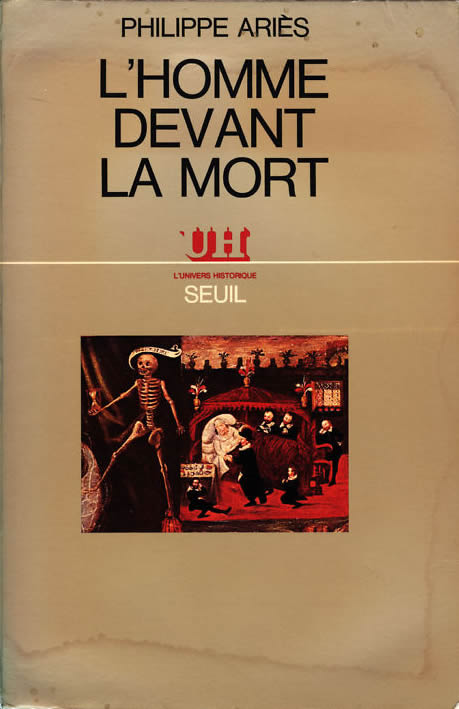 ne pas confondre la confrontation des faits avec les reconstructions mentales qu'on en peut former a posteriori. La première est l'objet de l'histoire ; la seconde, souvent, des idéologies. Rien n'est plus dangereux à cet égard que les délires autour du roman ou du récit national. Quand bien même ce fut une véritable avancée théorique d'intégrer une histoire des mentalités, celle-ci ne saurait résumer à elle seule l'Histoire ni lui épargner la nécessaire critique des documents. Faut-il le rappeler ? notre regard est toujours trop partiel et partial pour valoir preuve. C'est ce que Rioux rappelle en affirmant
ne pas confondre la confrontation des faits avec les reconstructions mentales qu'on en peut former a posteriori. La première est l'objet de l'histoire ; la seconde, souvent, des idéologies. Rien n'est plus dangereux à cet égard que les délires autour du roman ou du récit national. Quand bien même ce fut une véritable avancée théorique d'intégrer une histoire des mentalités, celle-ci ne saurait résumer à elle seule l'Histoire ni lui épargner la nécessaire critique des documents. Faut-il le rappeler ? notre regard est toujours trop partiel et partial pour valoir preuve. C'est ce que Rioux rappelle en affirmant
On peut accéder à ce qui, plus tard, apparaîtra comme une période considérée nostalgiquement comme heureuse, par exemple la Belle Époque ou les “trente glorieuses”, en l’ignorant sur le moment, mais en gardant tout de même l’espoir que les actions du présent profiteront aux générations suivantes.
- nous n'avons jamais conscience de l'histoire en train de se faire sous nos yeux : la France d'alors liquide les ultimes rémanences d'un pays agricole encore prédominant en 14, cherche - et semble trouver - sa posture de puissance intermédiaire après le double désastre des deux guerres mondiales mais où trouver le juste regard d'entre les anciens assistant à la disparition brusque de leur monde et les jeunes - catégorie pléthorique mais turbulente en ces années où les baby boomers accèdent à l'age adulte - qui estiment qu'il n'avance pas assez vite ? Tout juste peut-on observer que le rapport de forces jouait en leur faveur - au moins par le nombre - ce que 68 allait illustrer. Sans surestimer le poids des données démographiques, au reste ambiguës puisque la France sait encore préserver vigoureusement sa natalité en dépit de sa déprime, il faut bien admettre que voici fait qui éloigne vertigineusement la France d'alors de celle d’aujourd’hui : c'était alors un pays jeune ; c'est aujourd'hui un pays vieillissant qui le rapproche plus de celui des années trente où épuisé, craintif, on s'allait bientôt chercher refuge dans l'illusion d'un retour en arrière réparateur ourdi par un père Fouettard sénescent !
Fin d'une époque, début d'une nouvelle ou simple transition ?
Toujours est-il que cette vague forte d'industrialisation aura été conçue comme la marque de la modernité et le signe même de a renaissance. Pouvions-nous savoir qu'elle ne serait que transitoire et que trente années à peine plus tard, le pays s'engagerait dans la désindustrialisation ?
Voici pointée toute la cécité de l'observateur comme de l'acteur de l'Histoire : le recul permet sans grande difficultés de constater que ces période de prospérité sont bien plutôt des exceptions que des normes - la référence bienvenue à la Belle Époque le désigne bien. Or, parce que nous nos dirigeants appartiennent à cette génération, aucun n'imagine d'autre stratégie pour sortir de la crise que les recettes d'antan, le retour à la croissance, le productivisme etc et révèlent qu'ils ne possèdent aucune grille de lecture leur permettant de penser et préparer l'autre grande transition qu'impliquent les menaces environnementaux.  cette période qui n'a d'yeux que pour la machine - il suffit de réécouter de Gaulle parler de la civilisation mécanique comme moteur de l'évolution pour le comprendre - est manifestement celle d'une prodigieuse inconscience qui plonge ses racines très loin - dans le devenir comme maître et possesseur de la nature de Descartes comme dans le siècle des Lumières qui parlera pour la première fois du bonheur comme une idée nouvelle (St Just) - dont nous portons aujourd'hui le faix. Cette période est terminée sans que rien ne nous prépare à un avenir que nous ne savons ni plus entrevoir que préparer et qu'aucune grande théorie, idéologie, aucun projet politique. C'est ce qui nous sépare le plus d'elle.
cette période qui n'a d'yeux que pour la machine - il suffit de réécouter de Gaulle parler de la civilisation mécanique comme moteur de l'évolution pour le comprendre - est manifestement celle d'une prodigieuse inconscience qui plonge ses racines très loin - dans le devenir comme maître et possesseur de la nature de Descartes comme dans le siècle des Lumières qui parlera pour la première fois du bonheur comme une idée nouvelle (St Just) - dont nous portons aujourd'hui le faix. Cette période est terminée sans que rien ne nous prépare à un avenir que nous ne savons ni plus entrevoir que préparer et qu'aucune grande théorie, idéologie, aucun projet politique. C'est ce qui nous sépare le plus d'elle. - rien n'est plus irrationnel, en tout cas moins scientifique, que le bonheur qui peut à l'occasion faire l'objet du discours politique - mais comment alors ne pas s'en méfier ? - moins mesurable en tout cas. Parce que la France d'alors venait de très bas et très loin, qu'elle sortait à peine de longues années de pénuries et de privations, elle s'est engouffrée avec une particulière gourmandise dans un appétit dévorant de consommation que l'on a vite fait d'assimiler au bonheur. Loin de moi l'idée d'entonner le grand air moralisateur d'un bonheur spirituel plus riche que la perdition dans les choses matérielles où d'y déceler la cause profonde de ce grand mouvement de déchristianisation qui ira chercher ailleurs ses valeurs sacrées ; pour autant, comment ne pas constater que si le malheur est aisément repérable - guerres, souffrances, extrême pauvreté, chômage etc - le bonheur quant à lui s'avère plutôt comme le grand silence des âmes. Hegel n'avait pas tort : les peuples heureux n'ont pas d'histoire.
De la même manière que la guerre est toujours l'intrusion de la grande histoire dans la petite; le bouleversement des destinées individuelles par le sort collectif, de la même manière le bonheur se situe à l'exacte croisée entre raison et émotion, entre subjectif et objectif, mais surtout entre le local et le global. C'est cette croisée qui est intéressante.
Du bonheur
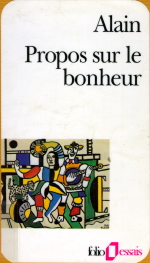 Partant de ce truisme que nul ne peut consciemment et volontairement aspirer au malheur, et qu'ainsi au moins par antiphrase que tous nous aspirions au bonheur, il faut bien admettre que nous parvenons malaisément à mettre du contenu derrière ce terme. Ne pas souffrir n'est qu'un premier pas et ne suffit pas à le définir même si ce pas est loin d'être négligeable. Alain, dans les propos qu'il lui consacra, le ramène surtout à la volonté - ce qui était bien dans la manière de ce républicain positiviste ! Qu'il relève de ce que l'on ébauche plutôt que de la passion, soit ! mais encore ? Qu'il n'y ait pas de projet politique qui ne le sous-entende - après tout l'on ne bâtit pas un projet de société pour que les choses soient pire qu'avant - est assez évident : le communisme lui-même dans son slogan de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, avait esquissé une organisation politique et économique dont la finalité était la reconnaissance de l'individu. Toute la question demeure de savoir jusqu'où peut le politique entreprendre : jusqu'à créer un homme nouveau - où l'on peut deviner le ferment de tous les totalitarismes - ou bien seulement préparer les conditions d'émergence de cet homme ? Où politique et psychologie vont se heurter : en dépit de la recherche d'un improbable continent freudo-marxiste, Éros semble bien, au yeux de Freud, totalement inconciliable avec la civilisation et le progrès un mythe bien fragile sous les poussées de Thanatos.
Partant de ce truisme que nul ne peut consciemment et volontairement aspirer au malheur, et qu'ainsi au moins par antiphrase que tous nous aspirions au bonheur, il faut bien admettre que nous parvenons malaisément à mettre du contenu derrière ce terme. Ne pas souffrir n'est qu'un premier pas et ne suffit pas à le définir même si ce pas est loin d'être négligeable. Alain, dans les propos qu'il lui consacra, le ramène surtout à la volonté - ce qui était bien dans la manière de ce républicain positiviste ! Qu'il relève de ce que l'on ébauche plutôt que de la passion, soit ! mais encore ? Qu'il n'y ait pas de projet politique qui ne le sous-entende - après tout l'on ne bâtit pas un projet de société pour que les choses soient pire qu'avant - est assez évident : le communisme lui-même dans son slogan de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, avait esquissé une organisation politique et économique dont la finalité était la reconnaissance de l'individu. Toute la question demeure de savoir jusqu'où peut le politique entreprendre : jusqu'à créer un homme nouveau - où l'on peut deviner le ferment de tous les totalitarismes - ou bien seulement préparer les conditions d'émergence de cet homme ? Où politique et psychologie vont se heurter : en dépit de la recherche d'un improbable continent freudo-marxiste, Éros semble bien, au yeux de Freud, totalement inconciliable avec la civilisation et le progrès un mythe bien fragile sous les poussées de Thanatos.
Le catholicisme avait eu au moins le mérite de ranger le bonheur au magasin des accessoires, les malheurs du monde n'étant jamais que le prix à payer d'une culpabilité originelle. A remiser le bonheur dans l'espérance lointaine d'une félicité paradisiaque, au moins permit-il à toute une culture de souffrir - dans tous les sens du terme - les malheurs du monde - en fait de les considérer comme norme du temporel. La modernité, certes, inventa le bonheur, mais surtout la frustration.
Au fond, tout ceci est-il bien vain - au sens de la vanité : le bonheur entendu comme pleine réalisation de ses désirs ne saurait s'entendre que comme une quête, certainement pas une conquête ; un désir réalisé est un désir mort et plongée dans l'inconscient. La dynamique de l'être tient assurément dans sa constante et renouvelée frustration.
Si je devais me replonger dans ces années-là et (re)raconter mon enfance, je dirais à peu près la même chose d'autant que mes parents s'étaient protégés à la fois du passé et de leurs famille en s'isolant dans un recoin perdu des frontières mosellanes où, de surcroît, le petit univers de l'école dressèrent encore plus ses murs de protection. Enfance heureuse d'abord parce qu'elle ne fut pas malheureuse et que rien ne m'y pesa ni ne m'entrave encore. Mais heureuse aussi parce que, entouré de la tendre affection de mes parents qui ne me demandèrent même pas d'être le meilleur à l'école mais seulement de faire au mieux, j'y aurai pu m'amuser, découvrir, m'intriguer parfois mais m'inquiéter jamais. Il y a dans le bonheur, enfantin en tout cas, quelque chose de l'ordre de l'innocence. Plus tard, lycéen puis étudiant, je m'initiai et transgressai sans doute quelques frontières sans que jamais le regard ne fut réprobateur. Heureux temps où l'on pouvait choisir sa voie sans trop se soucier des débouchés - c'est ainsi que j'empruntai les terres philosophiques. Oh bien sûr de me voir me destiner à l'enseignement ne pouvait pas déplaire, juste inquiéter que ce fût dans la discipline où il y avait le moins de postes à pourvoir mai j'entends encore mon père me dire que ce serait une autre manière de tuer que de contraindre un enfant à poursuivre une carrière qu'il ne désirait pas. Où le respect scrupuleux du 5e commandement n'allait-il pas se nicher …
Ce fut le temps de mes premières révoltes - antimilitaristes d'abord, guerre du Viet-Nam oblige, puis plus étroitement politique. En ces années-là être marxiste était une évidence, être gauchiste une obligation morale. Coincé entre la théorie et les camarades, je traversai ce monde que je ne connaissais pas, même si la classe ouvrière ne m'était, bien loin de là, pas étrangère. Ma répugnance à m'encaserner, mon horreur de tout dogmatisme firent que je ne m'y attardai pas vraiment. Me reste de ces années-là un violent dégoût devant cette bourgeoisie triomphante et cynique que Pompidou incarnait si fidèlement, et que l'étole de gloire épique d'un de Gaulle ne drapait même plus.
Ce monde allait bientôt disparaître et tout engloutir avec lui. Paradoxalement, mes années d'adulte furent celles où la gauche aura été beaucoup au pouvoir - vingt ans entre 81 et aujourd'hui - mais où crises après crises, les États se seront anémiés, la gauche reniée trop souvent, et les centaines de milliers de chômeurs ajouté aux millions qui les précédèrent … Au regard d'aujourd'hui, bien entendu, la période semble idyllique mais illustre surtout combien nous n'avions rien vu, ni vu venir ; rien compris à ce qui se passait. Me reste le goût non pas amer mais un peu désespérant devant ces révoltes vaines, ces luttes vite défaites, l'insolence incroyable de la bourgeoisie. L'inquiétude surtout devant notre impuissance à penser demain comme si une gauche moderne n'avait de sens qu'à se renier en teintant un peu, tout juste un peu, de social un libéralisme qui s'impose avec la violence de l'évidence et des partis pris.
J'entends encore ma mère me téléphoner au soir du 10 mai 81, un peu triste, pour me dire : maintenant ils nous ont même volé l'espoir ! Le malheur est-il vraiment le prix à payer pour que renaisse l'espoir. Si tel était le cas, assurément l'avenir serait le grand moment de la résurrection de l'espérance. Mais est-il encore des oreilles pour l'entendre, des langues pour la proclamer, des bouches pour la nourrir ?