Friedrich NIETZSCHE
(1844-1900)
Le cogito et les illusions de la grammaire
8 textes autour de l'illusion du cogito tirée des pièges tendus par la grammaire
1886
[La pensée ne prouve pas qu’il y ait un sujet, je, qui en soit la cause.
La certitude immédiate du « je pense » est un piège de la grammaire.]
Texte 1
Nietzsche, La Volonté de puissance (1886),
trad. G. Bianquis, t. I, livre I, Gallimard 1947, § 98, p. 65. {retour}
Soyons plus prudents que Descartes qui est resté pris au piège des mots. Cogito, à vrai dire, n’est qu’un seul mot, mais le sens en est complexe. Dans ce célèbre cogito, il y a : 1° quelque chose pense ; 2° je crois que c’est moi qui pense ; 3° mais en admettant même que ce deuxième point soit incertain, étant matière de croyance, le premier point : quelque chose pense, contient également une croyance, celle que « penser » soit une activité à laquelle il faille imaginer un sujet, ne fût-ce que « quelque chose » ; et l’ergo sum ne signifie rien de plus. Mais c’est la croyance à la grammaire, on suppose des « choses » et leurs « activités », et nous voilà bien loin de la certitude immédiate.
Texte 2
Nietzsche, Considérations inactuelle III, "Schopenhauer éducateur" §1, Folio Essais p. 19-20 {retour}
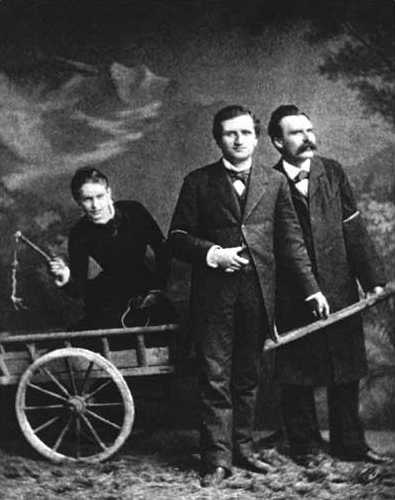 Mais comment nous retrouver nous-mêmes ? Comment l’homme peut-il se connaître ? C’est une chose obscure et voilée. Et s’il est vrai que le lièvre a sept peaux, l’homme peut se dépouiller de septante fois sept peaux avant de pouvoir se dire : Voici vraiment ce que tu es, ce n’est plus une enveloppe. C’est par surcroît une entreprise pénible et dangereuse que de fouiller ainsi en soi-même et de descendre de force, par le plus court chemin, jusqu’au tréfonds de son être. Combien l’on risque de se blesser, si grièvement qu’aucun médecin ne pourra nous guérir ! Et de plus, est-ce bien nécessaire alors que tout porte témoignage de ce que nous sommes, nos amitiés comme nos haines, notre regard et la pression de notre main, notre mémoire et nos oublis, nos livres et les traits que trace notre plume ? Mais voici comment il faut instaurer l’interrogatoire essentiel entre tous. Que la jeune âme […] se demande : « Qu’as-tu vraiment aimé jusqu’à ce jour ? Vers quoi t’es-tu sentie attirée, par quoi t’es-tu sentie dominée et comblée à la fois ? Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets de vénération, et peut-être, par leur nature et leur succession, te révèleront-ils la loi fondamentale de ton vrai moi. Compare ces objets entre eux, vois comment ils se complètent, s’élargissent, se surpassent, s’illuminent mutuellement, comment ils forment une échelle graduée qui t’a servi à t’élever jusqu’à ton moi. Car ton être vrai n’est pas caché tout au fond de toi : il est placé infiniment au-dessus de toi, à tout le moins au-dessus de ce que tu prends communément pour ton moi. »
Mais comment nous retrouver nous-mêmes ? Comment l’homme peut-il se connaître ? C’est une chose obscure et voilée. Et s’il est vrai que le lièvre a sept peaux, l’homme peut se dépouiller de septante fois sept peaux avant de pouvoir se dire : Voici vraiment ce que tu es, ce n’est plus une enveloppe. C’est par surcroît une entreprise pénible et dangereuse que de fouiller ainsi en soi-même et de descendre de force, par le plus court chemin, jusqu’au tréfonds de son être. Combien l’on risque de se blesser, si grièvement qu’aucun médecin ne pourra nous guérir ! Et de plus, est-ce bien nécessaire alors que tout porte témoignage de ce que nous sommes, nos amitiés comme nos haines, notre regard et la pression de notre main, notre mémoire et nos oublis, nos livres et les traits que trace notre plume ? Mais voici comment il faut instaurer l’interrogatoire essentiel entre tous. Que la jeune âme […] se demande : « Qu’as-tu vraiment aimé jusqu’à ce jour ? Vers quoi t’es-tu sentie attirée, par quoi t’es-tu sentie dominée et comblée à la fois ? Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets de vénération, et peut-être, par leur nature et leur succession, te révèleront-ils la loi fondamentale de ton vrai moi. Compare ces objets entre eux, vois comment ils se complètent, s’élargissent, se surpassent, s’illuminent mutuellement, comment ils forment une échelle graduée qui t’a servi à t’élever jusqu’à ton moi. Car ton être vrai n’est pas caché tout au fond de toi : il est placé infiniment au-dessus de toi, à tout le moins au-dessus de ce que tu prends communément pour ton moi. »
Généalogie de la morale
Texte 3 {retour}
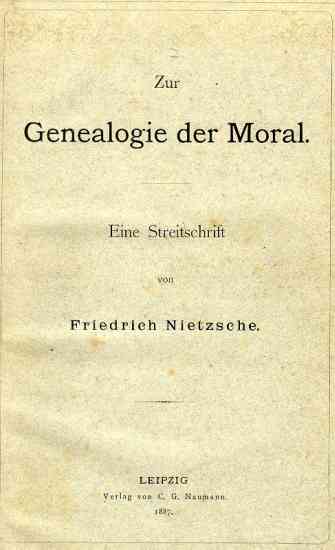 De tout temps on a voulu « améliorer » les hommes : c’est cela, avant tout, qui est appelé morale. Mais sous ce même mot « morale » se cachent les tendances les plus différentes. La domestication de la bête humaine, tout aussi bien que l’élevage d’une espèce d’hommes déterminée, est une « amélioration » : ces termes zoologiques expriment seuls des réalités, — mais ce sont là des réalités dont l’« améliorateur » type, le prêtre, ne sait rien en effet, — dont il ne veut rien savoir… Appeler « amélioration » la domestication d’un animal, c’est là, pour notre oreille, presqu’une plaisanterie. Qui sait ce qui arrive dans les ménageries, mais je doute bien que la bête y soit « améliorée ». On l’affaiblit, on la rend moins dangereuse, par le sentiment dépressif de la crainte, par la douleur et les blessures on en fait la bête malade. Il n’en est pas autrement de l’homme apprivoisé que le prêtre a rendu « meilleur ».
De tout temps on a voulu « améliorer » les hommes : c’est cela, avant tout, qui est appelé morale. Mais sous ce même mot « morale » se cachent les tendances les plus différentes. La domestication de la bête humaine, tout aussi bien que l’élevage d’une espèce d’hommes déterminée, est une « amélioration » : ces termes zoologiques expriment seuls des réalités, — mais ce sont là des réalités dont l’« améliorateur » type, le prêtre, ne sait rien en effet, — dont il ne veut rien savoir… Appeler « amélioration » la domestication d’un animal, c’est là, pour notre oreille, presqu’une plaisanterie. Qui sait ce qui arrive dans les ménageries, mais je doute bien que la bête y soit « améliorée ». On l’affaiblit, on la rend moins dangereuse, par le sentiment dépressif de la crainte, par la douleur et les blessures on en fait la bête malade. Il n’en est pas autrement de l’homme apprivoisé que le prêtre a rendu « meilleur ».
Texte 4
la psychologie de la volonté est une imposture perverse {retour}
Il ne nous reste aujourd’hui plus aucune espèce de compassion avec l’idée du « libre arbitre » : nous savons trop bien ce que c’est — le tour de force théologique le plus mal famé qu’il y ait, pour rendre l’humanité « responsable » à la façon des théologiens, ce qui veut dire : pour rendre l’humanité dépendante des théologiens… Je ne fais que donner ici la psychologie de cette tendance à vouloir rendre responsable. — Partout où l’on cherche des responsabilités, c’est généralement l’instinct de punir et de juger qui est à l’œuvre. On a dégagé le devenir de son innocence lorsque l’on ramène un état de fait quelconque à la volonté, à des intentions, à des actes de responsabilité : la doctrine de la volonté a été principalement inventée à fin de punir, c’est-à-dire avec l’intention de trouver un coupable. Toute l’ancienne psychologie, la psychologie de la volonté n’existe que par le fait que ses inventeurs, les prêtres, chefs de communautés anciennes, voulurent se créer le droit d’infliger une peine ou plutôt qu’ils voulurent créer ce droit pour Dieu… Les hommes ont été considérés comme « libres », pour pouvoir être jugés et punis, — pour pouvoir être coupables : par conséquent toute action devait être regardée comme voulue, l’origine de toute action comme se trouvant dans la conscience.
Texte 5 {retour}
Je considère la mauvaise conscience comme le profond état morbide où l’homme devait tomber sous l’influence de cette transformation, la plus radicale qu’il ait jamais subie – de cette transformation qui se produisit lorsqu’il se trouva définitivement enchaîné dans le carcan de la société et de la paix. (…) Tous les instincts qui n’ont pas de débouché, que quelque force répressive empêche d’éclater au-dehors, retourne en dedans – c’est là ce que j’appelle l’intériorisation de l’homme : de cette façon se développe en lui ce que plus tard on appellera son « âme ». Tout le monde intérieur, d’origine mince à tenir entre cuir et chair, s’est développé et amplifié, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur, lorsque l’expansion de l’homme vers l’extérieur a été entravée. Ces formidables bastions que l’organisation sociale a élevés pour se protéger contre les vieux instincts de liberté – et il faut placer le châtiment au premier rang de ces moyens de défense – ont réussi à faire se retourner tous les instincts de l’homme sauvage, libre et vagabond – contre l’homme lui-même. La rancune, la cruauté, le besoin de persécution – tout cela se dirigeant contre le possesseur de tels instincts : c’est là l’origine de la « mauvaise conscience ». (…) Mais alors fut introduite la plus grande et la plus inquiétante de toutes les maladies, dont l’humanité n’est pas encore guérie aujourd’hui, l’homme (…) malade de lui-même : conséquence d’un divorce violent avec le passé animal, (…) d’une déclaration de guerre contre les anciens instincts qui jusqu’ici faisaient sa force, sa joie et son caractère redoutable.
Friedrich Nietzsche, 1882, Le Gai Savoir, Livre V, 355, trad. P. Klossowski, UGE 10/18, 1981, p. 359-360.
[La connaissance ne doit pas prendre pour point de départ le monde de la conscience, qui lui est trop familier.]
Texte 6 {retour}
Honte à la suffisance de ceux qui prétendent connaître ! Que l’on examine sous ce rapport les principes et les solutions qu’ils proposent aux énigmes du monde.
Quand dans les choses, sous les choses, derrière les choses, ils retrouvent ce qui, par malheur, ne nous est que trop connu, par exemple notre table de multiplication ou notre logique, ou encore notre vouloir et notre convoitise, comme ils sont heureux, aussitôt ! Car « ce qui est connu est reconnu » : ils sont unanimes à cet égard. Mais les plus circonspects d’entre eux prétendent que le connu tout au moins serait plus facile à reconnaître que ce qui est étranger : il serait par exemple plus méthodique de prendre son point de départ dans le « monde intérieur », depuis les « faits de la conscience », parce que ce serait là le monde mieux connu de nous-mêmes ! Erreur des erreurs ! Le connu, c’est l’habituel, et l’habituel est ce qu’il y a de plus difficile à « reconnaître », c’est-à-dire à considérer en tant que problème, donc en tant qu’étranger, que lointain, que situé « hors de nous »… La grande assurance dont les sciences naturelles font preuve par rapport à la psychologie et la critique des éléments de la conscience — sciences que l’on pourrait dire antinaturelles — tient précisément au fait qu’elles prennent la réalité étrangère pour objet : tandis qu’il y a quelque chose de presque contradictoire et d’absurde à vouloir prendre pour objet ce qui n’est pas étranger…
Aurore
[Trad. Julien Hervier, Gallimard, coll. Idées]
Livre deuxième
Texte 7
115. Le prétendu « moi ». {retour}
Le langage et les préjugés sur lesquels repose le langage apportent de multiples obstacles à l’approfondissement des phénomènes internes et des instincts : par exemple du fait qu’il n’existe de mots que pour les degrés superlatifs de ces phénomènes et de ces instincts — ; par suite nous sommes habitués, là où les mots nous font défaut, à ne plus observer avec exactitude parce qu’il est malaisé de continuer à penser avec exactitude ; et l’on concluait autrefois automatiquement que là où s’arrête le royaume des mots, là s’arrête aussi le royaume de l’existence. Colère, haine, amour, pitié, désir, connaissance, joie, douleur, — tous ces noms ne conviennent qu’aux états extrêmes : lesétats plus doux, plus moyens, et surtout plus bas, qui sont constamment en jeu, nous échappent bien qu’ils tissent précisément la trame de notre caractère et de notre destin. Ces explosions extrêmes — et même le plaisir ou le déplaisir très modéré mais conscient pris a la dégustation d’un plat, à l’écoute d’un son, constitue peut‑être encore, si on l’apprécie à sa juste valeur, une explosion extrême — déchirent très souvent cette trame et forment alors des exceptions brutales, presque toujours consécutives à des accumulations : — et combien, à ce titre, elles peuvent induire l’observateur en erreur ! Tout comme elles induisent en erreur l’homme d’action. Tous, nous ne sommes pas ce que nous semblons être d’après les seuls états dont nous ayons conscience et pour lesquels nous ayons des mots — et par conséquent des louanges ou des blâmes — ; nous nous méconnaissons du fait de ces explosions grossières qui seules nous sont connues, nous tirons des conclusions à partir d’un matériel où les exceptions l’emportent sur la règle, nous nous enferrons dans la lecture d’une transcription apparemment si claire de notre moi. Mais notre opinion sur nous‑mêmes à laquelle nous sommes parvenus sur ces voies erronées, notre prétendu « moi » a désormais sa part dans l’élaboration de notre caractère et de notre destin.
Texte 8
116. Le monde inconnu du « sujet ». {retour}
Ce que les hommes ont tant de peine à comprendre, c’est leur ignorance sur eux‑mêmes, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours ! Non seulement sous le rapport du bien et du mal, mais sous des rapports beaucoup plus essentiels ! L’antique illusion selon laquelle on saurait, on saurait très précisément et dans tous les cas comment se produisent les actions humaines, est toujours vivante. Sans même parler du « Dieu qui voit dans les cœurs » ni de l’auteur de l’acte qui réfléchit avant d’agir, — non, personne ne doute de comprendre l’essentiel du processus selon lequel agit toute autre personne. « Je sais ce que je veux, ce que j’ai fait, je suis libre et responsable, je rends autrui responsable de ses actes, je peux nommer par leur nom toutes les possibilités morales et tous les mouvements intérieurs qui précèdent une action ; libre à vous d’accomplir n’importe quelle action, — en elle je me comprends et je vous comprends tous ! » — ainsi pensait autrefois tout le monde, ainsi pense encore presque tout le monde. Socrate et Platon, grands douteurs et admirables novateurs en ce domaine, étaient pourtant d’une crédulité innocente quant au plus fatal des préjugés, à la plus profonde des erreurs, à savoir que « de la juste connaissance doit résulter l’acte juste », — avec ce principe ils restaient toujours les héritiers de la folie et de la prétention générales : selon lesquelles il existe une connaissance de l’essence des actions. « Ce serait en effet terrible si de la connaissance parfaite de l’essence de l’acte juste ne résultait pas l’acte juste », — voilà le seul argument qui semblât nécessaire à ces grands hommes pour prouver cette idée, le contraire leur paraissait impensable et dément — et c’est pourtant le contraire qui est la réalité toute nue, démontrée chaque jour et à chaque heure de toute éternité ! La « terrible » réalité ne consiste‑t‑elle pas justement en cela : tout ce que l’on peut savoir d’un acte ne suffit jamais pour l’accomplir, en aucun cas on n’a encore pu jeter un pont de la connaissance à l’acte ? Les actions ne sont jamais ce qu’elles nous paraissent être ! Nous avons eu tant de mal à apprendre que les choses extérieures ne sont pas telles qu’elles nous apparaissent, — eh bien ! il en va de même du monde intérieur ! Les actions morales sont en vérité « quelque chose d’autre » — nous ne pouvons en dire davantage : et toutes les actions sont essentiellement inconnues. Le contraire était et est encore la croyance générale : — nous avons contre nous le plus ancien des réalismes ; jusqu’ici l’humanité pensait : « une action est telle qu’elle nous semble être ». (En relisant ces mots, un passage très significatif de Schopenhauer me revient en mémoire, et je voudrais le citer pour prouver que lui aussi restait et est toujours resté attaché sans aucun scrupule à ce réalisme moral : « En vérité chacun de nous est un juge compétent et parfaitement moral, connaissant précisément le bien et le mal, saint dans la mesure où il aime le bien et abomine le mal, — voilà ce qu’est chacun, tant qu’il n’examine pas ses propres actions mais celles d’autrui et qu’il lui suffit de donner ou de refuser son approbation, tout le poids de l’exécution reposant sur des épaules étrangères. Chacun peut, par conséquent, jouer les confesseurs en lieu et place de Dieu. »)