S Haffner Histoire d'un allemand
pp 326-337
Non, il était impossible de se retirer dans une sphère privée. Où que l'on se retirât, on se retrouvait partout placé devant ce qu'on avait voulu fuir. Je compris que la révolution nazie avait aboli liancienne séparation entre la politique et la vie privée, et qu'il était impossible de la traiter simplement comme un "événement politique". Elle ne se produisait pas seulement dans le domaine politique, mais tout autant dans la vie de chaque individu ; elle agissait comme un gaz toxique qui traverse tous les murs. Si on voulait échapper à ses émanations, la seule solution était l'éloignement physique. L'exil. L'adieu au pays auquel on était attaché par la naissance, la langue, l'éducation, l'adieu à tous les liens de la patrie.
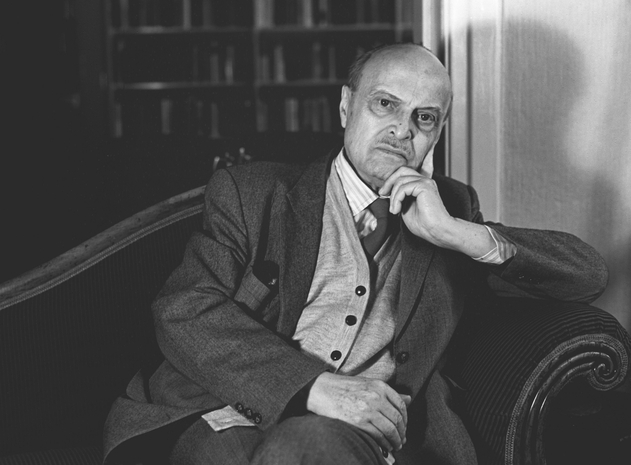 Au cours de cet été 1933, je me préparai à cet adieu-là. J'étais déjà accoutumé aux adieux petits et grands. j'avais perdu mes amis ; j'avais vu des gens que je fréquentais sans arrièrepensée se métamorphoser en assassins virtuels ou en ennemis prêts à me livrer à la Gestapo ; j'avais senti l'atmosphère de la vie quotidienne s'échapper sans laisser de trace ; des institutions aussi solidement fondées que la justice prussienne s'étaient écroulées sous mes yeux ; le monde des livres et des discussiOns avait disparu ; les opinions, les idées, les constructions de l'esprit s'étaient usées comme jamais -quant aux projets et aux perspectives fermes et raisonnables qui étaient les miens quelques mois auparavant, qu'étaientils devenus? L'aventure avait commencé. La façon dont je ressentais la vie avait changé radicalement. Je n'éprouvais pas seulement le déchirement de l'adieu, mais aussi l'étourdissement et l'ivresse qu'il procure. Je ne me sentais plus debout sur un sol stable, mais flottant, planant dans un espace vide, singulièrementléger, porté, libre comme l'air. Les pertes nouvelles, les nouveaux adieux ne me touchaient presque plus ; je me disais plutôt "laisse tomber" ou "allons, tu pourras te passer de cela comme du reste", et je me sentais certes de plus en plus pauvre, mais aussi de plus en plus léger. Et pourtant cet adieu -cet adieu intérieur à mon propre pays était encore difficile, pénible et douloureux. Il s'accomplissait lentement et par secousses, avec des rechutes ; je pensais parfois n'avoir jamais la force de partir pour de bon.
Au cours de cet été 1933, je me préparai à cet adieu-là. J'étais déjà accoutumé aux adieux petits et grands. j'avais perdu mes amis ; j'avais vu des gens que je fréquentais sans arrièrepensée se métamorphoser en assassins virtuels ou en ennemis prêts à me livrer à la Gestapo ; j'avais senti l'atmosphère de la vie quotidienne s'échapper sans laisser de trace ; des institutions aussi solidement fondées que la justice prussienne s'étaient écroulées sous mes yeux ; le monde des livres et des discussiOns avait disparu ; les opinions, les idées, les constructions de l'esprit s'étaient usées comme jamais -quant aux projets et aux perspectives fermes et raisonnables qui étaient les miens quelques mois auparavant, qu'étaientils devenus? L'aventure avait commencé. La façon dont je ressentais la vie avait changé radicalement. Je n'éprouvais pas seulement le déchirement de l'adieu, mais aussi l'étourdissement et l'ivresse qu'il procure. Je ne me sentais plus debout sur un sol stable, mais flottant, planant dans un espace vide, singulièrementléger, porté, libre comme l'air. Les pertes nouvelles, les nouveaux adieux ne me touchaient presque plus ; je me disais plutôt "laisse tomber" ou "allons, tu pourras te passer de cela comme du reste", et je me sentais certes de plus en plus pauvre, mais aussi de plus en plus léger. Et pourtant cet adieu -cet adieu intérieur à mon propre pays était encore difficile, pénible et douloureux. Il s'accomplissait lentement et par secousses, avec des rechutes ; je pensais parfois n'avoir jamais la force de partir pour de bon.
Et une fois encore, en parlant de moi, je ne raconte pas mon expérience individuelle et fortuite, mais celle de plusieurs milliers de gens.
Certes, en mars et en avril, tandis que la chute dans la boue s'accomplissait sous mes yeux, accompagnée de délire patriotique et des clameurs d'un nationalisme triomphant, j'avais déclaré dans des accès de rage que je voulais m'exiler, ne plus rien avoir à faire avec "ce pays", que j'aimais mieux vendre des cigarettes à Chicago que devenir secrétaire d'Etat en Allemagne, etc. Mais c'étaient là des crises irréfléchies et sans grande consistance. C'était une tout autre affaire, dans l'atmosphère glacée et raréfiée de ces mois d'adieu, que d'envisager vraiment et sérieusement de quitter mon pays.
Or, j'étais rien moins que nationaliste. Le nationalisme de club sportif tel qu'il avait régné pendant la guerre et tel qu'il nourrit aujourd'hui l'esprit des nazis, la joie de voir, avec une avidité . puérile, son pays représenté sur la carte sous la forme d'une grosse tache de couleur qui ne cesse de s'étendre, le sentiment de triomphe procuré par les "victoires", le plaisir d'humilier et d'asservir les autres, la délectation provoquée par la crainte que l'on inspire, l'éloge emphatique de sa propre nation dans le style des Maîtres chanteurs, cette masturbation cérébrale, affectation narcissique qui s'enorgueillit de penser allemand, de sentir allemand, insiste sur la fidélité allemande, exalte la valeur de l'homme allemand -"Sois allemand !" -, tout cela me rebutait et me répugnait depuis longtemps, y renoncer ne m'aurait en rien coûté. Cependant, cela ne m'empêchait nullement d'être un assez bon Allemand; j'en prenais assez souvent consCience, ne fût-ce que par la honte que m'inspiraient les déviances du nationalisme. Comme la plupart des dtoyens d'une nation, j'étais confus quand des compatriotes à moi, et a fortiori mon pays tout entier, faisaient mauvaise figure; j'étais atteint par les offenses que les nationalismes d'autres pays faisaient occasionnellement subir à l'Allemagne en paroles ou en actions ; j'étais fier des compliments qu'on lui décernait à l'occasion, des belles pages de l'histoire d'Allemagne et des beaux traits du caractère allemand. En un mot, je faisais partie de mon peuple comme on fait partie d'une famille : plus que tout autre prêt à la critique, pas toujours dans les meilleurs termes avec ses membres, et certainement pas disposé à lui 'consacrer ma vie età chanter "ma famille au-dessus de tout" -mais faisant partie d'elle et ne reniant jamais sérieusement cette appartenance. Renoncer à cette appartenance, se détourner tout à fait, apprendre à sentir sa patrie comme un pays ennemi, ce n'était pas une mince affaire.
Je n"'aime" pas l'Allemagne, pas plus que je ne m'aime moi-même. Si j'aime un pays, c'est la France, mais je pourrais aimer n'importe quel pays plus que le mien -même s'il n'y avait pas les nazis. Mais le pays qui est le vôtre a un tout autre rôle que celui de l'aimé, un rôle bien plus irremplaçable: c'est votre pays, tout simplement. Si on le perd, on . perd presque le droit d'en aimer un autre. On perd toutes les conditions nécessaires pour jouer au beau jeu de l'hospitalité nationale: échanges, invitations réciproques, apprentissage mutuel de l'autre, plaisir de parader devant l'autre. On devient un sans-patrie", un homme sans ombre, sans arrière-plan, au mieux un homme que l'on tolère quelque part -ou bien, si l'on renonce volontairement ou involontairement à . joindre l'émigration externe à l'émigration interne, un déraciné complet en exil dans son propre pays. Effectuer librement cette opération, le détachement interne de son propre pays, est un acte d'une intransigeance biblique : "Si ton oeil entraîne ta chute, arrache-le"· !" Nombreux sont ceux qui, comme moi sur le point de le faire, n'y sont pas parvenus. Depuis, ils titubent, incapables de se mouvoir en âme et en esprit, tremblant devant les crimes commis en leur nom, incapables d'en refuser la responsabilité, pris dans les rets de conflits apparerriment insolubles : ne doivent-ils pas faire des sacrifices pour leur pays -lui sacrifier jusqu'à la clairvoyance, la morale, la dignité humaine, la conscience ? Ce phénomène qu'ils nomment "l'essor inouï de l'Allemagne" ne montre-t-il pas que cela vaut la peine, que cela paie? Ils oublient qu'i! ne sert de rien à une nation, pas plus qu'à un homme, de gagner l'univers si elle vient à perdre son âme, et ils ne voient pas davantage qu'ils sacrifient à leur patriotisme (ou à ce qu'ils appellent ainsi) non seulement euxmêmes, mais aussi leur pays. . Car -et c'est ce qui rendait en fin de compte l'adieu presque inévitable -l'Allemagne ne restait pas l'Allemagne. Les nationalistes allemands l'ont détruite. Il devenait peu à peu évident que la question de savoir si l'on devait se détacher de son pays pour rester fidèle à soi-même n'était que la face visible du conflit. Le conflit lui-même, caché sous une infinité de phrases toutes faites et de platitudes, se jouait entre le nationalisme et la fidélité au pays.
L'Allemagne qui pour moi et mes semblables avait été "notre pays" n'était pas simplement un point sur la carte de l'Europe. C'était une constellation de . caractères bien définis: le sens de l'humain en faisait partie, un esprit ouvert, une réflexion méditative opiniâtre et profonde, une difficulté à s'accepter et à accepter le monde, le courage de se livrer à des expériences toujours renouvelées et de rejeter les solutions inadaptées, l'esprit critique vis-à-vis de soi-même, l'amour de la vérité, l'objectivité, l'insatisfaction, la soif d'absolu, une grande diversité, une certaine lourdeur, mais aussi le plaisir d'improviser librement, lenteur et sérieux, mais aussi une créativité inépuisable et ludique qui ne cessait de produire des formes toujours nou. velles pour les abandonner comme autant de tentatives avortées, le respect de la personnalité et de l'originalité, bonté, générosité, sentimentalité, musicalité, et par-dessus tout une grande liberté : quelque chose de mouvant, d'illimité, de démesuré, qui jamais ne se fige et jamais ne renonce. Nous étions secrètement fiers que notre pays fût, dans le domaine de l'esprit, celui des possibilités infinies. Quoi qu'il en fût, c'était le pays auquel nous nous sentions liés, dans lequel nous nous sentions chez nous.
Cette Allemagne-là, les nationalistes allemands l'ont saccagée, piétinée, et on a enfin compris qui est son ennemi mortels : le nationalisme allemand et le Reich. Quiconque veut lui rester fidèle et continuer à en faire partie doit avoir le courage de le reconnaître, et d'en tirer toutes les conséquences.
Le nationalisme, c'est-à-dire le narcissisme national et le culte voué à la nation par elle-même, est certainement partout une dangereuse pathologie de l'esprit, capable de déformer et d'enlaidir le visage d'une nation, de même que l'égoïsme et la vanité déforment et enlaidissent les traits d'un individu. Mais nulle part cette maladie n'est aussi maligne et aussi destructrice qu'en Allemagne justement parce que l'Allemagne est, dans son essence la plus intime, spacieuse, ouverte, expansive, et même, dans une certaine mesure, oublieuse de soi. Chez d'autres peuples, le nationalisme, lorsqu'ils en sont atteints, reste une faiblesse accidentelle qui n'affecte pas leurs quaHtés intrinsèques, mais il se trouve qu'en.Allemagne le nationalisme détruit la valeur spécifique du caractère national. Cela explique pourquoi les Allemands -. sans nul doute un peuple civilisé, sensible et très humain quand ils sont en bonne santé -deviennent, sitôt frappés par la maladie du nationalisme, tout simplement inhumains et révèlent une hideur bestiale dont aucun autre peuple n'est . capable. Car à eux, et à eux seuls, le nationalisme fait tout perdre : tout ce qui forme le noyau de leur humanité, de leur existence, de leur moi. Cette maladie, qui n'affecte chez les autres que le comportement, leur ronge l'âme. Un Français nationaliste peut éventuellement rester un Français très typique, et au demeurant très sympathique. Un Allemand qui succombe au nationalisme n'est plus un Allemand; c'est à peine s'il est encore un être humain. Le résultat, c'est un Reich allemand, peut-être même un grand Reich ou un empire pangermanique -et la destruction de l'Allemagne.
On aurait évidemment tort de supposer que l'Allemagne et sa culture étaient superbes et florissantes en 1932, et que les nazis ont tout démoli d'un seul coup. L'histoire de l'autodestruction de l'Allemagne du fait de son nationalisme pathologique est plus ancienne, et il vaudrait la peine de la conter. Son côté hautement paradoxal, c'est que chaque étape de cette autodestruction fut marquée par une guerre victorieuse, u~ triomphe apparent. Voici cent cinquante ans, "l'Allemagne" était en passe de devenir une grande nation. Les guerres de libération de 1813 à 1815 marquèrent la première grande régression, les guerres de 1864 à 1870 la deuxième. Nietzsche fut le premier prophète à discerner que la culture allemande avait perdu la guerre contre le Reich allemand. Dès cette époque, l'Allemagne perdit pour longtemps toute chance de trouver sa forme politique, coincée qu'elle était dans l'Empire prussien de Bismarck comme dans une camisole de force. Elle n'avait plus non plus de représentation politique (si ce n'était dans le centre catholique) : la droite nationaliste la haïssait, la gauche marxiste l'ignorait délibérément. Pourtant elle survécut, paisible et têtue, jusqu'en 1933. On la trouvait encore dans des milliers de maisons, de familles, de cercles privés, dans des salles de rédaction, des théâtres, des salles de concert, des maisons d'édition, à divers endroits de la vie publique allant de l'église au cabaret. Il fallut attendre les nazis et leur sens radical de l'organisation pour la débusquer et l'enfumer partout où elle se trouvait. C'est l'Allemagne qui fut leur premier territoire occupé, non l'Autriche ou la Tchécoslovaquie. Qu'ils l'aient occupée et piétinée au nom de l'Allemagne ne fut qu'une de leurs entourloupettes bien connues -et cela faisait aussi, bien sûr, partie de leur oeuvre destructrice. L'Allemand qui se sentait lié à cette Allemagne-là, et non à n'importe quel territoire qui s'étalerait à ce moment précis dans un espace géographique déterminé, n'avait plus qu'une seule issue: l'adieu, si terrifiante que lui parut cette démarche qui, extérieurement, lui coûterait son pays. Certes, cette ouverture d'esprit vaste et universelle empreinte à l'origine dans le caractère allemand lui rend peut-être cette perte plus facile qu'elle ne le serait pour un autre. On ne pouvait plus échapper au sentiment . que n'importe quelle terre étrangère serait plus accueillante, plus familière que le Reich d'Adolf Hitler. Et on se .demandait parfois, animé d'un léger espoir, si même, "au-dehors", on ne pourrait pas voir se reformer çà et là un petit morceau d'Allemagne.
* propos qui rejoint parfaitement celui que tiendra en 1962 Arendt dans son interview à la Zdf :
