| index | précédent | suivant |
|---|
Novembre 18 - Berlin
 L'histoire est décidément manchotte ; en tout cas unijambiste : elle est incapable d'envisager les événements autrement que du seul point de vue des vainqueurs ; au moins de celui du locuteur. Le mois dernier, Paris fêtait avec pompe et pédanterie le centenaire de l'armistice en présence des dirigeants des principaux pays concernés (Allemagne comprise) : il n'était pas idiot, un siècle après, de célébrer plutôt que la victoire contre l'ennemi, la fin de la guerre et l'unité de l'Europe toujours à faire et consolider ; toujours à réinventer.
L'histoire est décidément manchotte ; en tout cas unijambiste : elle est incapable d'envisager les événements autrement que du seul point de vue des vainqueurs ; au moins de celui du locuteur. Le mois dernier, Paris fêtait avec pompe et pédanterie le centenaire de l'armistice en présence des dirigeants des principaux pays concernés (Allemagne comprise) : il n'était pas idiot, un siècle après, de célébrer plutôt que la victoire contre l'ennemi, la fin de la guerre et l'unité de l'Europe toujours à faire et consolider ; toujours à réinventer.
Pendant qu'à Paris, Londres et Now York les foules fêtent dans le tumulte déraisonnable des jours de liesse ce qu'elles espèrent être sinon le retour à l'état ancien de cette Epoque qui ne se savait pas encore avoir été Belle au moins le début d'un monde plus apaisé, au même moment se jouait à Berlin une bien autre partition dont l'issue allait déterminer une grande partie de ce qui allait suivre.
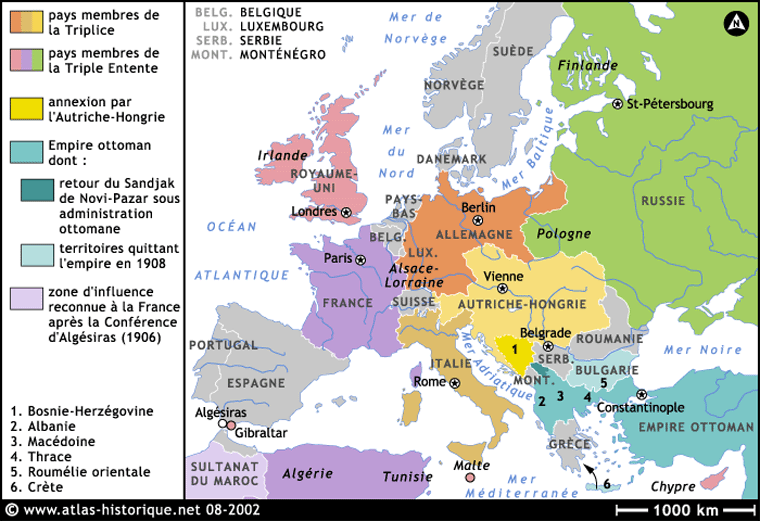 Une défaite est toujours un drame pour un pays. quand il s'agit comme ce fut le cas pour l'Empire Allemand (dominé par la Prusse) d'un Etat tout entier structuré autour de son armée et régi par un militarisme sans grande retenue, ni nuance c'est évidement une catastrophe. Ce qui va se jouer dans ces jours décisifs qui séparent la fin septembre du mois de Janvier 1919 c'est non seulement la fin de l'Empire, l'abdication de Guillaume II, et l'instauration d'une République et demain la perte consacrée par les futurs traités de territoires que le pays jugeait il y a peu essentiels ; c'est surtout une révolution incroyable, qui se révélera impossible ; c'est une révolution trahie comme l'écrira Sébastian Haffner.
Une défaite est toujours un drame pour un pays. quand il s'agit comme ce fut le cas pour l'Empire Allemand (dominé par la Prusse) d'un Etat tout entier structuré autour de son armée et régi par un militarisme sans grande retenue, ni nuance c'est évidement une catastrophe. Ce qui va se jouer dans ces jours décisifs qui séparent la fin septembre du mois de Janvier 1919 c'est non seulement la fin de l'Empire, l'abdication de Guillaume II, et l'instauration d'une République et demain la perte consacrée par les futurs traités de territoires que le pays jugeait il y a peu essentiels ; c'est surtout une révolution incroyable, qui se révélera impossible ; c'est une révolution trahie comme l'écrira Sébastian Haffner.
L'Allemagne, ce pays qui ne redouta jamais rien tant que ses deux fronts se retrouva en 18 devant un choix en lui-même sempiternel parce que dicté par la géographie mais pour elle devenu inédit - après Octobre 17 : le vent de l'Est avec ses grands espaces et ses rêves désormais prolétariens ou son ancrage occidental mais devenu désormais celui de ses ennemis. L'Allemagne n'a oublié ni sa compassion fraternelle devant 1789 ni sa cruelle déception devant le lâche abandon français de 1848. Mais si quelque chose en lui, et son histoire notamment, le fit regarder avec effroi autant qu'envie, tendresse autant que crainte, ce grand cousin qu'est le russe, ce dernier désormais englouti dans la révolution soviétique, a tout désormais d'un monstre qu'il faut juguler ou éviter.
Cette Allemagne de 1918 coincée entre deux modèles qu'elle ne peut plus suivre est seule ; enfermée par ses propres démons.
Un empire, fier de lui et dominateur, si arrogant qu'il s'enticha de se faire proclamer à Versailles dans la Galerie des Glaces pour bien marquer sa victoire sur la France et la fin des humiliations napoléoniennes s'effondre pourtant avant la République qu'involontairement il avait fait naître à Paris. Mais pas son militarisme qui suintera vingt années durant avant d'éclater en sa plus vulgaire et cruelle expression.
Oui décidément cet automne 18 sonne comme un glas bien plus que comme une aurore.
Elle penchera au pire et celui qui en fut l'acteur sinistre a nom Ludendorf. C'est de lui dont je veux parler ici.
Homme de l'ombre

 C'est encore chez Haffner qu'on ne trouve le portrait le plus pertinent même s'il suffit de regarder l'une quelcnque de ses photos pour en comprendre l'essentiel.
C'est encore chez Haffner qu'on ne trouve le portrait le plus pertinent même s'il suffit de regarder l'une quelcnque de ses photos pour en comprendre l'essentiel.
L'homme est grassouillet et ses rondeurs siéent parfaitement à ce militaire qui depuis longtemps fait plutôt la guerre dans les bureaux que sur le terrain. On remarquera cete lippe plongeante, cette moue dont il est difficile de savoir si elle est boudeuse ou méprisante ; cet horrible rictus qu'il traine de photos en photos comme une mauvaise manie de petit garçon effronté trop vite grandi mais malpoli qui, néanmoins, suffit à caractériser cette morgue militaire où se résume toute la Prusse.
L'homme n'a rien d'aimable et l'on imagine malaisément qu'il pût en rien avoir été aimé ; rien d'admirable et même aux moments de sa plus grande influence, il ne bénéficia d'aucune popularité mais seulement de cette déférence mêlée de crainte que l'on accorde à celui qu'on ne peut éviter non plus qu'esquiver sa capacité de nuisance.
Je ne suis pas sûr que cet homme pensât jamais : c'était assurément un bon technicien - mais de la guerre exclusivement - dont il savait orchestrer les contraintes ; sûrement pas un idéologue ; encore moins un visionnaire. Son vocabulaire se réduisait à trois mots - encore était-ils synonymes : armée ; Allemagne ; victoire.
Il était, à sa façon rude et même méchante, désintéressé. Ludendorff n'était ni un séducteur, ni un meneur d'hommes. Il n'était ni charmant, ni démoniaque, il ne savait ni ravir, ni convaincre, ni hypnotiser. Son contact était abrupt, sec, sans amabilité ni chaleur. En tant que militaire, il avait indéniablement du métier, sans être pour autant le stratège doué que ses admirateurs voulurent faire de lui plus tard. Ce n'était pas un Napoléon inspiré (cette guerre n'en connut dans aucun camp) mais un organisateur et un administrateur, un technicien de la guerre, doté de sang-froid et de capacité de décision, consciencieux, infatigable et brutal. Un bon général. Mais il y avait d'autres bons généraux. Si l'on se demande ce qui plaçait ce général bourgeois au-dessus des autres et qui faisait son efficacité et sa puissance, on ne trouve que ceci : sa dureté, son désintéressement sans faiblesse, qui lui permettaient de vouloir, de servir, de personnifier. Rien d'autre
 Homme d'ordre et de devoir en somme - ce qui convient parfaitement à un homme de guerre moins à un politique. Or c'est ce qu'il était devenu : au tournant de 1916. Avec son maître et chef Hindenburg, usant de la notoriété et de la gloire acquise à l'occasion de la victoire de Tannenberg, abusant des déboires sur le front Est sans pour autant de succès sur le front ouest de Falkenhayn, ils finissent par se débarrasser de ce dernier et à prendre la direction des opérations. En réalité ce n'est pas seulement le pouvoir militaire qu'ils prennent mais politique - le Kaiser étant progressivement réduit à un rôle symbolique d'apparat et de représentation. C'est peut-être ceci le plus incroyable dans l'histoire : que cette monarchie, certes absolue, ait pu ainsi aussi vite, verser du côté de la dictature militaire, sans retenue, toute honte bue, et surtout au profit d'un tel individu que rien, ni sa position sociale, ni son caractère, ne prédisposait à cela. Le duo Hindenburg-Ludendorf est un mirage : on aura beau parler, s'agissant de ces deux-ci de Dioscures, en réalité Hindenburg, plutôt falot, est entièrement dominé par Ludendorf. d'autant plus efficace que tout d'une pièce et en réalité désintéressé.
Homme d'ordre et de devoir en somme - ce qui convient parfaitement à un homme de guerre moins à un politique. Or c'est ce qu'il était devenu : au tournant de 1916. Avec son maître et chef Hindenburg, usant de la notoriété et de la gloire acquise à l'occasion de la victoire de Tannenberg, abusant des déboires sur le front Est sans pour autant de succès sur le front ouest de Falkenhayn, ils finissent par se débarrasser de ce dernier et à prendre la direction des opérations. En réalité ce n'est pas seulement le pouvoir militaire qu'ils prennent mais politique - le Kaiser étant progressivement réduit à un rôle symbolique d'apparat et de représentation. C'est peut-être ceci le plus incroyable dans l'histoire : que cette monarchie, certes absolue, ait pu ainsi aussi vite, verser du côté de la dictature militaire, sans retenue, toute honte bue, et surtout au profit d'un tel individu que rien, ni sa position sociale, ni son caractère, ne prédisposait à cela. Le duo Hindenburg-Ludendorf est un mirage : on aura beau parler, s'agissant de ces deux-ci de Dioscures, en réalité Hindenburg, plutôt falot, est entièrement dominé par Ludendorf. d'autant plus efficace que tout d'une pièce et en réalité désintéressé.
Homme de l'ombre, oui, éminence grise, sans doute. e sont les plus fascinants ; les plus redoutables aussi. Haffner en donne deux clés : désintéressé et notamment par le pouvoir et la gloire ; représentatif de cette bourgeoisie allemande en train de prendre lentement l'ascendant sur l'aristocratie prusienne.
Ce qu'il tient du premier trait : c'est son irrésistible ascension et son invraisemblable entêtement. A l'instar de Robespierre d'autant plus incontournable que précisément incorruptible, Ludendorf n'était pas homme à se laisser amadouer par quelque quolifichet. L'ombre lui convenait qui lui permit de mettre en œuvre des soltions, rarement originales, mais toujours massives ; toutes d'une pièce. Voici l'homme de la guerre à outrance ; de la guerre sous-marine etc qu'il put concevoir et mettre en place d'autant plus aisément que plus personne ni Hindenburg ni le Kaiser n'était en mesure de l'arrêter. L'obstacle n'était pas institutionnel mais psychologique.
C'est bien pour cela que la décision qu'il prend - soudaine vraiment ? - d'à la fois demander une armistice et de confier le pouvoir à des civils, des parlementaires, peut surprendre ; et a surpris. Il était, plus que tout autre, l'homme de la guerre à outrance ; celui aussi de cette étrange dictature militaire qui s'était substituée sans se l'avouer toujours, à la monarchie légèrement teintée de parlementarisme. Solution qu'Hindenburg approuve sans barguigner - mais cela faisait longtemps qu'il était sous la coupe de Ludendorf - qu'il soumettront à Guillaume II d'autant plus enclin à l'accepter qu'il était devenu faible et redoutait par dessus tout une révolution qui mettrait fin à l'Empire et donc à sa position.
 On peut en tirer deux leçons :
On peut en tirer deux leçons :
la crainte de la révolution bolchévique sera la raison, en tout cas le prétexte, à bien des renoncements tout au long du XXe siècle en Allemagne comme en France qui explique, selon moi, bien plus que la paix ratée de Versailles l'enchevêtrement des deux guerres mondiales ainsi que l'invraisemblable équilibre de la terreur qui présida à la guerre froide.
la cruelle absence de culture démocratique de l'Allemagne rendit possible tant le subterfuge de Ludendorf que l'écrasement de la révolution des conseils que le minage systématique de la République de Weimar par ceux-là même qui eussent du la défendre ; qu'enfin le 30 janvier 33.
Car ce que manigance Ludendorf n'est ni plus ni moins que la mise en place de la légende du coup de poignard dans le dos. L'armée ne pouvant être vaincue, la défaite ne saurait être le fait que de la trahison des civils, des parlementaires. D'où la nécessité de confier le plus tôt possible le pouvoir à un chancelier civil qui porterait tout le faix de l'opprobre. Ce que Ludendorf ne pouvait sans doute pas prévoir c'est que Max de Bade n'irait pas jusqu'au bout ; qu'Ebert matois, irait jusqu'à écraser les siens. Mais faisait ses affaires.
Que non seulement des civils, mais encore des socialistes, fussent les responsables de cette paix honteuse, lavait l'armée de toute culpabilité et ouvrait de bien droitières et soldatesques perspectives. Ludendorf ne voyait pas plus loin !
 Il faudrait sans doute réécrire l'histoire de cette révolution inédite qui fut assurément pacifiste et bien peu violente mais consacra pour longtemps la division du mouvement socialiste et communiste. Les socialistes furent effectivement des traitres et finirent par s'allier à l'Etat Major pour éviter une victoire des spartakistes.
Il faudrait sans doute réécrire l'histoire de cette révolution inédite qui fut assurément pacifiste et bien peu violente mais consacra pour longtemps la division du mouvement socialiste et communiste. Les socialistes furent effectivement des traitres et finirent par s'allier à l'Etat Major pour éviter une victoire des spartakistes.
Au point qu'il est difficile de décider d'entre l'habileté de Ludendorf ou de la trahison d'Ebert quoi eut le plus d'effet …
Mais les massacres de janvier, les assassinats de Liebknecht et de Rosa Luxemburg n'eurent pas d'autres responsables qu'Ebert, chancelier certes SPD pourtant.
 Reste la figure toujours fascinante de l'éminence grise. Celui-ci la traînera jusqu'en 24 et la tentative de coup d'Etat ratée ; au procès qui s'en suivit Hitler fera quelques mois de prision ; Ludendorf en réchappera. Mais on le voit c'est bien lui qui assure la transition entre le second et le troisième Reich. Sauf que lui n'a rien d'un Richelieu ni d'un Machiavel. C'est un militaire, buté, entêté, froid. On voudrait voir dans la légende du coup de poignard dans le dos une idée géniale, une rouerie de la plus grande finesse : ce n'est pourtant que l'expression de la plus rudimentaire - et de la seule - idée qu'un militaire puisse nourrir : l'armée est invincible et donc ne peut être vaincue que par une trahison ; l'armée est une valeur suprême et nul en conséquence ne peut ni ne doit la remettre en cause. C'est une démarche du même type qui a rendu possible l'Affaire Dreyfus en France. Il n'en va pas autrement ici. Son premier aspect justifie la demande d'armistice et le dimulacre de parlementarisme à quoi l'on se prête ; son second justifie qu'on se servît de la sottise des socialistes pour les inciter à écraser eux-mêmes toute velléité de révolution. On discutera sans fin pour déterminer si cette révolution de novembre en fut une réelle ou seulement une vague agitation due à l'effondrement militaire ; si elle était révolution communiste ou bien au contraire seulement une révolution bourgeoise bien à la manière du SPD comme le pense Haffner.
Reste la figure toujours fascinante de l'éminence grise. Celui-ci la traînera jusqu'en 24 et la tentative de coup d'Etat ratée ; au procès qui s'en suivit Hitler fera quelques mois de prision ; Ludendorf en réchappera. Mais on le voit c'est bien lui qui assure la transition entre le second et le troisième Reich. Sauf que lui n'a rien d'un Richelieu ni d'un Machiavel. C'est un militaire, buté, entêté, froid. On voudrait voir dans la légende du coup de poignard dans le dos une idée géniale, une rouerie de la plus grande finesse : ce n'est pourtant que l'expression de la plus rudimentaire - et de la seule - idée qu'un militaire puisse nourrir : l'armée est invincible et donc ne peut être vaincue que par une trahison ; l'armée est une valeur suprême et nul en conséquence ne peut ni ne doit la remettre en cause. C'est une démarche du même type qui a rendu possible l'Affaire Dreyfus en France. Il n'en va pas autrement ici. Son premier aspect justifie la demande d'armistice et le dimulacre de parlementarisme à quoi l'on se prête ; son second justifie qu'on se servît de la sottise des socialistes pour les inciter à écraser eux-mêmes toute velléité de révolution. On discutera sans fin pour déterminer si cette révolution de novembre en fut une réelle ou seulement une vague agitation due à l'effondrement militaire ; si elle était révolution communiste ou bien au contraire seulement une révolution bourgeoise bien à la manière du SPD comme le pense Haffner.

 Ce qui est certain est l'odieux compromis d'Ebert.
Ce qui est certain est l'odieux compromis d'Ebert.
L'invraisemblable double proclamation de la République dit tout et l'émotion de Scheidemann s'entend encore dans son récit quelques années plus tard : décidément ce peuple qui éprouva tant de difficultés à se concevoir un Etat digne de ce nom n'aura pas eu de chance : après l'échec retentissant du printemps des peuples qui vit la France répondre par un silence glacial à ses appels à l'aide, comment ce peuple ne se serait-il pas senti trahi ? après cette guerre perdue et le refus des socialistes de prendre leurs responsabilités, comment ce peuple ne se serait-il pas senti trahi ? Ceci n'excuse rien mais explique tout.
Incapable de se donner des dirigeants à la hauteur, ce peuple, sans expérience, méprisé par ceux-là même qu'il supposait le défendre, s'est donné au premier aventurier venu. Il l'a payé cher ; nous aussi! il le paie encore.
On ne vénère jamais impunément la soldatesque.