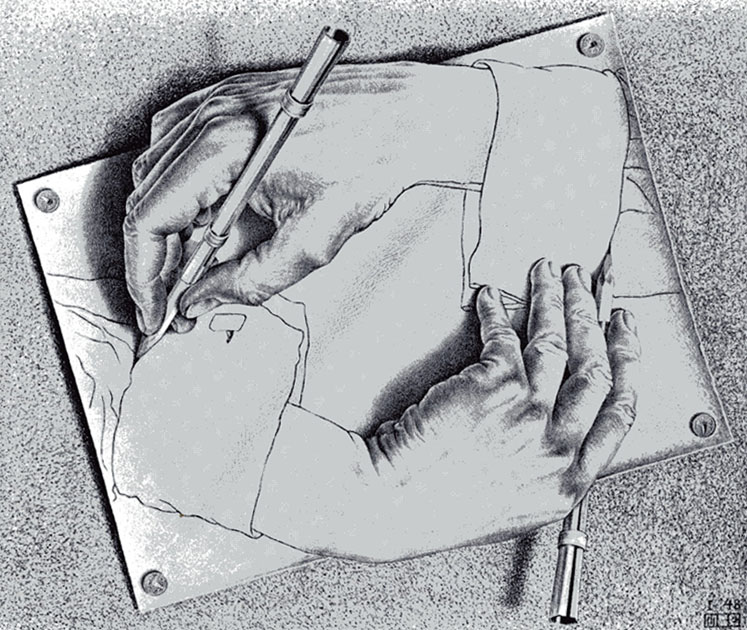| index | précédent | suivant |
|---|
Pierre Rosanvallon : « Une communauté d’effroi ne doit pas conduire à l’illusion de l’unité »
Pierre Rosanvallon, la mobilisation du 11 janvier n’a-t-elle pas mis au jour à la fois les éléments d’une communion de la société française comme d’énormes fractures sociales ?
 Nous avons d’abord vu le rassemblement d’une communauté d’effroi et d’interrogations. Les horreurs du monde dont nous entendons tous les jours parler ont soudain fait irruption chez nous, venant de l’intérieur. Mais je pense en même temps qu’il serait dangereux d’établir un lien causal entre terrorisme et défaut d’intégration.
Nous avons d’abord vu le rassemblement d’une communauté d’effroi et d’interrogations. Les horreurs du monde dont nous entendons tous les jours parler ont soudain fait irruption chez nous, venant de l’intérieur. Mais je pense en même temps qu’il serait dangereux d’établir un lien causal entre terrorisme et défaut d’intégration.
Le « milieu terroriste » ne concerne que des personnes à proprement parler déséquilibrées, qui voient dans le passage à l’extrême la solution à leurs problèmes d’identité, qui se raccrochent à l’expression d’une violence de revanche. Ces jeunes hommes ne sont pas en recherche d’intégration, ils ont au contraire fait le choix de se « désintégrer » en endossant les habits du radicalisme.
Il y a là le projet suicidaire de rejoindre dans la mort une communauté de martyrs. En revanche, ces événements nous ont permis de constater que l’union – dont tout le monde a parlé lors du 11 janvier – n’existait pas. Loin de manifester une véritable union nationale, cette communauté d’effroi a immédiatement fait apparaître le caractère problématique de cette prétendue unité.
En quel sens le 11 janvier a-t-il été aussi le signe de la désunion nationale ?
Au-delà des manifestations de rejet représentées par les « Je ne suis pas Charlie », toute une partie de la population française ne s’est de fait pas retrouvée dans ces manifestations du 11 janvier. Une partie du pays est restée en retrait. C’est la France institutionnelle, ainsi que celle des gens intégrés et de la citoyenneté impliquée qu’on a vu dans les rues, celle de ces Français qui suivent l’actualité, sont liés au milieu associatif et militant et ont le sentiment de faire corps avec d’autres. Lors des émeutes de 2005, c’était une catégorie bien identifiée de la population qui avait manifesté sa colère : les jeunes de banlieue.
Les réactions indifférentes au mouvement du 11 janvier nous ont montré qu’on avait affaire à quelque chose de plus diffus, qui dépassait de loin le « monde immigré » et la question de l’islam, même si celle-ci pèse lourd. C’est la fracture entre une France impliquée et une France marquée par un sentiment d’abandon, submergée par les difficultés personnelles, qui se sent marginalisée. Elle s’est manifestée par le retrait. Mais elle s’est en revanche exprimée, lors l’élection partielle du 8 février dans le Doubs, avec ses bulletins de vote anonymes. On a ainsi vu une nette fracture se révéler entre une France de la défection, dans ses différentes composantes, et celle de l’implication.
Assistons-nous à une crise de l’universalisme français ?
La grande histoire de la modernité a été celle de l’édification des Etats-nations. Alors que l’histoire humaine avait précédemment tendu vers l’idée d’empire, celle d’un universalisme assurant la paix. Comme les empires avaient échoué dans cette entreprise, cet idéal d’universalité a voulu prendre la forme plus modeste de l’Etat-nation. Ce modèle territorialisé de l’universalité se défait sous nos yeux. Les appels au séparatisme se multiplient partout dans le monde, une société d’éloignement, dans laquelle les groupes sociaux tendent à se regrouper entre personnes qui se ressemblent, se met progressivement en place. Les inégalités grandissantes accentuent en outre le phénomène. La France n’échappe pas à ce délitement.
Quels sont les risques de la dislocation de ce modèle à visée universelle ?
Le terrorisme est un élément de fragmentation supplémentaire qui apparaît soudainement alarmant, par sa visibilité, sa brutalité et sa détermination. Il a fait comprendre en grossissant le trait que si l’on ne sort pas de cette situation incertaine, nous risquons d’entrer dans des sociétés d’anomie, de chaos social, d’indifférence et de violence. Réalités qui constituent une grande part de l’histoire de l’humanité. Nous le voyons tous les jours.
Est-ce une immigration mal maîtrisée qui a contribué à déstabiliser le fragile pacte républicain ?
En France, on continue à parler d’immigrés à propos de personnes qui sont intégrés depuis deux ou trois générations. On ne dirait pourtant jamais de Nicolas Sarkozy qu’il est immigré parce que son père est issu de la petite noblesse hongroise. Ni de Manuel Valls dont le père était un peintre catalan. On appelle aujourd’hui « immigrés » ceux qui incarnent la mémoire et la mauvaise conscience de ce que l’universalisme français a raté, avec au premier chef l’expérience algérienne.
La République avait idéalisé l’entreprise coloniale comme extension de l’ambition universaliste, voulant montrer qu’on pouvait faire une société nouvelle avec d’autres langues, d’autres histoires, d’autres religions. Le monde maghrébin se voit affublé, génération après génération, du terme d’immigré à cause de cette histoire ratée. Les questions d’intégration ne sont pas simplement en France de l’ordre de la pratique quotidienne, elles remuent également un ensemble de rêves brisés. Car si l’Algérie n’est pas devenue française ce n’est pas simplement du fait de la révolte des Algériens, mais aussi parce que les autorités rêvaient et mentaient. Elles parlaient d’universalisme mais refusaient l’égalisation des niveaux de vie. Il y a donc eu une désoccidentalisation de ces populations à la mesure des déceptions et des échecs qui se sont répétés sur le terrain de l’intégration.
Le rappel des règles telles l’interdiction du port du voile à l’école ou de la burqa dans l’espace public ne permettent-ils pas à la société française d’affirmer son identité sans refuser la liberté de conscience prévue par la loi de 1905 ?
Certaines règles peuvent faciliter la cohabitation, mais elles ne résoudront pas tous les problèmes. Dans la rue, on peut porter le voile mais pas la burqa. Mais la loi ne peut pas définir le nombre de centimètres carrés de tissu ou la longueur d’une robe. Certes l’école doit être un sanctuaire, un lieu préservé des affrontements identitaires, mais elle doit également aider à faire réfléchir les individus sur ce qui leur permet de vivre ensemble. Il faut par exemple oser parler de l’expérience des guerres de religion ou de l’histoire de l’antisémitisme. Il faut ouvrir une réflexion sur les obstacles au vivre-ensemble.
Le mot laïcité est devenu trop élastique : pour certains, il désigne techniquement la neutralité de l’Etat, pour d’autres, un idéal de vie sociale harmonieuse où les individus n’auraient plus de classes sociales, de religions, d’histoires… Il faut se méfier de cette vision enchantée. Il faut apprendre le vivre-ensemble non pas grâce à une série d’interdictions, mais par une réflexion commune et permanente sur ce qui le rend possible ou difficile.
Si l’on ne s’intéresse qu’aux droits de l’individu, on crée alors une société multiculturelle à l’anglaise ou à l’américaine : chacun peut faire ce qu’il veut mais il n’y a plus d’espace commun, et la France deviendra une mosaïque de petites sociétés tour à tour indifférentes et hostiles. On ne peut pas faire nation et vivre en démocratie sans partir de ce constat.
La République, ce n’est pas que des procédures et des lois. C’est aussi ces « institutions invisibles » que sont la confiance et la légitimité. Et plus encore ces règles de civilité qui s’appellent respect, responsabilité, que la devise républicaine a réunies sous le terme générique de fraternité.