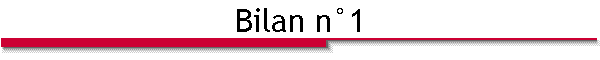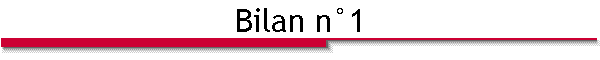Premier bilan
Le regard que l'on peut porter sur cette première phase est
quadruple:
 |
la critique portée par Platon contre les sophistes, et la
rhétorique en général semble à première vue implacable mais n'est sans doute
pas si définitive que cela dans le mesure où elle laisse ouvert le domaine
du discours de la transmission et de la recherche. On notera surtout qu'à sa
manière, elle s'invalide elle-même dans la mesure où, privilégiant l'échange
oral interpersonnel, elle signe en même temps les vrais débuts de la
philosophie grecque, ses débuts écrits en tout cas. Très vite, cette
condamnation de l'écrit sera dépassée par Aristote mais il semble qu'elle
l'est déjà par Platon lui-même. Ce n'est en réalité pas la rhétorique
elle-même que fustige Platon, mais une certaine rhétorique sophiste.
|
 |
cette critique, si elle est intimement liée à sa théorie
des Idées séparées et donc à sa conception de la philosophie est tout autant
liée à sa conception du politique tellement étrangère à la démocratie.
Conférer le pouvoir à ceux qui savent, c'est ce qu'aujourd'hui on nommerait
technocratie. La politique, réduite à n'être qu'une mise en œuvre,
rigoureuse, habile, morale, certes, de la sagesse, mais une application
pratique seulement de ces principes, ôte au politique toute dimension
idéologique, morale voire intellectuelle. A Comte rêvait de donner à cette
technique qu'est la politique une science digne de ce nom et crut l'avoir
fondée avec sa physique sociale; Platon quant à lui l'aura prédéfinie dans
la définition même de la philosophie. Ce qui, à côté de la ligne
opinion/science trace une nouvelle ligne entre d'une part le territoire des
philosophes et celui du peuple, celui-ci restant rivé aux affres du
sensible, de l'apparence, de l'opinable. S'adresser au peuple c'est en
réalité vouloir le convaincre; or nul dialogue n'est en réalité possible
avec lui tant il reste prisonnier de la doxa. C'est ici aussi que la
condamnation des sophistes prend tout son sens politique. Le peuple n'est
pas, ne peut pas être un interlocuteur valide, ne saurait être que
celui que l'on guide, conduit ou forme !
Ce que Barthes avait observé dès l'origine, confirmé par Perelman prend ici
toute sa dimension : la rhétorique des sophistes mutatis mutandis
occupe dans la Grèce antique la place qu'occupent désormais nos medias de
masse.
|
 |
cette critique ouvre en réalité le champ de la
communication beaucoup plus qu'elle ne le ferme : en dessous du dialogue
philosophique, il y a tout le terrain du dialogue social, politique; de la
parole humaine.
Terrain sans enjeu philosophique pour Platon, mais terrain que l'on ne peut
assurément pas laisser en friche et qu'investira précisément Aristote,
donnant ainsi à la Rhétorique ses lettres de noblesse et sa feuille de route
pour une très longue période. Se confirme ainsi ce que nous énoncions plus
haut : communication et philosophie n'ont tout simplement
ni le même objet ni le même destinataire !
Tout à l'air de se passer, dès le début de la philosophie grecque comme si,
de part et d'autre d'une ligne, pas si visible que cela, se jouaient
conjointement les sorts respectifs du politique et de la philosophie, de
l'information et de la communication. Le débat Aristote/Platon n'a rien
d'anodin à cet égard sur quoi nous pensons toujours et qui n'est au fond pas
tranché. Il justifie à la fois la profonde méfiance de la philosophie vis à
vis de la communication et leur lien apparemment indénouable. Mais en se
proposant l'objectif du double regard, nous n'affirmons pas autre chose que
la nécessité de penser la question d'un point de vue politique, aussi !
Or la question nous paraît d'autant plus actuelle que le discours ambiant,
dès lors qu'il s'agit du politique, du social et, surtout de l'économique,
confine au technocratisme de manière assez spontanée, régulière. Où certains
voient une remise en question, de fait, de la démocratie; où nous pouvons
voir des réminiscences plus ou moins maîtrisées de la pensée platonicienne.
1
La question de la légitimité de la rhétorique, de la communication, n'est
peut-être, qu'une manière moderne de poser la question de la légitimité de
la démocratie ! Préserver un espace pour la communication, n'est-ce pas
finalement préserver l'espace légitime de la démocratie ?
|
 |
exigence de méthode enfin : elle est dessinée dès le
Phèdre [266]
parce qu'évidemment l'exigence d'une recherche qui doive impérativement être
individuelle et engager l'âme elle-même dans ce dialogue intérieur où il
voit l'expression même de la pensée, n'oblitère pas la possibilité, mais la
nécessité surtout, de la transmission de cette sagesse ni donc l'exigence de
la méthode. Que celle-ci soit intimement liée à la notion de plaisir
n'empêche qu'elle soit posée en ces deux termes, ascendant de l'analyse,
descendant de synthèse, qui forment ainsi les deux pôles de la démarche
intellectuelle.
|
Il n'y a donc pas à s'étonner si cette réflexion sur les
relations philosophie/communication semble partir dans tous les sens parce
qu'elle engage en réalité presque tous les domaines de la connaissance
 |
le domaine de la science
|
 |
la question de la méthode
|
 |
la question du politique
|
 |
la question du langage
|
C'est cette intrication qui nous semble intéressante.

1) Dans l'analyse que mène C Bryon-Portet
de l'origine philosophique du
discrédit des média, on voit bien que plusieurs dimensions
s'entrecroisent mais qu'assurément la
conception platonicienne
y a sa part, centrale, au moins pour l'accent mis surtout sur un monde
intelligible, éternel, par opposition à un monde sensible, changeant, et
illusoire pour cela.
|