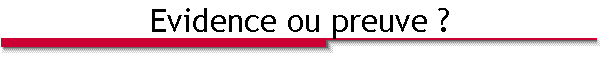
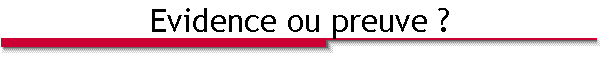
|
|
|
|
La culture de l'évidenceDans cet article célèbre paru en 1970 dans la revue Communications, R Barthes fait allusion, plus d'ailleurs qu'il ne l'explicite, à cette valeur de l'évidence remise en selle conjointement par le protestantisme, la méthode cartésienne et l'empirisme. Ce serait cette culture de l'évidence qui aurait contribué à disqualifier pour longtemps la rhétorique qui avait pris tant de place et d'importance depuis Aristote et tout au long des périodes médiévales. La rhétorique est triomphante : elle règne sur l'enseignement. La rhétorique est moribonde : restreinte à ce secteur, elle tombe peu à peu dans un grand discrédit intellectuel. Ce discrédit est amené par la promotion d'une valeur nouvelle, l'évidence (des faits, des idées, des sentiments), qui se suffit à elle-même et se passe du langage (ou croit s'en passer), ou du moins prétend ne plus s'en servir que comme d'un instrument, d'une médiation, d'une expression. Cette « évidence » prend, à partir du XVIe siècle, trois directions : une évidence personnelle (dans le protestantisme), une évidence rationnelle (dans le cartésianisme), une évidence sensible (dans l'empirisme). La rhétorique, si on la tolère (dans l'enseignement jésuite), n'est plus du tout une logique, mais seulement une couleur, un ornement, que l'on surveille étroitement au nom du « naturel ». Sans doute y avait-il dans Pascal quelque postulation de ce nouvel esprit, puisque c'est à lui que l'on doit l'Anti-Rhétorique de l'humanisme moderne ; ce que Pascal demande, c'est une rhétorique (un « art de persuader ») mentaliste, sensible, comme par instinct, à la complexité des choses (à la « finesse ») ; l'éloquence consiste, non à appliquer au discours un code extérieur, mais à prendre conscience de la pensée qui naît en nous, de façon à pouvoir reproduire ce mouvement lorsque nous parlons à l'autre, l'entraînant ainsi dans la vérité, comme si lui-même, de lui-même, la découvrait; l'ordre du discours n'a pas de caractères intrinsèques (clarté ou symétrie) ; il dépend de la nature de la pensée, à laquelle, pour être « droit », doit se conformer le langage1 Le mouvement paradoxal que décrit ainsi Barthes, omniprésence dans l'enseignement mais défaite sur le front de la pensée, traduit en réalité une double révolution :
1) R Barthes, L'ancienne Rhétorique, Communications 16, Ed Seuil, Points Essais p 285 Descartes, Règles (XII° règle) « Il n’y a pas d’autres voies qui s’offrent aux hommes, pour arriver à une connaissance certaine de la vérité, que l’intuition évidente et la déduction nécessaire » sur l'équivalence de la pensée et de l'immédiateté "Par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est en nous de sorte que nous en sommes immédiatement conscients" (2ème réponse aux objections) mais aussi Par le mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes; c'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose que penser". Principes de la philosophie, I, 9 |