"Un voyage dans les connaissances en train de se transformer"
Un entretien avec Edgar Morin, réalisé par Daniel Bougnoux et Bastien
Engelbach.
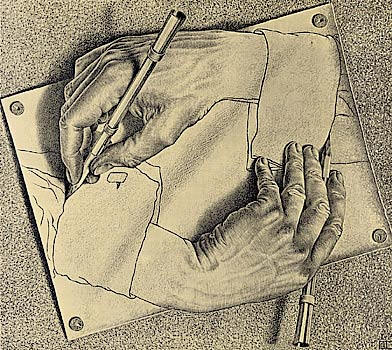
nonfiction.fr : Vous avez une
position singulière dans le paysage intellectuel français. Vous êtes
philosophe, vous vous intéressez de près aux sciences, vous avez écrit sur
de nombreux sujets, vous êtes aussi sociologue. Vous définissez-vous comme
philosophe ? Comment vous inscrivez-vous dans l’histoire de la philosophie ?
Votre œuvre a ceci de singulier, par rapport à beaucoup d’autres philosophes
du XXe siècle, qu’elle n’est pas tant une réflexion à partir de l’histoire
de la philosophie qu’une méditation sur la connaissance.
Edgar Morin : Je ne me définis pas,
les autres me définissent. Pendant longtemps, on me disait sociologue pour
la raison que j’étais institutionnellement dans la section de sociologie du
CNRS. Bien sûr tout ce que j’ai fait comporte une composante sociologique, à
part quelques ouvrages comme Commune en
France ou La rumeur d’Orléans qui ont une autre dimension, plus historique.
Il y a toujours une dimension réflexive dans mes travaux et à ce moment-là,
si on définit l’attitude philosophique par la recherche d’une réflexion,
d’un deuxième degré, d’un méta-niveau, alors cette étiquette me convient.
Mais je sais très bien que je ne m’inscris pas dans la condition des
philosophes contemporains : si la tendance contemporaine est une tendance
éminemment réflexive elle ne fait que se réfléchir elle-même. Moi, dans le
fond, j’ai une réflexion plus naïve, en revenant peut-être au principe de
l’étonnement philosophique aristotélicien : je pars de l’étonnement
généralisé devant tout. Je travaille sur une culture beaucoup plus multiple.
Il y a un travail de réflexion sur les sciences, où je ne sais rien de
spécifiquement original. On n’est pas trop nombreux en France ; il y a des
gens comme Michel Serres ou Dominique Lacourt, très différents de moi par
certains aspects. Mais là encore, c’est un des aspects. Je réfléchis aussi
sur la vie, donc on peut dire que je me réfère à Husserl qui demandait de se
référer au Lebenswelt, au monde de
la vie – mais lui entendait la vie vécue, alors que je n’entends pas
seulement la vie vécue, mais aussi la vie comme réalité biologique qui fait
partie de nous.
Héraclite et Pascal ou la pensée des
contradictions
Si je donne des points de repères, le point de repère fondamental est
Héraclite. Je me suis toujours senti en résonance avec ses propositions
contradictoires et sa façon de lier deux termes antinomiques : « Vivre de
mort », « Brûlure de vie », etc. C’est le penseur pour qui la contradiction
est au fondement de l’appréhension, de la compréhension même du monde ;
celui dont je me sens le plus proche. Je dirai aussi, en faisant un bond
historique, Pascal, parce que non seulement la réflexion de Pascal, et pas
seulement sur l’homme, est traversée par les contradictions, mais aussi
parce que lui-même est animé par une sorte de pulsion intellectuelle
antagoniste, la foi et le doute. Il fait de l’être humain un "monstre" comme
il dit, c’est-à-dire un tissu de contradictions. Cette tension constante
entre la foi et le doute, entre la raison et la religion fait qu’il les
ressent de manière à la fois antagoniste et complémentaire. Il manifeste, du
côté de la raison, un esprit extrêmement rationnel dans ses travaux
scientifiques, et du côté de la religion, son adhésion au catholicisme.
Je dirais qu’il y aussi chez moi quelque chose d’indéracinable et le doute.
Je suis quelqu’un à la recherche de foi, mais ayant foi non pas en une
révélation, mais peut-être dans la fraternité – tout en sachant que cette
foi en la fraternité ne signifie pas qu’elle va se réaliser sur terre, je
doute même qu’elle puisse se réaliser sur terre. Le lien foi-doute est
essentiel, foi et doute sont liés. Je crois être tout à fait rationnel et
suis animé par un doute non pas ravageur, mais fondamental, tout en ayant
une forme de foi, une aspiration indéracinable.
Je prends la religion dans son sens de "ce qui relie". Comme La Méthode est liée à une tentative
de relier les connaissances et que l’éthique pour moi est fondée sur la
reliance, disons que je suis d’un aspect religieux non institutionnel. Ce
qui m’avait beaucoup frappé chez Pascal, c’est que conscient que sa foi ne
peut pas avoir une preuve rationnelle, empirique, il a lancé l’idée de pari,
une idée extraordinaire, en rupture avec une tradition séculaire qui essaie
de réconcilier religion et raison. Il montre qu’une telle réconciliation
n’est pas possible, mais il se sert de la raison pour montrer les limites de
la raison. Ici, il peut peut-être s’inscrire dans la lignée de Paul, mais il
est en grande rupture avec une plus forte tradition de l’Église. Il utilise
des moyens rationnels pour montrer les limites de la raison et affirmer la
foi en même temps. Il affirme qu’il y a un ordre qui dépasse la raison,
l’ordre du cœur, que la raison ne connaît pas, sans renier la raison pour
autant. C’est cette parenté de fond avec Pascal que moi-même je ressens.
Kant, Hegel, Marx : de la réflexivité à la
multiplication des points de vue en passant par la dialectique
Je suis venu à Kant assez tard, mais je l’ai retrouvé dans tout ce que j’ai
voulu faire sur la réflexivité de la connaissance, sur la "connaissance de
la connaissance", avec bien entendu cette idée kantienne, concrétisée par la
neuro-science moderne, qu’effectivement nous ne connaissons pas la réalité
directement : notre connaissance de la réalité est toujours une traduction
et une reconstruction. Kant défendait cette thèse à sa façon, avec les
catégories et les données a priori de la sensibilité, mais on peut le faire autrement. Il y a bien d’autres
choses dans Kant, notamment son universalisme dont je me sens très proche,
mais je dirais que c’est surtout le Kant de la connaissance qui m’intéresse.
Hegel a joué un rôle important, capital. La dialectique de Hegel m’a frappé.
J’avais 22 ans lors de ma découverte de ce penseur qui, renouant avec
Héraclite, affronte les contradictions, dit que la vie doit affronter la
mort, avec cette idée que les contradictions peuvent être dépassées par une
synthèse – chose que je ne retiens plus guère aujourd’hui encore que je
crois qu'il y a des cas où les synthèses peuvent dépasser les
contradictions. Il y a cette idée importante aussi de négation, un
mouvement, un élan historico-cosmique : La
phénoménologie de l’esprit c’est l’histoire du monde vue comme si
c’était l’histoire de l’esprit. Son style, ses formules, sa poésie,
incontestablement, m'emplissaient d'enthousiasme.
J’ai également été animé, sans bien connaître, par les œuvres de Marx et
d’Engels. Quand je suis devenu étudiant, que je m’inscrivais à la Sorbonne,
je pensais qu’il fallait connaître l’économie – alors je me suis inscrit en
droit puisque les sciences économiques étaient enseignées en droit à
l’époque –, qu’il fallait connaître l’histoire – donc je me suis inscrit en
histoire –, la philosophie – donc je me suis inscrit en philosophie,
laquelle comportait en son sein à l’époque la sociologie –, je me suis
inscrit également en science politique. Je pensais que la connaissance
pertinente des phénomènes humains ou sociaux, historiques, psychologiques,
etc. nécessitait une culture où on pouvait considérer toutes les
connaissances, et bien entendu le lien entre la connaissance et l’action.
C’est cet esprit là qui a permis de faire des études historiques très
pertinentes comme Le Dix-huit Brumaire de
Louis Napoléon Bonaparte de Marx. Il y a là une acuité de pensée qui
reste très forte si l’on enlève certaines qui ne tiennent pas – peut-être
en raison de l’insuffisance des bases en certains points.
Par contre, je dirais que tout le chemin vers la complexité, vers la
conception ou la formulation de la complexité ne vient pas de philosophes.
Certes, je peux dire que c’est parce que je me suis voulu une formation
éclectique et multiple et dans laquelle j’ai omis de vous dire l’importance
de la formation en littérature. Dès l’âge de 13-14 ans j’ai dévoré Balzac,
j’ai dévoré Tolstoï, j’ai dévoré la littérature et pas seulement les romans,
sans compter le cinéma qui a joué un rôle important dans ma prise de
conscience. Cette culture m’a nourri et me semble aujourd’hui de plus en
plus importante. Quelques uns des constituants les plus importants de ce que
je suis, de ce que je crois, ont aussi été déclenchés par des films que j’ai
vu quand j’avais 13-15 ans, que ce soient des films soviétiques comme Le chemin de la vie, que ce soit L’opéra de quat’sous de Pabst, et
d’autres. Des choses auxquelles je crois viennent de la littérature : je
parlais du scepticisme, mais avant de lire Montaigne, j’ai lu toutes les
œuvres d’Anatole France et été marqué par ce que l’on appelait son
"scepticisme souriant"
.
Montaigne : la mémoire des persécutions et
l’esprit universaliste
Puisque je parle de Montaigne, c’est, je dirais, quelque chose de plus
profond. C’est une filiation, une filiation que je sens d’autant plus que
Montaigne était d’ascendance marrane. Sa famille maternelle est une famille
judéo-espagnole d’origine, convertie et dont il semble qu’un ou deux
descendants aient été brûlés dans les bûchers de l’Inquisition. On ne sait
rien, en ce sens, de la famille paternelle, mais il est intéressant de noter
qu’il a organisé la cérémonie de naturalisation française du recteur du
collège de Guyenne –le premier lieu où on a enseigné l’esprit critique et le
scepticisme en France – qui était un marrane, un Portugais venu en France,
après que celui-ci avait demandée à François Ier à être naturalisé français.
Ce ne sont que des éléments de convergence. Il y a aussi la lettre étonnante
que Montaigne a écrite à son père pour raconter la mort de La Boétie, lettre
très détaillée où il explique qu’après avoir reçu l’extrême onction, La
Boétie dit : "je meurs dans cette foi que Moïse a planté en Égypte, de là
s’est transportée en Judée, que nos pères ont conduite en France", chose
étonnante puisque La Boétie était un protestant. Est-ce qu’il voulait dire
que lui-même avait des racines marranes ?
Quand on pense par exemple que Bartolomé de Las Casas, ce prêtre espagnol
qui avait tout fait pour que l’on reconnaisse une âme humaine aux Indiens
était lui-même d’origine marrane, on peut penser qu’il est logique que
quelqu’un qui a le souvenir de la persécution subie par ses ancêtres va être
sensibles aux persécutions vécues par d’autres, ce qui a été du reste un
sentiment vécu pendant plusieurs siècles par des intellectuels juifs et qui
aujourd’hui a disparu depuis l’existence d’Israël. Ainsi Montaigne, dans
"Les cannibales" – d’ailleurs il s’intéressait beaucoup aux Indiens
d’Amérique – explique que l’on s’offusque de ce que ceux-ci mangent les
morts et qu’on les traite pour cela de barbare, alors qu’ils ne leurs font
pas de mal – ils sont morts – tandis que nous nous torturons, nous spolions,
nous détruisons, etc. Il y a chez lui un esprit universaliste, cette
ouverture extraordinaire. Là-dessus je me dis héritier de Montaigne. Et
aussi de Spinoza, du Spinoza qui a éliminé le Dieu extérieur au monde et
créateur de celui-ci pour penser le Dieu de l’immanence, le fondateur de la
modernité philosophique, et aussi le philosophe d’une réflexion politique
intrépide au nom de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion.
L’âge des coups de foudre
Après, passé l’âge des coups de foudre qui vous font découvrir ce que
vous attendiez, ce dont vous aviez besoin, où on peut être modifié par
quelque chose – Crimes et châtiments de Dostoïevski ou Résurrection de
Tolstoï m’ont modifié –, on trouve des choses importantes. Dans Bergson,
dans L’évolution créatrice j’ai
trouvé beaucoup de choses, dans Heidegger aussi, mais ce ne sont plus des
fondateurs, ce sont des nourritures actuelles. Peut-être qu’un jour je serai
révolutionné par quelque pensée, mais je n’ai plus guère le temps.
Voilà un peu ce que je peux dire. Alors philosophe, pas philosophe, ces
questions pour moi relèvent de l’étiquetage. Je suis très content qu’on ne
m’enferme pas dans la catégorie philosophe. Certains mettent "philosophe,
sociologue", d’autres mettent "sociologue [ou philosophe], écrivain". Ils
ont besoin de ça, de l’étiquette, de classer, de savoir. Les monstres
hybrides, qui n’ont pas de nom, peuvent peut-être, en un sens noble, être
quand même désigné comme étant des philosophes. Mais ce n’est pas à moi de
le dire, c’est aux autres.
Une pensée à la première personne
nonfiction.fr : Comment une pensée
peut-elle s’y prendre pour susciter à la fois l’enthousiasme de la
connaissance, le courage d’apprendre, le courage de changer son esprit. Je
pense que chez vous le ressort de votre élan philosophique est dans le fait
que vous vous inscriviez dans la tradition des philosophes à la première
personne : Montaigne, Pascal, le Descartes du Discours de la méthode ; ces philosophes qui ont été enracinés dans leur histoire et dans certains
événements.
Vous êtes un philosophe dont la réflexion doit beaucoup à l’événement et je
pense que vous avez construit votre pensée autour d’événements traumatiques
fondateurs : votre premier livre portait sur la mort et l’intériorisation de
la mort est évidemment le ressort de toute vie énergique ; l’amour ; la
question de l’appartenance au parti communiste, dans Autocritique,
qui est un traumatisme très fort, où je pense que vous avez ressenti quelque
chose de fondamental sur le lien social, sur la croyance communautaire, sur
la fraternité qui peut se renverser en clôture barbare. Même vos pages les
plus théoriques témoignent d’une histoire personnelle.
Il y a là une ressource très forte à faire entendre à ceux qui voudraient
que la philosophie reste le commentaire d’un commentaire ou une spécialité
parmi d’autres savoirs. Un philosophe n’est peut-être pas dans une catégorie
académique et est chargé de transmettre le désir de la connaissance.
"Méthode" veut dire chemin et au cœur de cette méthode il y a le chemin
personnel.
Edgar Morin : Je pense qu’il est
absolument vrai de dire qu’il y a une implication mutuelle entre ma vie et
ma pensée et du reste c’est parce que je l’ai toujours senti que j’ai voulu
faire des écrits avec l’importance du "je". Il y a aussi une chose du point
de vue philosophique, du point de vue de la façon de penser, je me vois
comme une abeille butinant toutes les fleurs, je fais du miel toutes fleurs
– les citations et les références de La
Méthode viennent de partout.
Les origines de la notion de complexité
J’ai oublié de mentionner tout à l’heure des gens comme von Foerster,
von Neumann – von Neumann qui ne m’intéresse pas seulement pour la théorie
des jeux mais surtout pour la différence entre machine vivante et machine
artificielle – qui ont été fondamentalement féconds pour moi au moment
d’écrire La Méthode. Ces penseurs
ont été à la fois des mathématiciens, des ingénieurs et des penseurs et
n’ont jamais été reconnus, n’ont jamais eu le statut de penseur et du reste
ont été ignorés aussi bien par les sciences physiques que par les sciences
humaines ou que par la philosophie. Ils ont fondé les idées de
l’auto-organisation. C’est important que je me réfère à ce type d’auteurs.
Ashby est le premier qui m’a fait rencontrer la notion de complexité. Selon
lui, la complexité c’est le degré de variété d’un système. Un système est
composé d’éléments divers, comme un système vivant est composé de molécules
diverses ou de cellules diverses, et c’est le degré de variété qui pour lui
le constitue : c’est l’union de l’unité et de la diversité, du multiple et
de l’un. Pour moi c’est une idée clef de complexité. Grâce au fait que j’ai
été marqué par Héraclite, Hegel, j’étais capable de comprendre ça, alors que
ceux qui sont marqués par la pensée disjonctive, ou bien mettent l’accent
sur l’unité et la diversité est alors une chose tout à fait secondaire, ou
bien mettent l’accent sur la diversité et finalement occultent l’unité.
J’étais mûr pour accepter l’idée de récursivité que von Foerster est le
premier à énoncer en dehors de son champ mathématique et pour considérer
qu’est récursif un processus où les effets et les produits sont nécessaires
à leur cause et à leur production, ce qui constitue une offense à la logique
classique.
Au noyau de ma façon de penser, se trouve la dialogique – ce que j’ai appelé
la dialogique pour la différencier de la dialectique hégélienne, pour la
montrer plus proche de la pensée héraclitéenne. Il est sûr que dialogique et
récursivité sont quasi les deux mamelles de mon travail. L’idée
hologrammatique est également importante : non seulement une partie est dans
un tout mais aussi le tout se trouve à l’intérieur de la partie, comme par
exemple la totalité du patrimoine génétique se trouve dans chaque cellule, y
compris de notre peau, ou encore la société en tant que tout est présente
par l’éducation, la culture, le langage dans l’esprit de chacun. Cette idée
là aussi, qui est contradictoire, m’a semblé tout à fait évidente. Même
cette formule, dont on a dit qu’elle était dérisoire, "tout est dans tout et
réciproquement", est vraie.
L’action conjointe du "je" et du monde dans
la constitution de la réalité
nonfiction.fr : Votre volonté
d’assumer une position subjective peut-elle s’expliquer par le fait que la
subjectivité n’est pas nécessairement quelque chose de partial et de fermé
et peut donc peut appréhender l’ensemble des choses ?
Edgar Morin : Je dirais même beaucoup
plus. Celui qui est persuadé d’avoir une connaissance objective,
c’est-à-dire impersonnel, celui-là se trompe doublement. La première erreur
c’est qu’il ignore que l’objectivité des objets est le produit d’une
coopération entre le monde extérieur et son propre esprit qui justement
détermine l’objet. Dès que l’on pense que dans toute connaissance il y a
traduction et construction on ne peut plus penser que l’on maîtrise
l’objectivité, on arrive à une certaine objectivité qui comporte
l’intervention du sujet. La deuxième chose, c’est ce que celui qui se croit
dans l’objectivité se met dans la position suprême, je dirai presque de Dieu
le père, c’est-à-dire qu’il se met à la tour de contrôle, et par là même
pense échapper à tout contrôleur et l’affirmation de sa propre subjectivité
permet d’échapper à ce type d’illusion et de prétention. C’est très
important pour moi, de même qu’il est important de reconnaître le "je" : il
fait partie de ma recherche objective et ma recherche objective fait
elle-même partie d’une recherche qui consiste à intégrer l’objectivité et
qui en reconnaît les limites.
nonfiction.fr : Par rapport à cette critique de
l’objectivité, vous expliquez que celle-ci est toujours déjà construite par
la subjectivité. Ceci s’inscrit également dans une révolution scientifique,
puisqu’à partir du XXe siècle, avec la physique quantique on découvre que
l’observateur est partie du phénomène observé. Quelles sont les découvertes
scientifiques qui ont joué un rôle important dans l’élaboration de La
Méthode ?
Le rapport entre philosophie et science est
d’ailleurs un aspect important de La Méthode dont trois points semblent permettre de définir le projet général. Il y a
tout d’abord un refus de la simplification, c’est-à-dire de la réduction de
l’explication des choses à un seul principe. Il y a aussi la volonté de
travailler avec les contradictions. Et un troisième point, que l’on vient
d’évoquer, qui est l’importance du "je". Trois points qui pourraient signer
la spécificité de La Méthode au-delà
de toute classification : la pensée des contradictions, le refus de la
réductibilité de la compréhension à un seul principe et la place du "je".
Tout ceci pouvant être unifié autour de l’idée centrale de la nécessité
d’une connaissance réflexive, c’est-à-dire qui interroge ses propres
conditions.
Edgar Morin : Avant de répondre, je
voudrais dire quelque chose sur ce que l’on appelle le constructivisme, qui
consiste à dire que notre conception de la réalité extérieure est construite
par notre esprit. Je suis co-constructiviste, c’est-à-dire que je parle de
la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la
réalité. Prenons par exemple les capacités innées de l’esprit à poser ses
catégories sur la réalité, pour en former une compréhension objective. Quand
on prend l’esprit à la façon kantienne, celui-ci est non seulement
transcendantal dans le sens ordinaire du mot, mais aussi au sens où il
transcende le monde : on peut se dire "mais d’où vient cet esprit ?" On peut
concevoir que c’est au cours d’une évolution biologique puis post-biologique
que l’esprit humain a pu lui-même se développer dans un processus où les
comportements et la vie elle-même ont conduit progressivement à sa
formation. Les animaux aussi ont une connaissance objective du monde
extérieur sinon ils ne survivraient pas. Même les végétaux qui n’ont pas de
cerveau ont une sorte de connaissance qui vient de l’interaction entre les
cellules. Il y a eu par exemple une expérience très intéressante que j’ai
vue dans Science : des scientifiques
on voulu exfolier entièrement un arbre et là-dessus l’arbre a produit un
surcroît de sève pour produire des feuilles et il a produit une substance
toxique contre les parasites habituels et les arbres de la même espèce du
voisinage ont commencé à élaborer la même substance. Donc effectivement il y
une transmission cognitive et une communication d’information. Du reste
l’existence, la vie, l’unicellulaire, a une composante cognitive et j’ai
appelé ça le computo. Donc, mon idée
c’est que notre esprit lui-même est le produit d’une dialogique
extraordinaire et évolutive et que donc on ne peut pas le donner comme
l’instance suprême.
La connaissance face à ses limites
Cela étant dit sur le constructivisme, la première chose du point de
vue des sciences c’est que toutes les grandes avancées des sciences butent
sur des problèmes fondamentalement philosophiques. On peut dire que la
grande avancée de la microphysique finit par buter sur le problème :
"qu’est-ce que la réalité ?", à partir du moment où la particule se présente
tantôt comme onde, de manière immatérielle, tantôt comme corpuscule, de
façon matérielle. À la limite on arrive à dissoudre la notion même de réel
dès qu’on arrive à ce niveau microphysique. Ce sont désormais des physiciens
qui essaient de répondre à cette question vu la carence des philosophes : d’Espagnat
avec Le réel voilé, mais vous avez
aussi David Bohm dont la conception retrouve presque une vision bouddhiste
où notre réalité empirique n’est que l’écume sur un océan d’une profondeur
indéterminée – le problème de l’univers arrive à une aporie fondamentale que
Kant déjà avait relevé : est-il éternel ou a-t-il un commencement ? ; les
deux propositions étant à la fois logiques et absurdes.
Et finalement on arrive à l’idée d’un commencement explosif mais qui ne se
ferait pas ex nihilo puisque s’il
surgit d’un vide et que ce vide selon les physiciens est animé de frissons,
de sorte de vibrations – le vide ne serait rien d’autre qu’un infini
énergétique. On se rend compte qu’on arrive à cette idée très hégélienne,
quand Hegel disait que l’être n’a pas de déterminations et donc est
similaire au néant tout en n’étant pas la même chose. Cette quasi-identité
de l’être et du néant se retrouve aujourd’hui avec ce problème du vide et du
plein. Certains aujourd’hui essaient même d’explorer cet univers d’avant le
temps et d’avant la matière. On ne sait rien mais on arrive à des limites de
la pensée.
Je crois que cette idée est très importante et fait partie de ce que j’ai pu
apprendre : les plus grands progrès de la pensée humaine viennent de la
découverte des limites de l’esprit, des limites de notre raison. Des notions
extrêmement énigmatiques sont apparues récemment comme celle de l’énergie
noire qui constituerait 70% de notre univers, qui est quasi invisible et qui
le pousse à la dispersion. Mais là encore on retrouve une idée dialogique
qui est extrêmement intéressante : si cela est vrai, cela prouve qu’il y a
une sorte d’antagonisme fondamental entre les forces de gravitation qui
unissent et qui rassemblent et les forces de disjonction, de séparation, qui
vont vers la dispersion infinie, qui aura peut-être la victoire. D’ailleurs
il y a un très beau mot de T.S Elliott qui dit que le monde finira dans un
murmure, whisper. Je trouve que ce
sont des questions extraordinaires qui ne suscitent absolument pas l’intérêt
des philosophes professionnels et qui réapparaissent chez quelques grands
astrophysiciens, comme Michel Cassé ou Hubert Reeves.
La définition et la connaissance de la vie
Je crois qu’on pourra créer de la vie, dans le sens où s’il est vrai que la
vie est une sorte de tourbillon de macromolécules qui amplifie sa diversité
et par une sorte de révolution ou bien éclate ou bien crée un méta-système
par rapport au système physico-chimique qui est le système vivant,
l’organisation vivante, laquelle à ce moment là a des qualités, des
propriétés. Entre parenthèse, une des idées les plus fortes qui ressort de
cette visite que j’ai faite à la théorie des systèmes et qui m’a conduit à
l’idée d’organisation, c’est l’idée d’émergence, c’est-à-dire que quand vous
avez un tout fait de parties séparées, le tout a des qualités nouvelles par
rapport à celle des parties isolées et ces qualités peuvent rétroagir sur
les parties. Qu’est-ce qu’on appelle la vie ? Pourquoi la plupart des
biologistes moléculaires disent "la vie n’existe pas", "on n’a jamais
rencontré la vie dans nos laboratoires" ? Parce que pour eux, ce sont les
interactions entre molécules et gènes qui constituent la vie, donc des
éléments physico-chimiques. Mais la vie se définit par les qualités qui
naissent de cette auto organisation que moi j’ai appelé
auto-éco-organisation, c’est-à-dire la capacité de se reproduire, de s’autoreproduire,
de s’autoréparer, une capacité cognitive et une capacité de mouvement. La
vie c’est les qualités de la vie ; l’organisation de la vie c’est la
complexité de l’organisation vivante qui devient auto-éco-organisatrice et
ce sont les qualités de cette organisation. Mais revenons au problème :
comment est apparue la vie ? C’est le mystère : pourquoi les émergences ?
Pourquoi même si vous mettez ensemble deux atomes d’hydrogène et un atome
d’oxygène, des gaz, vous obtiendrez un liquide qui aura des propriétés
différentes de ces deux gaz pris séparément. Finalement, les émergences sont
des qualités qui viennent des organisations et toute l’histoire du cosmos
c’est l’histoire de l’organisation, les noyaux, les atomes, les molécules,
et puis les proto-galaxies, les galaxies, les étoiles etc. Tout ça c’est de
l’organisation qui est un concept central chez moi, que je n’ai pas puisé
dans la philosophie, encore que chez Leibniz il y a quelque chose dans ce
sens là.
Le rapport à la science : "un voyage dans
les connaissances en train de se transformer"
Pour moi le scientifique et le philosophique sont indissolublement mêlés, se
renvoient l’un à l’autre sans arrêt, c’est-à-dire que mon voyage qu’est La Méthode est en même temps un
voyage aux possibilités et aux limites de la connaissance et en même temps
un voyage sur la connaissance elle-même. Il est certain que je n’ai pas
cherché à faire une encyclopédie des connaissances, j’ai fait un voyage dans
les connaissances en train de se transformer. Elles se transformaient
fondamentalement dans le monde physique, dans le monde biologique et tout
ceci amenait un noyau épistémologique qui se trouve je crois dans La Connaissance de la connaissance.
Je dois dire qu’il y a une scission purement contingente entre les deux
volumes que sont La Connaissance de la
connaissance et Les Idée.
Tout ça est solidaire. La "connaissance de la connaissance" c’est :
l’anthropologie de la connaissance qui se trouve dans La Connaissance de la connaissance ;
la sociologie de la connaissance qui se trouve dans Les Idées, l’écologie de la
connaissance c’est-à-dire les conditions sociales et culturelles ; la
noologie, c’est-à-dire la sphère où les constructions intellectuelles qui
sont les théories, les idées mais aussi les dieux et les mythes ; les
fondements même de toute connaissance. Mon idée de l’épistémologie de la
connaissance suppose que l’on interroge les conditions anthropologiques de
la connaissance, les conditions socio-culturelles, les conditions
organisationnelles de la connaissance et chacune renvoie aux autres. Si vous
focalisez sur l’anthropologie de la connaissance vous occultez la sociologie
de la connaissance, si vous focalisez sur la sociologie de la connaissance
vous oubliez l’anthropologie et chaque clôture crée des illusions, par
exemple l’illusion de la sociologie de la connaissance c’est de croire que
la connaissance n’a que des déterminations historiques hic et nunc.
Mon chapitre clef à cet égard concerne la logique et la paradigmatologie.
Mon idée, c’est que nous avons besoin de la logique aristotélicienne
classique dès que nous avons affaire à un monde d’objets séparés, dès que
nous découpons la réalité en petits morceaux, mais dès que nous cessons de
découper en petits morceaux ça ne fonctionne plus. Cette logique doit être
alors, dans tous les moments fondamentaux ou créateurs, transgressée sans
que je puisse dire "voici une nouvelle logique qui est nécessaire
aujourd’hui". On ne peut être que transgresseur et c’est l’idée de la
dialogique qui n’est pas une nouvelle logique mais une façon d’accepter la
transgression avec quelques orientations.
La paradigmatologie c’est le noyau du noyau. Le mot de "paradigme" a été
utilisé par Thomas Kuhn pour indiquer l’ensemble des conditions dans
lesquelles les connaissances subissent un certain nombre de contraintes et
d’orientations. Le sens du mot est flou et changeant chez celui-ci, alors
j’ai voulu reprendre le terme non pas directement chez les Grecs, mais chez
Jakobson, dans sa grammaire qui définit le niveau paradigmatique comme le
niveau du choix des mots et des notions et le niveau syntagmatique comme
celui du discours continu. J’ai un peu extrapolé ça pour le poser sur
l’ensemble des problèmes de la connaissance en disant que la
paradigmatologie est le niveau qui contrôle tous les discours qui se font
sous son emprise et qui oblige les discours à obéir. Le grand paradigme de
l’Occident, celui qui a été formulé par Descartes – mais il a formulé la
chose qui se faisait à son époque historiquement – c’est le paradigme de la
disjonction entre l’esprit et la matière, la philosophie et la science,
cette disjonction qui a permis la manipulation et la fécondité des sciences
qui en a découlé. Pour moi, le niveau de paradigme est un niveau qui
concerne aussi bien la connaissance, qui est enraciné aussi dans la société.
Je crois que ce que j’ai dit de mieux, c’est cette façon de voir la
multidimensionnalité de la réalité paradigmatique, et c’est là que l’on
arrive au cœur de La Méthode.
Pourquoi y a-t-il eu une suite ? Je ne pensais pas traiter du problème de
"l’humanité de l’humanité", puisque j’avais fait prématurément un livre qui
s’appelle Le paradigme perdu de la nature
humaine où je croyais avoir traité ça. Je l’avais écrit en 1972. À la
fin de La Connaissance de la connaissance plusieurs années s’étaient écoulées et je me suis rendu compte que mes idées
s’étaient enrichies : j’ai donc fait L’Humanité de l’humanité. Et une fois que je suis arrivé là, je me
suis dit que l’idée d’une éthique complexe sortait naturellement. Ce ne sont
pas des ajouts.
La réception de La Méthode
nonfiction.fr : Ce que vous venez de
dire renvoie au jeu et vous êtes stimulé par les situations de jeu,
c’est-à-dire les situations limites où la raison elle-même soit débouche sur
le pari, soit débouche sur la poésie, soit débouche sur une remise en
question de ses paradigmes, fondements ou routines. Tout cela nous ramène à
une sorte de méga-jeu qui est l’entreprise même de connaître.
Il y a un enthousiasme philosophique qui
est véritablement présent dans votre discours et dans votre démarche. Se
pose alors la question de savoir qui va s’emparer de tout ça et comment.
Avez-vous une idée du mode d’emploi de votre Méthode par vos interlocuteurs où quand il vous
arrive d’être sollicité par une association, des ingénieurs, une université
(une université au Mexique porte votre nom) ? Vous venez de dire que
l’écriture de La Méthode ne s’est
pas faite de manière linéaire et il semble que l’on ne la lise pas non plus
linéairement.
Dans les échanges que vous avez avec vos
interlocuteurs à propos de La Méthode,
où est-ce que ça accroche le mieux ? Par où les gens vont-ils entrer dans le
coffret qui vient d’être publié ? Comment l’esprit du temps résonne-t-il à La Méthode ?
Edgar Morin : Ils peuvent y entrer
par le livre qu’ils veulent puisque tous les volumes sont à la fois
interdépendants et autonomes. Je ne peux pas parler de mes lecteurs, mais
je peux dire ce que je sais de ceux, nourris de ma façon de pensée, qui ont
fait un travail écrit : par exemple en Espagne, Emilio Roger qui a fait sa
thèse de doctorat sur La Méthode. Il
y a ceux qui s’approprient ces idées en eux, qui apportent leur propre
substance, leur propre façon de voir et qui à mes yeux sont fidèles. Et puis
il y a évidemment un phénomène de dispersion, d’interprétation hâtive,
d’incorporation sans véritable digestion. Je pense que j’ai droit aussi à
des pseudo-disciples, des gens qui croient être des interprètes et qui ne le
sont que très partiellement.
Dans le fond, il s’est passé ceci que je n’ai pas eu de chaire où pouvoir
exposer La Méthode : elle n’était
pas possible puisque je n’aurai pu en avoir une qu’au moment où La Méthode était terminée. Je ne
suis pas un jardinier qui a pu faire son jardin en arrosant ses plantes,
j’ai été l’arbre dont les germes, les spores se répandent partout sans que
je m’en rende compte portés par des vents. Par exemple, j’ai été surpris en
1994 ou 1995, quand j’étais invité à Medellín en Colombie – Medellín était
pour moi le cartel de la drogue et je suis arrivé dans une ville qui non
seulement a plusieurs universités et ou le séminaire que j’ai fait a été
suivi par des psychologues, des psychanalystes, des mathématiciens, etc. –
de voir que mes livres, déjà traduits en espagnol mais arrivant
difficilement dans la région, était lus : certains voyageurs ont pu
l’acheter en Espagne, des francophones en France et après le système des
photocopies et plus tard d’Internet a fait qu’il y avait une connaissance.
Je l’ai vu à Cuba également où je me suis rendu compte qu’il y avait trois
chaires de complexité dans trois universités différentes, dont une à la
Havane, et j’y ai rencontré certains parmi les meilleurs connaisseurs, par
exemple Carlos J. Delgado qui lui-même de par sa compétence, enseigne dans
cette université du Mexique qui porte mon nom. C’est la dispersion : parfois
ça pousse très bien, parfois il y a des terrains arides, parfois il y a des
malentendus. Je trouve que c’est en France où il y a le plus grand nombre de
malentendus, les uns voyant dans La Méthode une vague tentative de vulgarisation scientifique, les autres y
voyant un grand système post-hégélien, d’autres une encyclopédie. Pour
comprendre La Méthode, il faut
sentir le mouvement et l’aspiration : ceux qui m’ont rencontré sont ceux qui
ont senti la même aspiration, le même besoin.
Une réforme de l’éducation
Les choses se passent comme ça, je découvre au cours de voyages des
imprégnations plus ou moins fortes, légères, superficielles, mais ce que je
crois c’est que le prolongement véritable maintenant serait une réforme de
l’éducation, qui se situe dans les trois livres pédagogiques que j’ai écrits
par la suite : La tête bien faite ;
le recensement des journées que j’avais organisées quand Allègre m’avait
confié une mission de réforme des contenus de l’enseignement – mon rapport
n’a eu aucun résultat sinon ces journées qui s’appellent "Relier les
connaissances" où je tissais le fil des connaissances physiques jusqu’à la
complexité ; et finalement ce livre qui m’a été demandé par l’Unesco qui
s’appelle Les sept savoirs nécessaires à
l’éducation du futur où je prends des thèmes fondamentaux qui sont
ignorés par l’enseignement et qui sont absolument nécessaires. Traiter ces
thèmes c’est relier les connaissances et rentrer dans la façon de penser
complexe. Un thème porte sur la connaissance elle-même, qui comporte les
pièges, les erreurs et les illusions de la connaissance, c’est-à-dire que ce
que l’on croit réservés aux seuls épistémologues doit être partagé pour tous
: puisque tout le monde croit connaître il faut savoir quels sont les
dangers et les pertinences de la connaissance. L’autre thème, c’est la
condition humaine : on n’apprend nulle part ce que c’est qu’être humain. Le
troisième, c’est l’ère planétaire qu’on appelle mondialisation aujourd’hui.
La compréhension humaine ensuite et l’affrontement des incertitudes. Ces
thèmes pourraient être inscrits dans les enseignements, sous une forme qui
peut être systématique dès le secondaire – peut-être même certaines choses
dès le primaire comme la compréhension d’autrui – et bien entendu dans les
structures universitaires ou même pour commencer sous la forme d’une année
propédeutique pour tous avec ces sept savoirs.
Il y a donc ce problème des savoirs fondamentaux. Vient ensuite la question
de l’enseignement d’une certaine sensibilité rationnelle, c’est-à-dire une
sensibilité à l’ambiguïté, aux ambivalences. Il y a toute sorte d’exemples
possibles : par exemple la mondialisation est un phénomène typiquement
ambivalent, il y a plusieurs mondialisations. Une sensibilité à la causalité
complexe, à ce que j’ai appelé l’écologie de l’action, toute une série de
choses qui par de multiples exemples pris dans l’expérience quotidienne
peuvent être utiles.
Le troisième aspect serait plus centralement épistémologique et concernerait
la paradigmatologie. Ce serait trois façons d’entrer, la troisième étant la
plus difficile et pouvant être la dernière.
Je crois que ce j’ai fait est le début de quelque chose quoi doit désormais
essayer de s’enraciner pour avoir un effet, sinon ça sera une œuvre que les
uns liront, que les autres ne liront pas, dont il y aura des parties qui
influenceront certains et en rebuteront d’autres. Si cela se fait dans les
meilleures conditions, La Méthode entrera dans la culture, mais mon ambition est plus grande, à partir du
moment où je suis persuadé que c’est vital, puisque la pensée complexe
consiste à voir les problèmes fondamentaux et globaux et que sinon la
connaissance actuelle rend myope ou aveugle ; si je pense que c’est vital
pour l’individu, pour le citoyen et pour l’être humain dans un contexte où
l’une des causes du désastre vers lequel pourrait s’acheminer l’humanité
serait la cécité et l’aveuglement. Je pense qu’il faut essayer d’enraciner.
J’ai la chance qu’une université commence à fonctionner au Mexique. Il y
aura peut être un mouvement de diffusion et de rayonnement. C’est ça pour
moi la postérité et je voudrais maintenant y contribuer avec les forces qui
me restent. J’étais à Lima au Pérou où une université a décidé de créer un
institut de complexité, une autre a créé un diplôme de complexité. Voilà à
mes yeux la seule façon que cet effort prenne un sens.
La place de l’éthique
nonfiction.fr : Le souci d’une éthique est présent dès le
début de l’œuvre. À la conclusion de La Nature de la nature vous expliquez que la science telle qu’on la pratique, dans la séparation
des savoirs, en même temps qu’elle est une science mutilée est une science
mutilante, puisqu’elle produit des effets sur le réel, en cherchant à le
dominer. Il y a donc dès vos ouvrages sur la science une considération
éthique qui est présente.
Edgar Morin : Incontestablement,
puisque fidèle à ce premier mouvement j’ai pensé que la connaissance n’est
pas pure mais doit avoir des effets concrets, et je dirais que ce n’est pas
seulement une éthique de la connaissance qui se dégage dans La Méthode, mais qu’elle vise à une
meilleure connaissance de l’éthique, c’est-à-dire une meilleure façon
d’orienter nos actions. Tout ceci est inséparable.
L’humanisme aux deux visages
nonfiction.fr : Vous évoquiez au début de l’entretien
l’importance d’Héraclite. Un autre grand penseur s’est inscrit dans le
sillage d’Héraclite : Nietzsche. Vous partagez avec lui l’idée que la
manière dont nous formulons une vérité dépend en grande partie de la manière
dont nous la construisons ainsi que le refus de ramener le monde et la
connaissance à un seul principe unificateur. Mais en même temps chez
Nietzche tout ceci aboutit à une forme de désespoir, de nihilisme, dont on
ne sort que par l’esthétique, tandis que chez vous la découverte des limites
de la connaissance en permet le progrès. Il y a là la formulation d’un
espoir, qui conduit à la notion d’humanisme, reposant sur la possibilité
maintenue des progrès de la connaissance ainsi que sur ce que vous nommiez
votre foi en la fraternité qui nous apparaîtrait ici comme en réponse à la
mort de Dieu chez Nietzsche. Quelle place accordez-vous à la notion
d’humanisme ?
Edgar Morin : Tout d’abord, je crois
que Nietzsche est un penseur de fulgurations et on peut trouver certains
aspects désespérants, mais on trouve aussi le "gai savoir" et une joie
extraordinaire. À la différence d’Héraclite qui formule les contradictions,
Nietzsche les porte en lui. On peut le prendre aussi de façon tonique et non
désespérée.
En ce qui me concerne, bien que pendant vingt années la notion d’humanisme a
été ridiculisée par la pensée dominante, je crois qu’elle doit être
sauvegardée. Mais il faut prendre des précautions, il y avait deux
humanismes dans l’humanisme. On peut distinguer deux sources de l’humanisme
européen : une source grecque, les hommes dirigent leur cité, la capacité
des humains à s’autogouverner, par la démocratie, avec cette idée que la
raison est ce qui doit nous guider en tant qu’humain ; l’aspect
judéo-chrétien, Dieu qui a fait l’homme à son image dans la Bible, Jésus
fils de Dieu supposé a pris forme et chair humaines, et puis le message
fraternitaire dans l’Évangile. On peut dire que c’est une sorte de symbiose
entre ces courants antagonistes qui pénètre l’humanisme européen. Mais cet
humanisme, je le répète, a deux visages, le premier visage, une fois qu’il
est laïcisé profondément – bien qu’il continue sans doute à être irrigué par
l’évangélisme – se manifeste chez Montaigne, Montesquieu, dans la
Déclaration des droits de l’homme, dans l’idée que tout être humain a droit
à la même dignité, à être respecté en tant que tel, quel que soit son âge,
sa race, son sexe. Ceci est l’idée profonde de l’humanisme : l’idée d’une
communauté humaine, ce que je développe dans Terre-Patrie. Nous avons une
communauté de destins, une communauté d’origine, une communauté d’identité à
travers nos diversités.
Je poursuis cet humanisme en rejetant l’autre visage, celui qui veut faire
de l’homme le maître et le possesseur de la nature. Descartes l’énonce
encore avec prudence en disant que la science doit permettre à l’homme de se
rendre "comme maître et possesseur de la nature", mais le message deviendra
plus impératif avec Buffon, Marx, avec le développement économique,
technique et scientifique moderne qui met en marche la maîtrise du monde.
Cet humanisme est non seulement arrogant, mais en plus il est devenu absurde
puisque la maîtrise de la nature considérée comme un monde d’objets conduit
à la dégradation non seulement de la vie, mais aussi de nous-mêmes. Il était
fondé sur la disjonction absolue entre l’humain et le naturel, alors que
nous sommes dépendants. Nous devons abandonner l’idée d’un humanisme où
l’homme prend la place de Dieu. Il ne faut pas nous diviniser, il faut nous
respecter.
L’universalisme concret dans la diversité et
l’unité de ce par où nous pâtissons
Là-dessus, je reprends le flambeau de l’humanisme, avec ce qu’il comporte
d’universalisme, mais en faisant la rupture avec ce qu’il comporte
d’universalisme abstrait, parce que du temps où j’étais communiste –
communiste de guerre – j’avais une idée d’unité humaine où les cultures, les
patries me semblaient secondaires, où la diversité culturelle me semblait
négligeable, où il me semblait logique que l’on arrive à un monde athée.
Maintenant, ce n’est pas seulement que je pense qu’on ne pourra pas
déraciner les religions, je pense qu’il faut un humanisme concret, fait de
diversités et d’unité, qui reconnaisse les diversités humaines qui sont des
formes de richesse. Par exemple, on dit que ce qui est humain c’est la
culture, ce qui est appris, l’ensemble des savoirs, des savoirs-faires, des
croyances, mais la culture, personne ne l’a jamais vue, on ne connaît la
culture qu’à travers les cultures.
Le langage qui a la même structure fondamentale se manifeste par les langues
qui sont très diverses.
Je crois que l’humanisme aujourd’hui doit reconnaître les diversités tout en
maintenant l’unité. C’est le livre Terre-Patrie qui l’exprime le mieux, avec cette idée d’un évangile de
la perdition : je préfère dire soyons frères parce que nous sommes perdus
plutôt que soyons frères pour que nous soyons sauvés. Je dis que le fait que
nous soyons confrontés aux mêmes problèmes – tout être humain doit vivre les
mêmes tragédies, la mort de ses proches, la mort des gens qu’il aime, y
compris sa propre mort –, que nous soyons capables d’éprouver les mêmes
émerveillements et les mêmes bonheurs, tout ceci me fait dire que nous
devons avoir une certaine fraternité. C’est un message plus proche du
bouddhisme que du christianisme, cette sorte de compassion : nous pâtissons
de la même façon.
Préserver la pluralité des cultures
nonfiction.fr : C’est quelque chose d’assez proche de ce
que Jan Patočka appelle la "communauté des ébranlés". Pour lui l’histoire
est d’abord problématicité, élaboration commune, et finalement ce qui est le
liant de toute humanité c’est l’ébranlement du sens, le fait qu’il soit
toujours à construire et à élaborer.
Edgar Morin : J’ai beaucoup utilisé
cette pensée de Patočka dans Penser
l’Europe pour définir la culture européenne. Ce que j’ai essayé de
sauvegarder dans La Méthode c’est la
problématicité, l’idée de l’inachèvement inévitable de toute connaissance
qui donc la rend problématique elle-même. C’est une idée très importante. Il
serait beau que l’on arrive à des symbioses de culture ou de civilisation,
parce que la civilisation occidentale a produit des choses uniques, la
démocratie, les droits de l’homme, mais elle a aussi des carences très
fortes, et en se lançant dans la conquête du monde, avec la technique, le
calcul, elle a occulté et sacrifié bien des réalités humaines qui cherchent
aujourd’hui leur expression en Occident même, par exemple avec le recours au
yogisme, au bouddhisme zen, à différentes formes de spiritualité. Je serais
partisan d’une forme de symbiose entre les civilisations – et je ne pense
pas forcément les grandes civilisations, mais aussi les petites
civilisations – qui serait le sens enrichi de l’humanisme. Le défaut de
l’Occident est de s’être cru propriétaire de la raison et de la vérité et de
mépriser comme superstition tout ce qui était autre. Quand on parle de
peuples disposant de longues traditions orales sans connaître l’écriture, le
mépris consiste à les rejeter dans la superstition, alors qu’ils ont des
savoirs-faires, des connaissances médicales. Le sens de l’humanisme, de plus
en plus difficile à réaliser, parce qu’on a fait des culturicides, des
ethnocides de toutes ces petites civilisations extrêmement riches, serait de
reconnaître les arts de vivre qui existent ailleurs.
nonfiction.fr : Il est parfois difficile de réaliser ces
symbioses. Dès lors que l’on découvre une altérité, une autre culture, on
peut se demander à partir de quel moment cette découverte n’est pas tentée
déjà par l’incorporation qui annule les différences.
Edgar Morin : En réalité, j’ai
constaté que l’intégration signifie désintégration. Je l’ai vu chez les Cris
du Nord Québec, population à qui la société Hydro-Québec a racheté des
territoires, ce qui leur a donné du travail le temps de construire les
barrages. La population s’est sédentarisée dans des maisons à l’occidentale
et le résultat a été que le lac artificiel qui a été créé a coupé la route
aux caribous, ce qui a fait que les hommes ne pouvaient plus chasser le
caribou qui était la ressource alimentaire fondamentale ; que les poissons
étaient infestés de mercure, ce qui fait qu’ils étaient impropres à la
communication. Les hommes, devenus chômeurs des barrages, ne pouvaient plus
redevenir chasseurs, les femmes sont devenues obèses à cause de la
nourriture occidentale à laquelle elles n’étaient pas habituées,
l’alcoolisme a fait ses ravages même chez les enfants. Il n’y a pas de
solution logique, on ne peut pas parler de créer des réserves qui
enfermerait ce peuple comme dans un ghetto. La voie, c’est ce qu’ont suivi
les Indiens du Nord du Canada, qui se sont confédérés. Ces peuples avaient
chacun une langue et se sont confédérés, pour sauvegarder leur identité en
créant un lobby qui permette de résister aux pressions. De même, au Brésil,
il y a un représentant des populations indiennes, amazoniennes au parlement
de Brasilia. Il y a des actions qui essaient de laisser dans leurs terres
des peuples qu’on veut chasser parce qu’on découvre des richesses minières
ou bien pour permettre le développement de l’agriculture massive. La défense
des territoires est devenue pour eux une chose importante, car ils n’ont pas
de lobby, ils n’ont pas d’État national, ils ne peuvent pas se défendre et
ce sont des associations comme Survival international qui les défendent en
essayant de parler de ce qui arrive. C’est un problème tragique, sans
solution, mais il y a quand même une voie de sauvegarde et de maintien : il
y a des cas où ces peuples jouissent de leur territoire en tant que
chasseurs ramasseurs et rallient même certains blancs occidentaux à leur
mode de vie.
Propos recueillis le 10 avril 2008 chez
Edgar Morin, par Daniel Bougnoux et Bastien Engelbach