Marguerite Yourcenar
Mémoires d'Hadrien
 La nouvelle des incursions sarmates arriva à Rome pendant la célébration du triomphe dacique de Trajan. Cette fête longtemps différée durait depuis huit jours. On avait mis près d'une année à faire venir d'Afrique et d'Asie les animaux sauvages qu’on se proposait d'abattre en masse dans l'arène ; le massacre de douze mille bêtes fauves, l'égorgement méthodique de dix mille gladiateurs faisaient de Rome un mauvais lieu de la mort. Je me trouvais ce soir-là sur la terrasse de la maison d'Attianus, avec Marcius Turbo et notre hôte. La ville illuminée était affreuse de joie bruyante : cette dure guerre, à laquelle Marcius et moi avions consacré quatre années de jeunesse, devenait pour la populace un prétexte à fêtes avinées, un brutal triomphe de seconde main. Il n'était pas opportun d'apprendre au peuple que ces victoires si vantées n'étaient pas définitives, et qu’un nouvel ennemi descendait sur nos frontières. L'empereur, déjà occupé à ses projets d'Asie, se désintéressait plus ou moins de la situation au nord-est, qu’il préférait juger réglée une fois pour toutes. Cette première guerre sarmate fut présentée comme une simple expédition punitive. J'y fus envoyé avec le titre de gouverneur de Pannonie et les pouvoirs de général en chef.
La nouvelle des incursions sarmates arriva à Rome pendant la célébration du triomphe dacique de Trajan. Cette fête longtemps différée durait depuis huit jours. On avait mis près d'une année à faire venir d'Afrique et d'Asie les animaux sauvages qu’on se proposait d'abattre en masse dans l'arène ; le massacre de douze mille bêtes fauves, l'égorgement méthodique de dix mille gladiateurs faisaient de Rome un mauvais lieu de la mort. Je me trouvais ce soir-là sur la terrasse de la maison d'Attianus, avec Marcius Turbo et notre hôte. La ville illuminée était affreuse de joie bruyante : cette dure guerre, à laquelle Marcius et moi avions consacré quatre années de jeunesse, devenait pour la populace un prétexte à fêtes avinées, un brutal triomphe de seconde main. Il n'était pas opportun d'apprendre au peuple que ces victoires si vantées n'étaient pas définitives, et qu’un nouvel ennemi descendait sur nos frontières. L'empereur, déjà occupé à ses projets d'Asie, se désintéressait plus ou moins de la situation au nord-est, qu’il préférait juger réglée une fois pour toutes. Cette première guerre sarmate fut présentée comme une simple expédition punitive. J'y fus envoyé avec le titre de gouverneur de Pannonie et les pouvoirs de général en chef.
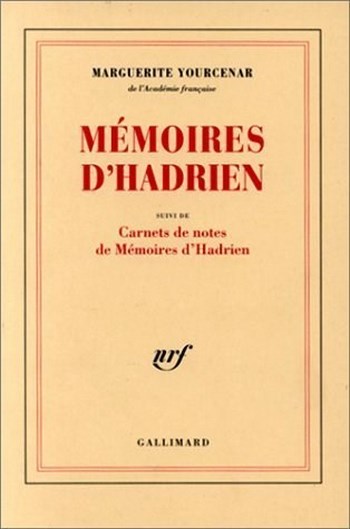 Elle dura onze mois, et fut atroce. Je crois encore que l'anéantissement des Daces avait été à peu près justifié : aucun chef d'État ne supporte volontiers l'existence d'un ennemi organisé installé à ses portes. Mais l'effondrement du royaume de Décébale avait créé dans ces régions un vide où se précipitait le Sarmate ; des bandes sorties de nulle part infestaient un pays dévasté par des années de guerre, brûlé et rebrûlé par nous, où nos effectifs insuffisants manquaient de points d'appui ; elles pullulaient comme des vers dans le cadavre de nos victoires daces. Nos récents succès avaient sapé la discipline : je retrouvais aux avant-postes quelque chose de la grossière insouciance des fêtes romaines. Certains tribuns montraient devant le danger une confiance imbécile : isolés périlleusement dans une région dont la seule partie bien connue était notre ancienne frontière, ils comptaient, pour continuer à vaincre, sur notre armement que je voyais diminuer de jour en jour par l'effet des pertes et de l'usure, et sur des renforts que je ne m'attendais pas à voir venir, sachant que toutes nos ressources seraient désormais concentrées sur l'Asie.
Elle dura onze mois, et fut atroce. Je crois encore que l'anéantissement des Daces avait été à peu près justifié : aucun chef d'État ne supporte volontiers l'existence d'un ennemi organisé installé à ses portes. Mais l'effondrement du royaume de Décébale avait créé dans ces régions un vide où se précipitait le Sarmate ; des bandes sorties de nulle part infestaient un pays dévasté par des années de guerre, brûlé et rebrûlé par nous, où nos effectifs insuffisants manquaient de points d'appui ; elles pullulaient comme des vers dans le cadavre de nos victoires daces. Nos récents succès avaient sapé la discipline : je retrouvais aux avant-postes quelque chose de la grossière insouciance des fêtes romaines. Certains tribuns montraient devant le danger une confiance imbécile : isolés périlleusement dans une région dont la seule partie bien connue était notre ancienne frontière, ils comptaient, pour continuer à vaincre, sur notre armement que je voyais diminuer de jour en jour par l'effet des pertes et de l'usure, et sur des renforts que je ne m'attendais pas à voir venir, sachant que toutes nos ressources seraient désormais concentrées sur l'Asie.
Un autre danger commençait à poindre : quatre ans de réquisitions officielles avaient ruiné les villages de l'arrière ; dès les premières campagnes daces, pour chaque troupeau de bœufs ou de moutons pompeusement pris sur l'ennemi, j'avais vu d'innombrables défilés de bétail arraché à l'habitant. Si cet état de choses persistait, le moment était proche où nos populations paysannes, fatiguées de supporter notre lourde machine militaire, finiraient par nous préférer les barbares. Les rapines de la soldatesque présentaient un problème moins essentiel peut être, mais plus voyant. J'étais assez populaire pour ne pas craindre d'imposer aux troupes les restrictions les plus dures ; je mis à la mode une austérité que je pratiquai moi-même ; j'inventai le culte de la Discipline Auguste que je réussis plus tard à étendre à toute l'armée. Je renvoyai à Rome les imprudents et les ambitieux, qui me compliquaient ma tâche ; par contre, je fis venir des techniciens, dont nous manquions. Il fallut réparer les ouvrages de défense que l'orgueil de nos récentes victoires avait fait singulièrement négliger ; j'abandonnai une fois pour toutes ceux qu'il eût été trop coûteux de maintenir. Les administrateurs civils, solidement installés dans le désordre qui suit toute guerre, passaient par degrés au rang de chefs semi-indépendants, capables de toutes les exactions envers nos sujets et de toutes les trahisons envers nous. Là encore, je voyais se préparer dans un avenir plus ou moins proche les révoltes et les morcellements futurs. Je ne crois pas que nous évitions ces désastres, pas plus que nous n'éviterons la mort, mais il dépend de nous de les reculer de quelques siècles. Je chassai les fonctionnaires incapables ; je fis exécuter les pires. Je me découvrais impitoyable.
Un automne brumeux, puis un hiver froid, succédèrent à un humide été. J'eus besoin de mes connaissances en médecine, et d'abord pour me soigner moi-même. Cette vie aux frontières me ramenait peu à peu au niveau du Sarmate : la barbe courte du philosophe grec devenait celle du chef barbare. Je revis tout ce qu'on avait déjà vu, jusqu'à l'écœurement, durant les campagnes daces. Nos ennemis brûlaient vivants leurs prisonniers ; nous commençâmes à égorger les nôtres, faute de moyens de transport pour les expédier sur les marchés d'esclaves de Rome ou de l'Asie. Les pieux de nos palissades se hérissaient de têtes coupées. L'ennemi torturait ses otages ; plusieurs de mes amis périrent de la sorte. L'un d'eux se traîna jusqu'au camp sur des jambes sanglantes ; il était si défiguré que je n'ai jamais pu, par la suite, me rappeler son visage intact. L'hiver préleva ses victimes : groupes équestres pris dans la glace ou emportés par les crues du fleuve, malades déchirés par la toux geignant faiblement sous les tentes, moignons gelés des blessés. D'admirables bonnes volontés se groupèrent autour de moi ; la petite troupe étroitement intégrée à laquelle je commandais avait la plus haute forme de vertu , la seule que je sup porte encore : la ferme détermination d'être utile. Un transfuge sarmate dont j'avais fait mon interprète risqua sa vie pour retourner fomenter dans sa tribu des révoltes ou des trahisons ; je réussis à traiter avec cette peuplade ; ses hommes combattirent désormais à nos avant-postes, protégeant les nôtres. Quelques coups d'audace, imprudents par eux-mêmes, mais savamment ménagés prouvèrent à l'ennemi l'absurdité de s'attaquer à Rome. Un des chefs sarmates suivit l'exemple de Décébale : on le trouva mort dans sa tente de feutre, près de ses femmes étranglées et d'un horrible paquet qui contenait leurs enfants. Ce jour-là, mon dégoût pour le gaspillage inutile s'étendit aux pertes barbares ; je regrettai ces morts que Rome aurait pu assimiler et employer un jour comme alliés contre des hordes plus sauvages encore. Nos assaillants débandés disparurent comme ils étaient venus, dans cette obscure région d'où surgiront sans doute bien d'autres orages. La guerre n'était pas finie. J'eus à la reprendre et à la terminer quelques mois après mon avènement. L'ordre, du moins, régnait momentanément à cette frontière. Je rentrai à Rome couvert d'honneurs. Mais j'avais vieilli.