Suprématie de l'adjectif
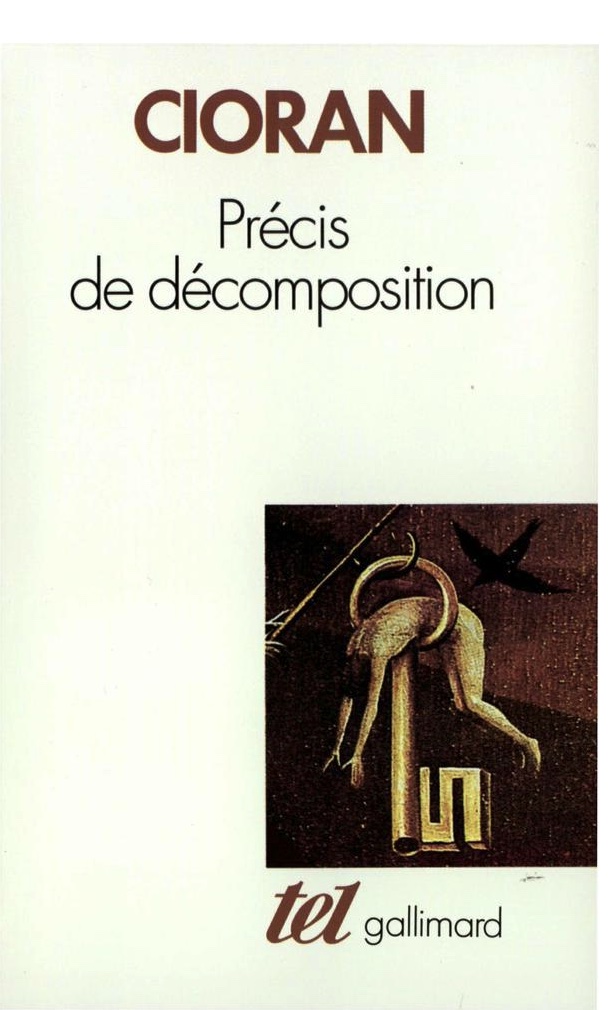 Comme il ne peut y avoir qu'un nombre restreint de positions en face des problèmes ultimes, l'esprit se trouve limité dans son expansion par cette borne naturelle qu'est l'essentiel par cette impossibilité de multiplier indéfiniment les difficultés capitales : l'histoire s'attache uniquement à changer le visage d 'une quanricé d'interrogations et de solutions. Ce que l'esprit invente n'est qu'une série de qualifications nouvelles ; il rebaptise les éléments ou cherche dans ses lexiques des épithètes moins usées pour une même et immuable douleur. On a toujours souffert, mais la souffrance a été ou« sublime» ou« juste» ou« absurde», selon les vues d'ensemble que le moment philosophique entretenait. Le malheur constitue la trame de tout ce qui respire ; mais ses modalités ont évolué ; elles ont composé cette succession d'apparences irréductibles, qui induisent chaque être à croire qu'il est le premier à souffrir ainsi. L'orgueil de cette unicité l'incite à s'éprendre de son propre mal et à l'endurer. Dans un monde de souffrances, chacune d'elles est solipsiste par rapport à toutes les autres. L'originalité du malheur est due à la qualité verbale qui l'isole dans l'ensemble des mots et des sensations ... Les qualificatifs changent : ce changement s'appelle progrès de l'esprit. Supprimez-les tous : que resterait-il de la civilisation ? La différence entre l'intelligence et la sottise réside dans le maniment de l'adjectif, dont l'usage sans diversité constitue la banalité. Dieu lui-même ne vit que par les adjectifs qu'on lui ajoute ; c'est la raison d'être de la théologie. Ainsi, l'homme, en qualifiant toujours différemment la monotonie de son malheur, ne se justifie devant l'esprit que par la quête passionnée d'un adjectif nouveau.
Comme il ne peut y avoir qu'un nombre restreint de positions en face des problèmes ultimes, l'esprit se trouve limité dans son expansion par cette borne naturelle qu'est l'essentiel par cette impossibilité de multiplier indéfiniment les difficultés capitales : l'histoire s'attache uniquement à changer le visage d 'une quanricé d'interrogations et de solutions. Ce que l'esprit invente n'est qu'une série de qualifications nouvelles ; il rebaptise les éléments ou cherche dans ses lexiques des épithètes moins usées pour une même et immuable douleur. On a toujours souffert, mais la souffrance a été ou« sublime» ou« juste» ou« absurde», selon les vues d'ensemble que le moment philosophique entretenait. Le malheur constitue la trame de tout ce qui respire ; mais ses modalités ont évolué ; elles ont composé cette succession d'apparences irréductibles, qui induisent chaque être à croire qu'il est le premier à souffrir ainsi. L'orgueil de cette unicité l'incite à s'éprendre de son propre mal et à l'endurer. Dans un monde de souffrances, chacune d'elles est solipsiste par rapport à toutes les autres. L'originalité du malheur est due à la qualité verbale qui l'isole dans l'ensemble des mots et des sensations ... Les qualificatifs changent : ce changement s'appelle progrès de l'esprit. Supprimez-les tous : que resterait-il de la civilisation ? La différence entre l'intelligence et la sottise réside dans le maniment de l'adjectif, dont l'usage sans diversité constitue la banalité. Dieu lui-même ne vit que par les adjectifs qu'on lui ajoute ; c'est la raison d'être de la théologie. Ainsi, l'homme, en qualifiant toujours différemment la monotonie de son malheur, ne se justifie devant l'esprit que par la quête passionnée d'un adjectif nouveau.
(Et pourtant cette quête est pitoyable. La misère de l'expression qui est la misère de l'esprit, se manifeste dans l'indigence des mots, dans leur épuisement et leur dégradation : les attributs par lesquels nous déterminons les choses et les sensations gisent finalement devant nous comme des charognes verbales. Et nous dirigeons des regards pleins de regrets vers le temps où ils ne dégageaient qu'une odeur de renfermé. Tout alexandrinisme ressort au début du besoin d'aérer les mots, de suppléer à leur flétrissure par un raffinement alerte ; mais il finit dans une lassitude où l'esprit et le verbe se confondent et se décomposent. (Etape idéalement dernière d'une littérature et d'une civilisation : figurons-nous un Valéry avec l'âme d'un Néron ... )
Tant que nos sens frais et notre cceur naïf se retrouvent et se délectent dans l'univers des qualifications, ils prospèrent au hasard de l'adjectif, lequel, une fois disséqué, s'avère impropre et déficient. Nous disons de l'espace, du temps et de la souffrance qu'ils sont infinis ; mais infini n'a pas plus de portée que: beau, sublime, harmonieux, laid ... Veut-on s'astreindre à voir au fond des mots ? On n'y voit rien, chacun d'eux, détaché de l'âme expansive et fertile, étant vide et nul. Le pouvoir de l'intelligence s'exerce à projeter sur eux un lustre, à les polir et à les rendre éclatants; ce pouvoir, érigé en système, s'appelle culture, - feu d'artiflce sur un arrière-plan de néant.)