Pays convalescent, pouvoir évanescent
15 AOÛT 2012 |
EDWY PLENEL
Mardi 14 août, jour des trois premiers mois de la présidence Hollande, la sécurité fut le seul message du changement. Tandis que le démantèlement des camps de Roms tient lieu de priorité estivale du gouvernement, comme d’autres étés sous la droite au point d’inquiéter la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et la Ligue des droits de l’homme, le choix de communication fait par l’Elysée – un hommage tardif à deux gendarmes tuées en juin dans le Var – était rattrapé par les violences nocturnes d’Amiens, entre jeunes et policiers. Tout changerait donc pour que rien ne change, les usines visitées et sollicitées en campagne électorale étant de nouveau effacées au profit des commissariats, des gendarmeries et des casernes ?
Indéniable, l’apaisement d’avoir tourné la page de l’hystérie sarkozyste n’est pas une rente de situation. Et la normalité, elle aussi bienvenue, sera bientôt dévaluée si elle n’est qu’attentisme, entre passivité et habileté. « Normal » : on le sait, ce seul mot fut le meilleur viatique électoral de François Hollande. Par contraste silencieux, il soulignait l’anormalité de l’adversaire, l’excès et l’abus de pouvoir incarnés par Nicolas Sarkozy et son quinquennat. Mais cette trouvaille reposait sur un malentendu, tant la personnalisation de la compétition présidentielle l’identifiait à la normalité de l’individu alors que l’enjeu véritable, énoncé par le futur président de la République lui-même dès 2006, était la « normalisation » de la fonction présidentielle.
 Car l’anormalité sarkozyste n’était pas celle d’un homme, mais la résultante d’un système de pouvoir dont il est le pur produit et dont il a su exploiter les dérives institutionnelles. C’est aujourd’hui tout le problème de François Hollande : il est le président normal d’un système anormal. Sa normalité personnelle revendiquée et affichée ne suffit évidemment pas à résoudre cette contradiction, et ceci d’autant moins que les trois premiers mois de sa présidence n’ont été marqués par aucun zèle ni empressement réformateurs en la matière, les promesses initiales étant renvoyées à une commission ad hoc, confiée à Lionel Jospin – on y reviendra.
Car l’anormalité sarkozyste n’était pas celle d’un homme, mais la résultante d’un système de pouvoir dont il est le pur produit et dont il a su exploiter les dérives institutionnelles. C’est aujourd’hui tout le problème de François Hollande : il est le président normal d’un système anormal. Sa normalité personnelle revendiquée et affichée ne suffit évidemment pas à résoudre cette contradiction, et ceci d’autant moins que les trois premiers mois de sa présidence n’ont été marqués par aucun zèle ni empressement réformateurs en la matière, les promesses initiales étant renvoyées à une commission ad hoc, confiée à Lionel Jospin – on y reviendra.
De cette anormalité foncière, qui, sourdement, mine, épuise et affaiblit notre démocratie depuis des décennies, témoignent paradoxalement les succès électoraux derrière lesquels le nouveau pouvoir, essentiellement socialiste, peut avoir l’illusion de se croire durablement à l’abri (les résultats officiels de la présidentielle sont ici et ceux des législatives sont là). Avec seulement 28,63% des suffrages exprimés pour son candidat au premier tour de l’élection présidentielle (soit 22,31% des inscrits, un gros cinquième du corps électoral), le PS écrase en effet la représentation nationale de sa domination, ses 297 députés et apparentés représentant à eux seuls plus de la moitié (51,47% précisément) de l’Assemblée (voir ici la répartition des groupes parlementares). Jamais le PS, avec, l’an passé, le passage à gauche du Sénat auquel s’ajoute la majorité de régions et de départements qu’il contrôle, n’avait eu en mains autant de pouvoirs à la fois, nationalement et localement.
Or l’effet d’aubaine momentané du présidentialisme est un miroir aux alouettes, habile à tromper les naïfs ou les satisfaits, les suivistes et les cyniques. Outre l’évidente pluralité partisane qu’il rabougrit et humilie, créant du ressentiment (le Front de gauche et le Front national en sont les premières victimes électorales), il masque les fragilités structurelles de la victoire : non seulement un faible écart final au second tour de 1.139.983 voix (2,47% des inscrits), malgré la dynamique de rejet du président sortant et, surtout, sa campagne d’extrême droite, mais aussi la faible participation, notamment dans les quartiers populaires, aux législatives qui ont suivi (une abstention de 42,78% au premier tour et de 44,60% au second, soit 43,68% et 46,74% des inscrits si on y ajoute les blancs et nuls).
Depuis son avènement, le nouveau pouvoir vit sur le crédit de cette normalité promise et plutôt respectée. Plutôt, car si l’affaire symbolique de la supposée « Première Dame » et de son tweet a servi d’utile piqûre de rappel, en revanche la nomination à la Caisse des dépôts, au risque d’un conflit d’intérêts, de l’ami Jean-Pierre Jouyet, ex-ministre de Sarkozy, restera comme un contre-exemple. Toujours est-il que cette posture rencontre l’état d’esprit provisoire d’un peuple qui s’est senti profondément humilié, malmené et fatigué par l’hyperprésidence sarkozyste, son omniprésence médiatique, sa virulence contre tous et sa complaisance pour elle seule.
D’où cette impression estivale bizarre d’un pays en attente ou en absence, retenant son souffle ou faisant une pause, alors même que les nuages s’amoncellent, que la crise s’approfondit et que les difficultés s’accumulent.
Un pouvoir qui oublie de mobiliser la société
Une posture ne fait pas une mobilisation, pas plus qu’une attitude ne tient lieu de programme. Car le crédit de la « présidence normale » n’est pas illimité. Il l’est d’autant moins que le vote dont ont bénéficié François Hollande et son parti ne fut pas majoritairement d’adhésion, mais plutôt de refus (du sortant) et d’attente (du changement). A cette aune, les trois premiers mois du quinquennat s’achèvent sur une déception. Certes, le gouvernement s’est mis sérieusement au travail, et des mesures heureuses ont été prises, notamment fiscales et scolaires (lire ici le bilan dressé par Matignon). Mais, comme l’ont illustré un discours de politique générale sans ampleur du premier ministre et une session parlementaire extraordinaire sans ordre du jour mobilisateur, tout se passe comme si le nouveau pouvoir avait oublié la société. Oublié de lui parler, de la motiver et de la rassembler.
Sauf à d’emblée concéder du terrain à ses adversaires, et donc à renier les idéaux dont elle se réclame, l’épreuve du pouvoir pour la gauche ne peut être qu’un exercice permanent de pédagogie et de mobilisation. Car elle aura toujours contre elle les vulgates dominantes aux innombrables relais médiatiques, tous ces préjugés, fausses évidences et automatismes de pensée qui essentialisent en réalités immuables des intérêts minoritaires, faisant passer en contrebande les injustices et les inégalités qui les garantissent. Et cela n’a pas manqué : à peine étaient-ils installés que les nouveaux gouvernants ont vu ces intérêts de classe se rappeler bruyamment à leur (bon et mauvais) souvenir, avec une conscience aiguë des rapports de force.
En avant-garde des milieux patronaux, le groupe PSA a été chargé d’imposer à la gauche de gouvernement le marché de dupes habituel des milieux économiques : assumant une brutalité sociale qu’il remisait ou édulcorait quand la droite était aux affaires, il la somme de faire passer auprès des classes populaires une destruction d’emplois sans précédent dans un département socialement emblématique, la Seine-Saint-Denis (retrouvez tous nos articles dans notre dossier: Social, l’état d’urgence). Tandis que les dirigeants des syndicats de salariés étaient occupés à prendre leur marque auprès d’un pouvoir soucieux de respecter les corps intermédiaires et de relancer le dialogue social, tous les secteurs économiques et financiers potentiellement ébranlés par les promesses de la campagne prenaient le circuit court du lobbying pour faire valoir leur puissance et, donc, leur capacité de nuisance.
C’est ainsi que les banquiers, avec le secours du gouverneur de la Banque de France se faisant leur porte-parole, ont tout fait pour retarder le doublement du plafond du Livret A destiné à soutenir le logement social, à aider l’épargne populaire et, surtout, à la protéger de la spéculation. Les pétroliers ont fait de même qui ont imposé, en pleine période de vacances et, donc, de déplacements, une tergiversation au ministre de l’économie sur le blocage, pourtant fermement promis par le candidat, du prix de l’essence. A ces pressions des milieux de l’industrie, de la finance et de l’énergie, s’ajoutent évidemment celles de l’Union européenne telle qu’elle est devenue, plus proche de ces milieux économiques et financiers que de ses peuples, au point d’avoir fait des marchés les arbitres de leur devenir.
Dans ce contexte d’adversité faussement feutrée des gens d’affaires et d’intérêts, l’épisode en cours de la « règle d’or » et du pacte budgétaire, ce Traité européen (TSCG) dont la ratification semble désormais promise à n’être qu’une formalité parlementaire, illustre ce qui menace déjà la présidence Hollande : l’habileté. Non pas, et surtout en temps de tempête, que celle-ci soit forcément malvenue, mais à condition que le cap soit lisible. Prétendre que le seul ajout d’un mini-pacte de croissance vaut renégociation d’un Traité hier qualifié « d’austérité » par le candidat et que son adoption française sans débat national pourrait par magie le rendre non-contraignant, c’est vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Mais, surtout, cette façon de passer les caps délicats, loin de créer une dynamique rassembleuse et un rapport de forces favorable, démobilise et démoralise tant elle obscurcit les enjeux. Supplantée par la technique – des cabinets, des experts, des spécialistes, des techniciens, des habitués, etc. –, la politique s’y égare, devenant illisible pour le plus grand nombre. Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de la montée persistante de l’extrême droite, de ses idées et de son parti : une vie publique dévitalisée et égarée, sans repère ni cohésion, appelle inévitablement des politiques mystificatrices et mensongères, démagogiques et autoritaires.
C’est ici qu’il faut donner l’alerte. Car deux événements disent une régression assumée des socialistes sur cette question essentielle, de la démocratie et de sa vitalité. L’un est la contribution commune lancée par la première secrétaire Martine Aubry et le premier ministre Jean-Marc Ayrault en vue du congrès du PS, prévu cet automne à Toulouse. L’autre est la mise en place de la commission présidée par Lionel Jospin sur la rénovation et la moralisation de la vie publique. Dans les deux cas, la consigne est au verrouillage du débat, au détriment de l’initiative, de l’invention et de la participation.
Un abandon revendiqué de la démocratie participative
La contribution Aubry-Ayrault (le texte intégral est ici), qui a pris de court certains des proches de François Hollande, a surgi comme un brusque rappel à la discipline : un an après la fin de l’aberration Strauss-Kahn – ce soutien de la direction du PS au candidat le plus improbable –, suivie des riches débats pluralistes de la primaire, la diversité des socialistes est sommée de s’effacer devant la cohésion gouvernementale. Les ministres sont fermement conviés à se rallier, sauf à se démettre. Uniformisatrice, la logique étatique devrait donc s’emparer d’un parti dont les différences et les différends sont flagrants. Le PS étant à lui seul majoritaire à l’Assemblée, cela ne peut que signifier l’avènement de majorités automatiques, imposant aux socialistes renoncements et suivismes face à des décisions concoctées par la technostructure opaque qui réunit ministres, cabinets, réseaux, visiteurs et solliciteurs.
Dans sa finalité tactique, cette contribution est contraire à l’objectif proclamé de revaloriser le Parlement, ses initiatives et ses débats. Si les socialistes n’assument pas entre eux, publiquement, les débats qui les partagent, que ce soit au sein du gouvernement ou au sein des Assemblées, s’ils ne laissent pas à leurs députés la liberté de suivre parfois les propositions des autres forces de gauche (EELG et FdG), c’en est évidemment fini d’une gauche de gouvernement ouverte aux exigences et aux expériences de la société, à ses revendications et à ses propositions. Le paradoxe, c’est que ce texte qui ferme le débat avant qu’il ait eu lieu proclame, dans sa deuxième partie, que « réussir le changement, c’est mobiliser la société ».
Mais c’est pour, immédiatement, affirmer, dans un réflexe curieusement défensif : « Pour nous, redisons-le, la démocratie est d’abord représentative. Qu’elle soit en crise – pourquoi le nier quand tant de nos concitoyens ne se rendent pas aux urnes – ne doit pas nous conduire à l’oublier, mais à œuvrer pour lui redonner son crédit et sa grandeur ». Ce passage ne laisse pas d’étonner, d’autant plus que Ségolène Royal figure parmi les signataires de ce texte. Car, élus et bien élus, personne ne leur conteste leur qualité de représentants de la nation. En revanche, depuis les défaites de 2002 et 2007 et jusqu’à l’invention par le PS lui-même de la primaire citoyenne, il semblait acquis que redynamiser la démocratie supposait de développer son exigence participative et, donc, d’aller au-delà de sa dimension représentative, sans se contenter de la compléter par un dialogue institutionnel avec les syndicats et autres « corps intermédiaires ».
L’appel à une « démocratie participative » ne fut pas une lubie ou un gadget ségolénistes mais l’écho en France, sous le choc de l’impensable défaite de 2002, de débats intellectuels anciens et d’expériences concrètes approfondies venus d’autres pays et continents. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, la crise de la démocratie nourrit la tentation d’en réserver la maîtrise à ses professionnels, supposés compétents et avertis, le peuple se contentant de les choisir à intervalles réguliers lors des scrutins. Cette conception faible de la démocratie est, de longue date, contestée par les tenants d’une conception forte qui ancre la démocratie dans sa promesse originelle : le pouvoir du peuple, d’un peuple qui gouverne et se gouverne, qui intervient et contrôle, initie et participe, s’implique et se mobilise (voir par exemple sur Mediapart l'entretien de Cornelius Castoriadis filmé par Chris Marker).
En 2007, dans l’un des livres qui initia ce débat (Le pouvoir au peuple, La Découverte), le sociologue Yves Sintomer résumait ainsi l’enjeu de la démocratie participative : « Le vrai problème n’est pas que la société française soit entrée dans une phase de décadence, mais que le système politique actuel soit incapable de se nourrir des dynamiques civiques existantes pour s’attaquer résolument aux défis du monde présent ». C’est d’ailleurs si vrai que le PS lui-même, paralysé par une crise de leadership depuis la déroute de 2002, a été contraint de se tourner vers les citoyens, bien au-delà de son propre parti, afin de sortir de cette impasse.
Les dirigeants socialistes leur en sont bien peu reconnaissants qui, aujourd’hui, s’arcboutent sur une démocratie représentative anémiée après avoir été les premiers bénéficiaires de la démocratie participative. Auraient-ils déjà oublié la justification de cette primaire citoyenne, telle que l’énonçaient ses principaux promoteurs, Olivier Ferrand et Arnaud Montebourg ? « Nos partis politiques, écrivaient-ils en 2009 dans Primaire, comment sauver la gauche (Seuil), ne fonctionnent pas de manière démocratique. Centralisme “bonapartiste” pour les uns, “avant-garde éclairée” pour les autres : le résultat est le même, c’est une petite oligarchie dirigeante qui y détient le pouvoir. »
En conséquence de quoi, ils voyaient dans la primaire « un accélérateur de la transformation de la gauche » : « La primaire contient une obligation de se mettre à l’écoute des Français. (…) Cette obligation d’écoute des Français, c’est aussi une prise de pouvoir des citoyens, à qui la gauche aura donné de nouveaux droits démocratiques. (…) Cette primaire est donc un moyen de reconstruire une confiance altérée ou perdue entre les Français ». Disparu brutalement cet été, Olivier Ferrand n’est plus de ce monde pour rafraîchir la mémoire de Mme Aubry et de M. Ayrault, tandis qu’Arnaud Montebourg est silencieux, puisque ministre du gouvernement que dirige ce dernier. C’est pourtant maintenant, à l’épreuve du pouvoir, que les questions qu’ils posaient deviennent décisives.
Car, autant le dire tout net, sans le peuple des citoyens, les dirigeants socialistes ne seraient pas où il sont aujourd’hui. Auraient-ils oublié les aveuglements strauss-kahniens de leur direction jusqu’au fait-divers new-yorkais ? Les tentations, lâchetés et opportunismes de certains des leurs, issus de tous leurs courants, sous le sarkozysme triomphant des débuts ? Les mobilisations sociales, manifestations populaires et grèves ouvrières, qui ont nourri l’exigence de changement ? Les révélations journalistiques qui ont bousculé l’agenda médiatique du pouvoir, lequel anesthésiait l’information ?
Toute cette dynamique était porteuse de ce qui coûte le moins mais rapporte le plus : un sursaut démocratique, d’invention et de refondation. Et, pour l’instant, le compte n’y est pas.
Une commission Jospin qui dépossède le Parlement
On prête à Georges Clemenceau (1841-1929) cet aveu : « Si vous voulez enterrer un problème, créez une commission ». Or les débuts de la présidence Hollande sont marqués par une imprévue « commissionnite ». Imprévue parce qu’elle ne fut aucunement annoncée à ses électeurs. Qu’il faille de l’écoute, de la négociation et de la concertation pour faire aboutir sans encombres des réformes, c’est l’évidence même. Mais, ici, il ne s’agit pas de cela : dans plusieurs domaines, et notamment celui de la refondation démocratique, le nouveau président a délégué à des commissions qu’il a lui-même nommées la réflexion sur les réformes nécessaires. Faisant comme si des engagements clairs n’avaient pas été pris devant le peuple dont il suffisait de confier la mise en œuvre au Parlement, en restaurant ses pouvoirs et en respectant ses prérogatives ainsi qu’il l’avait promis durant sa campagne.
De l’OTAN à l’euthanasie, en passant par Hadopi, l’audiovisuel ou la vie publique, cette cascade de commissions et de missions est un renoncement politique en ce qu’elle dépossède le Parlement de son rôle premier. Pourquoi faudrait-il prendre des avis d’experts, lesquels ne sont pas forcément indépendants ou indiscutables, sur des questions largement débattues devant le pays, entre socialistes et dans la gauche, depuis une décennie ? Voire bien plus longtemps si l’on s’en tient à la « Commission chargée de la rénovation et de la déontologie de la vie publique » dont l’ordre du jour putatif a déjà été inventorié et rabâché depuis au moins 1995, sinon 1981, d’élections en élections, de campagnes en campagnes, de promesses en promesses, de congrès en congrès, de rapports en rapports.
Seule annonce de l’interview présidentielle du 14 juillet, l’institution de cette commission présidée par Lionel Jospin confisque, du moins provisoirement, une réflexion qui aurait dû être d’emblée parlementaire, suscitant l’intérêt du pays, la curiosité des médias et la mobilisation des citoyens. Sa composition, fort traditionnelle, et son fonctionnement, très fermé (lire ici l’article très complet de Stéphane Alliès), illustrent jusqu’à la caricature cette vision, au choix élitiste, aristocratique ou avant-gardiste, d’une démocratie plus en sûreté si ne s’en mêlent que des professionnels, compétents et expérimentés. De fait, à l’heure de la révolution numérique, cette commission est toujours introuvable sur internet, à l’exception des communiqués élyséens (ici et là).
Pas de site donc, pas de banque de données, pas de rappel des rapports, missions et engagements précédents, aucune audition prévue, nulle conférence de presse annoncée, bref un travail à huis clos, sans fenêtre publique, vers ou pour le public… Dans le secret de ses travaux, un groupe de personnalités choisies par le Prince du moment entend ainsi préparer, clés en mains, les projets de loi que le Parlement n’aura plus qu’à avaliser. Le processus étant en cours, on ne peut évidemment exclure que les ruses de la raison nous réservent des surprises et qu’au final, cette commission soit plus audacieuse dans ses propositions qu’elle ne l’est dans sa façon de faire.
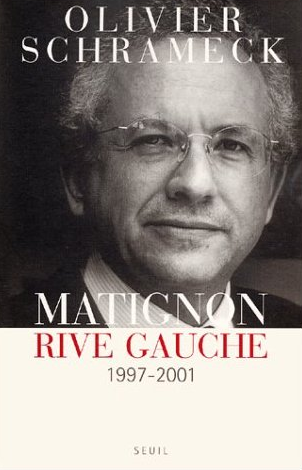 Reste que les anciennes prises de position publiques de l’ex-premier ministre sur les questions institutionnelles autorisent que l’on s’interroge dès maintenant. Promoteur du quinquennat, qu’il imposa à Jacques Chirac sous la cohabitation, et de l’inversion du calendrier, passage qu’il imposa au PS de l’élection présidentielle de 2002 avant les législatives, Lionel Jospin n’est certainement pas le moins présidentialiste des leaders socialistes. Le conseiller d’Etat Olivier Schrameck, son indéfectible collaborateur du temps où il fut ministre puis premier ministre, qui sera la cheville ouvrière de sa commission, a d’ailleurs rendu compte précisément, dans son livre de 2001, Matignon Rive gauche (Seuil), de ces paris venus d’en haut sur lesquels trébucha finalement la gauche quelques mois plus tard, dans les urnes d’en bas.
Reste que les anciennes prises de position publiques de l’ex-premier ministre sur les questions institutionnelles autorisent que l’on s’interroge dès maintenant. Promoteur du quinquennat, qu’il imposa à Jacques Chirac sous la cohabitation, et de l’inversion du calendrier, passage qu’il imposa au PS de l’élection présidentielle de 2002 avant les législatives, Lionel Jospin n’est certainement pas le moins présidentialiste des leaders socialistes. Le conseiller d’Etat Olivier Schrameck, son indéfectible collaborateur du temps où il fut ministre puis premier ministre, qui sera la cheville ouvrière de sa commission, a d’ailleurs rendu compte précisément, dans son livre de 2001, Matignon Rive gauche (Seuil), de ces paris venus d’en haut sur lesquels trébucha finalement la gauche quelques mois plus tard, dans les urnes d’en bas.
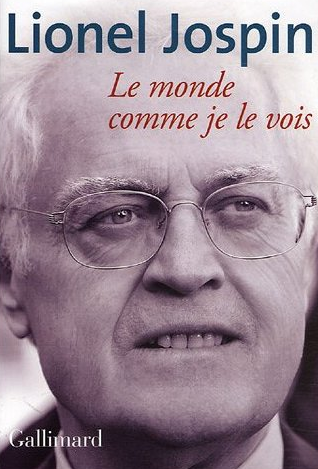 Dans l’ouvrage de 2005, Le monde comme je le vois (Gallimard), où il revient sur son expérience gouvernementale, Lionel Jospin assume cette inflexion présidentialiste. « Le défaut d’unité et de responsabilité de notre pouvoir exécutif est dû à sa conception même, écrit-il. Deux têtes dans un exécutif, c’est une de trop, à moins que l’une d’entre elles ne soit vouée à une fonction purement symbolique de représentation de l’Etat (comme un monarque ou le président d’une démocratie parlementaire). Notre bicéphalisme érode la responsabilité, chacun se dérobe : le premier ministre puisqu’il ne décide pas et le président, puisqu’il n’assume pas. Il faut donc réformer nos institutions. »
Dans l’ouvrage de 2005, Le monde comme je le vois (Gallimard), où il revient sur son expérience gouvernementale, Lionel Jospin assume cette inflexion présidentialiste. « Le défaut d’unité et de responsabilité de notre pouvoir exécutif est dû à sa conception même, écrit-il. Deux têtes dans un exécutif, c’est une de trop, à moins que l’une d’entre elles ne soit vouée à une fonction purement symbolique de représentation de l’Etat (comme un monarque ou le président d’une démocratie parlementaire). Notre bicéphalisme érode la responsabilité, chacun se dérobe : le premier ministre puisqu’il ne décide pas et le président, puisqu’il n’assume pas. Il faut donc réformer nos institutions. »
L’orientation qui, à l’époque, avait sa faveur ne fait nul doute : priorité au président de la République, donc effacement du premier ministre, et non pas cette « autre solution possible (qui) consiste à revenir au parlementarisme » : « Un président qui gouverne et assume la responsabilité de l’exécutif, et un Parlement qui obtient la plénitude de ses fonctions, voilà un choix qui améliore clairement nos institutions actuelles », affirmait-il. A l’inverse, « il n’est nullement certain que le parlementarisme saurait imposer les disciplines nécessaires à une action d’Etat continue et déterminée ». Répondant par avance aux objections de ceux qui s’inquiètent d’un risque de « césarisme » en cas de « régime purement présidentiel », il ajoutait : « Mais les Césars sont loin ».
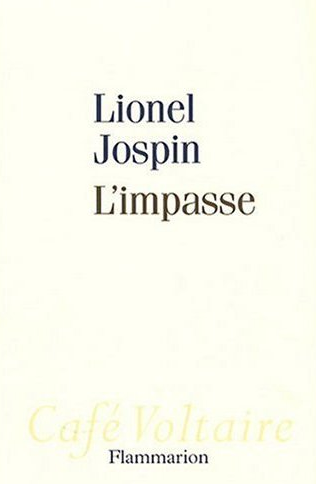 Deux ans plus tard, la réalité du sarkozysme hyperprésidentiel apportait un démenti à cet optimisme jospinien, fondé sur l’accoutumance au fait présidentiel, laquelle masque les régressions démocratiques du présidentialisme français. Ce manque de préscience n’est pas sans rapport avec une conception limitée de la démocratie dont témoignait, en 2007, un nouveau livre de Lionel Jospin, L’impasse (Flammarion), réquisitoire contre Ségolène Royal et, notamment, sa « démocratie participative ». On y retrouve la même antienne que dans le texte Aubry-Ayrault : « Dans tous pays où règne la démocratie, elle est représentative. L’ensemble du peuple ne peut exercer sa souveraineté qu’en déléguant à ses élus le pouvoir de décider en son nom et conformément à des orientations qu’ils lui ont soumises ».
Deux ans plus tard, la réalité du sarkozysme hyperprésidentiel apportait un démenti à cet optimisme jospinien, fondé sur l’accoutumance au fait présidentiel, laquelle masque les régressions démocratiques du présidentialisme français. Ce manque de préscience n’est pas sans rapport avec une conception limitée de la démocratie dont témoignait, en 2007, un nouveau livre de Lionel Jospin, L’impasse (Flammarion), réquisitoire contre Ségolène Royal et, notamment, sa « démocratie participative ». On y retrouve la même antienne que dans le texte Aubry-Ayrault : « Dans tous pays où règne la démocratie, elle est représentative. L’ensemble du peuple ne peut exercer sa souveraineté qu’en déléguant à ses élus le pouvoir de décider en son nom et conformément à des orientations qu’ils lui ont soumises ».
Avant qu’en 2017, d’éventuelles mauvaises surprises électorales illustrent les limites de cette conception immobile et figée de la démocratie, n’aurait-il pas mieux valu confier la rénovation des institutions à des réformateurs plus audacieux et plus inventifs ?
L’audace démocratique contre le retour du fascisme
En conclusion de L’impasse (2007), Lionel Jospin imaginait un « nouveau cap » pour la gauche dont la traduction serait « un grand parti de toute la gauche échappant enfin à la guerre des deux gauches, réformiste et radicale ». Or, sous l’épreuve du sarkozysme, c’est exactement l’inverse qui s’est produit : le départ de Jean-Luc Mélenchon du PS et la création du Front de gauche. Par delà les affiliations partisanes – auxquelles il faut ajouter les écologistes d’EELV qui n’ont aucune intention de jouer les godillots –, cet approfondissement de l’écart en lieu et place du rapprochement espéré est une réalité avec laquelle le nouveau pouvoir doit compter, sauf à présumer de ses forces.
Car, du débat européen aux questions sociales et démocratiques, ces divisions qui traversent la gauche et ses partis témoignent des effets de réalité produits par l'expérience vécue de ces dix dernières années d’une droite au pouvoir sans partage. La pire illusion pour François Hollande – et les deux signaux négatifs Aubry-Ayrault et Jospin en relèvent – serait de croire qu’avec son élection, la gauche reprend un cours politique… normal qui n’aurait jamais dû s’interrompre en 2002. Comme si tout revenait dans l’ordre, comme si rien d’essentiel ne s’était produit, de la crise économique historique à l’ascension d’une droite extrême.
L’époque appelle audace, invention et mobilisation. Non pas qu’il faille regretter l’agitation destructrice de la présidence sortante, mais rien ne serait pire qu’un apaisement synonyme d’endormissement, de conversion à l’ordre des choses et de soumission au rapport de forces. Après, il sera trop tard. Les socialistes nous ont habitué à des lucidités dans l’échec et la défaite qu’ils oublient une fois au pouvoir et qu’il n’est jamais inutile de leur rappeler. Par exemple, ce réquisitoire implacable de 1991 contre la politique économique et européenne qu’incarnait alors Pierre Bérégovoy (1925-1993), où s’installaient à demeure les bombes à retardement de la crise d’aujourd’hui.
« La gauche française au pouvoir s’est cantonnée en matière économique dans la gestion à court terme et dans la défense (ce qui n’est déjà pas si mal) de ce qui restait de ses valeurs. Convertie à la crédibilité internationale, surnageant dans la vague libérale, elle s’est placée sur le terrain de l’adversaire et s’y est naturellement trouvée progressivement démunie. (…) Plus profondément, les objectifs d’une politique de gauche, à être sans cesse repoussés au-delà des résultats d’une période de rigueur qui ne s’arrête jamais, deviennent illisibles, peu crédibles, voire introuvables. »
Les auteurs de ce livre, intitulé L’heure des choix (Odile Jacob), ne sont autres que les nouveaux président de la République et ministre de l’économie, François Hollande et Pierre Moscovici. Les immenses défis de la crise donnent une dimension prophétique à cette mise en garde qui vaut aussi bien pour les questions économiques que démocratiques, puisqu’il s’agit dans les deux cas de promouvoir la justice et l’égalité. « Croyons-nous en la démocratie ? » : en 1934, au creux de la dépression américaine provoquée par la crise de 1929 à laquelle notre crise actuelle est comparable, une voix s’est élevée pour poser cette simple question. Et cette voix, celle du père intellectuel d’une radicalité démocratique inscrite dans le pragmatisme de l’expérience, a beaucoup compté dans le réveil des Etats-Unis face au fascisme et au nazisme, lequel réveil n’avait rien d’inéluctable.
Dans Une foi commune (enfin édité en français par La Découverte, en 2011), ce philosophe, John Dewey (1859-1952), posait la question de l’adhésion à la démocratie et de la force mobilisatrice de son idéal selon lequel « chaque citoyen est un souverain ». Soucieux de la construction d’un public qui participe à la démocratie, qui soit informé sur ses enjeux et que l’on implique dans ses solutions, Dewey démontrait que, loin de se réduire à ses dimensions représentative et délibérative, sa vitalité suppose un écosystème complexe et dynamique. Une démocratie qui ne serait confiée qu’à la délégation de pouvoir de ses élus serait anémiée et fragile, soulignait-il, et donc à la merci de n’importe quel démagogue.
Faute de ces audaces, de pensées et d'actes, d’autres forces que la gauche récupéreront et exploiteront les attentes d’un peuple qui en est venu à douter de la démocratie elle-même. L’enseignement des dernières années, en France comme ailleurs en Europe, c’est que ce ne seront sans doute pas les droites conservatrices classiques, mais des droites nouvelles, extrémisées et radicalisées. Ces droites dont le néerlandais Rob Riemen a récemment montré, dans un essai brûlant en forme d’alarme au-delà de son propre pays (chez NiL), qu’elles n’étaient, au bout du compte, malgré leurs atours nouveaux, que « l’éternel retour du fascisme » (lire ici un compte-rendu dans le Club).
Un retour, ajoutait-il, facilité par « des partis politiques qui ont renoncé à leurs idéaux », par « la cupidité du monde des affaires », par des « intellectuels qui cultivent un nihilisme complaisant » et par « des mass medias qui s’emploient à l’abêtissement du public, plutôt que de chercher à développer son sens critique »… Nous sommes donc bien tous concernés.