| index | précédent | suivant |
|---|
L'avenir du prolétariat
 A la recherche de mascarons, j'aurai au moins appris à lever le nez ! Angle de l'avenue Suffren et de l'avenue du Général Tripier, non loin de l'avenue Bouvard qui offre une vue, de part et d'autre, de la Tour Eiffel et du Grand Palais Éphémère, dans un de ces quartiers on ne peut plus bourgeois, cet grand immeuble cossu en diable, imposant une respectabilité presque écrasante, non loin finalement, de l'autre côté du Champ de Mars de l'avenue Rapp où trône tout aussi bien une cathédrale orthodoxe, clinquante à souhait - que les mauvaises langues surnomme cathédrale Poutine - où triomphe l’immeuble Lavirotte.
A la recherche de mascarons, j'aurai au moins appris à lever le nez ! Angle de l'avenue Suffren et de l'avenue du Général Tripier, non loin de l'avenue Bouvard qui offre une vue, de part et d'autre, de la Tour Eiffel et du Grand Palais Éphémère, dans un de ces quartiers on ne peut plus bourgeois, cet grand immeuble cossu en diable, imposant une respectabilité presque écrasante, non loin finalement, de l'autre côté du Champ de Mars de l'avenue Rapp où trône tout aussi bien une cathédrale orthodoxe, clinquante à souhait - que les mauvaises langues surnomme cathédrale Poutine - où triomphe l’immeuble Lavirotte.
 Où je vois cette étonnante mention : L'avenir du Prolétariat.
Où je vois cette étonnante mention : L'avenir du Prolétariat.
L'histoire est jolie même si elle ne finit pas très bien. Celle d'un philanthrope Henri Ferdinand Boire (né le 11 juin 1857 à Léran en Ariège) receveur des Postes de son état qui imagina en cette fin du XIXe où n'existait encore aucun système de retraites de créer une organisation de prévoyance destinée aux travailleurs prévoyants de l'atelier, des champs et du bureau : en échange d'une cotisation d'un sou par jour et grâce à un nombre de sociétaires en constante augmentation, cette organisation put assurer à ses souscripteurs une rente pour leurs vieux jours. Aucun d'eux n'était actionnaire et ne pouvait ainsi revendiquer plus que sa part ni donc de pouvoir prendre le contrôle de la société.
Tout aurait pu durer longtemps ainsi car entre-temps l'Avenir du Prolétariat devint propriétaire de plus d'une quarantaine d'immeubles dans Paris et ailleurs et le nombre de sociétaires augmentait irrésistiblement. Même la création, garantie par l’État d'un système de retraite puis de complémentaires ne l'entrava pas.
Il fallut un contrôle du fisc dans les années 70 : repérant que l'organisation ne correspondait à aucune norme juridique, ni celle d'une SCI ni celle d'une société d'assurances ou de fonds de pension, l'administration l'obligea à se doter d'un système qui transforma les souscripteurs en actionnaires. Les ennuis commencèrent, les divisions et les OPA !
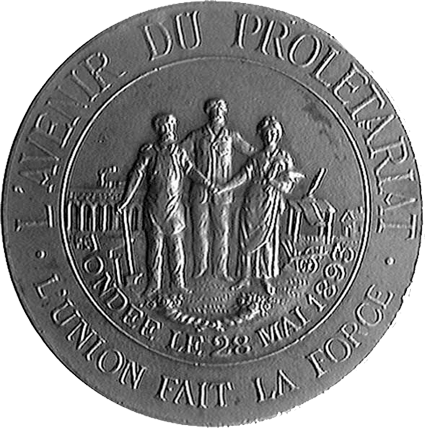 L'aventure, joliment idéaliste, s'arrêta !
L'aventure, joliment idéaliste, s'arrêta !
Symbolique sans doute de notre époque. Il n'est pas tant de manières que cela de barrer la route du prolétariat. La solution politique sembla à beaucoup la plus évidente et du fascisme au conservatisme le plus épais en passant même par ces mièvres cauteleux qui osèrent même s'intituler radicaux-socialistes, nombreux furent ceux qui combattirent les partageux. La lutte contre le bolchévisme servit même de prétexte aux fascistes pour justifier leurs guerres. Le monde libre d'après 45 ne se priva pas de l'honneur d'en copier l'argumentaire.

En réalité, la solution était sottement technique comme l'entonnent jusqu'au dégoût les libéraux de tout poil, les technocrates les plus endurcis, les thuriféraires de la pensée unique. Il aura suffi d'un peu d'intéressement pour briser l'élan de solidarité. Les anciens n'eurent pas tort de se méfier de cette propriété qui invariablement allait télescoper l'égalité et achever bientôt de la fracasser.
La liberté du renard dans le poulailler !
Et le prolétariat sonnerait presque comme un gros mot.
Ils furent quelques uns, inspirés parfois par des modèles allemands, anarcho-syndicalistes ou simplement hommes de bien comme il arrivait qu'on les appelât, qui tentèrent en cette Belle-Epoque qui ne le fut pas pour tout le monde, d'inventer un monde plus humain, moins cruel, moins cynique. Nous devrions nous souvenir que ce capitalisme dut son étonnante prospérité et ses victoires d'avoir été sauvage, sans foi et presque sans loi. Que l'opulence de ces donneurs de leçons s'érigea sur la misère oraganisée de ce prolétariat qu'ils ne daignèrent même pas regarder en face.
Souvenons-nous en au moment où, un peu plus d'un siècle plus tard, d'autres, plus cyniques encore, mais à la compréhension matoise, mais aux évidences assénées comme des coups de massue, se piquent, réforme après réforme, de ruiner ce qui fut mis en place, rejetant avec une insolence criminelle, sur les petits revenus, les faibles et les indigents qui répugneraient à travailler plus, la responsabilité d'un système qu'ils s'épuisent à déclarer à bout de souffle.
 Même mort, le prolétariat les dérange encore. Même épuisés, les travailleurs les dégoûtent. Tellement vulgaire, la sueur.
Même mort, le prolétariat les dérange encore. Même épuisés, les travailleurs les dégoûtent. Tellement vulgaire, la sueur.
La famille Catteau se paye L'Avenir du prolétariat. Ce système de prévoyance atypique était très convoité.
Ironie du sort et des affaires, L'Avenir du prolétariat s'est livré
aux Catteau, une riche famille du Nord, pour échapper aux marchands de biens. C'est que «l'association des déshérités de la fortune» abritait de quoi attiser bien des convoitises: une trentaine d'immeubles situés dans les arrondissements les plus huppés de la capitale, avec en prime quelques pied-à-terre spacieux à Lyon et Toulouse. Au total, un trésor foncier estimé à 800 millions de francs mi-1994. Ce parc immobilier est passé sous le contrôle des Catteau fin 1994 pour environ 6.000 francs par mètre carré. En dépit de la chute des prix depuis le début de la décennie (22.000 francs le mètre carré parisien en 1990, un peu plus de 17.000 aujourd'hui), la marge reste confortable. Cette opération juteuse sur le long terme, une fois rénovés les immeubles et renégociés les loyers 1948, a toutefois sonné le glas d'une idée généreuse.
En 1893, Ferdinand Boire, receveur des Postes et philanthrope dans l'âme, s'émeut du sort des ouvriers trop vieux ou trop malades pour retourner à l'usine. La protection sociale était encore dans les limbes et le travailleur imprévoyant pouvait se trouver du jour au lendemain réduit à la misère. Ferdinand Boire décide de remédier à ce cauchemar en incitant ses compatriotes à épargner durant leur période d'activité afin d'assurer leurs arrières.
Chaque année pendant un minimum de quinze ans et un maximum de cinquante ans, l'ouvrier devait verser une cotisation à une société civile, L'Avenir du prolétariat, qui investissait les fonds recueillis dans des immeubles de rapport. Sage, Ferdinand Boire avait mis la quasi-SCI (société civile et immobilière) à l'abri des convoitises: L'Avenir du prolétariat n'appartenait à personne. En fin de contrat, la société reversait à ses membres l'intégralité des sommes qu'ils lui avaient confiées. Aucun bénéficiaire ne pouvait donc revendiquer un droit sur son contrôle. Ceux qui interrompaient leur versement en cours de route perdaient tout. En revanche, les autres recevaient une petite rente en fonction des loyers engrangés et des plus-values immobilières réalisées. Compte tenu du décalage inévitable entre cotisants et ayants droit, plus la société avait de membres, plus les adhérents percevaient une retraite confortable. Le prosélytisme était donc une règle de conduite: au début du siècle, plus de 150.000 membres cotisaient. Deux guerres mondiales après sa naissance, L'Avenir du prolétariat était devenu un riche propriétaire foncier. Indifférente aux tourments du siècle, la société continuait à recueillir des adhésions et continuerait peut-être encore si le fisc ne s'en était mêlé.
Au milieu des années 1970, lors d'un contrôle de routine, les inspecteurs des impôts réalisent qu'ils ont affaire à un OFNI: un objet financier non identifié. L'Avenir du prolétariat ne relève d'aucune structure juridique connue: il ne respecte pas les ratios de solvabilité imposés aux caisses de retraite, aux sociétés d'assurance ou aux fonds de pension. Il n'est pas non plus soumis aux règles d'affectation du capital des sociétés civiles immobilières. Dix ans plus tard, la Direction générale des impôts somme la société de choisir son camp. En 1987, L'Avenir du prolétariat opte pour le statut de société civile immobilière (SCI). Il lui faut partager son capital entre ses membres. Là commencent les ennuis. Difficile en effet de trouver une clé de répartition entre adhérents cotisants et adhérents retraités qui satisfasse les uns et les autres. «Comme un autre associé, j'avais souscrit 250 parts en 1972. En 1987, avec la conversion, lui a eu 45 actions et moi 13...», s'indigne un ancien membre. A 900 francs la part, la différence était sensible. On est en 1990, en plein boom immobilier. Le mécontentement des associés fait l'affaire des promoteurs qui décident de lancer une offre publique d'achat privée pour rafler le maximum de parts. Prix unitaire proposé: 3.000 francs. Plus de trois fois le prix de rachat autoritairement fixé par les gérants de L'Avenir du prolétariat.
Les promoteurs avaient cependant oublié les défenses anti-OPA disséminées dans les statuts. Aucun sociétaire de L'Avenir du prolétariat ne pouvait en détenir plus de trois parts pour mille; en outre, seuls les membres d'une même famille pouvaient acquérir des titres sans avoir à demander l'accord de la gérance. Les promoteurs doivent bientôt jeter l'éponge: «Nous étions pleins comme des oeufs. Nous, nos enfants, nos parents, nos frères et soeurs. Plus aucun membre de nos familles qui n'avait son quota de 3 pour mille parts de L'Avenir du prolétariat. Et, au final, nous n'avions guère plus de 12% du capital...», sourit Alain Frei, qui initia la première tentative de raid au côté d'un marchand de biens, Louis Benedetti.
L'attaque avait mis en évidence que la gérance rachetait au rabais les parts des associés désirant quitter L'Avenir du prolétariat. Sentant venir la sanction, la direction contacte Franck Noël, conseiller patrimonial de grandes familles du Nord. Au nombre desquelles la très nombreuse famille Catteau. Vingt et un Catteau sont mobilisés pour acheter des parts. D'autre familles alliées se joignent à l'opération. Avec l'appui actif des gérants, les Catteau récupèrent la majorité du capital de L'Avenir du prolétariat. Prix payé aux associés: un peu plus de 3.000 francs la part; prix payé à Frei, Benedetti et Cie, près de 5.200 francs la part... Fin de l'histoire: L'Avenir du prolétariat, désormais transformé en société anonyme, devrait prochainement abandonner son patronyme pour celui, plus marketing, de Foncière ADP .