| index | précédent | suivant |
|---|
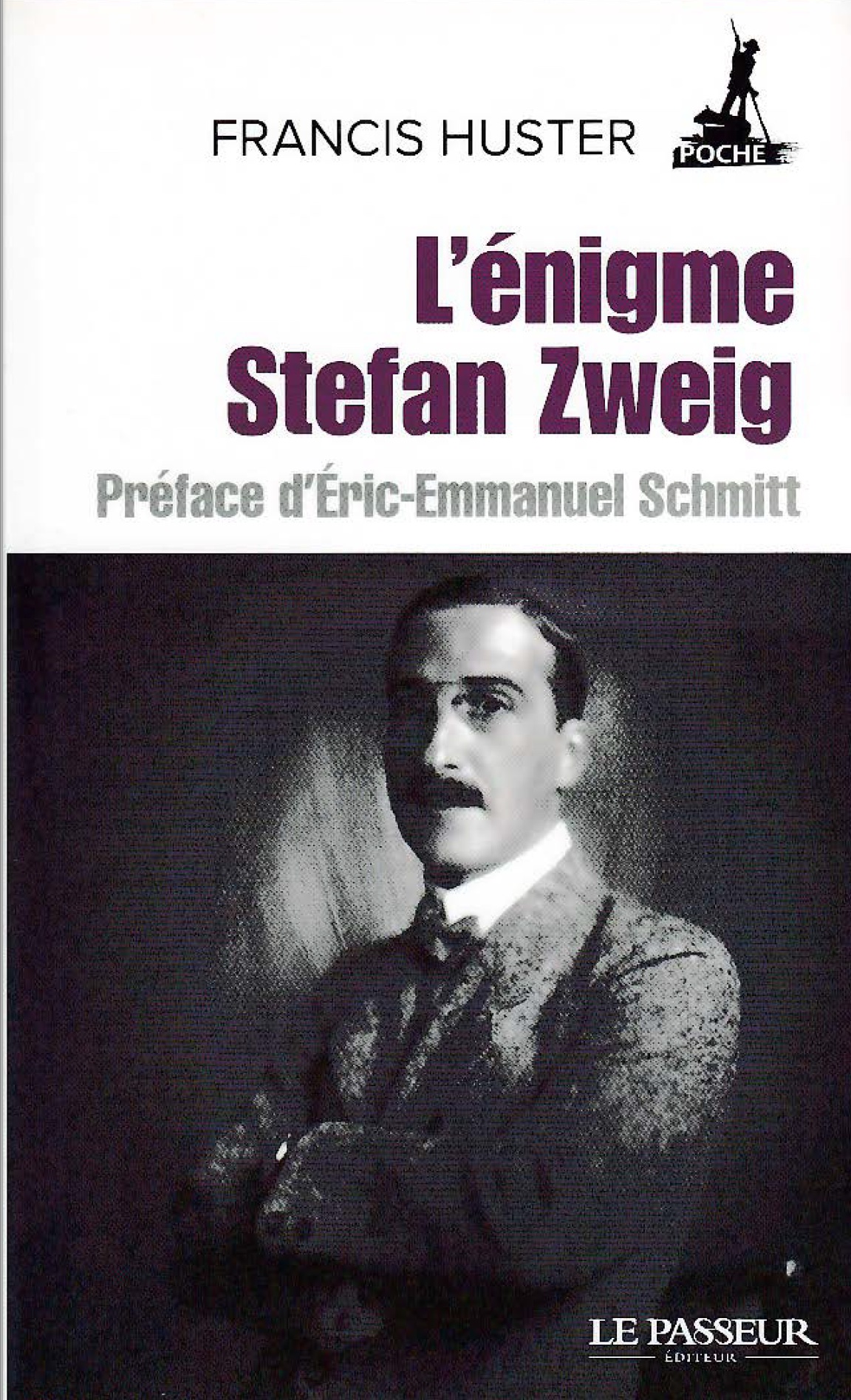 F Huster l'énigme Zweig Echec au moi p 118
F Huster l'énigme Zweig Echec au moi p 118
Certes, il y a toutes sortes d'écrivains.
Ceux debout, immobiles, qui observent, comme des poteaux indicateurs montrant aux lecteurs la direction à prendre pour suivre leurs personnages. Ils ont la malice aussi de nous entraîner sur de fausses pistes, nous obligeant à emprunter l'itinéraire de déviation. Ne serait ce que pour nous éloigner quelque temps du héros. Pour lui conférer encore davantage de force lorsque nous le retrouverons.
Il y a ensuite les écrivains assis ou couchés. Ceux qui se posent. Et tout est en eux. Rien ne leur échappe, car rien ne s'en échappe. Lire un livre, c'est lire en eux. Ils sont la plupart du temps d'insupportables cabots, mais leur génie manipule tout avec tant de talent que l'on ne peut que saluer la performance.
Et enfin, la troisième catégorie d'écrivains regroupe ceux qui marchent, qui ont le talent de cheminer à côté de leurs personnages, de les précéder quand il le faut, pour nous en dire plus que le personnage ne sait de lui, ou qui acceptent de le suivre pour le laisser lui-même s'expliquer librement sans le recours de son créateur. Ces écrivains-là obligent le lecteur à marcher aussi vite qu'eux. À leur côté et du début du livre à la fin. Le rythme est haletant et soutenu, puis s'emballe jusqu'au dénouement fatal.
Hugo et Tolstoï, debout, sont nos guides. Proust et Céline, couchés, sont nos monstres. Camus et Zweig, marcheurs infatigables, sont nos miroirs.
Les oeuvres des debout vieillissent vite, car le monde change et leurs routes n'existent plus. La vitesse de compréhension les dépasse. Mais tout en restant figées, elles sont sculptées dans le marbre et deviennent les véritables monuments de la littérature. Oui, Victor et Léon, Hugo et Tolstoï, sont à visiter et revisiter à l'infini.
Les couchés sont à leur place, d'où ils trônent pour l'éternité. Ces statues n'ont pas fini d'être admirées pour ce qu'elles sont : les témoins d'un siècle, d'une époque. Qu'ils ont magnifié en illuminant, comme des phares, chaque recoin de son labyrinthe qu'ils gardent à jamais. On ne peut plus parler du XXe siècle sans évoquer Proust et Céline. Comme pour le XVIIIe Voltaire et Rousseau, Racine et Corneille au XXIIe.
Mais ce qui conclut ce bref raisonnement, c'est la jeunesse éternelle et la fraîcheur bienfaisante des marcheurs. Eux, nous les avons suivis, malgré nous, comme tous les millions d'autres lecteurs. Nous nous sommes surpris à les aimer, bien sûr. Au point de nous étonner de découvrir tant de choses que nous pensions sans les avoir formulées aussi clairement. Avec les mots les plus justes pour exprimer tout haut ce que nous sentions en nous. Mais pas au point, non plus, d'affirmer qu'avec eux, à côté d'eux, nous avions affaire à des génies. De grands écrivains, certes mais pas plus. Puis a commencé la révélation. Est-ce nous qui y revenions, ou eux qui ne nous quittaient plus ?
Nous avions beau marcher à notre rythme, ils semblaient s'en accommoder. Et ne nous lâchaient pas. Camus et Zweig faisaient désormais partie de notre vie, de notre famille, de nos proches. Nous nous sommes tous sentis obligés de parcourir leur oeuvre, de les connaître davantage. Plus ils nous devenaient familiers, plus nous découvrions en nous-mêmes ces zones jamais défrichées en notre âme, où nous nous étions pourtant égarés, nous aussi.