Diderot, Le neveu de Rameau
MOI. — Si l’expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d’être gueux.
LUI. — Il est dur d’être gueux, tandis qu’il y a tant de sots opulents aux dépens desquels on peut vivre. Et puis le mépris de soi, il est insupportable.
MOI. — Est-ce que vous connaissez ce sentiment-là ?
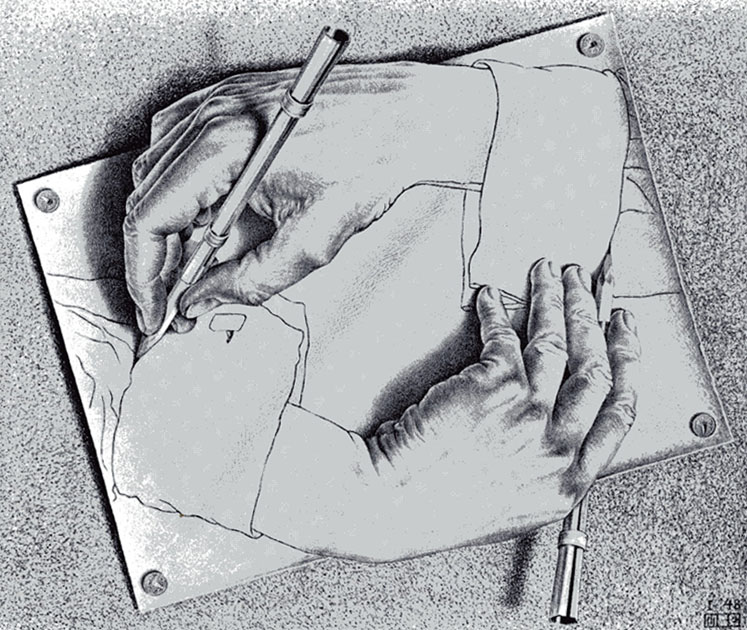 LUI. — Si je le connais ! Combien de fois je me suis dit : Comment, Rameau, il y a dix mille bonnes tables à Paris, à quinze ou vingt couverts chacune ; et de ces couverts-là il n’y en a pas un pour toi ! Il y a des bourses pleines d’or qui se versent de droite et de gauche, et il n’en tombe pas une pièce sur toi ! Mille petits beaux esprits sans talent, sans mérite, mille petites créatures sans charmes, mille plats intrigants sont bien vêtus, et tu irais tout nu ! et tu serais imbécile à ce point ! Est-ce que tu ne saurais pas flatter comme un autre ? est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer, parjurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas favoriser l’intrigue de madame, et porter le billet doux de monsieur comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas encourager ce jeune homme à parler à mademoiselle, et persuader mademoiselle de l’écouter, comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d’un de nos bourgeois qu’elle est mal mise ; que de belles boucles d’oreilles, un peu de rouge, des dentelles, ou une robe à la polonaise, lui siéraient à ravir ? Que ces petits pieds-là ne sont pas faits pour marcher dans la rue ? Qu’il y a un beau monsieur, jeune et riche, qui a un habit galonné d’or, un superbe équipage, six grands laquais, qui l’a vue en passant, qui la trouve charmante, et que depuis ce jour-là il en a perdu le boire et le manger, qu’il n’en dort plus, et qu’il en mourra ? — Mais mon papa ? — Bon, bon, votre papa ! il s’en fâchera d’abord un peu. — Et maman qui me recommande tant d’être honnête fille ; qui me dit qu’il n’y a rien dans ce monde que l’honneur ? — Vieux propos qui ne signifient rien. — Et mon confesseur ? — Vous ne le verrez plus ; ou si vous persistez dans la fantaisie d’aller lui faire l’histoire de vos amusements, il vous en coûtera quelques livres de sucre et de café. — C’est un homme sévère, qui m’a refusé l’absolution pour la chanson, Viens dans ma cellule. — C’est que vous n’aviez rien à lui donner : mais quand vous lui apparaîtrez en dentelles… — J’aurai donc des dentelles ? — Sans doute, et de toutes les sortes…, en belles boucles de diamants… — J’aurai donc de belles boucles de diamants ? — Oui. — Comme celles de cette marquise qui vient quelquefois prendre des gants dans notre boutique. — Précisément… dans un bel équipage avec des chevaux gris pommelés, deux grands laquais, un petit nègre, et le coureur en avant ; du rouge, des mouches, la queue portée. — Au bal ? — Au bal, à l’Opéra, à la Comédie… (déjà le cœur lui tressaillit de joie…) — Tu joues avec un papier entre tes doigts. Qu’est-ce cela ? — Ce n’est rien. — Il me semble que si. — C’est un billet. — Et pour qui ? — Pour vous, si vous étiez un peu curieuse. — Curieuse ? je le suis beaucoup ; voyons (elle lit). Une entrevue ! cela ne se peut. — En allant à la messe. — Maman m’accompagne toujours ; mais s’il venait ici un peu matin, je me lève la première, et je suis au comptoir avant qu’on soit levé… — Il vient, il plaît ; un beau jour, à la brune, la petite disparaît, et l’on me compte mes deux mille écus… Hé quoi ! tu possèdes ce talent-là, et tu manques de pain ! N’as-tu pas de honte, malheureux ?… Je me rappelais un tas de coquins qui ne m’allaient pas à la cheville, et qui regorgeaient de richesses. J’étais en surtout de bouracan, et ils étaient couverts de velours ; ils s’appuyaient sur la canne à pomme d’or et en bec de corbin, et ils avaient l’Aristote ou le Platon au doigt. Qu’étaient-ce pourtant ? de misérables croque-notes ; aujourd’hui ce sont des espèces de seigneurs. Alors je me sentais du courage, l’âme élevée, l’esprit subtil, et capable de tout ; mais ces heureuses dispositions apparemment ne duraient pas, car, jusqu’à présent, je n’ai pu faire un certain chemin. Quoi qu’il en soit, voilà le texte de mes fréquents soliloques, que vous pouvez paraphraser à votre fantaisie, pourvu que vous en concluiez que je connais le mépris de soi-même, ou ce tourment de la conscience qui naît de l’inutilité des dons que le ciel nous a départis ; c’est le plus cruel de tous. Il vaudrait presque autant que l’homme ne fût pas né.
LUI. — Si je le connais ! Combien de fois je me suis dit : Comment, Rameau, il y a dix mille bonnes tables à Paris, à quinze ou vingt couverts chacune ; et de ces couverts-là il n’y en a pas un pour toi ! Il y a des bourses pleines d’or qui se versent de droite et de gauche, et il n’en tombe pas une pièce sur toi ! Mille petits beaux esprits sans talent, sans mérite, mille petites créatures sans charmes, mille plats intrigants sont bien vêtus, et tu irais tout nu ! et tu serais imbécile à ce point ! Est-ce que tu ne saurais pas flatter comme un autre ? est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer, parjurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas favoriser l’intrigue de madame, et porter le billet doux de monsieur comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas encourager ce jeune homme à parler à mademoiselle, et persuader mademoiselle de l’écouter, comme un autre ? Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d’un de nos bourgeois qu’elle est mal mise ; que de belles boucles d’oreilles, un peu de rouge, des dentelles, ou une robe à la polonaise, lui siéraient à ravir ? Que ces petits pieds-là ne sont pas faits pour marcher dans la rue ? Qu’il y a un beau monsieur, jeune et riche, qui a un habit galonné d’or, un superbe équipage, six grands laquais, qui l’a vue en passant, qui la trouve charmante, et que depuis ce jour-là il en a perdu le boire et le manger, qu’il n’en dort plus, et qu’il en mourra ? — Mais mon papa ? — Bon, bon, votre papa ! il s’en fâchera d’abord un peu. — Et maman qui me recommande tant d’être honnête fille ; qui me dit qu’il n’y a rien dans ce monde que l’honneur ? — Vieux propos qui ne signifient rien. — Et mon confesseur ? — Vous ne le verrez plus ; ou si vous persistez dans la fantaisie d’aller lui faire l’histoire de vos amusements, il vous en coûtera quelques livres de sucre et de café. — C’est un homme sévère, qui m’a refusé l’absolution pour la chanson, Viens dans ma cellule. — C’est que vous n’aviez rien à lui donner : mais quand vous lui apparaîtrez en dentelles… — J’aurai donc des dentelles ? — Sans doute, et de toutes les sortes…, en belles boucles de diamants… — J’aurai donc de belles boucles de diamants ? — Oui. — Comme celles de cette marquise qui vient quelquefois prendre des gants dans notre boutique. — Précisément… dans un bel équipage avec des chevaux gris pommelés, deux grands laquais, un petit nègre, et le coureur en avant ; du rouge, des mouches, la queue portée. — Au bal ? — Au bal, à l’Opéra, à la Comédie… (déjà le cœur lui tressaillit de joie…) — Tu joues avec un papier entre tes doigts. Qu’est-ce cela ? — Ce n’est rien. — Il me semble que si. — C’est un billet. — Et pour qui ? — Pour vous, si vous étiez un peu curieuse. — Curieuse ? je le suis beaucoup ; voyons (elle lit). Une entrevue ! cela ne se peut. — En allant à la messe. — Maman m’accompagne toujours ; mais s’il venait ici un peu matin, je me lève la première, et je suis au comptoir avant qu’on soit levé… — Il vient, il plaît ; un beau jour, à la brune, la petite disparaît, et l’on me compte mes deux mille écus… Hé quoi ! tu possèdes ce talent-là, et tu manques de pain ! N’as-tu pas de honte, malheureux ?… Je me rappelais un tas de coquins qui ne m’allaient pas à la cheville, et qui regorgeaient de richesses. J’étais en surtout de bouracan, et ils étaient couverts de velours ; ils s’appuyaient sur la canne à pomme d’or et en bec de corbin, et ils avaient l’Aristote ou le Platon au doigt. Qu’étaient-ce pourtant ? de misérables croque-notes ; aujourd’hui ce sont des espèces de seigneurs. Alors je me sentais du courage, l’âme élevée, l’esprit subtil, et capable de tout ; mais ces heureuses dispositions apparemment ne duraient pas, car, jusqu’à présent, je n’ai pu faire un certain chemin. Quoi qu’il en soit, voilà le texte de mes fréquents soliloques, que vous pouvez paraphraser à votre fantaisie, pourvu que vous en concluiez que je connais le mépris de soi-même, ou ce tourment de la conscience qui naît de l’inutilité des dons que le ciel nous a départis ; c’est le plus cruel de tous. Il vaudrait presque autant que l’homme ne fût pas né.
(Je l’écoutais ; et à mesure qu’il faisait la scène de la jeune fille qu’il séduisait, l’âme agitée de deux mouvements opposés, je ne savais si je m’abandonnerais à l’envie de rire, ou au transport de l’indignation. Je souffrais ; vingt fois un éclat de rire empêcha ma colère d’éclater, vingt fois la colère qui s’élevait au fond de mon cœur se termina par un éclat de rire. J’étais confondu de tant de sagacité et de tant de bassesse, d’idées si justes et alternativement si fausses, d’une perversité si générale de sentiments, d’une turpitude si complète, et d’une franchise si peu commune. Il s’aperçut du conflit qui se passait en moi :
(...)
LUI. — Et que puisque je puis faire mon bonheur par des vices qui me sont naturels, que j’ai acquis sans travail, que je conserve sans effort, qui cadrent avec les mœurs de ma nation, qui sont du goût de ceux qui me protègent, et plus analogues à leurs petits besoins particuliers que des vertus qui les gêneraient, en les accusant depuis le matin jusqu’au soir, il serait bien singulier que j’allasse me tourmenter comme une âme damnée pour me bistourner et me faire autre que je ne suis, pour me donner un caractère étranger au mien, des qualités très-estimables, j’y consens pour ne pas disputer, mais qui me coûteraient beaucoup à acquérir, à pratiquer, ne me mèneraient à rien, peut-être à pis que rien, par la satire continuelle des riches auprès desquels les gueux comme moi ont à chercher leur vie. On loue la vertu, mais on la hait, mais on la fuit, mais elle gèle de froid, et dans ce monde il faut avoir les pieds chauds, et puis cela me donnerait de l’humeur infailliblement ; car pourquoi voyons-nous si fréquemment les dévots si durs, si fâcheux, si insociables ? C’est qu’ils se sont imposé une tâche qui ne leur est pas naturelle ; ils souffrent, et quand on souffre on fait souffrir les autres : ce n’est pas là mon compte, ni celui de mes protecteurs ; il faut que je sois gai, souple, plaisant, bouffon, drôle. La vertu se fait respecter, et le respect est incommode ; la vertu se fait admirer, et l’admiration n’est pas amusante. J’ai affaire à des gens qui s’ennuient, et il faut que je les fasse rire. Or, c’est le ridicule et la folie qui font rire, il faut donc que je sois ridicule et fou ; et quand la nature ne m’aurait pas fait tel, le plus court serait de le paraître. Heureusement je n’ai pas besoin d’être hypocrite ; il y en a déjà tant de toutes les couleurs, sans compter ceux qui le sont avec eux-mêmes ! Ce chevalier de la Morlière, qui retape son chapeau sur son oreille, qui porte la tête au vent, qui vous regarde le passant par-dessus son épaule, qui fait battre une longue épée sur sa cuisse, qui a l’insulte toute prête pour celui qui n’en porte point, et qui semble adresser un défi à tout venant, que fait-il ? tout ce qu’il peut pour se persuader qu’il est un homme de cœur ; mais il est lâche. Offrez-lui une croquignole sur le bout du nez, et il la recevra avec douceur. Voulez-vous lui faire baisser le ton ? élevez-le, montrez-lui votre canne, et appliquez votre pied entre ses fesses. Tout étonné de se trouver un lâche, il vous demandera qui est-ce qui vous l'a appris, d’où vous le savez ? lui-même l’ignorait le moment précédent ; une longue et habituelle singerie de bravoure lui en avait imposé, il avait tant fait les mines, qu’il croyait la chose. Et cette femme qui se mortifie, qui visite les prisons, qui assiste à toutes les assemblées de charité, qui marche les yeux baissés, qui n’oserait regarder un homme en face, sans cesse en garde contre la séduction de ses sens ; tout cela empêche-t-il que son cœur ne brûle, que des soupirs ne lui échappent, que son tempérament ne s’allume, que les désirs ne l’obsèdent, et que son imagination ne lui retrace la nuit ?… Alors que devient-elle ? qu’en pense sa femme de chambre, lorsqu’elle se lève en chemise et qu’elle vole au secours de sa maîtresse qui se meurt ? Justine, allez vous recoucher ; ce n’est pas vous que votre maîtresse appelle dans son délire. Et l’ami Rameau, s’il se mettait un jour à marquer du mépris pour la fortune, les femmes, la bonne chère, l’oisiveté, à catoniser, que serait-il ? un hypocrite. Il faut que Rameau soit ce qu’il est, un brigand heureux avec des brigands opulents, et non un fanfaron de vertu ou même un homme vertueux, mangeant sa croûte de pain seul ou à côté des gueux. Et pour le trancher net, je ne m’accommode point de votre félicité, ni du bonheur de quelques visionnaires comme vous.
MOI. — Je vois, mon cher, que vous ignorez ce que c’est, et que vous n’êtes pas même fait pour l’apprendre.
LUI. — Tant mieux, mordieu ! tant mieux : cela me ferait crever de faim, d’ennui, et de remords peut-être.
MOI. — D’après cela, le seul conseil que j’aie à vous donner c’est de rentrer bien vite dans la maison d’où vous vous êtes imprudemment fait chasser.
LUI. — Et de faire ce que vous ne désapprouvez pas au simple, et qui me répugne un peu au figuré ?
MOI. — Quelle singularité !
LUI. — Il n’y a rien de singulier à cela ; je veux bien être abject, mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité… Vous riez ?
MOI. — Oui, votre dignité me fait rire.
LUI. — Chacun a la sienne. Je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion, et non à l’ordre d’autrui. Faut-il qu’on puisse me dire : Rampe, et que je sois obligé de ramper ? C’est l’allure du ver, c’est la mienne ; nous la suivons l’un et l’autre quand on nous laisse aller, mais nous nous redressons quand on nous marche sur la queue : on m’a marché sur la queue, et je me redresserai. Et puis vous n’avez pas d’idée de la pétaudière dont il s’agit. Imaginez un mélancolique et maussade personnage, dévoré de vapeurs, enveloppé dans deux ou trois tours de sa robe de chambre ; qui se déplaît à lui-même, à qui tout déplaît ; qu’on fait avec peine sourire en se disloquant le corps et l’esprit en cent manières diverses ; qui considère froidement les grimaces plaisantes de mon visage et celles de mon jugement, qui sont plus plaisantes encore ; car, entre nous, ce père Noël, ce vilain bénédictin si renommé pour les grimaces, malgré ses succès à la cour, n’est, sans me vanter ni lui non plus, en comparaison de moi, qu’un polichinelle de bois. J’ai beau me tourmenter pour atteindre au sublime des Petites-Maisons, rien n’y fait. Rira-t-il ? ne rira-t-il pas ? voilà ce que je suis forcé de me dire au milieu de mes contorsions ; et vous pouvez juger combien cette incertitude nuit au talent. Mon hypocondre, la tête renfoncée dans un bonnet de nuit qui lui couvre les yeux, a l’air d’une pagode immobile à laquelle on aurait attaché un fil au menton, d’où il descendrait jusque sous son fauteuil. On attend que le fil se tire, et il ne se tire point : ou s’il arrive que la mâchoire s’entr’ouvre, c’est pour vous articuler un mot désolant, un mot qui vous apprend que vous n’avez point été aperçu, et que toutes vos singeries sont perdues. Ce mot est la réponse à une question que vous lui aurez faite il y a quatre jours ; ce mot dit, le ressort mastoïde se détend et la mâchoire se referme.
(Puis il se mit à contrefaire son homme. Il s’était placé dans une chaise, la tête fixe, le chapeau jusque sur ses paupières, les yeux demi-clos, les bras pendants, remuant sa mâchoire comme un automate, et disant : « Oui, vous avez raison, mademoiselle, il faut mettre de la finesse là.) » — C’est que cela décide, que cela décide toujours et sans appel, le soir, le matin, à la toilette, à dîner, au café, au jeu, au théâtre, à souper, au lit, et, Dieu me le pardonne, je crois, entre les bras de sa maîtresse. Je ne suis pas à portée d’entendre ces dernières décisions-ci, mais je suis diablement las des autres… Triste, obscur, et tranché comme le Destin, tel est notre patron.
Vis-à-vis, c’est une bégueule qui joue l’importance, à qui l’on se résoudrait à dire qu’elle est jolie, parce qu’elle est jolie, quoiqu’elle ait sur le visage quelques gales par-ci par-là, et qu’elle coure après le volume de madame Bouvillon[7]. J’aime les chairs quand elles sont belles ; mais aussi trop est trop, et le mouvement est si essentiel à la matière ! Item, elle est plus méchante, plus fière et plus bête qu’une oie. Item, elle veut avoir de l’esprit. Item, il faut lui persuader qu’on lui en croit comme à personne. Item, cela ne sait rien, et cela décide aussi. Item, il faut applaudir à ses décisions des pieds et des mains, sauter d’aise et transir d’admiration : « Que cela est beau, délicat, bien dit, finement vu, singulièrement senti ! Où les femmes prennent-elles cela ? Sans étude, par la seule force de l’instinct, par la seule lumière naturelle ! cela tient du prodige. Et puis, qu’on vienne nous dire que l’expérience, l’étude, la réflexion, l’éducation y font quelque chose !… » Et autres pareilles sottises, et pleurer de joie ; dix fois la journée se courber, un genou fléchi en devant, l’autre jambe tirée en arrière, les bras étendus vers la déesse, chercher son désir dans ses yeux, rester suspendu à sa lèvre, attendre son ordre, et partir comme un éclair. Qui est-ce qui veut s’assujettir à un rôle pareil, si ce n’est le misérable qui trouve là, deux ou trois fois la semaine, de quoi calmer la tribulation de ses intestins ? Que penser des autres, tels que le Palissot, le Fréron, le Mallet, le Baculard, qui ont quelque chose, et dont les bassesses ne peuvent s’excuser par le borborygme d’un estomac qui souffre ?
MOI. — Je ne vous aurais jamais cru si difficile.
LUI. — Je ne le suis pas. Au commencement je voyais faire les autres, et je faisais comme eux, même un peu mieux, parce que je suis plus franchement impudent, meilleur comédien, plus affamé, fourni de meilleurs poumons. Je descends apparemment en droite ligne du fameux Stentor…
(Et, pour me donner une juste idée de la force de ce viscère, il se mit à tousser d’une violence à ébranler les vitres du café, et à suspendre l’attention des joueurs d’échecs.)
MOI. — Mais à quoi bon ce talent ?
LUI. — Vous ne le devinez pas ?
MOI. — Non, je suis un peu borné.
LUI. — Supposez la dispute engagée et la victoire incertaine ; je me lève, et, déployant mon tonnerre, je dis : « Cela est comme mademoiselle l’assure… c’est là ce qui s’appelle juger ! Je le donne en cent à tous nos beaux esprits. L’expression est de génie. » Mais il ne faut pas toujours approuver de la même manière ; on serait monotone, on aurait l’air faux, on deviendrait insipide. On ne se sauve de là que par du jugement, de la fécondité ; il faut savoir préparer et placer ses tons majeurs et péremptoires, saisir l’occasion et le moment. Lors, par exemple, qu’il y a partage entre les sentiments ; que la dispute s’est élevée à son dernier degré de violence, qu’on ne s’entend plus, que tous parlent à la fois, il faut être placé à l’écart, dans l’angle de l’appartement le plus éloigné du champ de bataille, avoir préparé son explosion par un long silence, et tomber subitement comme une Comminge[8], au milieu des contendants : personne n’a eu cet art comme moi. Mais où je suis surprenant, c’est dans l’opposé : j’ai des petits tons que j’accompagne d’un sourire, une variété infinie de mines approbatives ; là, le nez, la bouche, le front, les yeux, entrent en jeu ; j’ai une souplesse de reins, une manière de contourner l’épine du dos, de hausser ou de baisser les épaules, d’étendre les doigts, d’incliner la tête, de fermer les yeux, et d’être stupéfait comme si j’avais entendu descendre du ciel une voix angélique et divine ; c’est là ce qui flatte. Je ne sais si vous saisissez bien toute l’énergie de cette attitude-là ; je ne l’ai point inventée, mais personne ne m’a surpassé dans l’exécution. Voyez, voyez.
MOI. — Il est vrai que cela est unique.
LUI. — Croyez-vous qu’il y ait cervelle de femme qui tienne à cela ?
MOI. — Non ; il faut convenir que vous avez porté le talent de faire le fou et de s’avilir aussi loin qu’il est possible.
(...)
MOI. — Qu’avez-vous lu ?
LUI. — J’ai lu et je lis et relis sans cesse Théophraste, La Bruyère et Molière.
MOI. — Ce sont d’excellents livres.
LUI. — Ils sont bien meilleurs qu’on ne pense ; mais qui est-ce qui sait les lire ?
MOI. — Tout le monde, selon la mesure de son esprit.
LUI. — Presque personne. Pourriez-vous me dire ce qu’on y cherche ?
MOI. — L’amusement et l’instruction.
LUI. — Mais quelle instruction ? car c’est là le point.
MOI. — La connaissance de ses devoirs, l’amour de la vertu, la haine du vice.
LUI. — Moi j’y recueille tout ce qu’il faut faire et tout ce qu’il ne faut pas dire. Ainsi quand je lis l’Avare, je me dis : sois avare si tu veux, mais garde-toi de parler comme l’Avare. Quand je lis le Tartufe, je me dis : sois hypocrite si tu veux, mais ne parle pas comme l’hypocrite. Garde tes vices qui te sont utiles, mais n’en aie ni le ton ni les apparences, qui te rendraient ridicule. Pour te garantir de ce ton, de ces apparences, il faut les connaître ; or, ces auteurs en ont fait des peintures excellentes. Je suis moi, et je reste ce que je suis ; mais j’agis et je parle comme il convient. Je ne suis pas de ces gens qui méprisent les moralistes ; il y a beaucoup à profiter, surtout avec ceux qui ont mis la morale en action. Le vice ne blesse les hommes que par intervalle ; les caractères du vice les blessent du matin au soir. Peut-être vaudrait-il mieux être un insolent que d’en avoir la physionomie ; l’insolent de caractère n’insulte que de temps en temps, l’insolent de physionomie insulte toujours. Au reste, n’allez pas imaginer que je sois le seul lecteur de mon espèce ; je n’ai d’autre mérite ici que d’avoir fait par système, par justesse d’esprit, par une vue raisonnable et vraie, ce que la plupart des autres font par instinct. De là vient que leurs lectures ne les rendent pas meilleurs que moi, mais qu’ils restent ridicules en dépit d’eux ; au lieu que je ne le suis que quand je veux, et que je les laisse alors loin derrière moi ; car le même art qui m’apprend à me sauver du ridicule en certaines occasions, m’apprend aussi dans d’autres à l’attraper supérieurement. Je me rappelle alors tout ce que les autres ont dit, tout ce que j’ai lu, et j’y ajoute tout ce qui sort de mon fonds, qui est en ce genre d’une fécondité surprenante.
MOI. — Vous avez bien fait de me révéler ces mystères, sans quoi je vous aurais cru en contradiction.
LUI. — Je n’y suis point ; car pour une fois où il faut éviter le ridicule, heureusement il y en a cent où il faut s’en donner. Il n’y a pas de meilleur rôle auprès des grands que celui de fou. Longtemps il y a eu le fou du roi en titre, en aucun il n’y a eu en titre le sage du roi. Moi, je suis le fou de Bertin et de beaucoup d’autres, le vôtre peut-être dans ce moment, ou peut-être vous le mien : celui qui serait sage n’aurait point de fou ; celui donc qui a un fou n’est pas sage ; s’il n’est pas sage il est fou, et peut-être, fût-il le roi, le fou de son fou. Au reste, souvenez-vous que, dans un sujet aussi variable que les mœurs, il n’y a rien d’absolument, d’essentiellement, de généralement vrai ou faux ; sinon, qu’il faut être ce que l’intérêt veut qu’on soit, bon ou mauvais, sage ou fou, décent ou ridicule, honnête ou vicieux. Si par hasard la vertu avait conduit à la fortune, ou j’aurais été vertueux, ou j’aurais simulé la vertu comme un autre ; on m’a voulu ridicule, et je me le suis fait ; pour vicieux, nature seule en avait fait les frais. Quand je dis vicieux, c’est pour parler votre langue ; car si nous venions à nous expliquer, il pourrait arriver que vous appelassiez vice ce que j’appelle vertu, et vertu ce que j’appelle vice.
Nous avons aussi les auteurs de l’Opéra-Comique, leurs acteurs et leurs actrices, et plus souvent leurs entrepreneurs Corbie, Moeth, tous gens de ressource et d’un mérite supérieur.
Et j’oubliais les grands critiques de la littérature, l’Avant-Coureur, les Petites Affiches, l’Année littéraire, l’Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, toute la clique des feuillistes[9].
MOI. — L’Année littéraire ! l’Observateur littéraire ! Cela ne se peut ; ils se détestent.
LUI. — Il est vrai ; mais tous les gueux se réconcilient à la gamelle. Ce maudit Observateur littéraire, que le diable l’eût emporté lui et ses feuilles ! C’est ce chien de petit prêtre avare, puant et usurier, qui est la cause de mon désastre. Il parut sur notre horizon hier pour la première fois ; il arriva à l’heure qui nous chasse tous de nos repaires, l’heure du dîner. Quand il fait mauvais temps, heureux celui d’entre nous qui a la pièce de vingt-quatre sols dans sa poche ! Tel s’est moqué de son confrère qui était arrivé le matin crotté jusqu’à l’échine et mouillé jusqu’aux os, qui le soir rentre chez lui dans le même état. Il y en eut un, je ne sais plus lequel, qui eut, il y a quelques mois, un démêlé violent avec le Savoyard qui s’est établi à notre porte ; ils étaient en compte courant : le créancier voulait que son débiteur se liquidât, et celui-ci n’était pas en fonds. On sert, on fait les honneurs de la table à l’abbé, on le place au haut bout. J’entre ; je l’aperçois. « Comment, l’abbé, lui dis-je, vous présidez ? voilà qui est fort bien pour aujourd’hui ; mais demain vous descendrez, s’il vous plaît, d’une assiette, après demain, d’une autre assiette,et ainsi d’assiette en assiette, soit à droite, soit à gauche, jusqu’à ce que de la place que j’ai occupée une fois avant vous ; Fréron, une fois après moi : Dorat, une fois après moi ; Fréron, Palissot, une fois après Dorat ; vous deveniez stationnaire auprès de moi, pauvre plat…, comme vous, qui siedo sempre come un maestoso carro fra duoi coglioni. » L’abbé, qui est un bon diable, et qui prend tout bien, se mit à rire ; mademoiselle, pénétrée de mon observation et de la justesse de ma comparaison, se mit à rire ; tous ceux qui siégeaient à droite et à gauche de l’abbé, ou qu’il avait reculés d’un cran, se mirent à rire ; tout le monde rit, excepté monsieur, qui se fâche, et me tient des propos qui n’auraient rien signifié si nous avions été seuls… « Vous êtes un impertinent. — Je le sais bien, et c’est à cette condition que vous m’avez reçu. — Un faquin. — Comme un autre. — Un gueux. — Est-ce que je serais ici sans cela ? — Je vous ferai chasser. — Après dîner, je m’en irai de moi-même… — Je vous le conseille… » On dîna ; je n’en perdis pas un coup de dent. Après avoir bien mangé, bu largement (car après tout il n’en aurait été ni plus ni moins, messire Gaster est un personnage contre lequel je n’ai jamais boudé), je pris mon parti, et je me disposais à m’en aller ; j’avais engagé ma parole en présence de tant de monde, qu’il fallait bien la tenir. Je fus un temps considérable à rôder dans l’appartement, cherchant ma canne et mon chapeau où ils n’étaient pas, et comptant toujours que le patron se répandrait dans un nouveau torrent d’injures, que quelqu’un s’interposerait, et que nous finirions par nous raccommoder à force de nous fâcher. Je tournais, car moi je n’avais rien sur le cœur ; mais le patron, lui, plus sombre et plus noir que l’Apollon d’Homère lorsqu’il décoche ses traits sur l’armée des Grecs, son bonnet une fois plus renfoncé que de coutume, se promenait en long et en large, le poing sous le menton. Mademoiselle s’approche de moi : « Mais, mademoiselle, qu’est-ce qu’il y a donc d’extraordinaire ? ai-je été différent aujourd’hui de moi-même? — Je veux qu’il sorte. — Je sortirai. Je ne lui ai pas manqué. — Pardonnez-moi ; on invite monsieur l’abbé, et… — C’est lui qui s’est manqué à lui-même en invitant l’abbé, en me recevant, et avec moi tant d’autres bélîtres. Moi… — Allons, mon petit…, il faut demander pardon à monsieur l’abbé. ― Je n’ai que faire de son pardon. — Allons, allons, tout cela s’apaisera… » On me prend par la main ; on m’entraîne vers le fauteuil de l’abbé ; j’étends les bras, je contemple l’abbé avec une espèce d’admiration, car qui est-ce qui a jamais demandé pardon à l’abbé ? « L’abbé, lui dis-je, l’abbé, tout ceci est bien ridicule, n’est-il pas vrai ? » Et puis je me mets à rire, et l’abbé aussi. Me voilà donc excusé de ce côté-là ; mais il fallait aborder l’autre, et ce que j’avais à lui dire était une autre paire de manches. Je ne sais plus trop comment je tournai mon excuse : « Monsieur, voilà ce fou… — Il y a trop longtemps qu’il me fait souffrir ; je ne veux plus en entendre parler. — Il est fâché. — Oui, je suis fâché. — Cela ne lui arrivera plus. — Qu’au premier faquin… ». Je ne sais s’il était dans ces jours d’humeur où mademoiselle craint d’en approcher, et n’ose le toucher qu’avec ses mitaines de velours, ou s’il entendit mal ce que je disais, ou si je dis mal ; ce fut pis qu’auparavant. — Que diable ! est-ce qu’il ne me connaît pas ? est-ce qu’il ne sait pas que je suis comme les enfants, et qu’il y a des circonstances où je… ? Et puis je crois, Dieu me pardonne, que je n’aurais pas un moment de relâche. On userait un pantin d’acier à tirer la ficelle du matin au soir, et du soir au matin. Il faut que je les désennuie, c’est la condition ; mais il faut que je m’amuse quelquefois. Au milieu de ces imbroglio il me passa par la tête une pensée funeste, une pensée qui me donna de la morgue, une pensée qui m’inspira de la fierté et de l’insolence : c’est qu’on ne pouvait se passer de moi, que j’étais un homme essentiel.
MOI. — Oui, je crois que vous leur êtes très-utile, mais qu’ils vous le sont encore davantage. Vous ne retrouverez pas, quand vous voudrez, une aussi bonne maison ; mais eux, pour un fou qui leur manque, ils en retrouveront cent.
LUI. — Cent fous comme moi ! monsieur le philosophe, ils ne sont pas si communs. Oui, des plats fous. On est plus difficile en sottise qu’en talent ou en vertu. Je suis rare dans mon espèce, oui, très-rare. À présent qu’ils ne m’ont plus, que font-ils ? Ils s’ennuient comme des chiens. Je suis un sac inépuisable d’impertinences. J’avais à chaque instant une boutade qui les faisait rire aux larmes : j’étais pour eux les Petites-Maisons entières.
MOI. — Aussi vous aviez la table, le lit, l’habit, veste et culotte, les souliers, et la pistole par mois.
LUI. — Voilà le beau côté, voilà le bénéfice ; mais des charges, vous n’en dites mot. D’abord, s’il était bruit d’une pièce nouvelle, quelque temps qu’il fît, il fallait fureter dans tous les greniers de Paris, jusqu’à ce que j’en eusse trouvé l’auteur ; que je me procurasse la lecture de l’ouvrage, et que j’insinuasse adroitement qu’il y avait un rôle qui serait supérieurement rendu par quelqu’un de ma connaissance. « Et par qui, s’il vous plaît ? — Par qui ? belle question ! ce sont les grâces, la gentillesse, la finesse. — Vous voulez dire mademoiselle Dangeville ? Par hasard la connaîtriez-vous ? — Oui, un peu ; mais ce n’est pas elle. — Et qui donc ? » Je nommais tout bas… « Elle ! — Oui, elle, » répétais-je un peu honteux, car j’ai quelquefois de la pudeur ; et à ce nom il fallait voir comme la physionomie du poëte s’allongeait, et d’autres fois comme on m’éclatait au nez. Cependant, bon gré mal gré qu’il en eût, il fallait que j’emmenasse mon homme à dîner ; et lui, qui craignait de s’engager, rechignait, remerciait. Il fallait voir comme j’étais traité quand je ne réussissais pas dans ma négociation ! j’étais un butor, un sot, un balourd ; je n’étais bon à rien ; je ne valais pas le verre d’eau qu’on me donnait à boire. C’était bien pis lorsqu’on jouait, et qu’il fallait aller intrépidement, au milieu des huées d’un public qui juge bien, quoi qu’on en dise, faire entendre mes claquements de mains isolés, attacher les regards sur moi ; quelquefois dérober les sifflets à l’actrice, et ouïr chuchoter à côté de soi : « C’est un des valets déguisés de celui qui… Ce maraud-là se taira-t-il !… » On ignore ce qui peut déterminer à cela ; on croit que c’est ineptie, tandis que c’est un motif qui excuse tout.
MOI. — Jusqu’à l’infraction des lois civiles ?
LUI. — À la fin cependant j’étais connu, et l’on disait : « Oh ! c’est… » Ma ressource était de jeter quelques mots ironiques qui sauvassent du ridicule mon applaudissement solitaire, qu’on interprétait à contre-sens. Convenez qu’il faut un puissant intérêt pour braver ainsi le public assemblé, et que chacune de ces corvées valait mieux qu’un petit écu ?
MOI. — Que ne vous faisiez-vous prêter main-forte ?
LUI. — Cela m’arrivait aussi, je glanais un peu là-dessus. Avant que de se rendre au lieu du supplice, il fallait se charger la mémoire des endroits brillants où il importait de donner le ton. S’il m’arrivait de les oublier et de me méprendre, j’en avais le tremblement à mon retour ; c’était un vacarme dont vous n’avez pas l’idée. Et puis à la maison une meute de chiens à soigner ; il est vrai que je m’étais sottement imposé cette tâche ; des chats dont j’avais la surintendance. J’étais trop heureux si Micou me favorisait d’un coup de griffe qui déchirât ma manchette ou ma main. Criquette est sujette à la colique ; c’est moi qui lui frotte le ventre. Autrefois mademoiselle avait des vapeurs, ce sont aujourd’hui des nerfs. Je ne parle pas d’une indisposition légère dont on ne se gêne pas devant moi. Pour ceci, passe, je n’ai jamais prétendu contraindre ; j’ai lu… On en use à son aise avec ses familiers, et j’en étais ces jours-là plus que personne. Je suis l’apôtre de la familiarité et de l’aisance ; je les prêchais là d’exemple, sans qu’on s’en formalisât ; il n’y avait qu’à me laisser aller. Je vous ai ébauché le patron. Mademoiselle commence à devenir pesante, il faut entendre les bons contes qu’ils en font.
MOI. — Vous n’êtes pas de ces gens-là ?
LUI. — Pourquoi non ?
MOI. — C’est qu’il est au moins indécent de donner du ridicule à ses bienfaiteurs.
LUI. — Mais n’est-ce pas pis encore de s’autoriser de ses bienfaits pour avilir son protégé ?
MOI. — Mais si le protégé n’était pas vil par lui-même, rien ne donnerait au protecteur cette autorité.
LUI. — Mais si les personnages n’étaient pas ridicules par eux-mêmes, on n’en ferait pas de bons contes. Et puis est-ce ma faute s’ils s’encanaillent ? est-ce ma faute, lorsqu’ils sont encanaillés, si on les trahit, si on les bafoue ? Quand on se résout à vivre avec des gens comme nous, et qu’on a le sens commun, il y a je ne sais combien de noirceurs auxquelles il faut s’attendre. Quand on nous prend, ne nous connaît-on pas pour ce que nous sommes, pour des âmes intéressées, viles et perfides ? Si l’on nous connaît, tout est bien. Il y a un pacte tacite qu’on nous fera du bien, et que tôt ou tard nous rendrons le mal pour le bien qu’on nous aura fait. Ce pacte ne subsiste-t-il pas entre l’homme et son singe et son perroquet ? Le Brun jette les hauts cris que Palissot, son convive et son ami, ait fait des couplets contre lui. Palissot a dû faire les couplets, et c’est le Brun qui a tort. Poinsinet jette les hauts cris que Palissot ait mis sur son compte les couplets qu’il avait faits contre le Brun. Palissot a dû mettre sur le compte de Poinsinet les couplets qu’il avait faits contre le Brun, et c’est Poinsinet qui a tort. Le petit abbé Rey… jette les hauts cris de ce que son ami Palissot lui a soufflé sa maîtresse, auprès de laquelle il l’avait introduit : c’est qu’il ne fallait point introduire un Palissot chez sa maîtresse, ou se résoudre à la perdre ; Palissot a fait son devoir, et c’est l’abbé Rey… qui a tort. Le libraire D*** jette les hauts cris de ce que son associé B*** a pu laisser croire ce qui n’était pas : quoi qu’il en soit, B*** a fait son rôle, et c’est D*** et sa femme qui ont tort. Qu’Helvétius jette les hauts cris, que Palissot le traduise sur la scène comme un malhonnête homme, lui à qui il doit encore l’argent qu’il lui prête pour se faire traiter de sa mauvaise santé, se nourrir et se vêtir ; a-t-il dû se promettre un autre procédé de la part d’un homme souillé de toutes sortes d’infamies, qui par passe-temps fait abjurer la religion à son ami ; qui s’empare du bien de ses associés ; qui n’a ni foi, ni loi, ni sentiment ; qui court à la fortune per fas et nefas, qui compte ses jours par ses scélératesses, et qui s’est traduit lui-même sur la scène comme un des plus dangereux coquins ; impudence dont je ne crois pas qu’il y eût dans le passé un premier exemple, ni qu’il y en ait un second dans l’avenir ? Non. Ce n’est donc pas Palissot, mais c’est Helvétius qui a tort. Si l’on mène un jeune provincial à la ménagerie de Versailles, et qu’il s’avise par sottise de passer la main à travers les barreaux de la loge du tigre ou de la panthère ; si le jeune homme laisse son bras dans la gueule de l’animal féroce, qui est-ce qui a tort ? Tout cela est écrit dans le pacte tacite ; tant pis pour celui qui l’ignore ou l’oublie. Combien je justifierais, par ce pacte universel et sacré, de gens qu’on accuse de méchanceté, tandis que c’est soi qu’on devrait accuser de sottise ! Oui, grosse comtesse, c’est vous qui avez tort, lorsque vous rassemblez autour de vous ce qu’on appelle parmi les gens de votre sorte des espèces, et que ces espèces vous font des vilenies, vous en font faire, et vous exposent au ressentiment des honnêtes gens. Les honnêtes gens font ce qu’ils doivent, les espèces aussi ; et c’est vous qui avez tort de les accueillir. Si Bertin vivait doucement, paisiblement avec sa maîtresse ; si par l’honnêteté de leurs caractères ils s’étaient fait des connaissances honnêtes ; s’ils avaient appelé autour d’eux des hommes à talent, des gens connus dans la société par leur vertu ; s’ils avaient réservé pour une petite compagnie éclairée et choisie les heures de distraction qu’ils auraient dérobées à la douceur d’être ensemble, de s’aimer, de se le dire dans le silence de la retraite, croyez-vous qu’on en eût fait ni bons ni mauvais contes ? Que leur est-il donc arrivé ? ce qu’ils méritaient ; ils ont été punis de leur imprudence, et c’est nous que la Providence avait destinés de toute éternité à faire justice des Bertins du jour, et ce sont nos pareils d’entre nos neveux qu’elle a destinés à faire justice des M*** et des B*** à venir. Mais, tandis que nous exécutons ses justes décrets sur la sottise, vous qui nous peignez tels que nous sommes, vous exécutez ses justes décrets sur nous. Que penseriez-vous de nous si nous prétendions avec des mœurs honteuses jouir de la considération publique ? Que nous sommes des insensés. Et ceux qui s’attendent à des procédés honnêtes de la part de gens nés vicieux, des caractères vils et bas, sont-ils sages ? Tout a son vrai loyer dans ce monde. Il y a deux procureurs généraux, l’un à votre porte, qui châtie les délits contre la société ; la nature est l’autre. Celle-ci connaît tous les vices qui échappent aux lois. Vous vous livrez à la débauche des femmes, vous serez hydropique ; vous êtes crapuleux, vous serez pulmonique ; vous ouvrez votre porte à des marauds et vous vivez avec eux, vous serez trahi, persiflé, méprisé : le plus court est de se résigner à l’équité de ces jugements, et de se dire à soi-même : c’est bien fait ; de secouer ses oreilles et de s’amender, ou de rester ce qu’on est, mais aux conditions susdites.
MOI. — Vous avez raison.
(...)
LUI. — Le chant est une imitation, par les sons, d’une échelle inventée par l’art ou inspirée par la nature, comme il vous plaira, ou par la voix ou par l’instrument, des bruits physiques ou des accents de la passion, et vous voyez qu’en changeant là-dedans les choses à changer, la définition conviendrait exactement à la peinture, à l’éloquence, à la sculpture et à la poésie. Maintenant, pour en venir à votre question, quel est le modèle du musicien ou du chant ? C’est la déclamation, si le modèle est vivant et puissant ; c’est le bruit, si le modèle est inanimé. Il faut considérer la déclamation comme une ligne, et le chant comme une autre ligne qui serpenterait sur la première. Plus cette déclamation, type du chant, sera forte et vraie, plus le chant qui s’y conforme la coupera en plus grand nombre de points ; plus le chant sera vrai, et plus il sera beau ; et c’est ce qu’ont très-bien senti nos jeunes musiciens. Quand on entend, Je suis un pauvre diable, on croit reconnaître la plainte d’un avare ; s’il ne chantait pas, c’est sur les mêmes tons qu’il parlerait à la terre quand il lui confie son or, et qu’il lui dit : Ô terre, reçois mon trésor. Et cette petite fille qui sent palpiter son cœur, qui rougit, qui se trouble, et qui supplie monseigneur de la laisser partir, s’exprimerait-elle autrement ? Il y a dans ces ouvrages toutes sortes de caractères, une variété infinie de déclamations : cela est sublime, c’est moi qui vous le dis. Allez, allez entendre le morceau où le jeune homme qui se sent mourir s’écrie : Mon cœur s’en va ! Écoutez le chant, écoutez la symphonie, et vous me direz après quelle différence il y a entre les vraies voix d’un moribond et le tour de ce chant ; vous verrez si la ligne de la mélodie ne coïncide pas tout entière avec la ligne de la déclamation. Je ne vous parle pas de la mesure, qui est encore une des conditions du chant ; je m’en tiens à l’expression, et il n’y a rien de plus évident que le passage suivant que j’ai lu quelque part : Musices seminarium accentus, l’accent est la pépinière de la mélodie. Jugez de là de quelle difficulté et de quelle importance il est de savoir bien faire le récitatif ! Il n’y a point de bel air dont on ne puisse faire un beau récitatif, et point de beau récitatif dont un habile homme ne puisse faire un bel air. Je ne voudrais pas assurer que celui qui récite bien chantera bien ; mais je serais surpris que celui qui chante bien ne sût pas bien réciter. Et croyez tout ce que je vous dis là, car c’est le vrai.
MOI. — Je ne demanderais pas mieux que de vous en croire, si je n’étais arrêté par un petit inconvénient.
LUI. — Et cet inconvénient ?
MOI. — C’est que si cette musique est sublime, il faut que celle du divin Lulli, de Campra, de Destouche, de Mouret, et même, soit dit entre nous, celle du cher maître, soit un peu plate.
LUI, s’approchant de mon oreille, me répondit : — Je ne voudrais pas être entendu, car il y a ici beaucoup de gens qui me connaissent : c’est qu’elle l’est aussi. Ce n’est pas que je me soucie du cher maître, puisque cher il y a ; c’est une pierre, il me verrait tirer la langue d’un pied qu’il ne me donnerait pas un verre d’eau. Mais il a beau faire, à l’octave, à la septième : Hon, hon ; hin, hin ; tu, tu, tu, turlututu, avec un charivari de diable ; ceux qui commencent à s’y connaître, et qui ne prennent plus du tintamarre pour de la musique, ne s’accommoderont jamais de cela. On devait défendre par une ordonnance de police, à toute personne, de quelque qualité ou condition qu’elle fût, de faire chanter le Stabat de Pergolèse. Ce Stabat, il fallait le faire brûler par la main du bourreau ! Ma foi, ces maudits bouffons, avec leur Servante maîtresse, leur Tracallo, nous en ont donné rudement… Autrefois, un Tancrède, une Issé[10], une Europe galante, les Indes, Castor, les Talents lyriques[11], allaient à quatre, cinq, six mois ; on ne voyait point la fin des représentations d’une Armide[12]. À présent, tout cela vous tombe les uns sur les autres comme des capucins de cartes. Aussi Rebel et Francœur[13] en jettent-ils feu et flamme. Ils disent que tout est perdu, qu’ils sont ruinés, et que si l’on tolère plus longtemps cette canaille chantante de la foire, la musique nationale est au diable, et que, l’Académie royale du cul-de-sac n’a qu’à fermer boutique. Il y a bien quelque chose de vrai là-dedans. Les vieilles perruques qui viennent là, depuis trente à quarante ans, tous les vendredis, au lieu de s’amuser comme ils ont fait par le passé, s’ennuient et bâillent sans trop savoir pourquoi ; ils se le demandent et ne sauraient se répondre. Que ne s’adressent-ils à moi ? La prédiction de Duni s’accomplira ; et, du train que cela prend, je veux mourir si dans quatre ou cinq ans, à dater du Peintre amoureux de son modèle, il y a un chat à ferrer dans le célèbre impasse. Les bonnes gens ! ils ont renoncé à leurs symphonies pour jouer des symphonies italiennes. Ils ont cru qu’ils feraient leurs oreilles à celle-ci, sans conséquence pour leur musique vocale ; comme si la symphonie n’était pas au chant, à un peu de libertinage prés inspiré par l’étendue de l’instrument et la mobilité des doigts, ce que le chant est à la déclamation réelle ; comme si le violon n’était pas le singe du chanteur, qui deviendra un jour, lorsque le difficile prendra la place du beau, le singe du violon. Le premier qui joua Locatelli fut l’apôtre de la nouvelle musique. À d’autres, à d’autres ! on nous accoutumera à l’imitation des accents de la passion ou des phénomènes de la nature par le chant et la voix, par l’instrument, car voilà toute l’étendue de l’objet de la musique ; et nous conserverons notre goût pour les vols, les lancés, les gloires, les triomphes, les victoires ? Va-t’en voir s’ils viennent, Jean. Ils ont imaginé qu’ils pleureraient ou riraient à des scènes de tragédie ou de comédie musiquées ; qu’on porterait à leurs oreilles les accents de la fureur, de la haine, de la jalousie, les vraies plaintes de l’amour, les ironies, les plaisanteries du théâtre italien ou français, et qu’ils resteraient admirateurs de Ragonde[14] ou de Platée[15] (je t’en réponds, Tarare, pompon) ; qu’ils éprouveraient sans cesse avec quelle facilité, quelle flexibilité, quelle mollesse, l’harmonie, la prosodie, les ellipses, les inversions de la langue italienne se prêtaient à l’art, au mouvement, à l’expression, aux tours et à la valeur mesurée du chant, et qu’ils continueraient d’ignorer combien la leur est roide, sourde, lourde, pesante, pédantesque et monotone. Eh ! oui, oui ; ils se sont persuadé qu’après avoir mêlé leurs larmes aux pleurs d’une mère qui se désole sur la mort de son fils, après avoir frémi de l’ordre d’un tyran qui ordonne un meurtre, ils ne s’ennuieraient pas de leur féerie, de leur insipide mythologie, de leurs petits madrigaux doucereux qui ne marquent pas moins le mauvais goût du poëte que la misère de l’art qui s’en accommode. Les bonnes gens ! cela n’est pas et ne peut être ; le vrai, le bon et le beau ont leurs droits : on les conteste, mais on finit par admirer ; ce qui n’est pas marqué à ce coin, on l’admire un temps, mais on finit par bâiller. Bâillez donc, messieurs, bâillez à votre aise, ne vous gênez pas. L’empire de la nature et de ma trinité, contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront jamais, le vrai qui est le Père, et qui engendre le bon qui est le Fils, d’où procède le beau qui est le Saint-Esprit, s’établit doucement. Le dieu étranger se place humblement sur l’autel à côté de l’idole du pays ; peu à peu il s’y affermit ; un beau jour il pousse du coude son camarade, et patatras ! voilà l’idole en bas. C’est comme cela qu’on dit que les Jésuites ont planté le christianisme à la Chine et aux Indes ; et nos Jansénistes ont beau dire, cette méthode politique qui marche à son but sans bruit, sans effusion de sang, sans martyres, sans un toupet de cheveux arraché, me semble la meilleure.
MOI. — Il y a de la raison à peu près dans tout ce que vous venez de dire.
LUI. — De la raison ! tant mieux. Je veux que le diable m’emporte si j’y tâche. Cela va comme je te pousse. Je suis comme les musiciens de l’impasse quand mon maître parut. Si j’adresse, à la bonne heure. C’est qu’un garçon charbonnier parlera toujours mieux de son métier que toute une académie, que tous les Duhamel du monde[16]…
(Et puis le voilà qui se met à se promener, en murmurant dans son gosier quelques-uns des airs de l’Ile des fous, du Peintre amoureux de son modèle, du Maréchal-ferrant, de la Plaideuse[17] ; et de temps en temps il s’écriait, en levant les mains et les yeux au ciel : « Si cela est beau, mordieu ! si cela est beau ! Comment peut-on porter à sa tête une paire d’oreilles, et faire une pareille question ? » Il commençait à entrer en passion et à chanter tout bas, il élevait le ton à mesure qu’il se passionnait davantage ; vinrent ensuite les gestes, les grimaces du visage et les contorsions du corps ; et je dis : « Bon ! voilà la tête qui se perd, et quelque scène nouvelle qui se prépare… » En effet, il part d’un éclat de voix : « Je suis un pauvre misérable… Monseigneur, monseigneur, laissez-moi partir… Ô terre, reçois mon or, conserve mon trésor, mon âme, mon âme, ma vie ! Ô terre !… Le voilà le petit ami, le voilà le petit ami ! Aspettar si non venire… A Zerbina penserete… Sempre in contrasti con te si sta… » Il entassait et brouillait ensemble trente airs italiens, français, tragiques, comiques, de toutes sortes de caractères. Tantôt avec une voix de basse-taille il descendait jusqu’aux enfers, tantôt, s’égosillant et contrefaisant le fausset, il déchirait le haut des airs ; imitant, de la démarche, du maintien, du geste, les différents personnages chantants ; successivement furieux, radouci, impérieux, ricaneur. Ici c’est une jeune fille qui pleure, et il en rend toute la minauderie ; là il est prêtre, il est roi, il est tyran ; il menace, il commande, il s’emporte ; il est esclave, il obéit ; il s’apaise, il se désole, il se plaint, il rit ; jamais hors de ton, de mesure, du sens des paroles ni du caractère de l’air. Tous les pousse-bois avaient quitté leurs échiquiers et s’étaient rassemblés autour de lui ; les fenêtres du café étaient occupées en dehors par les passants qui s’étaient arrêtés au bruit. On faisait des éclats de rire à entr’ouvrir le plafond. Lui n’apercevait rien ; il continuait, saisi d’une aliénation d’esprit, d’un enthousiasme si voisin de la folie, qu’il est incertain qu’il en revienne et s’il ne faudra pas le jeter dans un fiacre et le mener droit aux Petites-Maisons. En chantant un lambeau des Lamentations de Jomelli, il répétait avec une précision, une vérité et une chaleur incroyables les plus beaux endroits de chaque morceau : ce beau récitatif obligé où le prophète peint la désolation de Jérusalem, il l’arrosa d’un torrent de larmes qui en arrachèrent de tous les yeux. Tout y était, et la délicatesse du chant, et la force de l’expression, et la douleur. Il insistait sur les endroits où le musicien s’était particulièrement montré un grand maître. S’il quittait la partie du chant, c’était pour prendre celle des instruments, qu’il laissait subitement pour revenir à la voix, entrelaçant l’une à l’autre de manière à conserver les liaisons et l’unité du tout, s’emparant de nos âmes, et les tenant suspendues dans la situation la plus singulière que j’aie jamais éprouvée. Admirais-je ? oui, j’admirais. Étais-je touché de pitié ? j’étais touché de pitié ; mais une teinte de ridicule était fondue dans ces sentiments, et les dénaturait.
Mais vous vous seriez échappé en éclats de rire à la manière dont il contrefaisait les différents instruments ; avec des joues renflées et bouffies, et un son rauque et sombre, il rendait les cors et les bassons ; il prenait un son éclatant et nasillard pour les hautbois, précipitant sa voix avec une rapidité incroyable pour les instruments à cordes, dont il cherchait les sons les plus approchés ; il sifflait les petites flûtes, il roucoulait les traversières ; criant, chantant, se dèmenant comme un forcené, faisant à lui seul les danseurs, les danseuses, les chanteurs, les chanteuses, tout un orchestre, tout un théâtre lyrique, et se divisant en vingt rôles divers ; courant, s’arrêtant avec l’air d’un énergumène, étincelant des yeux, écumant de la bouche. Il faisait une chaleur à périr, et la sueur qui suivait les plis de son front et la longueur de ses joues se mêlait à la poudre de ses cheveux, ruisselait et sillonnait le haut de son habit. Que ne lui vis-je pas faire ? Il pleurait, il riait, il soupirait, il regardait ou attendri, ou tranquille, ou furieux : c’était une femme qui se pâme de douleur, c’était un malheureux livré à tout son désespoir ; un temple qui s’élève ; des oiseaux qui se taisent au soleil couchant ; des eaux ou qui murmurent dans un lieu solitaire et frais, ou qui descendent en torrent du haut des montagnes ; un orage, une tempête, la plainte de ceux qui vont périr, mêlée au sifflement des vents, au fracas du tonnerre. C’était la nuit avec ses ténèbres, c’était l’ombre et le silence, car le silence même se peint par des sons. Sa tête était tout à fait perdue. Épuisée de fatigue, tel qu’un homme qui sort d’un profond sommeil ou d’une longue distraction, il resta immobile, stupide, étonné ; il tournait ses regards autour de lui comme un homme égaré qui cherche à reconnaître le lieu où il se trouve ; il attendait le retour de ses forces et de ses esprits ; il essuyait machinalement son visage. Semblable à celui qui verrait à son réveil son lit environné d’un grand nombre de personnes, dans un entier oubli ou dans une profonde ignorance de ce qu’il a fait, il s’écria dans le premier moment : « Eh bien ! messieurs, qu’est-ce qu’il y a ?… D’où viennent vos ris et votre surprise ? Qu’est-ce qu’il y a ?… » Ensuite il ajouta : « Voilà ce qu’on doit appeler de la musique et un musicien ! Cependant, messieurs, il ne faut pas mépriser certains airs de Lulli. Qu’on fasse mieux la scène de J’attendrai l'aurore…, sans changer les paroles, j’en défie. Il ne faut pas mépriser quelques endroits de Campra, les airs de violon de mon maître, ses gavottes, ses entrées de soldats, de prêtres, de sacrificateurs ; Pâles flambeaux, Nuit plus affreuse que les ténèbres…, Dieu du Tartare, dieu de l’oubli… » Là il enflait sa voix, il soutenait ses sons ; les voisins se mettaient aux fenêtres, nous mettions nos doigts dans nos oreilles. Il ajoutait : « C’est qu’ici il faut des poumons, un grand organe, un volume d’air. Mais, avant peu, serviteur à l’Assomption ! le Carême et les Rois sont passés. Ils ne savent pas encore ce qu’il faut mettre en musique, ni par conséquent ce qui convient au musicien. La poésie lyrique est encore à naître ; mais ils y viendront à force d’entendre Pergolèse, le Saxon, Terradeglias, Traetta et les autres ; à force de lire Métastase, il faudra bien qu’ils y viennent.
MOI. — Quoi donc ! est-ce que Quinault, Lamotte, Fontenelle, n’y ont rien entendu ?
LUI. — Non, pour le nouveau style. Il n’y a pas six vers de suite, dans tous leurs charmants poëmes, qu’on puisse musiquer. Ce sont des sentences ingénieuses, des madrigaux légers, tendres et délicats. Mais pour savoir combien cela est vide de ressources pour notre art, le plus violent de tous, sans en excepter celui de Démosthènes, faites-vous réciter ces morceaux : combien ils vous paraîtront froids, languissants, monotones. C’est qu’il n’y a rien là qui puisse servir de modèle au chant ; j’aimerais autant avoir à musiquer les Maximes de La Rochefoucauld ou les Pensées de Pascal. C’est au cri animal de la passion à dicter la ligne qui nous convient ; il faut que ses expressions soient pressées les unes sur les autres ; il faut que la phrase soit courte, que le sens en soit coupé, suspendu ; que le musicien puisse disposer de tout et de chacune de ses parties, en omettre un mot ou le répéter, y en ajouter une qui lui manque, la tailler et retailler comme un polype, sans la détruire ; ce qui rend la poésie lyrique française beaucoup plus difficile que dans les langues à inversions, qui présentent d’elles-mêmes tous ces avantages… Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein ; me voilà prête à recevoir le coup fatal ; frappe, ose… Ah ! je languis, je meurs… un feu secret s’allume dans mes sens… Cruel Amour, que veux-tu de moi ?… Laisse-moi la douce paix dont j’ai joui… rends-moi la raison… Il faut que les passions soient fortes ; la tendresse du musicien et du poëte lyrique doit être extrême ; l’air est presque toujours la péroraison de la scène. Il nous faut des exclamations, des interjections, des suspensions, des interruptions, des affirmations, des négations ; nous appelons, nous invoquons, nous crions, nous gémissons, nous pleurons, nous rions franchement. Point d’esprit, point d’épigrammes, point de ces jolies pensées ; cela est trop loin de la simple nature. Et n’allez pas croire que le jeu des acteurs de théâtre et leur déclamation puissent nous servir de modèles. Fi donc ! il nous le faut plus énergique, moins maniéré, plus vrai ; les discours simples, les voix communes de la passion nous sont d’autant plus nécessaires que la langue sera plus monotone, aura moins d’accents ; le cri animal ou de l’homme passionné leur en donne.