Spritualité et management
Plutôt qu’une spiritualité, une philosophie
Le terme est vague à souhait mais en désignant le fait de se consacrer, non forcément de manière exclusive, à la vie de l’esprit, il implique nécessairement l’idée d’élévation, d’extériorité. Esprit s’oppose à matière comme un principe sinon transcendant en tout cas indépendant. La réintroduction du dualisme métaphysique n’est pas anodine qui correspond à la fois à une réalité – l’introduction de principes spirituels dans les procédures de management – à un sentiment mâtiné de craintes – le retour du religieux – mais encore, et peut-être surtout à cette exigence diffuse de sens et de liberté d’autant plus insistante que les conditions de travail se font plus ardues en période de crise mais du coup, en même temps d’autant plus hors d’atteinte.
La conjonction entre spiritualité et management est d’autant plus délicate à penser que spiritualité draine religion derrière lui comme un impensé plus ou moins coupable ; or religiosité et spiritualité ne se recoupent que très partiellement et il serait en tout cas fallacieux de réduire spiritualité au mode chrétien d’être au monde et notamment à la relation si particulière à l’Eglise qu’implique le catholicisme ; mais aussi à la transcendance dans le cadre d’un créationnisme monothéiste.
Définir spiritualité
Il n’empêche : ce qui peut être retenu revient à cette tendance à aller chercher réponse et sens ailleurs, au-delà ou à l’extérieur, aux préoccupations de l’ici et maintenant ; à se chercher référence ailleurs qui puisse déterminer l’action et la décision. Mais traduit en même temps une profonde insatisfaction comme si le travail n’était pas – ou plus – le vecteur de la réalisation de soi et qu’il ne permît soit que de réaliser une partie de son moi profond soit au contraire qu’il fût un empêchement à ce que ce dernier fût reconnu.
Derrière la résurgence de cette spiritualité il y a bien une religion ou plus exactement la faillite d’une religion : celle du travail. Il y a en réalité un conflit, sévère, où peut bien se lire une crise sinon de civilisation en tout cas de modèle. Que reste-t-il du bonheur idée nouvelle en Europe de Saint Just ? que reste-t-il de la libération par le travail que via la Réforme et Hegel un Marx aura contribué à populariser jusque dans les classes laborieuses ?
Même s’il est vrai que religion est trop précisément connoté pour que chacun s’y puisse reconnaître et que spiritualité a le mérite parce que justement vague d’être un concept plus ouvert, il n’empêche que c’est bien en son terme – et double sens – que la question se pose qui réside dans la conjonction ou plus exactement l’harmonisation entre les impératifs de la production et les exigences de l’être ; entre la règle et le siècle.
Que faire ou, plutôt, comment faire pour que l’appel de l’être ne contredise pas les rigueurs de la matière ; pour que l’être ne se perde pas, ne s’aliène pas dans les méandres du quotidien ? Vieille question : aussi vieille que le dualisme d’ailleurs. Qu’elle resurgisse aujourd’hui sous des atours plus modernes ne change rien à l’affaire : entre le repli sur soi dans le calme monacal et le nécessaire accommodement avec le réel du Rendez à César ce qui appartient à César l’interrogation managériale moderne n’invente rien et ne fait que feuilleter avec angoisse les vieilles recettes d’une ontologique aporie.
Nous y avons appris quelque chose pourtant où la systémique peut être de quelque secours : il ne nous servirait de rien d’entendre l’un ou l’autre terme isolément. C’est en terme de flux, de relation qu’il faut entendre la question. Mais c’est un peu comme si outre matière, énergie et information, le système entreprise échangeait aussi du sens avec son environnement. C’est dans ces jointures qu’il faut porter notre regard ainsi que dans les réservoirs où le système le stocke. Mais c’est déjà répéter le refus résolu d’une approche technicienne de la question : l’idéologie est de retour – ainsi que le risque des gourous et coachs de tout poil. Je vois dans le fait même de poser une telle question une superbe boucle de rétroaction où il faut comprendre que ni l’entreprise ni la spiritualité ne demeurent intactes. Où, tant la pensée complexe que l’histoire des idées qu’encore la philosophie peuvent, ensemble, être des points d’appui car il ne s’agit pas de dénoncer quelque oxymore ou de redouter quelque instrumentalisation de l’une par l’autre. Eviter de tels truismes c’est écarter les fausses questions.
Evacuer d’emblée deux faux problèmes
Celui du comment agir
Dans cette question il y a une apparence : celle d’un oxymore, relevé spontanément ; mais il y a aussi une réalité, celle de l’évocation, invocation ou utilisation de la spiritualité dans les réflexions sur l’art de gérer. Mais il y a en réalité une constante qui en réalité est double :
Celle du manager qui doit bien pouvoir se donner des principes d’action qui, comme tout principe, doivent bien être hors jeu – en dehors ; celle de l’homme de foi qui ne peut pas ne pas se demander comment vivre, c'est-à-dire appliquer sa foi au quotidien. Cette constante c’est celle de la continuité entre théorie et pratique.
Cette question a une apparence – celle du dehors et du dedans ; d’une extériorité d’où ré-émergent images, modèles et mythes : de la Caverne à la Traversée du désert ; du Sinaï à l’Aventin et Capitole. Cette question a en même temps une réalité : celle de la relation entre, non l’être et la pensée mais l’être et l’action. Mais, pour cette raison fondatrice elle-même, ressemble tellement à celle de la morale et du politique qu’on pourrait aisément l’évacuer en invoquant au gré César, Luther, Machiavel ou – au mieux – Kant. Elle se réduit, tourne autour, d’une pratique qui viserait exclusivement un but, élevé, lointain, pérenne et s’attacherait, au risque de l’impuissance ou de la faute, à garder pur le foyer des intentions.
Bref, une question si simple où, comme toujours, le piège réside dans le et qui fait courir le terrifiant écueil d’une spiritualité aspirant le management au risque de l’angélisme niais ; ou bien de l’instrumentalisation d’une spiritualité cache-sexe d’une mégalomaniaque obsession de la performance.
Non, décidément il faut sans doute oser la provocation en arguant combien d’entre les deux il n’est ni dilemme, ni paradoxe, ni oxymore mais cette unique continuité fondée sur cette évidence épistémologique : il n’est pas de pratique humaine qui ne s’adosse à une théorie, une représentation du monde fût-elle spontanée ou quelconque comme l’eût écrit A Comte et s’il est vraie que théorie et pratique obéissent à des impératifs opposés, il n’empêche qu’elles se nourrissent sempiternellement l’une de l’autre. Non, décidément, si la question se ramenait à un comment agir, décidément une morale suffirait largement !
Celui du rapport au politique
Mais comment ne pas voir, second problème, que la question spirituelle renvoie également au rapport à l’espace social et politique.
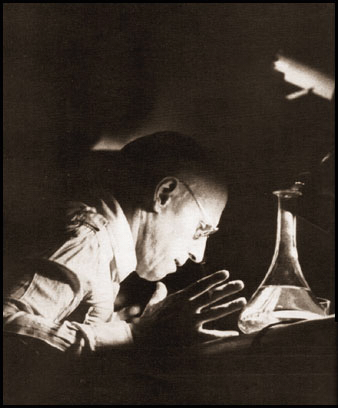 M Foucault (2012) dans son Cours du 9 janvier 80 rappelle comment Septime Sévère donnait audience et rendait justice dans une salle où il avait fait représenter son ciel de naissance et, par conséquent, la configuration des étoiles présidant à son destin – en prenant d’ailleurs soin de cacher celui prédisant sa fin ! Il illustre ainsi combien le pouvoir ne se peut exercer et représenter qu’en s’accompagnant d’un rituel de manifestation de la vérité. D’où deux questions :
M Foucault (2012) dans son Cours du 9 janvier 80 rappelle comment Septime Sévère donnait audience et rendait justice dans une salle où il avait fait représenter son ciel de naissance et, par conséquent, la configuration des étoiles présidant à son destin – en prenant d’ailleurs soin de cacher celui prédisant sa fin ! Il illustre ainsi combien le pouvoir ne se peut exercer et représenter qu’en s’accompagnant d’un rituel de manifestation de la vérité. D’où deux questions :
Si vérité absolue il y a, qu’elle fût un modèle abstrait ou un Etre suprême, alors la liberté est un vain mot, une douçâtre illusion. En conséquence de quoi le pouvoir, et toute pratique en général, ne seraient que simple application technique de préceptes absolus. Autant dire que le précepte démocratique est nécessairement coincé entre savoir et liberté : pas de citoyens libres sans savoir, mais si le savoir est absolu, la liberté ne saurait résider que dans une pieuse obéissance.
Par ailleurs, il n’est pas d’action qui ne suppose une théorie, qui ne suppose au moins virtuellement que l’on détienne le savoir. L’action est arrêt de la pensée, au moins provisoire. Mais en même temps l’action est inverse de l’action tant elle entraîne à subir les conséquences qu’on aura soi-même déroulées.
Faux problème que de supposer que la spiritualisation du management impliquerait mise au pas, voire aliénation pour cela seul que l’arrière-plan fût absolu : il en va en réalité de même pour toute action pour ceci même qu’elle est suspension de la pensée. La seule question qui vaille tient à la qualité d’extériorité ou de transcendance de cet arrière-fond. Tout a l’air de se passer comme si l’action ne pouvait être que catastrophe au sens étymologique du terme c'est-à-dire mouvement d’esquive. A ce titre, toute théorie du management demeure le signe d’un arrière-fond idéologique révélateur de son époque (Boltanski, 2011)
Non décidément la question ne réside ni dans la position d’une extériorité ni dans celle de la liberté mais bien plutôt dans leur relation tant cette extériorité n’existe que par rapport à l’intériorité.
La double logique de toute spiritualité : intériorité et extériorité
On peut reprendre ici l’analyse faite en son temps par Benveniste, et la critique qu’y porta Derrida sur le double sens du mot religion : à la fois relier et recueillir. Benveniste (1967) distingue effectivement les étymologies de Cicéron et Lactance présumant que l’interprétation par religare serait seconde, chrétienne en l’occurrence, tandis que celle en relegere correspondît mieux à la tradition romaine et fût donc antérieure. Outre qu’il est vain de vouloir traquer dans l’étymologie autre chose qu’un indice de la manière dont une culture percevait ou pensait mais assurément fallacieux d’y penser dénicher une quelconque vérité éternelle, le débat révèle néanmoins les deux versants de toute spiritualité : si religare renvoie au lien – que ce soit avec Dieu ou avec l’autre – relegere renvoie plutôt à l’idée de recueillement, et donc de retour sur soi. Derrida quant à lui, tout en récusant l’illusion de toute vérité étymologique considère que ces deux significations constituent ensemble la définition du fait religieux : à la fois chercher en soi, dans la méditation et le recueillement de quoi fonder son existence et plus généralement justifier son être, et, d’un autre côté, se réaliser dans le lien avec l’autre. C’est bien cette double tension, vers l’en-soi et l’autre que soi, vers l’intériorité aussi bien que vers l’extériorité qui constitue la double logique de la spiritualité sans qu’il soit nécessaire de dénicher en l’une ou en l’autre une vérité plus ancienne ou plus véridique. Tension que l’on retrouve jusque dans le développement simultané, en toute religion, d’un courant mystique à côté d’une démarche orthodoxe, ou, dans l’histoire chrétienne dans la distinction entre un clergé régulier et séculier.
La question spirituelle débute à l’instant précis où l’on se demande ce qu’on fait là ! où l’on cherche (à se donner) un sens à son existence propre ne serait-ce que parce qu’on aurait désappris de le pouvoir trouver dans la logique propre de sa vie sociale. Elle débute donc, fort logiquement, à partir du moment où l’on suppose qu’il y ait, au fondement de ce qui est, un principe, une valeur, un être, qu’importe, c'est-à-dire une extériorité qui le fonde. Que l’on considère ce fondement comme un principe et alors on obtient tout simplement une politique ou une science ; comme une valeur, alors une morale ; comme un être, alors une religion. Mais dans les trois cas, dans le même mouvement qui fait se dessiner la dualité, il importe de fixer les règles qui en définissent les relations.
On a coutume de dire que Rome a inventé le droit privé, la protection de l’individu par rapport à tout empiètement du pouvoir central : c’était reconnaître une première extériorité. Mais en même temps admettre une première frontière en posant la notion d’individu qui est tout sauf évidente. Ce que Rome pensait en terme de droit et de politique, du côté de l’objet, Jérusalem autant qu’Athènes, quoique en des termes différents, l’auront pensé du côté du sujet et il n’est pas étonnant alors que le christianisme se pût si facilement accommoder du dualisme platonicien tant il proposait, certes encore de manière abstraite – l’existence séparée des Idées – la suprématie de l’être sur le devenir ; de l’être sur l’avoir ; de l’être sur le faire ; mais surtout de la pensée sur l’être.
Il n’y a donc, de ce point de vue, pas de différence essentielle entre politique, morale et spiritualité : tous trois ont besoin de s’inventer un arrière-monde (Nietzche) un surplomb sur quoi s’ériger. Rome a toujours un peu tendance à enterrer ses cadavres ; Jérusalem à les ériger en oriflamme. En réalité, ceci revient au même : il s’agira toujours pour reprendre l’expression de F Jacob d’expliquer ce qu’on voit par ce qu’on ne voit pas où sciences, mythes et politique agissent de même.
Les deux apories de la spiritualité
Déconstruire le concept de spiritualité revient à dévoiler une double aporie : elle exhausse l’individu mais l’enferme dans une relation étroite et soumise à l’Esprit ; elle affirme son autonomie mais en même temps nie le monde
La naissance de l’individu libre …
L’individu reste la grande invention du christianisme quand même cette invention n’eût pas fini de dérouler ses effets ; quand même presque avortée dès le départ, elle dût prendre souvent les chemins de traverse pour se laisser découvrir. « Il n’y a plus, dit-il, ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni mâle ni femme » (Gal, 3, 28)
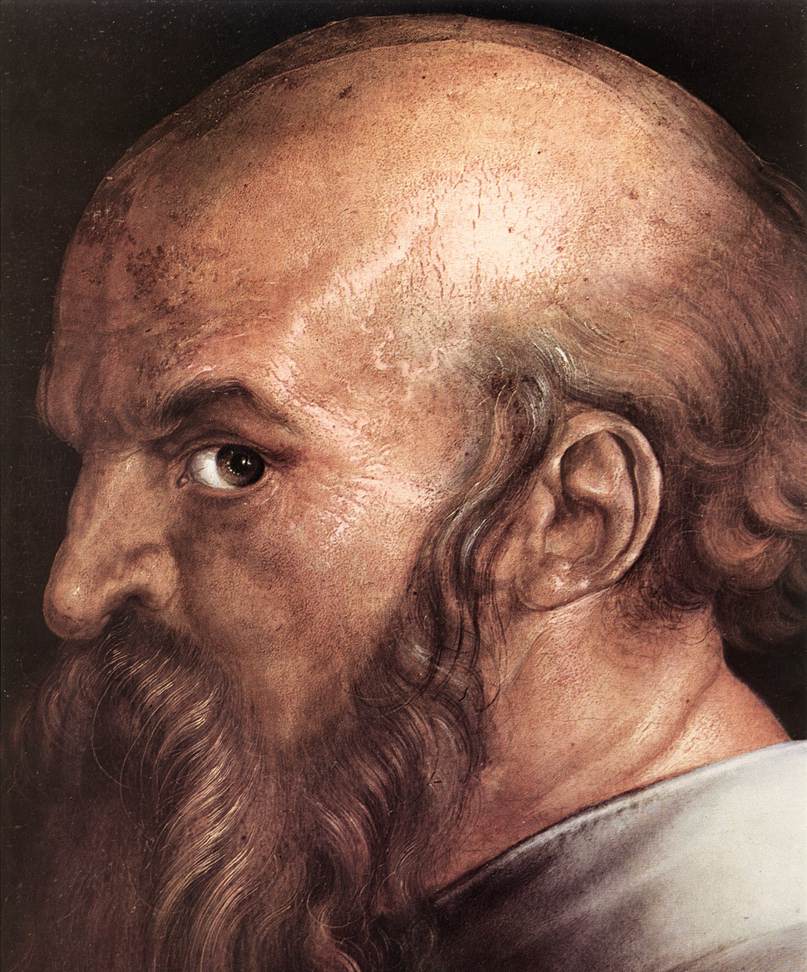 C'est effectivement avec Paul de Tarse, lui-même révélateur par sa triple appartenance aux mondes juif, grec et latin de cette grande révolution, que débute la grande innovation du christianisme dans ce qu'il se voulut catholique c'est-à-dire universel. Résolue par le concile de Jérusalem, la question est cruciale qui va rapidement trancher l'histoire de l'antiquité en deux parties radicalement distinctes. Il n'est pas nécessaire pour le nouveau chrétien de se faire circoncire autrement dit la Parole s'adresse à tous et pas seulement aux Juifs. Sans en avoir l'air, on sort subitement de l'aire des religions nationales. Que le message christique enveloppe la loi mosaïque est une évidence et nombreuses sont les références dans le Nouveau Testament à l'Ancien pour mieux marquer la filiation
C'est effectivement avec Paul de Tarse, lui-même révélateur par sa triple appartenance aux mondes juif, grec et latin de cette grande révolution, que débute la grande innovation du christianisme dans ce qu'il se voulut catholique c'est-à-dire universel. Résolue par le concile de Jérusalem, la question est cruciale qui va rapidement trancher l'histoire de l'antiquité en deux parties radicalement distinctes. Il n'est pas nécessaire pour le nouveau chrétien de se faire circoncire autrement dit la Parole s'adresse à tous et pas seulement aux Juifs. Sans en avoir l'air, on sort subitement de l'aire des religions nationales. Que le message christique enveloppe la loi mosaïque est une évidence et nombreuses sont les références dans le Nouveau Testament à l'Ancien pour mieux marquer la filiation
Mais, de manière aussi paradoxale qu'ostentatoire, il se veut aussi rupture : ce que l'anaphore (Vous avez appris ... mais moi je vous dis) du Sermon sur la Montagne illustre bien. Au Sinaï ce fut le peuple qui avait été exhaussé, c'est désormais l'individu qui est convoqué. C'est, assurément, question théologique que de mesurer ce qui d'ici à là réside de continuité ou de rupture et la question ne nous concerne pas. C'est, sans doute, question d'histoire autant que de métaphysique que de repérer ce qu'il y a de liberté ou d'obéissance requise : sans doute la Réforme mettra-t-elle plus aisément l'accent sur la liberté d'examen et de conscience quand Rome aura plutôt exigé l'obéissance à la loi. Question d'époque, d'interprétation sans doute mais le ver était dans le fruit dès le début et ce ver a un nom : l'individu.
Quand on analyse de très près le passage de la lettre aux Galates on repère en réalité trois données aussi importantes l'une que l'autre : l'opposition entre vivre selon la loi et vivre selon la foi ; un appel à la liberté ; l'érection de l'individu comme héritier
La première est invite explicite à appliquer les préceptes de la loi et de n'en pas rester à leur seule observance formelle. Autant dire qu'il ne suffit pas, plus, d'être né de, et donc ni d'être circoncis ni héritier de la longue lignée des Hébreux pour être sauvé ou seulement concerné par la Parole : encore faut-il la vivre. L'engagement est intérieur ; il est ainsi individuel.
La seconde annonce un argument qu'on retrouvera beaucoup plus tard sous la plume de Rousseau : obéir aux lois qu'on s'est données c'est cela la liberté ! Tant que la loi n'est qu'un corpus extérieur à quoi l'on se soumet de manière formelle, l'on ne saurait être libre. Or c'est bien à la liberté que nous invite Paul (5,1). Ce que le grec appellerait sagesse par opposition à savoir, Paul l'appelle vivre selon la foi et non la loi. Or la foi n'est pas un engagement formel, elle est étymologiquement parole donnée, ce qui engage et suscite précisément la confiance. De la foi à la fidélité il n'y a qu'un pas : ce que Paul attend c'est précisément cet engagement total au service de Dieu, un engagement intérieur et non simplement l'observance de rites formels prescrits par la loi.
La troisième arrache l'homme a toute logique d'appartenance et ce n'est pas pour rien que ce soit à propos de la circoncision que le propos s'enclenche : il ne s'agit pas, au nom de sa judéité, de se sentir héritier d'une parole, d'une promesse d'une alliance, mais au contraire de tenir sa part c'est-à-dire de s'engager. Ce qu'il est, le chrétien le doit être de lui-même et non par héritage et ne se définit ainsi que par son engagement. La référence à l'héritage est tout à fait intéressante (3,15) qui dit à la fois la rupture et la continuité. L'alliance n'est pas un contrat mais plutôt une promesse unilatérale par quoi Dieu donne tout mais ne reçoit rien en échange. Pour quoi le fidèle s'engage en tâchant de se montrer digne d'une promesse qui n'est pas biffable.(Ratzinger, 1995)
En germe, mais en germe seulement, on a ici réuni ce qui fera le grand apport de l'âge classique puis des Lumières : l'autonomie de l'individu.
Mais pour autant, cette autonomie cache une soumission, volontaire certes, ce qui en gomme les aspérités mais une soumission néanmoins.
… mais seul
Cet individu, qu’est-il ? ou plutôt que n’est-il pas ?
D'abord il ne se réduit pas à ses appartenances. Il est tout à fait remarquable que ces appartenances à la Loi, au Temple, à la Raison ne sont jamais présentées comme des facteurs de liberté mais au contraire de dépendance. Cet individu nouveau est un fils, mais adoptif. Il n'est pas héritier, mais choisi : c'est par son engagement qu'il devient. Ce je est d'abord un ensemble vide ; il n'a pas de nature préalable qui pré-déterminerait ses comportements ou ses choix ; ce je-là est hésitant : il croit, certes, mais avec toute l'hésitation de la foi et l'incertitude de la croyance.
Paul le relève de la Loi et le consacre à l'Esprit : il faut mesurer ce que ceci peut signifier au delà de l'engagement spirituel. Ce Je-ci est à l'intersection de tous les risques et finalement de toutes les tentations. Qu'il se plie à la loi, ne serait-ce que par conformisme et alors il risque d'être pris au piège de toutes les appartenances ; qu'il s'engage résolument du côté de l'Esprit et le voici, paria, méprisé voire persécuté, marginal dans un système qui n'entend que la conformité aux usages et à la Loi mais pis encore, incertain même de la validité du chemin qu'il emprunterait.
Ce qui est encore une autre manière de dire combien cet individu vaut la place qu'il occupe ou ne veut pas occuper dans le système. C'est ici toute l'aporie des premiers chrétiens qui durent bien inventer, à leur manière parfois rugueuse, souvent entêtée, une autre façon d'être au monde. S'en dégager totalement et risquer évidemment de ne pas faire souche ; s'y plier et risquer d'y perdre son âme. Son royaume n'est pas de ce monde mais comment y demeurer nonobstant ?
Il s'agit d'être une créature nouvelle (Gal ,6, 15) dit Paul. Soit ! mais qu'est-ce à dire ?
Rien, justement ! Sans aller chercher du côté de Sartre une réponse qui ne vaudrait que par analogie, on peut néanmoins avancer en tout cas que cette créature est totalement contingente. Elle n'a pas de nature ; seulement un engagement ! Elle n'a pas de certitude ; seulement des doutes et une espérance ! Tout au plus peut-on avancer qu'en récusant la logique d'appartenance elle répudie ce qui pouvait s'y trouver de mortifère et ce n'est certainement pas un hasard que ce soit les liens d'Amour qui soient ici mis en avant plutôt que la surenchère de gloire et de mérite. L'homme, dans la caverne de Platon suit peut-être un chemin difficile fait d'aveuglements, d'éblouissements, à l'aller comme au retour, mais il y a bien, au dehors, un modèle, une forme, une Idée à quoi se conformer. Exister pour lui, revient à poser ses pas dans des traces intangibles, ineffaçables. L'essence, oui, y précède toujours son existence.
A l'inverse exact, ici, une relation totalement unilatérale, sans contrepartie prévisible, sans gain assuré, qui est tout le contraire du contrat. Qui dit l'essentiel, c'est-à-dire le rapport à l'autre, où précisément l'on cherche à rebours de la dialectique, à échapper à toute spirale de la négation qui ne ferait que reproduire les conflits sans véritable espoir d'un quelconque retour.
C'est encore dire que cet individu n'existe que dans sa différenciation par rapport à tout ce qui n'est pas lui ; n'existe que dans la relation. Que ce soit avec Dieu dont il tente de prolonger la promesse, ou avec l'autre à qui il tend la main ou la joue, cet individu est tout sauf seul. Et pourtant ... !
Ce que Paul préfigure c'est bien cet homme qui marche et se construit dans sa relation à l'autre. Sans programme préétabli, sans instinct ou nature, sans code non plus qui lui fixerait la conduite à adopter, il fluctue ou décline tel l'atome de Lucrèce et fabrique sa différence dans cette chute même.
On aura finalement assez peu avancé si l'on considère que l'émergence de cet individu ne règle aucunement ni sa nature ni la place qu'il occupe dans le système. Tout juste savons-nous que, dans une telle perspective, l'individu à la fois n'existe que dans sa relation à l'autre et ne se construit que dans cette relation elle-même.
Ensemble presque vide, ceci signifie-t-il que sa place serait déterminée au global par le système lui-même ? Non justement !
Ce qu'affirme Paul, et qui signifie l'exact avènement de l'individu c'est son autonomie qui implique sans doute de se mettre sous la Lumière de la foi et de la promesse, mais suppose que ceci provienne non pas d'un influx extérieur mais d'un mouvement intérieur - l'acte de foi. Le credo.
On retrouve ici une remarque de Nietzsche laissant à comprendre combien la morale était affaire de faibles et non de forts, d'individus si peu assurés de la moralité de leur comportement qu'ils eussent besoin de la bride de la Loi. Autre façon de dire que la moralité était affaire d'intériorité et non d'obéissance à la loi quelle qu'elle fût.
Ce que l'on aura en tout cas compris c'est ce qui gît ici de dynamique d'un ego qui se construit et qui jamais ne saurait être figé, à moins d'être écrasé. L'essentiel se joue ici, dans ce qu'on pourrait appeler un système ouvert. Mais un système sans objet. Il faut y revenir.
Une extériorité mais une transcendance impérieuse
Arguer d’une spiritualité revient toujours à jouer d’un espace contre un autre. L’essentiel n’est pas là ; relève d’une autre logique, plus essentielle, moins superficielle. Il n’est pas de spiritualité qui ne se joue d’une extériorité qui, invariablement, démonétise l’ici et maintenant. On peut y voir quelque chose comme une dialectique où les deux, se tenant face à l’autre, n’existeraient que dans leur irrémédiable face-à-face. Sans doute - c’est bien ainsi que Nietzsche, prolongeant Feuerbach l’entendit - cette extériorité n’est jamais que l’idéalisation aliénée de notre propre être, quelque chose comme un exutoire que le faible s’offre pour consolation. Si tel devait être le cas, et, pour autant que ce le soit, on ne peut qu’avoir affaire à une de ces gémellités dont les processus victimaires ont le secret – et c’est bien après tout le cas : deux mondes, face à face, dont chacun revendique la primeur, où chacun se revendique principe de l’autre. Qu’importe l’issue qui revient au même : que la spiritualité emporte la mise et elle se soumettra le matériel comme espace simple de preuve et d’épreuve où devra s’aguerrir chacun face à la vérité devant les manifestations de quoi il s’agenouillera ; que le temporel, au contraire, gagne la mise – et qui mieux que Dumézil l’aura illustré, et alors il se parera des oripeaux célestes, jusqu’à l’eschatologie. Ce qui illustre au mieux la thèse de Girard car tout ceci revient au même : quoique avec des hésitations – le paysan est un paganus qui préfère travailler plutôt que d’attendre de Dieu qu’il pourvoie à ses besoins – le christianisme finira bien par faire du travail à la fois le signe de la faute et le moyen par excellence du salut. Le travail libérateur, qui trouvera son accomplissement avec la Réforme puis avec Hegel et Marx aura constitué la véritable rupture avec l’antiquité et la condition de possibilité de la société industrielle. De son côté, le matérialisme, dans la version libérale ou laïque républicaine perçoit bien vite la nécessité de se donner un fondement axiologique où subordination, obéissance ont la part belle. Les deux, identiquement ne pourront d’ailleurs proliférer qu’à l’unique condition de désenchanter le monde, soit en le rabaissant au rang de lieu de tentation et perdition, d’épreuve en tout cas ; soit en le réduisant au rang de stock que l’on puisse arraisonner à loisir.
C’est ici le lot commun de cette martingale que représente la dialectique où, finalement, c’est toujours le combat qui l’emporte sur des protagonistes condamnés à se ressembler pour pouvoir s’affronter : en changeant d’ordre, en changeant les règles, en passant du réel au discours sur le réel, en se donnant un arrière-plan, métaphysique ou métalangage, la dialectique se trouve cet espace, toujours contigu à deux ordres différents, où l’on gagne toujours. C’est le même que celui des Romains lors de l’enlèvement des Sabines ; le même que celui qu’invente Véturie forçant Coriolan à renoncer. L’individu a beau gagner, se ménageant un espace de sortie ou de refuge, il ne le peut finalement qu’en se soumettant. On pourrait reprendre la lecture que Foucault fit en son temps des fondements du baptême selon Tertullien on y retrouverait les mêmes rituels, les mêmes exigences de sincérité prouvée, les mêmes épreuves.
En clair : si l’on veut arguer, en invoquant la spiritualité, de la possibilité pour l’individu de se ménager un espace de liberté face à l’engagement total que le manager peut exiger de lui, alors la défense de la vie privée, ou le devoir de désobéir qu’un Rousseau puis un Robespierre avait fondé serait amplement suffisant. L’existence même d’une extériorité peut suffire à se prémunir contre les tentations totalitaires. Mais la spiritualité ne serait plus alors qu’un habillage sophistiqué pour camoufler les empiètements.
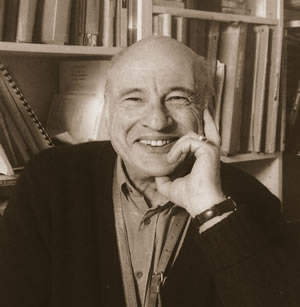 Ce n’est pas un hasard si on put voir dans le monothéisme contradictoirement le ferment de tous les totalitarismes (par exemple Morin, 2012) ou, inversement le moyen de s’y soustraire (B-H Levy 1979). Car si, d’un côté, il signifiait une seule humanité et, on l’a vu, l’accomplissement du sujet en son engagement individuel, et qu’il préparât ainsi les grandes heures de l’humanisme, d’un autre côté il n’y parvint qu’à la condition d’un autoritarisme dont on ne saurait méconnaître les aspérités. Ce que l’on retrouve politiquement : s’il est vrai que la puissance de l’Eglise évita aux monarchies d’être totalitaires pour cela même que leur pouvoir s’arrêtait aux frontières de l’âme, il n’empêche que simultanément l’Eglise, avec la même impérieuse obstination s’acharna à requérir de chacun une obéissance totale comme signe même de la piété. Que la Réforme crut inventer un nouveau rapport entre religion et politique sous l’égide de la liberté d’examen et de conscience est une chose ; qu’elle ne put y parvenir qu’en se mettant sous la protection des princes protestants en est une autre, historique, qui désigne bien combien et comment la spiritualité ne devient événement que sous couvert d’une institution forte qui l’organise et l’impose, d’une institution au pouvoir d’autant plus fort qu’elle se pense comme la voie de l’absolu.
Ce n’est pas un hasard si on put voir dans le monothéisme contradictoirement le ferment de tous les totalitarismes (par exemple Morin, 2012) ou, inversement le moyen de s’y soustraire (B-H Levy 1979). Car si, d’un côté, il signifiait une seule humanité et, on l’a vu, l’accomplissement du sujet en son engagement individuel, et qu’il préparât ainsi les grandes heures de l’humanisme, d’un autre côté il n’y parvint qu’à la condition d’un autoritarisme dont on ne saurait méconnaître les aspérités. Ce que l’on retrouve politiquement : s’il est vrai que la puissance de l’Eglise évita aux monarchies d’être totalitaires pour cela même que leur pouvoir s’arrêtait aux frontières de l’âme, il n’empêche que simultanément l’Eglise, avec la même impérieuse obstination s’acharna à requérir de chacun une obéissance totale comme signe même de la piété. Que la Réforme crut inventer un nouveau rapport entre religion et politique sous l’égide de la liberté d’examen et de conscience est une chose ; qu’elle ne put y parvenir qu’en se mettant sous la protection des princes protestants en est une autre, historique, qui désigne bien combien et comment la spiritualité ne devient événement que sous couvert d’une institution forte qui l’organise et l’impose, d’une institution au pouvoir d’autant plus fort qu’elle se pense comme la voie de l’absolu.
En clair, s’il y a bien dans le spiritualisme chrétien la puissance autonome d’un ego credo, il y a aussi, parallèlement au in unum deum, l’affirmation du in unam catholicam eccleciam qui ne peut que tempérer ici ce que l’autonomie proclamait là.
Toute la question réside ici : certes, l’affirmation paulinienne de l’autonomie en appelle à l’engagement volontaire et autonome et en cela ensemence les ferments d’une liberté qui ne cessera plus de résonner, mais n’y parvient en réalité qu’en déplaçant le champ de l’obédience. Affirmait certes l’autonomie mais moins du sujet que de la sujétion composant par avance un Traité de la servitude volontaire.
Toute la question réside ici : l’impératif de la liberté est-il compatible avec l’existence même d’un absolu transcendant ; l’affirmation de soi est-elle possible autrement que sous la forme d’un sujet, autrement écrit d’un soumis ?
Pourtant comment ne pas voir que c’est la position elle-même de cet espace intérieur, privé qui fera un Comte concevoir que l’élément premier de la société est la famille et non l’individu et les constituants de 89, considérer pour cette raison même l’inutilité du vote des femmes ! C’est qu’à tout prendre, cet espace intérieur n’a de sens que sous l’égide de la soumission à un autre supérieur à quoi toute sagesse revient à reconnaître la nécessaire soumission.
Toute la question est ici : dans cette ontologie dialectique où l’être de l’homme ne cesse de s’affirmer face au dieu créateur, y a-t-il véritablement de la place pour ce qui n’est pas spirituel ? la grande odyssée humaine qu’invente cette première forme chrétienne de philosophie de l’histoire ne put fonder ce dialogue avec l’Autre sans en même temps expulser tout ce qui n’est pas lui : le monde.
L’avènement de l’individu : plutôt qu’une dialectique, une boucle de réaction
Mais on peut y déceler aussi quelque chose comme une boucle de rétroaction. Car ce qu’il y a de résolument nouveau c’est combien à la fois le monde et le sujet ont changé.
Ce que l’on peut entendre par spiritualité renvoie invariablement à un rapport avec ce qui n’est pas elle et ce n’est pas rien de dire combien la définition de l’une rejaillit inexorablement sur l’autre. Sortir de la logique de la négation telle que G Bataille l’avait entrevue, par quoi l’homme adviendrait par la double négation de lui-même (éducation, religion morale) et du monde (technique) c’est constater combien en l’affaire ce fut toujours le monde qui perdit au point de toujours laisser l’homme seul face à lui-même ou à Dieu – qu’importe. C’est ce solipsisme-là qui est dévastateur, qui l’est deux fois : une première fois parce qu’il aura provoqué, par négligence – c'est-à-dire étymologiquement par absence de lien – les désastres environnementaux à venir ; une seconde fois parce qu’il aura accompli l’isolement (Verlassenheit- Arendt 1951) de l’individu. Au bilan, la dialectique esprit/monde aura purement et simplement abouti à l’implosion de l’un et l’explosion de l’autre.
Tant l’individu que le monde ont changé
Repenser le lien entre les deux, une fois évacué le truisme selon quoi l’un ne saurait se tenir qu’en face de l’autre, revient à constater combien monde et individu ont changé
D’abord, l’émergence de l’individu ne saurait être entendue si comme un refuge – repli sur soi – ni comme un danger centrifuge. Si autrefois l’individu trouvait dans son poêle ou sa librairie l’espace quiet d’une méditation, il est désormais englué dans un espace de proximité, où fusent informations, bruits et où l’autre, est tellement proche que la difficulté se fait jour désormais de faire corps, de faire groupe. Cette priorité de l’esprit, qui passait par le dessin d’un espace de silence est à ce jour tellement obéré par la modernité que notre ego paraît écrasé par la fureur ambiante. Sans doute, oui, la modernité devra-t-elle passer par la restauration du silence. Il n’est de relation entre l’ego et le monde que pour autant qu’ils se distinguent. Si l’identité est le péril majeur à éviter quand elle se confond avec l’appartenance, en revanche force est de constater combien l’individu qui se forme dans ce tourbillon épais de noise et d’information n’est plus le même. (Serres, 2010)
 Ensuite, refouler toute tentation à l’enracinement, à tout ce qui pourrait replonger l’individu dans une logique d’appartenance qui débouche toujours sur la violence, en tout cas la négation. S’il est bien une idée à retenir du spiritualisme chrétien c’est bien cette promesse inachevée d’un individu qui loin de se résumer à une quelconque procession de ses racines excèderait de toute part par la force de son engagement. L’individu a partie liée avec l’objet-monde, avec une société-monde (Morin, 2012) et que ce soit au niveau de l’entreprise ou de la cité, il ne peut plus s’y soustraire. Il ne sera pas, demain, de spiritualité qui vaille, non plus que de politique ou de management, qui ne s’efforce de prendre le parti du monde, qui n’intègre l’impératif d’un développement durable pour l’esprit strictement lié à celui du monde. Penser son action du côté du monde, ce n’est pas seulement se contenter de dénicher quelque principe qui guide son action, c’est récuser toute perspective locale, technicienne mais tenter plutôt de tracer les voies conciliant les contraires : l’autonomie individuelle qui peut paraître centrifuge et l’insertion sociale.
Ensuite, refouler toute tentation à l’enracinement, à tout ce qui pourrait replonger l’individu dans une logique d’appartenance qui débouche toujours sur la violence, en tout cas la négation. S’il est bien une idée à retenir du spiritualisme chrétien c’est bien cette promesse inachevée d’un individu qui loin de se résumer à une quelconque procession de ses racines excèderait de toute part par la force de son engagement. L’individu a partie liée avec l’objet-monde, avec une société-monde (Morin, 2012) et que ce soit au niveau de l’entreprise ou de la cité, il ne peut plus s’y soustraire. Il ne sera pas, demain, de spiritualité qui vaille, non plus que de politique ou de management, qui ne s’efforce de prendre le parti du monde, qui n’intègre l’impératif d’un développement durable pour l’esprit strictement lié à celui du monde. Penser son action du côté du monde, ce n’est pas seulement se contenter de dénicher quelque principe qui guide son action, c’est récuser toute perspective locale, technicienne mais tenter plutôt de tracer les voies conciliant les contraires : l’autonomie individuelle qui peut paraître centrifuge et l’insertion sociale.
Enfin, le monde a changé parce que, loin d’être encore un objet inerte, est à présent un véritable sujet de l’histoire dans laquelle il est entré sur le mode du péril et de l’urgence. Il n’est pas certain que nous puissions longtemps encore l’évacuer comme sujet de droit : demain, aujourd’hui, en réalité c’est bien l’urgence où il nous intime de répondre qui jette une lumière crue sur toutes nos institutions politiques, économiques incapables encore de prendre en compte le point de vue du monde, c'est-à-dire incapables de se penser comme élément d’un objet monde.
Qu’il faille aujourd’hui faire référence à la spiritualité pour organiser notre action dans le monde est révélateur de notre impuissance à penser le monde comme acteur ; de la certitude où nous sommes que nos représentations, qu’elles fussent religieuses ou laïques, n’ont abouti jusqu’à présent qu’à une dénégation fatale. En même temps ériger l’esprit en principe, le penser en métaphysique serait tout aussi dangereux .
Une nouvelle approche de la spiritualité
Se souvenir alors qu’esprit renvoie au souffle, au vent, à ce qui circule et atteste de la vie par l’échange même.
Il ne servirait de rien de chercher dans une quelconque spiritualité des recettes toutes prêtes, ou dans le cahier du maître (Bergson cité par Merleau-Ponty) tout simplement parce qu’autant le sujet que le monde ont ainsi changé. S’il demeure un acquis précieux que l’individu ne se définisse ni par sa culture, ni par ses racines encore moins par les contrats qu’il noue, il n’en reste pas moins que lui appartient désormais de réinventer ses rapports à la fois avec le prochain et avec le monde.
C’est moins, à ce titre, dans les pratiques du management que dans une nouvelle approche de l’individu qu’il faut chercher.
On peut toujours tel E Morin arguer que la gravité même de la crise obligera demain à trouver de nouvelles solutions ce qui est certain, en tout cas, tient en quelques points :
La flexibilité du marché du travail est désormais telle que ni le métier ni l’entreprise ne peuvent plus asseoir quelque logique d’identification que ce soit. C’est assez suggérer que l’appartenance ne peut plus fonder aucune subordination. Que ce serait bien plutôt l’égale immersion dans le monde – et la nécessité de le préserver – qui peut demain garantir l’intégration.
Toute contradiction qui viendrait à survenir entre pratique professionnelle et impératif moral d’autonomie s’avère désormais d’autant plus insupportable que la menace se fait plus forte. C’est bien en terme de lien qu’il faut penser. Si la modernité aura laissé l’économique aspirer à la fois le religieux et le politique, aura cru pouvoir fonder la dynamique sociale sur le travail et l’entreprise, on devine bien désormais combien le délitement du tissu social, la difficulté pour l’individu à faire corps et groupe mais en même temps l’incapacité de l’entreprise à faire sens autrement que comme instrument de profit, condamnent l’individu à chercher ailleurs échappatoire, exutoire ou réponse au risque d’un repli dangereux ; condamnent l’entreprise à se donner sinon une mission globale, politique et spirituelle – le mirage de l’entreprise citoyenne a montré l’inanité d’une telle espérance – tout au moins des objectifs dépassant la finalité locale du profit et de la performance. Nous gageons que c’est autour du développement durable et du souci environnemental que ce jouera demain cette exigence globale.
Si la dialectique sujet/objet aura abouti à la fois à la destruction de celui-ci et à l’étouffement de celui-là, on peut néanmoins imaginer – espérer ? – que derrière l’aspiration à une nouvelle forme de spiritualité se cache en réalité , avec l’entrée brutale de la nature dans l’histoire, quelque chose comme l’accomplissement de la promesse paulinienne : un nouvel individu semble poindre qui se veut à la fois fin et moyen ; fin en soi qui s’adjoint l’économie comme outil mais ferait de son accomplissement l’impératif à la fois moral et politique : moyen parce qu’il garantirait par sa relation au proche la préservation du monde.
Que cette nouvelle promotion de l’esprit sous les auspices de l’individu autonome puisse prendre la forme du panthéisme et passer par la restauration de la valeur de la matière n’est pas le moindre des paradoxes de la modernité. Kant avait vu que l’impossibilité de fonder en raison une quelconque transcendance obligeait à un impératif qui reconnût l’autre comme fin ; il manquait à ce catégorique-là la reconnaissance du monde. Nous y voilà.
Que cette nouvelle spiritualité passe par la refondation de toutes les formations techniques – technologiques ? – est une évidence. La philosophie dont après tout l’objet est non la connaissance du monde que l’interrogation sur notre rapport au monde est assurément, avec l’histoire, le seul moyen d’éviter demain l’impuissance et l’aveuglement de l’expert, non parce qu’elles conféreraient une quelconque culture générale que pour l’obligation où elles nous placent d’une systématique remise en perspective à la fois de nos pratiques et de nos représentations. Ce qu’Heidegger avait dénoncé – la victoire de la raison instrumentale – se traduit aujourd’hui par le privilège de plus en plus accordé dans l’université à la recherche appliquée et par le mépris à peine camouflé pour certaines recherches – philosophie, histoire, anthropologie etc. – hâtivement présentées comme des luxes difficilement supportables par une société en crise. La science ne pense pas (Heidegger 1954) était peut-être une provocation mais pointait un danger en partie confirmé aujourd’hui d’une Université ivre de brevets à déposer condamnée qu’elle est, pour se financer, à se mettre au service de l’industrie. Ce faisant elle aura oublié, elle aussi l’objet – l’étant – pour ne se poser plus la question de ce qu’il est mais seulement de comment il est. Effet ultime de ces boucles de rétroaction, c’est bien non seulement aux techniques de se repenser, mais à la philosophie elle-même qui ne saurait plus se contenter désormais de se retirer sur son hautain Aventin : le management a sans doute autant besoin de la philosophie que la philosophie du management.
Les révolutions, on le sait ramènent toujours au même : derrière cet appel à la spiritualité se cache peut-être simplement un appel à ce que depuis Cicéron on appelle les humanités …
Conclusion
Spiritualité de questions plus que de réponse toutes faites ; de chemin et donc de méthode plutôt que de parousie, de système plus que de consolation : telle semble bien la perspective. Non pas imaginer que la spiritualité puisse être demain un outil, ou une référence externe qui viendrait consolider les bases fragiles de l’entreprise mais au contraire, parce qu’il ne saurait être de spiritualité qu’en acte, mais en même temps de management que comme truchement d’une finalité librement conçue et préparée, repenser quête individuelle et principes de management comme autant de boucles où chacun s’affirmerait tour à tour moyen et fin de l’autre.
Que ceci passe par une réhabilitation des sciences molles, mais aussi de la philosophie non pas comme un simple arrière-fond culturel mais bien plutôt comme un dialogue remettant le technique à sa place, désigne assez combien c’est, à sa façon, à une véritable révolution culturelle que nous assistons, où les pièges le disputent aux espérances, mais où, en tout cas la spiritualité ne saurait avoir de sens que comme promotion de l’autonomie de l’individu non pas dans, encore moins contre, mais avec le monde.
Références
ARENDT Hannah (1951) Le système totalitaire, Le Seuil (coll « Points / Essais), 2005
Benvéniste (1969) Le Vocabulaire des institutions indo-européennes t.2, « Pouvoir, droit, religion », Paris, éditions de minuit
L Boltanski, E Chiapello (2011) Le nouvel esprit du capitalisme Gallimard tel 2011
J Derrida (1996) Foi et savoir, Paris, Seuil, Points-Essais, 2001, (1re éd. 1996)
M Foucault (2012) Du gouvernement des vivants, Cours au Collège de France, EHESS, Gallimard, Seuil
R Girard (1982), Le bouc émissaire, Fayard
M Heidegger (1954) Qu’appelle-t-on penser, PUF
F Jacob (1981) Le jeu des possibles, Fayard
B-H Levy (1979) Le testament de Dieu, Calmann-Levy
E Morin (2012), La voie, Fayard,
Joseph RATZINGER (1995) La Théologie de l'Alliance dans le Nouveau Testament (communication du lundi 23 janvier 1995), Académie des sciences morales et politiques, http://www.asmp.fr
 Chroniques
Chroniques