 Fragilité et fécondité des démocraties
Fragilité et fécondité des démocraties
La dissolution des repères de la certitude
Claude Lefort
Conférences Marc Bloch 2009
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j’ai pleinement conscience de l’honneur qui m’est fait à présent, mais en outre le fait que cette conférence solennelle soit conçue dans le cadre d’un hommage à Marc Bloch m’émeut particulièrement. Mon frère, Bernard Lefort, qui devait devenir un journaliste fort connu à partir de la Libération, fut avant la guerre un élève de Marc Bloch, à la Sorbonne. Non seulement il eut le sentiment d’une révélation en entendant Marc Bloch, du même ordre que celle que je connus, beaucoup plus tard, quand je fus l’élève de Merleau-Ponty, mais il noua une relation personnelle avec son maître et je vis, il n’y a pas longtemps encore, des lettres qui témoignaient de l’affection que celui-ci portait à son élève.
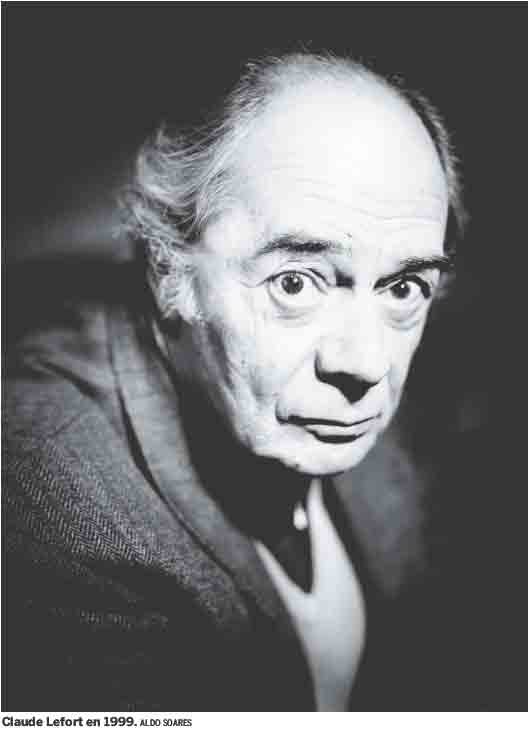 M’étant décidé à vous proposer une réflexion sur la démocratie, je me suis souvenu d’une référence que j’avais faite à Marc Bloch, il y a quelques années, dans un petit essai sur les villes européennes, à l’intention de la revue Esprit. Je faisais ressortir la singularité d’une nouvelle forme de société et d’un nouveau type d’homme. Marc Bloch, en effet, dans l’un des derniers chapitres de sa Société féodale 1, observe que surgit dès le xie siècle un terme neuf, le bourgeois, pour désigner un nouveau type d’homme, soit marchand, soit artisan, qui se distingue par sa capacité d’initiative. « Un instinct très sûr », écrit-il, « avait saisi que la ville se caractérisait, avant tout, comme le site d’une humanité particulière. » Dans mon essai, je me référais également à Max Weber qui, dans Économie et société 2, fait ressortir l’originalité de la ville européenne en regard de la ville chinoise ou russe. Il souligne en outre qu’elle rompt avec le droit féodal. « C’est », écrit-il, « dans les villes d’Europe centrale et septentrionale qu’apparaît la maxime “l’air de la ville rend libre” ».
M’étant décidé à vous proposer une réflexion sur la démocratie, je me suis souvenu d’une référence que j’avais faite à Marc Bloch, il y a quelques années, dans un petit essai sur les villes européennes, à l’intention de la revue Esprit. Je faisais ressortir la singularité d’une nouvelle forme de société et d’un nouveau type d’homme. Marc Bloch, en effet, dans l’un des derniers chapitres de sa Société féodale 1, observe que surgit dès le xie siècle un terme neuf, le bourgeois, pour désigner un nouveau type d’homme, soit marchand, soit artisan, qui se distingue par sa capacité d’initiative. « Un instinct très sûr », écrit-il, « avait saisi que la ville se caractérisait, avant tout, comme le site d’une humanité particulière. » Dans mon essai, je me référais également à Max Weber qui, dans Économie et société 2, fait ressortir l’originalité de la ville européenne en regard de la ville chinoise ou russe. Il souligne en outre qu’elle rompt avec le droit féodal. « C’est », écrit-il, « dans les villes d’Europe centrale et septentrionale qu’apparaît la maxime “l’air de la ville rend libre” ».
Faut-il le préciser, la constitution de la ville, à considérer son régime, n’est pas démocratique. Mais on ne peut non plus la reléguer dans les marges de la civilisation européenne. Un petit nombre de villes s’avèrent à son foyer, tant par l’ampleur de leur commerce que par leur culture. Successivement Bruges, Anvers et Amsterdam ont été les centres d’un commerce international. Dans le sud de l’Europe, Venise et Florence furent de grands foyers de la modernité. Florence, en outre, à la différence de Venise dont le gouvernement fut tôt capté par quelques grandes familles, devint à la fin du xive siècle le théâtre de conflits sociaux – notamment d’une révolte des ciompi, ouvriers de la laine, qui incita le gouvernement à faire droit pendant un temps à des oppositions politiques et des libertés publiques sans précédent. L’événement eut pour effet d’ouvrir la cité à une population jusqu’alors tenue à distance. Sous l’effet de l’immigration, une masse de novi cives (nouveaux citoyens) suscita une mobilité sociale ailleurs inconnue. Ce n’est pas un hasard si, dans une telle conjoncture, Machiavel trouva la ressource d’une analyse de la division sociale d’un conflit qui, en tout régime, oppose le Peuple et les Grands. Ajoutons qu’il est aussi significatif que ce soit à Amsterdam, alors qu’elle est devenue une capitale européenne, que Spinoza défende la démocratie et mentionne élogieusement Machiavel dans son Traité théologico-politique. Certes, les idées égalitaires, comme l’observait Célestin Bouglé 3 – un des fondateurs de notre sociologie –, font leur apparition dans le monde de la ville, mais plus significative me paraît la formation d’un milieu dans lequel chacun, quel que soit son rang, est susceptible de rencontrer chacun – où tous se côtoient. Cette remarque me rappelle l’image que Jacques Le Goff donnait du citadin à l’ère médiévale :
« Quoi de commun entre le mendiant, le bourgeois, le chanoine, la prostituée, tous citoyens ? Entre l’habitant de Florence et celui de Montbrison, si leurs constitutions sont dissemblables, comme leur mentalité, le chanoine croise forcément la prostituée, le mendiant, le chanoine. Les uns et les autres ne peuvent s’ignorer 4… ».
Le côtoiement, peut-être ce terme indique-t-il au mieux le caractère du milieu urbain et nul doute qu’il fasse déjà reconnaître une caractéristique de la démocratie : l’instauration d’un espace public.
La démocratie, nous sommes enclins à la voir soudainement surgir en Amérique. Encore faut-il observer qu’elle fut le foyer de multiples violences et de conflits de la mob avec les autorités et plus largement le théâtre d’un débat dans les années qui précédaient l’indépendance. Bernard Bailyn a publié un livre passionnant – The Ideological Origins of the American Revolution 5 – qui met en évidence la fécondité du débat, la diversité des manifestes, des pamphlets, des lettres publiques – agitation intellectuelle qui eut pour foyer des villes et en outre fait place à une large interrogation sur le destin qu’ont connu des villes européennes.
Je reviens brièvement sur l’analyse fort subtile de Tocqueville. Il lui arrive de mentionner une différence de classe au sein de la démocratie américaine. Il va même jusqu’à signaler la formation d’une « aristocratie industrielle ». Non seulement il critique ceux qui redoutent la turbulence de la démocratie, mais cette « inquiète activité » qui la caractérise lui paraît féconde ; il craint plutôt que, sur le couvert de la tranquillité publique, les libertés s’éteignent et qu’ainsi vienne à s’imposer un pouvoir despotique. Bref, si l’on tient compte de ses origines et du milieu auquel il s’adresse, l’audace de son analyse nous étonne. Sans doute fait-il son deuil du « bon régime » et la démocratie semble-t-elle, à ses yeux – pour reprendre une formule de Raymond Aron – le moins mauvais des régimes. Mais on doit convenir qu’en dépit de l’attention qu’il porte à la distinction de classes et au développement de l’industrie, sa pensée est commandée par l’idée de l’avènement d’une société désormais fondée sur l’indépendance des individus. Ainsi n’est-il d’autre avenir, à ses yeux, que soit la libre association – si imprévisible et périlleuse qu’elle puisse être, mais qui du moins peut trouver un débouché politique dans un gouvernement démocratique, capable de combiner l’autorité et la liberté – soit, dans l’hypothèse du retrait de chacun dans son monde privé, la formation d’un pouvoir au-dessus de tous.
L’argument de Tocqueville m’importe parce qu’il m’incite à mettre en évidence ce qu’il dissimule. Soit le concept d’égalité des conditions : il a le mérite de faire découvrir, en deçà de la définition de la démocratie comme régime, un changement dans la vie sociale. Mais comme il ignore le conflit de classes, il méconnaît le fait que le pouvoir ne cesse d’en dépendre. En bref, réduire la démocratie au règne de l’égalité des conditions, c’est dissoudre la société, ne concevoir qu’un réseau de relations entre des individus.
Ce qui est si extraordinaire dans la démocratie et qui mérite l’attention, c’est qu’elle tende et parvienne plus ou moins – à l’échelle d’une nation – à instaurer un espace commun, un mode de coexistence, qui non seulement fait place à la division de classes et à la pluralité des intérêts et des opinions, mais qu’elle suscite, pour une part, puisqu’elle requiert une participation de l’ensemble ou du plus grand nombre de citoyens à la vie publique, et que ceux-ci sont incités à forger des institutions susceptibles de faire prévaloir des intérêts collectifs.
Je m’attachais à déceler, un peu plus tôt, en deçà des principes qui définissent la démocratie, un nouveau mode de relation sociale et qui implique le côtoiement, mais ce n’était pas dans l’intention de ramener ces principes à la fonction d’une superstructure ou pour dénoncer une démocratie formelle. À s’en tenir à la souveraineté du peuple et au suffrage universel et à l’égalité des citoyens devant la loi, on mesure ce qu’il y a de révolutionnaire dans la démocratie moderne. La souveraineté du peuple abolit l’image d’un pouvoir incarné par un prince ou les représentants d’une aristocratie, l’image des membres d’une incorporation du peuple dans le régime. De fait, cette souveraineté ne s’affirme qu’à la faveur d’une consultation et du décompte des voix qui se sont portées sur les candidats. Il semble paradoxalement que le pouvoir chargé de l’exercice de la souveraineté ne procède que du dénombrement des suffrages – la majorité valant pour le tout. Encore faut-il admettre que le peuple, en tant qu’il se définit comme l’ensemble des citoyens, ne peut trouver dans le principe de la majorité qu’une abstraction nécessaire de la compétition des intérêts. La vertu du suffrage universel se révèle, en revanche, à constater, d’une part, qu’elle implique une mobilisation périodique de la masse des citoyens et stimule les interventions des partis, des syndicats, des divers groupes d’intérêts, qu’elle procure l’occasion d’un débat public d’une ample diffusion d’informations grâce à la liberté de la presse. Autrement dit, l’exercice de la souveraineté du peuple a la vertu de restituer l’image de l’unité et de la diversité des citoyens, mais ajoutons aussitôt que la démocratie implique la reproduction périodique de la consultation populaire. En conséquence celui ou ceux qui sont investis de l’exercice du pouvoir ne peuvent se l’approprier : le lieu du pouvoir demeure vide. Quant à la volonté du peuple, il est tacitement admis qu’elle est susceptible de s’exprimer différemment voire contradictoirement : le peuple s’avère, pour reprendre la formule de Pierre Rosanvallon, « introuvable ».
La désincorporation du pouvoir s’accompagne d’une désintrication de la politique, au sens limité de ce terme, du droit et des divers domaines de connaissance et de création. Désormais, le pouvoir ne dit pas le droit ; pas davantage ne fixe-t-il des bornes à l’exercice de la connaissance. Ainsi s’ouvre la possibilité de la définition de nouveaux droits sous l’effet des changements qui affectent la vie sociale et sous l’effet de revendications de catégories de citoyens qui cherchent à faire reconnaître la légitimité de leurs aspirations. De même s’ouvrent la possibilité d’une diffusion des connaissances et celle d’un libre examen des présupposés sur lesquels se fondent pendant un temps les théories ou les interprétations communément admises. Je n’oublie pas, en outre, qu’avant même qu’il ne soit établi était apparue l’idée d’une constitution qui énonçait des droits inviolables. Dès lors que sont jugées inséparables la souveraineté du droit et la souveraineté du peuple, la loi n’a plus d’ancrage dans une institution, ou dans une fraction du corps social ; la loi ne déchoit pas au niveau de la réglementation mais elle ne s’impose, ne se reformule que sous l’effet du refus de l’arbitraire. La démocratie admet implicitement la légitimité du débat sur la distinction du légitime et de l’illégitime.
Nous parlons de la démocratie libérale et de la démocratie représentative. Mais ce dernier concept doit retenir l’attention. Le pouvoir ne peut s’exercer que tout en demeurant toujours en quête de sa légitimation et la société ne peut garder sa cohésion qu’à la condition de l’établissement d’une « scène politique » sur laquelle la division se trouve transposée et transfigurée. La notion de représentation doit donc retenir quelque chose de la signification qu’on lui donne dans la langue commune. La démocratie représentative n’est pas seulement ce système dans lequel des représentants participent à l’autorité politique à la place des citoyens qui les ont mandatés ; sa fonction non moins essentielle est d’assurer à la société une sorte de visibilité d’elle-même. En outre la représentation n’acquiert sa pleine signification que si elle s’accompagne d’un réseau d’associations dans lequel se manifestent des initiatives collectives. La représentation politique, si indispensable qu’elle soit, ne constitue qu’un des moyens par lesquels les groupes sociaux réussissent à donner une expression publique à leurs intérêts ou à leurs inspirations et à prendre conscience de leur force et de leur chance relatives au sein de l’ensemble social. Ainsi ne peut-on négliger qu’il y a souvent, du fait de la défaillance du Parlement, ou en concurrence avec lui, des syndicats, des associations alliées, des mouvements sociaux qui exercent une fonction de représentation même si celle-ci n’est pas publiquement reconnue. Voilà qui incite à réexaminer le concept de participation. Celle-ci, à son premier degré, implique le sentiment qu’ont les citoyens d’être concernés par le jeu politique au lieu d’avoir à subir des mesures qui décident de leur sort ; le sentiment d’être pris en compte dans le débat politique. Participer, c’est d’abord le sentiment d’avoir droit à avoir des droits, selon la belle formule d’Hannah Arendt.
J’observe encore que la démocratie implique non seulement la séparation des pouvoirs – exécutif, et législatif, et judiciaire – mais aussi la délimitation d’activités qui relèvent de l’administration d’État. C’est grâce aux institutions représentatives que l’État n’est pas investi de la toute-puissance. Dans la démocratie, si importante que soient les fonctions d’administration et les contraintes qu’elle fait peser sur les citoyens, chacun sait que le sort des revendications collectives dépend en dernier ressort de la décision d’un gouvernement qui est transitoire et toujours en quête de l’adhésion populaire. Parallèlement les agents de la fonction publique jouissent d’un statut qui garantit leur indépendance et les met à l’abri d’une ingérence politique. On peut s’étonner que la démocratie moderne requière un puissant appareil d’État mais celui-ci coexiste avec un système mobile qui suppose la reconstitution périodique des organes de délibération publique.
Enfin la société démocratique s’institue là où existe une économie de marché, elle se développe en liaison avec le capitalisme et l’essor de la technique qui ne cesse de façonner les rapports de chacun avec chacun et avec la nature. En outre, si nous devons admettre que la démocratie n’a pas rompu avec l’idéologie du libéralisme, il faut reconnaître qu’elle ouvre à la définition de droits sociaux et qu’elle est toujours plus confrontée à l’exigence de corriger les effets de la logique du marché qui menacent la cohésion de la société.
Fragilité de la démocratie ? Qu’il suffise de prendre pour repère 1936. Le Front populaire marque assurément un tournant dans l’histoire de la démocratie : celui de l’intervention d’État dans les conditions de la société industrielle : réglementation de la durée du travail et instauration des congés payés. Aux États-Unis, trois ans plus tôt, Roosevelt avait inauguré l’ère du New Deal ; il s’était heurté à une violente opposition, mais il avait réussi à faire admettre une réforme qui se réclamait du libéralisme alors même qu’elle était en contradiction avec l’idéologie officielle. La France avait connu au début des années 1930 de violentes oppositions au régime démocratique. Les Croix de feu – tout en se réclamant d’une idéologie purement nationaliste – avaient tenté d’attaquer le Parlement. L’époque avait vu l’essor de groupes ouvertement fascisants : que l’on se souvienne seulement des noms de Doriot et de Déat. À l’époque, la distinction des conditions de vie dans la bourgeoisie et dans le peuple était manifeste et génératrice de conflits sociaux.
En évoquant cette époque je trouve l’occasion de rejoindre les analyses de Marc Bloch. Dans L’étrange défaite (rédigé de juillet à septembre 1940) 6 l’historien, bien qu’il ne soit pas marxiste (il le dit clairement tout en faisant état de son admiration pour la pensée de Marx), écrit : « il est, dans l’état présent de nos sociétés, inévitable que les diverses classes aient des intérêts opposés et prennent conscience de leurs antagonismes. Le malheur de la patrie commence quand la légitimité de ces heurts n’est pas comprise 7. » Sans reproduire la description aussi objective que possible des traits caractéristiques des bourgeois, je signale le changement qu’il décrit au cours des années 1930. La crise économique, note-t-il, a sapé la stabilité des fortunes, la rente a fondu, la résistance des salariés à toute baisse de leurs rémunérations a amené à amenuiser le profit ; l’ensemble de ceux qui s’étaient habitués à commander et s’étaient accommodés est pris d’inquiétude.
Après s’être appliqué à préciser les critères qui permettent de déterminer une appartenance à la bourgeoisie – d’un point de vue strictement sociologique – Bloch en vient à décrire l’état d’esprit et le comportement des bourgeois, menacés qu’ils se sentent par les réformes et les revendications des ouvriers. Il met en évidence le mépris et le cynisme qu’inspirent aux bourgeois ceux qui bénéficient d’une amélioration de leurs conditions de vie. « Quiconque avait quatre sous crut sentir passer le vent du désastre 8. » Évoquant l’espoir des masses en un monde nouveau, il s’étonne de l’immoralité du patronat.
« Combien de patrons, parmi ceux que j’ai rencontrés, ai-je trouvés capables […] de saisir ce qu’une grève de solidarité, même peu raisonnable, a de noblesse : “passe encore, disent-ils, si les grévistes défendaient leurs propres salaires” 9. »
En outre, son tableau de la bourgeoisie de l’époque fait ressortir l’arrogance et l’incompétence des cadres issus des grandes écoles, notamment de Sciences-Po, et des officiers restés dans l’ignorance des nouvelles techniques militaires.
Nul témoignage aussi instructif sur la démocratie d’avant-guerre, un régime qui, tout à la fois, fait place à la division de classe et – Bloch n’insiste pas assez sur ce point – est capable de susciter une étonnante mobilisation de la population en juin 1936. Permettez-moi de dire que j’en fus témoin, bien que très jeune, et conserve tant le souvenir d’une manifestation de masse sans égal ainsi que le spectacle étonnant d’ouvriers débonnaires gardant des usines en grève. S’agit-il d’une révolution manquée ? Certes pas. Un intermède plutôt, mais l’indice d’une effervescence de la démocratie avant qu’elle ne s’abîme sous l’effet – comme le dit Bloch – de l’incapacité de la bourgeoisie d’apprécier la fonction de l’État et tout autant du danger que représentaient l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste.
Impossible de survoler l’histoire de plus d’un demi-siècle, inutile d’évoquer la crise du parlementarisme, la création d’une nouvelle république, la nature du régime instauré par De Gaulle, dont je note au passage qu’il a contribué au maintien de la démocratie, je me borne à mentionner quelques faits significatifs à mes yeux, susceptibles d’éclairer les épreuves auxquelles se voit soumise la démocratie – qu’il s’agisse de l’évolution de la politique, de l’économie ou des mœurs. Je fais la première place, bien qu’ils ne se dessinent que peu à peu, aux changements du mode de production. Sous l’effet des progrès de la technique, la grande industrie – qui allait de pair avec la concentration de masse d’ouvriers dans les usines et y réduisait le travail du plus grand nombre à une exécution d’opérations qui n’impliquent pas de formation professionnelle – s’amenuise. Simultanément se multiplient des modes d’activités qui exigent une compétence et donnent naissance à de nouveaux modes de coopération. Ces changements donnent lieu à une abondante littérature sociologique. Le fait majeur, à mes yeux, est la disparition du prolétariat en tant que classe ; parallèlement, la bourgeoisie telle que Marc Bloch la décrivait ne constitue plus qu’une minorité de privilégiés, tandis que se multiplient cadres, techniciens, ingénieurs formés dans des écoles spécialisées. Ajoutons à ces derniers ceux qu’on nomme les commerciaux. L’élite sortie de Sciences-Po, dont se moquait Bloch, subsiste mais la classe dominante comprend désormais diverses couches sociales dont la parenté ne se manifeste qu’à considérer leur revenu, et leurs loisirs. Voilà bien un trait distinctif de la démocratie : à présent l’opposition des classes traditionnelles disparaît tandis que subsiste la division sociale. En 1945, se produit une soudaine ascension du parti communiste, d’autant plus remarquable qu’il bénéficie du soutien, non seulement d’une masse importante de salariés, mais de la faveur d’intellectuels qui admirent le régime soviétique. Je rappelle le scandale qu’a suscité le livre de Kravchenko 10 qui décrivait les mœurs du régime soviétique après s’en être évadé. Remarquable est l’aveuglement d’hommes cultivés, jouissant de la liberté d’expression, face à un régime qui ne cachait pas son intolérance à l’égard de toute opposition et faisait de l’unanimité le critère de sa légitimité. On sait que nombre des admirateurs de l’Union soviétique abandonnèrent sa cause quelques années plus tard mais, me demandais-je alors, la démocratie est-elle si fragile qu’une partie de son élite soit prête à la renier ? Si fragile, en outre, que le parti socialiste s’obstina longtemps à une alliance avec le parti communiste alors qu’il savait que sa stratégie dépendait en tout premier lieu de la stratégie du pouvoir soviétique. Enfin que de doutes s’associent à la croyance en la démocratie, j’entends à l’attachement aux libertés politiques et civiles, quand le gouvernement fait preuve d’un nationalisme inconditionnel face aux revendications des peuples colonisés. La guerre d’Indochine et davantage encore la guerre d’Algérie donnèrent l’occasion d’entrevoir l’abîme que recouvre l’attachement à la liberté et à la légalité. Encore ne suffit-il pas de se référer à une situation exceptionnelle qui exposa les citoyens à un choix entre l’attachement à la puissance du pays et le respect qu’inspire une volonté d’indépendance.
Mais comment expliquer les progrès de la xénophobie ces dernières années, rendre raison de l’abjection des dénonciations des « sans-papiers » encouragées par les autorités ? La démocratie n’est pas seulement, je l’ai signalé, un régime politique, lié à un mode de production, elle ne requiert pas seulement l’indépendance de la justice. Sa fécondité ne tient pas seulement au fait qu’elle accepte la division sociale : elle se caractérise par ses mœurs et peut-être leur corruption est-elle le plus dangereux changement car le moins visible. Que l’on considère par exemple l’inquiétude que suscite à présent la dégradation des banlieues. Soudainement se découvre que les effets des inégalités ne sont pas mesurables en termes « objectifs », que la ségrégation peut susciter une dissolution des repères de la sociabilité, une désinsertion qui va jusqu’à atteindre l’usage de la langue et les catégories de l’entendement.
C’est une nouvelle fragilité de la démocratie que l’on observe. Les menaces que comportaient soit l’expansion du communisme, la lutte de classe, le nationalisme, s’accompagnaient d’une sensibilité à l’histoire, de la croyance à une alternative. Mais si menaçants que soient les conflits que recèle l’état du monde, les enjeux de la démocratie en France semblent dangereusement s’effacer. Étrange conjoncture, à présent, dans laquelle, d’un côté, s’accroissent les inégalités, voire la ségrégation des plus démunis et, de l’autre, s’impose une administration assujettie au pouvoir d’État dans des domaines par excellence indépendants, l’Hôpital, l’Université et la Justice.
Notes
1 Marc Bloch, La société féodale. La formation des liens de dépendance, Paris, Albin Michel, [1939] 1968.
2 Max Weber, La ville, Paris, Aubier-Montaigne, 1982.
3 Célestin Bouglé, Les idées égalitaires. Étude sociologique, [Latresne], Le Bord de l’eau, [1899] 2007.
4 Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1964.
5 Bernard Bailyn, The Ideological Origin of the American Revolution, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1969.
6 Marc Bloch, L’étrange défaite, Paris, Gallimard, 1990.
7 Ibid., p. 194.
8 Ibid., p. 197.
9 Ibid., p. 198.
10 Victor Andreïevitch Kravchenko, J’ai choisi la liberté ! La vie publique et privée d’un haut fonctionnaire soviétique, Paris, Éditions SELF, 1947.